Carnet 2018
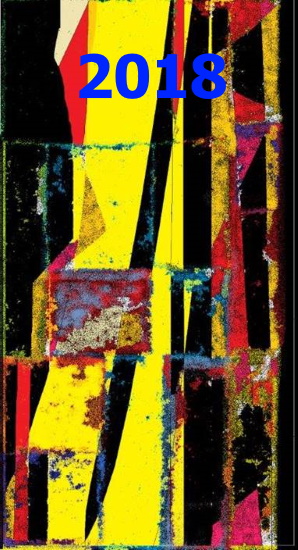
|
2 janvier
J’aère, j’ouvre les fenêtres… le soleil est doucement violent sur les bibliothèques du salon.
Les Essais de Montaigne, l’Esprit des Lois, Causes de la Grandeur et de la Décadence de l’Empire Romain, Racine (Bérénice surtout), Stendhal, les Chroniques italiennes, Salammbô et sa cruauté, Jacques le Fataliste, La Bruyère que j’aime plus que tout parce qu’il fend l’armure comme les meilleurs maîtres d’armes, Chateaubriand parce qu’il a l’élégance du d’Ormesson d’aujourd’hui en plus corsaire et la royauté dans la fidélité, Fénelon pour le baroquisme de l’insolence, Bossuet pour le marbre du verbe, Pascal pour la Grâce et la génuflexion devant l’Infini.
Sans compter Giono qui est à tous les étages, avec des éditions multiples. Céline aussi est là-haut dans la chambre, seul. « Cent ans de Solitude » aussi.
Mais les couleurs sur les tranches sont en train de faner. Je porte ces œuvres comme un socle qui fait qu’on tient debout.
…………………………………………………………………………
SPINOZA
Spinoza, au-delà de toutes ses démonstrations géométriques, semble oublier l’immense dimension du désir dans sa puissance.
Mais il n’y voit pas qu’une affection et une passion triste de notre âme, il n’omet pas d’y trouver cette dimension (immanente !) jointe à notre esprit indissociablement, qui en est probablement comme l’essence motrice.
Les sources de notre servitude sont probablement à voir plus profondément et bien ailleurs que dans la sujétion à nos désirs. Le désir, en effet, ne serait-t-il pas comme une matrice qui se voit donner jour à une espérance ?
La Raison n’a jamais eu d’espérance.
La Béatitude ne se pourrait-elle tenir vivante que par la seule édification parfaite des effets de la Raison ? Qui pourrait le croire ?
Ce que je ne peux accepter par la Raison, le puis-je par le Cœur ?
Pascal contre et avec Spinoza ? Probablement.
Il est impossible que la seule perfection de la Raison sur son socle de vérité pénètre cette puissance irraisonnable du désir.
Le désir témoigne de la fragilité de notre être et reste bien le marqueur de notre finitude.
Pourquoi en savons nous plus sur notre condition commune dans son inexorable finitude que sur d’hypothétiques sagesses métaphysiques ?
Je commence l’année par des sourcils froncés et interrogateurs…
………………………………………………………………………………………
LES TEMPS CHANGENT
Il fut un temps où l’on rasait le crâne des femmes (ou mieux encore…) qui avaient simplement eu des faiblesses pour des soldats allemands.
Aujourd’hui on dépêche des sociologues et des psy pour déradicaliser des femmes d’ici qui prennent ouvertement les armes contre la France et les valeurs de l’Occident.
……………………………………………………………………………………….
3 janvier
Macron sosie de Boris Vian ? Déjà en Algérie « j’irais cracher sur vos tombes », et puis schizophrène, « Monsieur le Président je vous écrit une lettre… » sur « l’Ecume des jours » d’un quinquennat…
…………………………………………………………………………….
Dimanche 7 janvier
Max Raabe et le Palast Orchester. Une nuit à Berlin. C’est légèrement kitsch et émouvant. Kurt Weil et quelques autres. La nostalgie du cabaret entre deux guerres. Pourquoi pas ? J’ai cru même au début, tant l’accent était prononcé et la tendresse légère, à quelque fantaisie viennoise…
………………………………………..
9 janvier
Depuis deux jours, c’est la tempête sur tout le Sud-Est. Les températures sont anormalement élevées mais la nuit on croirait entendre des hurlements de chats et des mélopées orientales ciselées par le vent sur les arêtes des ferronneries des balcons et dans le cœur des arbres.
……………………………….
10 janvier
SPINOZA
L’Ethique, dans ses conclusions, laisse bien sur sa faim. Le chemin de la Béatitude, suivant le droit respect de la Raison dans nos actions, ne serait pas plus que la félicité de penser en toute liberté. L’immortalité de la pensée, par ailleurs, échappe à la finitude du corps par le seul fait que celle-ci est hors du temps. Ce que les marxistes des années 60 reprocheront bien à Spinoza, ce sera d’achever par une métaphysique spiritualiste.
Parti d’un raisonnement et d’un cheminement quasi mathématique révélant l’immanence de la nature humaine identique à celle de Dieu dans un grand mouvement de Cosmos, l’Ethique en fin de parcours, s’achève par une sorte de métaphysique de la consolation pour la condition de l’homme qui aurait bien su guider sa pensée et la conservation de son être profond.
Faire de la bonne conduite de la pensée la source des Béatitudes semble un peu faible comme aboutissement d’un si grand livre, et ne peut suffire par ailleurs à expliquer les fins dernières. Pas plus que la condition humaine ne peut exclure de son champ de questionnement la raison même de son existence. Il y a, à la fin de l’expérience spinoziste, une insensibilité aux problème du Moi et de la conscience, lesquels sont comme dilués dans un grand Tout. C’est le côté hindouiste ou bouddhiste de l’auteur. Faire de l’humain une simple émanation causale égale à d’autres causes existantes dans le vivant, se heurte aux problèmes de la souffrance, de la solitude, et de l’inévitable questionnement que chaque conscience se pose sur le sens même de la vie. La joie de Spinoza se réduit-elle à la seule balance positive de ce qui peut augmenter ma capacité à me mouvoir dans la conservation de mon être ?
……………………………………………………………………………………….
COROLLAIRE
Donc nous ne sommes rien d’autre que des fétus de paille perdus dans le grand cosmos. Youppi ! Ceux qui nous assènent cette vérité le font avec le sourire béat de ceux qui découvrent la réalité du courant d’air.
Nous devrions atteindre une même béatitude en apprenant que la singularité de notre personne, corps et esprit, ce qui a fait le sel de l’existence, la véritable joie qui a pu être la notre sur le chemin de la vie, de nos amours, ce qui donnait du prix à chaque pas de notre chemin, y englobant même les misères, ne ressortent que du domaine de l’illusion.
Ce qui devrait rendre heureux (ou qui devrait nous installer dans la joie durable) c’est de saisir que nous sommes dépersonnalisés et transitoires, que l’arbre qui meurt devrait être content demain de re vivre sous la forme d’un tiroir de bureau (en bois).
………………………………………………..
12 janvier
FIN DE PARTIE
je quitte le navire, ce matin à dix heures, non sans avoir emporté les photos de Cécilia et Hélène, déjà jaunies de m’avoir accompagné tout ce temps exposées à la lumière du matin, quelques livres précieux, quelques monographies sur Mahler, Bruckner, le monumental Mozart de Georges de Saint Foix, le Beethoven de Romain Rolland, les vieux Proust en éditions banales qui m’ont toujours suivi au travers des divers déménagements professionnels, et puis mon non moins vieux Mémoire universitaire sur La Musique dans l’Esthétique de Hegel, que j’aurais voulu inconsciemment semer depuis longtemps et qui s’est tellement bien caché que j’éprouve une certaine tendresse à y relire les maladresses bien naturelles qu’on peut commettre à l’âge de ces forfaitures.
J’ai quitté, comme une horloge qui ne sert plus, le rythme de ces trente huit années pour un nouveau qui commence maintenant. En Avril, la Sicile ? J’y pense déjà.
Ce matin on a fait quelques photos de Brigitte et moi, dans l’allée où nous prenions souvent le café à la poursuite de quelques rayons de soleil.
…………………………………
Carlo Maria Giulini me fait sortir de ma douce torpeur, vers dix sept heures, avec le Philharmonia et La Mer. Il n’en fallait pas moins pour aujourd’hui… Giulini a la fluidité de la grande tradition de Monteux et Ingelbrecht.
……………………………….
13 janvier
Demain j’irai récupérer le Paul Klee qui restait dans mon bureau, « L’arrivée du jeune marié ».
……………………………….
Brigitte m’a offert un beau pastel de Wladimir Kasim. C’est assez onirique, délirant, minutieux. Entre la Kermesse héroïque et Till l’Espiègle.
……………………………….
18 janvier
Centenaire de la mort de Debussy. Les commémorations commencent. La sonate pour violon, la dernière, qui sent dans sa perfection classique l’achèvement d’une œuvre sur une douleur, une résignation. C’est Bertrand Chamayou et Renaud Capuçon. Peut-on faire mieux ?
…………………………..
Dans le petit bassin à l’angelot du jardin, est-ce un début de printemps ? Un oiseau aux couleurs bleu blanc noir, au méchant cri de corneille, boit en toute confiance. Et se baigne aussi… se secoue les plumes et s’envole, comme voulant se débarrasser de l’hiver.
…………………………………………………………………………………………
19 janvier
Depuis plus de six mois et l’affaire Weinstein, il n’est pas un jour qui n’ait son lot de femmes violées, attouchées, harcelées. Comme durant la quinzaine des promotions chez Drucker, le phénomène du rapport des violences subies par les femmes resurgit de manière compacte, récurrente, et comme encadré par l’information avec la densité que pourrait avoir une épidémie. Si l’on devait comptabiliser le nombre de ces femmes qui portent plainte aujourd’hui, il serait plus facile de citer celles qui, soit gardent le silence, soit attendent encore d’avoir une fenêtre médiatique pour révéler au grand jour l’expérience de leur misère. Il ne s’agit pourtant que d’un phénomène constaté ou du moins subodoré depuis toujours, dans le milieu du show biz et principalement celui du cinéma. La fameuse promotion canapé plus ou moins imposée comme incontournable moyen de réussir. Jusque là, rien de nouveau, si ce n’est que la résonance de la diffusion de ces cas de violence ne se résume plus à cette seule caste professionnelle. L’employée d’entreprise et la femme de la rue anonyme descendent manifester contre ces agissements qui se dévoilent au grand jour. Avec tout le lot d’interrogations qui nuancent ces violences, qu’elles relèvent de la simple tentative de séduction, ce qui est somme toute dans la nature des rapports humains, ou qu’elles soient franchement de l’ordre du harcèlement méthodique et répétitif. Le franchissement de la séduction vers la tentative de dégradation systématique ne pouvant se confondre. Ce qui paraît ahurissant, c’est la quantité de révélation de viols ou de violences avérées d’une manière générale dans toutes les catégories de la vie sociale. N’y aurait-il pas un phénomène collectif de dénonciation comme il y a des phénomènes de déballage plus ou moins directs de solidarité du genre moi aussi il m’est arrivé … qui n’aurait qu’un lointain rapport avec les violences réelles subies par certaines ? Nous sentons bien qu’au-delà des faits avérés, il y ait une tentative de récupération féministe du rapport futur attendu entre homme et femme. La logique est d’ailleurs respectée dans ce monde d’argent, d’ordinateur, de virtualité, où tout peut se mettre à plat, depuis la reconnaissance des homophilies, des droits qui y sont afférant, des naissances programmées en toute abstraction etc. Il n’est donc pas loin le moment, (mais n’y sommes nous pas déjà !), au nom de la parité et de l’égalité, où la femme devra payer pour rencontrer un homme dans un quelconque site de type Mythic…
…………………………………………………………………………………………
20 janvier
« Les Vacances de Monsieur Hulot » auraient été inspiré à Jacques Tati par le grand père architecte de notre pape de l’écologie, Nicolas, qui vécut dans le même immeuble haussmannien que le cinéaste. Le burlesque n’a jamais vraiment quitté l’environnement de ce pape qui voudrait faire rouler la France à vélo alors qu’il déclare posséder quelques neufs véhicules à moteur: un bateau de 200 cv, une moto, six voitures et accessoirement un scooter électrique. Avec accessoirement aussi, le second patrimoine déclaré du gouvernement actuel…
…………………………………………………………………………………………
J’admire « Singing in the Rain », je souris tendrement à “Tchériomouchky”, et je ne retiens mes larmes à “West Side Story”.
………………………………………………………………………………………..
Wolfgang Sawallisch s’exprime dans un français presque gourmand. Il reste le schumannien symphoniste le plus mémorable dans les miracles fait à Dresde. Pourquoi ne le considère-t-on pas autant qu’un Fürtwangler ?
…………………………………………………………………………………………
25 janvier
Renaud Gagneux est parti. Discrètement. Je ne l’aimais pas trop dans les années 80. Je crois qu’il n’aimait pas Pélléas. Ses quatuors à cordes restent. Avec sincérité.
…………………………………………………………………………………………
Katy est dans le froid du Vaucluse. Peut-être qu’elle sera lundi sur le bord du chemin à Lenval…
…………………………………………………………………………………………
Les premiers mimosas, un peu gris déjà…
…………………………………………………………………………………………
Le Paul Klee a retrouvé sa place à la maison. Il me suit
depuis quarante ans au moins ! Je crois qu’il y restera définitivement.
…………………………………………………………………………………………
27 janvier
On fait aujourd’hui parler les robots. L’intelligence artificielle nous fera demain concurrence.
Question posé au robot : « Etes-vous conscient que vous êtes un robot ? »
Réponse : « Etes-vous sûr que vous êtes un humain ? »
La technologie avance vite. L’insolence aussi.
…
2001, l’Odyssée de l’espace était donc bien en avance
………………………………………………………………………………………..
29 janvier
Katy sera là demain ( ?). Ses messages fébriles ne semblent pas en douter. Elle est dans le froid et les congères de cette Provence qui peut être si rude…
………………………………………………………………………………………..
Merveilleux Trio à cordes de Schnittke. Je n’oublie pas que parmi les premières musiques de chambre qui m’habitaient du temps de la rue Dante était ce trio de Petrassi, (par les membres du quatuor Parrenin), que j’écoutais les yeux fermés, durant ce quart d’heure velouté, dans la mysticité de ces nuits de mansarde. ………………………………………………………………………………………..
30 janvier
Le temps est désespérément gris au-dessus de St Paul. La forêt et les arbres taillés, derrière les fenêtres de la chambre, font des bras noueux et zébrés sur le blanc laiteux du ciel.
Mes états d’âme sont aussi dans la somnolence sans couleur, de ce rythme nouveau de ma vie, au point de me sentir presque coupable de ne plus partager la fébrilité soucieuse de ceux que je viens à peine de quitter. ……………………………………………………………………………………….
Petit, j’ai souvenir d’avoir longtemps voulu déformer intentionnellement certaines phrases pour les rendre plus conformes à ce qu’on attendait d’une réponse d’enfant. Du moins je l’imaginais ainsi. Quand on me demandait si maman allait bien, je n’osais dire « maman va bien » (alors que je savais que c’était la réponse que j’aurais du donner) mais, « maman, elle va bien »… comme pour gauchir consciemment des phrases que je trouvais d’une langue trop parfaitement conforme aux adultes. Etait-ce pour préserver sans le savoir un univers d’enfance fait de maladresses feintes ?
………………………………………………………………………………………..
fin de nuit du 30
L’Assemblée Nationale se devrait de repenser, en ces temps de fureur féministe et de réaménagement des anciennes Régions de France, des appellations qui seraient plus conformes, tout à la fois, à l’esprit de l’écriture inclusive, à l’homophilie triomphante et à la parité des hommes et des femmes, en proposant de rebaptiser « également » l’Ile et Vilaine en Elle est Vilain.
Ce qui d’un seul coup ne ferait que rendre Justice.
Et comme dirait Georges Pérec dans une préface à la Cathédrale de Chartres, il est beau mais elle est Beauce.
…………………………………………………………………………………………
3 février
« Toute la poésie de Mallarmé est, malgré tout, celle du désir non satisfait ». Est-ce une vérité applicable au seul Mallarmé, ou n’est-ce pas plutôt la vérité de presque toute poésie ?
Du moins, si du désir satisfait peut naître une source poétique, il paraît évident que le propre du poétique est de souvent chercher au-delà. La mer recommencée en quelque sorte. Mallarmé n’est pas le Faune mais il l’invente dans le décor qu’il à mis en scène.
L’alphabet est hermétique pour l’analphabète.
La poésie se paie de mots.
La poésie est plus souvent conciliation que résolution.
Ressemblance entre l’inspiration et le désir. Mais le meilleur poème n’assouvit pas son auteur.
-Desnos-
………………………………………………………………………………………
Passant au bas du parvis du MAMAC, depuis lequel l’effet est le plus saisissant, dans une immense baie de verre, une avalanche de chaises bleues, signifiant comme la fin d’une fête, une centaine de chaises peut-être, (anciennement sur la Promenade des Anglais), constitue une des accumulations chaotiques d’Arman la plus spectaculaire. Elle serait dans son œuvre ce que serait la symphonie pour l’orchestre , les accumulations de violons et de violoncelles, et autres objets détournés de leur fonction moulés dans du plexiglas en seraient la musique de chambre.
Je souris encore devant la réflexion la plus spontanée et la moins feinte de Dalila devant un tel désordre organisé à grande échelle : « Il ne doivent pas souvent faire le ménage dans ce Musée… »
……………………………………………………………………………………….
4 février
Dans « Voyage en Italie », on sent que Goethe traverse le pays comme le « vagabond, l’errant, le Wanderer… Je me suis enfui de Carlsbad à trois heures du matin : autrement on ne m’aurait pas laissé partir ! … je ne pouvais différer plus longtemps. »
Goethe tente d’échapper à un univers par trop pesant et le voyage est déjà, en cette fin du XVIII° siècle, le remède et le baume contre la maladie d’une certaine suractivité et les contraintes de la vie d’homme public. C’est donc, dans cet immense récit, le voyage considéré comme une odyssée. Nous sommes à cent lieues de Stendhal, qui considère l’Italie (dans ses multiples Voyages) comme arriverait un Consul, un Ambassadeur, qui visite une église, en fait la description, la nomenclature de toute son architecture, décrivant les multiples trésors de peintures et d’œuvres d’art, les anecdotes qui y seraient relatives, pour finir dans les intrigues politiques, mondaines et nocturnes des salons des plus beaux milieux. Stendhal semble connaître l’Italie à proportion de l’amour qu’il lui porte, mais aussi tous les italiens et les italiennes nécessaires…
…………………………………………………………………………………………
5 février
L’indépendance de la Catalogne est une affaire qui n’a pas fini. Les franco-castillans ont, depuis le XVIII° siècle, soutenus la couronne d’Espagne en imposant un Bourbon contre la Catalogne alliée aux Habsbourg.
…………………………………………………………………………………………Parmi les célébrations du centenaire de la mort de Debussy, des échos nous parviennent de Vienne, où Klimt, né la même année et mort la même année, fera l’objet de quelques commémorations communes aux deux artistes.
………………………………………………………………………………………..
En Une de « Libé » en date d’hier, une tornade de haine s’abat, comme de coutume, dès lors que les seuls noms de Brasillach, Céline et Maurras, trio de malfaiteurs, de criminels et d’ordures pensantes se trouvent cités dans les remous de l’actualité. S’agissant pourtant d’une simple opération financière qui rapporterait beaucoup à la maison Gallimard, il serait question de publier dans la vénérable institution d’édition les œuvres maudites de Céline (Bagatelles pour un Massacre, Les Beaux Draps, et l’ Ecole des Cadavres), Libé titre donc, comme pour un procès d’Assise : « Le retour de l’infâme »…
Surtout le retour de l’Ordre Moral et de la bienpensance coutumière du quotidien qui ne peut ignorer que ces œuvres sont disponibles depuis bien longtemps en versions PDF. Gratuites. Même Mein Kampf est en vitrine…
Dans le même temps Maurras, au siège 16 de l’Académie française, ne sera pas présenté, par la seule volonté de Madame Nyssen, ministre de la Culture dont le père était éditeur ( !) aux commémorations de l’Académie. Il ne s’agit pourtant ici que de commémoration et non de célébration d’un auteur et d’un homme politique qui avait notamment marqué en leur temps, et le général de Gaulle et François Mitterrand.
Libé , la Pravda de maintenant… créations de Sartre (La Cause du Peuple) et de July, des lendemains de 68, d’un doux maoïsme et d’un trotskisme qui fleurent bon l’hystérie de la pensée des penseurs de la France d’aujourd’hui. France exemplaire…
……………………………………………………………………………………….
7 février
Delcassé… L’Avenue (Rue ?) Delcassé à Rabat s’éclaire aujourd’hui enfin d’une signification que je ne pouvais comprendre du temps où nous y vivions. Théodore Delcassé, ministre des Affaires Etrangères, fut l’artisan, à la fin du XIX° siècle, qui comprit très vite que la France ne pouvait tirer ni force ni grandeur de son seul régime politique frappé d’asthénie irrémédiable, mais bien ailleurs, au-delà des frontières, outre-mer.
Ce seul nom est comme l’acte de naissance du Maroc contemporain.
Il avait la conviction que la confrontation avec l’Angleterre pouvait se négocier. Celle-ci empêtrée par la guerre des Boers finit par laisser les mains libres à la France, dans l’espoir qu’elle renonce de son côté à contester son hégémonie en Egypte. Restera seulement à négocier difficilement avec l’Allemagne de Guillaume II avant la Première Guerre. C’est la Banque de Paris et des Pays-Bas qui délivre le premier emprunt au sultan Abd el Aziz en 1902 pour un montant de plusieurs millions. L’engrenage est lancé. Le sultan passe rapidement sous contrôle français. Delcassé prit soin de verrouiller le dispositif en écartant toute participation de banque étrangère. En attendant les grands marchés de travaux publics que les investissements vont financer par l’emprunt de 1904. Le sultan, dans la main de la Banque de Paris, confie de surcroît la mission de doter le Maroc d’une Banque d’Etat.
(Lyautey, A. Teyssier, chapitre « aux confins du Maroc et de la politique »)
Celle-là même où mon père a passé une grande partie de sa vie d’employé de banque. Celle où ma tante Lucia connut Laurent Rio son futur mari, directeur de ladite Banque d’Etat dès les années cinquante. En 1956 la Banque devint Banque du Maroc. Je me souviens que le changement d’appellation avait occasionné de grands travaux remodelant la façade de lettres et de caractères arabes qui venaient en traduction du nouveau nom de la banque. C’était le début de ce Maroc aux maisons blanches où je suis né et vécu cinquante années plus tard.
Le nom de la rue Delcassé (Avenue ?) a du disparaître depuis bien longtemps. Elle partait du Rond point de la gare, et allait vers le cinéma Royal, passant par la boulangerie qui faisait de merveilleuses viennoiseries et par le magasin de disques, « Au Clavecin ».
…………………………………………………………………………………………
8 février
J’entends Roger Muraro parler avec une grande ferveur de son passage dans les classes de Messiaen et d’Yvonne Loriod. Une phrase m’a éclairé sur l’approche qu’un élève peut avoir d’un grand maître : « Je n’ai pas seulement retenu les leçons de ses deux grands artistes, j’ai comme témoigné de leur existence ».
………………………………………………………………………………..
Encore des dénonciations pour harcèlement. Cette fois c’est Hulot le ministre qui s’empêtre dans des déclarations. Le féminisme est en pleine épanouissement. Sauf qu’il s’agit de toujours dénoncer ce qui est dénonçable à peu de frais. C’est le combat du sous-tif… Combien de ces associations de défense des droits de la femme sont allés filmer la cité de Sevran en Seine Saint Denis, où seule la présence des hommes semblent autorisée, comme au bled, et si des femmes apparaissent, c’est voilées, et à distance dissuasive d’une caméra ? Il est certes plus facile de dénoncer des tentatives de harcèlement avérées ou supposées, dans de simples revendications pour une justice de droits communs que de combattre sur un même plan le plus total déni de liberté pour les femmes de la future république des barbus.
On peut en dire autant des forces de l’ordre qui déploient tout l’arsenal répressif que l’on sait, contre les automobilistes devenus des sources immédiates d’impôts, que de faire respecter les lois de la République dans les quartiers pudiquement nommés sensibles. Le tohu-bohu des associations féministes, pas plus courageuses que ça, manifestent la même ligne de fracture au-delà de laquelle il n’est pas bon de s’avancer.
………………………………………………………………………………………..
Lors de son Voyage en Italie, Goethe a logé à l’auberge de l’Ours à Rome, quelques siècles après Montaigne ! Y avait-il déjà des couloirs balisés empruntés par nos gloires littéraires comme il y aurait aujourd’hui dans notre être-là des personnes de notre connaissance avec lesquelles se trouver nez à nez à Bangkok, sur la Place du Dam ou aux Seychelles ?
……………………………………………………………………………………
René Daumal a eu l’idée extraordinaire de mourir avant d’achever son roman « Le Mont Analogue ». A charge aux lecteurs, aidés de plans et d’énigmes, héritant d’une sorte de livre en kit, d’achever la fin. Et dont diverses maisons d’éditions proposeraient telle version de Mr X, telle autre de Mr Y. (J’avais déjà fait un rêve analogue s’agissant d’une participation collective d’auteurs d’une même pièce).
Ce serait une sorte d’absolu pour un auteur de rendre potentielles de multiples pistes conclusives, qui ne craindrait plus d’avoir à choisir (ou imposer) avec remord, un dénouement linéaire unique. Ce serait, non plus un work in progress, mais un work en parallèle.
Comme dans les œuvres qui ménagent une happy end ou au contraire une fin triste et dramatique.
Peut-être serait-ce là aussi un aveu et une considération moindre pour la singularité de l’acte créateur ?
Mais après tout, et plus loin dans le temps, les plus hauts chefs d’œuvres du Moyen-Age ne restaient-ils pas anonymes ?
Plus près de nous, ne serait-ce pas Bruckner, sans le vouloir, qui aurait créé un précédent, laissant des mouvements entiers de symphonies, soit inachevés, soit dans l’incertitude d’un achèvement définitif, donnant ainsi naissance aux fameuses versions Haas, Novak ou Oeser ?
……………………………………………………………………………………….
12 février
La Mairie de Paris de Anne Hidalgo n’est pas à une honte près. Maintenant c’est la maison de Pierre Henry, décédé en Juillet dernier, qui va faire place à un projet immobilier. La maison /musée du compositeur aménagée depuis 1971, rue Cardinet, était devenue un studio de composition, un centre de rencontres et de réception une fois l’an au moins (présentation d’œuvres à la presse, conférences etc). Avec de véritables orchestres de haut-parleurs, de consoles et quelques cinquante mille assemblages sonores enregistrés et stockés dans des archives comme autant de pièces précieuses. « Une Maison de sons »… L’épouse du compositeur n’a pu obtenir que la maison soit classée. Il est question de renvoyer tout cet arsenal dans un centre de culture et de loisirs, déracinant ainsi ce qui, depuis plusieurs décennies, constitue le cœur battant de la création électroacoustique dans les lieux même qui l’ont vue s’épanouir.
…………………………………………………………………………………………
Dès les premières phrases des Mots de Sartre, il y a ce retour à l’écriture des fabuleux contes de Voltaire, de Diderot et peut-être plus encore, de Flaubert… Cette douce musique de la phrase légère, plutôt courte et ciselée. Sartre ne pouvait pas ne pas en être conscient. « En Alsace, aux environs de 1850, un instituteur accablé d’enfants consentit à se faire épicier. Ce défroqué voulut une compensation : puisqu’il renonçait à former les esprits, un de ses fils formerait les âmes… ». Sartre n’aura jamais fait mieux que dans les Mots.
…………………………………………………………………………………………
15 février
DIAGNOSTIC ARTAUD
Dans la douleur de sa chair, à manger ses propres dents dans leur gouffre, je me demande encore si Artaud ne sublime une schizophrénie addictive et une déraison programmée par l’épuisement de la drogue, comme qui voudrait s’abstraire du bastingage empesé de la vie qu’il n’a jamais semblé accrocher dans son meilleur parallèle, ou si le malade de Rodez a trouvé dans la noblesse et le classicisme de ses lettres la déjection geignarde et la sublimation d’une impuissance à vivre.
D’où l’œuvre d’art inséparable dans son esprit de la neuronale et abyssale expérience du ventre et le refus, dans la douleur de ses membres, de porter le monde.
…………………………………………………………………………………………
Dans les Lettres et les Nouvelles Lettres de Rodez, il se regarde souffrir, il met en scène sa souffrance. Jacques Rivière a du être bien patient en recevant et en répondant à Artaud. Mais il devait aussi savoir que ces échanges d’état d’âme finiraient dans un beau recueil de la collection Poésie…
………………………………………………………………….
16 février
Dans la préface des Mémoires d’un touriste, Dominique Fernandez rapporte que Stendhal ne connaissait rien aux architectures antérieures à la Renaissance et avant 1500 d’une manière générale. Il n’entendait rien aux différentes architectures romanes et gothiques. Moins certainement que n’en saurait aujourd’hui un simple amateur de vieilles pierres traversant nos contrées. Même après que Mérimée lui ai donné les clés pour en entrevoir les différences et l’esprit inhérent à chacun des deux styles : « Beyle m’a toujours paru indifférent à l’architecture et n’avait sur cet art que des idées d’emprunt. Je crois lui avoir appris à distinguer une romane d’une gothique… il reprochait à nos églises d’être tristes (…) Nos églises sombres et lugubres avaient été inventé, disait-il, par des moines fripons qui voulaient s’enrichir en faisant peur aux gens timides ». Ce grand observateur qu’était Stendhal n’échappait pas à ces critères esthétiques qui prévalurent longtemps sur tout ce qui touchait à la pensée du Moyen Age. Ce qui n’empêchât pas Stendhal de piller les livres de Mérimée sur la France. Sur Giotto, ses lumières n’étaient pas plus vives, qu’il partageait les réserves habituelles des préjugés de son temps concernant cette fin du Moyen Age : « Ses ouvrages sont désagréables à voir et si Giotto naissait aujourd’hui dans la patrie des Appiani et des Bossi, qui doute qu’il n’enfantât des chefs d’œuvre comparables à ceux de Raphaël ».
……………………………………………………………………………………..
17 février
Je le redis. Les mouvements féministes ne deviendront crédibles que lorsqu’ils s’attaqueront au péril extrême constitué par l’esclavage structurel dans lequel sont maintenues les femmes de l’Islam. Ce serait cent mille fois plus courageux et responsable que de prétendre révéler et endiguer les dérives sexistes, somme toute minoritaires, relevant du droit commun, dans notre occident.
Que penser de la montée des marches au dernier Festival de Cannes ? Des dizaines de femmes, des stars faisant la promotion de leur film, le sourire carnassier, le sexe à découvert, soulevant ostensiblement leur robe et laissant voir le plus intime au-delà duquel il n’y aurait plus rien à dévoiler.
La dernière tendance féministe ? Font-elles partie des futures plaignantes revendiquant à la fois le droit de s’exhiber et de dénoncer les perversités à leur endroit ?
……………………………………………………………………………………….
22 février
C’est un vrai temps de Carnaval niçois. Pluie et grisaille aussi sûres, chaque année, que le Carnaval a des confettis et des batailles de fleurs. En fait de batailles, il s’agit plutôt de défilés de chars avec des jeunes filles (plus ou moins jeunes) courageuses et gainées de costumes à paillettes, dans leur presque nudité, qui lancent dans le public ébahi des bouquets de mimosas. Ce qui distingue ce Carnaval des autres, c’est cette dominante jaune des fleurs qui ont l’avantage de rentrer ensuite par gerbes à la maison et de finir d’embaumer dans des vases.
…………………….
Après plusieurs jours d’inquiétude inutile, le cardiologue a une interprétation rassurante de mes analyses de sang.
……………………………..
24 février
Regardant des photos de Rabat des années de mon enfance, j’ai souvenir d’un minaret à quelques dizaines de mètres de l’immeuble de Nonina. On y entendait le muezzin à heures fixes, et cela faisait partie du décor. Sur d’autres photos, je viens à peine de saisir qu’aujourd’hui, un autre minaret que je croyais être celui qui avait toujours été en place, a été construit depuis notre départ du Maroc. Le précédent, que j’avais toujours eu sous les yeux, se situait plus près de l’immeuble des Phosphates, c’est-à-dire, plus sur la gauche, en prenant l’axe de l’Avenue Mohamed V.
Il a donc été détruit… Ce qui fait que la Cathédrale de Rabat (dont la légende familiale veut que le Nono ait contribué tout la-haut à l’érection de la croix), le temple Protestant, l’église Saint François et toutes les autres, furent des constructions religieuses antérieures aux édifices musulmans de la ville moderne. Seules la Tour Hassan et les constructions musulmanes de la vieille ville ont été édifiées bien avant. Ce nouveau minaret, plus élevé que le précédent, suivant la volonté du Roi Hassan II, a été érigé intégralement avec les pierres du précédent, après 1964, pour s’aligner sur la grande avenue et un peu plus près du Palais Royal, au pied de la route d’Aïn el Aouda…
………………………………………………………..
Maintenant c’est Henri. La fatigue du corps, malgré l’envie de vivre. L’angoisse que j’ai sentie au téléphone. L’usure qui prend à l’heure des bilans dans les milieux de la soixantaine…
…………………………………………………………
Les Dialogues de Platon ne sont-ils pas trop polis ? Et toi qu’en dis-tu jeune Théétète ?…
………………………………………………………….
Pourquoi n’y a-t-il jamais de rêves heureux, mais comme un caveau nauséabond dans nos âmes ? La nuit d’avant , le rêve a du être aussi court qu’il a été tranchant. Il s’agissait de Y. Nous étions dans un lieu mal identifié, mais aux paroles brûlantes, je compris qu’on parlait de sa disparition. Le mot qu’on ne veut jamais entendre était prononcé. Il est mort. C’est en un instant une falaise qui écrase, le sang qui reflue, le froid de glace d’une lame qui rentre dans la partie vivante de votre âme.
……………………………………………………………
26 février
Des flocons de neiges tombent. C’est beau à voir depuis la fenêtre de la chambre Nord. Le premier rideau de la forêt est comme traversé d’une pluie blanche, poudreuse. Ca vient du ciel comme des petits morceaux de sucre, légers comme si de très haut on avait crevé un traversin. On ne voit plus Saint Paul et moins encore le Baou. L’hiver ira cette année au bout de ses givres et de ses froidures. Je ne sors pas depuis trois jours.
…………………………………………
28 février
RAPA NUI
Depuis mon séjour au Chili (2010) je ne prenais plus de nouvelles de l’Ile de Pâques. Cette idée d’aller si loin avec Francis avait son origine dans une conversation enflammée et enivrée d’un désir d’atteindre ce vrai bout du monde. Les circonstances n’ont pas voulu que nous rejoignons l’Ile aux statues. Le temps qui nous était imparti et nos faibles moyens ne l’ont pas permis. Mais nous avons connu Valparaiso, qui en soi, valait à elle seule le voyage. L’Isla Negra et l’Ile de Chiloë, à défaut de celle de Pâques.
Ce qui paraît sûr aujourd’hui, c’est que les pascuans ne seraient pas originaires des côtes continentales du Pérou, bien que Thor Heyerdhal ait tout de même prouvé que c’eut été possible dans l’aventure du Kon Tiki, fait d’assemblage de rondins de balsa , sans clou ni rivet, mais de simples ligaments de cordages et une voile unique ! Il a réalisé, simplement pour prouver ce qu’on ne pensait réalisable, ce que les Incas auraient pu envisager lors d’une hypothétique expédition. Heyerdhal et son maigre équipage est le conquérant solitaire et hasardeux de l’île la plus solitaire au monde. Plus prosaïquement, l’analyse ADN montre que les pascuans seraient originaires des îles Marquises, des polynésiens de Huku Iva. La langue marquisienne serait aussi très semblable.
Les statues polynésiennes d’origine auraient de grandes similitudes avec celles de Pâques de par la forme saillante des mentons mais une taille plus réduites due à une roche plus dure à tailler. J’ai pensé un temps que les statue de l’île pouvait avoir un lien avec celles des sites archéologiques de San Agustin en Colombie. Mais les différents foyers culturels colombiens restent uniques et autarciques même en regard de leurs voisins incasiques du Sud. Lorsqu’on regarde les alignements des colosses le long des rivages de Pâques, alors qu’il serait attendu qu’ils se positionnent face à la mer, en forme d’aspiration quelconque vers un ailleurs espéré, ou un prolongement de leur propre finitude terrestre, témoins et sentinelles spirituelles, ils tournent en fait le dos à la mer !
Ou ne serait-ce pas une indication concernant d’étranges divinités qui se seraient présentées venant de la mer ?…
Rapa Nui, bien qu’isolée entre toutes les terres les plus isolées qui soient, n’en porte pas moins un regard tourné vers elle-même. Ce qui n’empêchât pas un terrible déboisement de quelque vingt millions d’arbres entre le 13° et le 17° siècle. Au risque d’un effondrement écologique et de l’extermination des pascuans eux-mêmes.
Du Chili j’ai gardé ce souvenir qu’à mesure qu’on descend vers le Sud, la course du soleil s’inverse dans le ciel, que la densité du bleu y est incomparable et je n’écarte pas l’idée d’un jour fouler les landes dévastées et nues de l’île aux statues qui regardent ce ciel dans une déjà proche éternité.
………………………………………………………………………………………
28/ 1 Mars
La neige absolue, celle du silence, chez nous aux Hameaux, trente trois ans plus tard, après celle du Vallon Barla (janvier 85), qui avait paralysé la ville plusieurs jours…
Ce que nous aimons dans la neige, c’est ce tapis d’immobilité qui s’installe, que ne procure pas la violence de la pluie.
L’orage gardant le charme des déchaînements sublimes donnent envie de nous engloutir dans des havres protecteurs.
Avec cet écran de grisaille et la neige dans son dos, le Baou a des airs de Half Dome…
………………………………………..
Et Schnittke va bien avec ce temps. En avalanche. Je fais défiler les concertos pour violon, les mouvements lents du trio à cordes.
…………………………………………
Guy Goffette est à l’aise dans la poésie qui vise le ventre du provincial. Je l’aime, il nourrit l’esprit. La Jalousie est un chef d’œuvre de quelques lignes.
……………………………………………
En France, le rapport à la viande est devenu trouble. Dans sa tiédeur morale, il n’est plus possible de parler de taureau que pour défendre sa cause. L’humanisme institutionnalisé est unilatéralement dressé contre le culte de Mithra. Il n’y a plus la voix discordante d’un Eluard ou d’un Picasso libres de s’opposer à l’éthique des lobbies animaliers. Comme Hulot voudrait mettre le pays à vélo, certains voudraient nous contraindre moralement par respect du vivant et interdire les jeux de mort.
Mon Dieu, sommes nous devenus si barbares ?!
Jolis cœurs omnivores ! comment meurent donc la viande de boucherie ?
…………………………………………………………………………………
En ce moment de neige et d’inactivité, je fais des tris, je coupe aux ciseaux des morceaux de phrases, des pensées expansives.
…………………………………………………………………………………
Comment aimer l’Artaud de la lettre aux écoles de Bouddha ?
…………………………………………………………………………………
J’entendais ce matin que Jeanne d’Arc avait été victime de racisme ( !)… Déjà j’avais un doute.
En fait, il s’agissait d’une effigie de la Pucelle qui se devait ( !) d’être métisse. Et qui a du faire réagir dans les rangs ceux qui pensent que ladite Jeanne, Lorraine et chrétienne, voulait sauver la France dans son identité de l’Occupant anglais, et finit au bûcher à Rouen. Mais se devant d’être universellement vivante aujourd’hui, elle se devait donc d’être métisse. (Même l’Artaud qui joua un rôle de clerc (remarquablement !) dans le film de Dreyer doit s’étonner). Aujourd’hui, les avis et les analyses concernant Jeanne d’Arc vont de l’hilarité billevisiste des rationalistes, aux défenseurs de ce point important symbolique et charnel de l’Histoire de France. Au même titre que de Gaulle sauvant la France en 40… Jeanne métisse pourquoi ? De quelle Afrique mêlée ou d’autres sangs (puisque métissage est un sang nouveau) voudrait on la façonner ? L’insulte faite à la Patronne des Résistances en France, à l’enracinement, aux valeurs et au symbole de la liberté semble passer au second plan pour promouvoir l’idée d’une incarnation métisse offerte en symbole au monde entier. (Jeanne pour tous ? Pourquoi pas ? Mais d’abord Jeanne de France. Lorraine et chrétienne). En quelque sorte, Jeanne ne serait pas morte charnellement pour sauver une France en danger, mais pour sauver à rebours un monde en déficit d’égalité qui, de Johannesburg à Toronto, d’une bien pensante caisse de résonance viserait à une identité mêlée, sans racine, et coulée dans le moule d’une grisaille mondiale.
Ceux qui voudraient jeter l’image de ce qui a toujours été le marqueur martyre et la légende inaugurale de nos racines françaises de liberté se devraient de se taire.
Dans la légende de l’Ouest américain, il est très juste de penser qu’entre la vérité des faits historiques et la Légende , il est toujours préférable de choisir la Légende.
Et de na pas forcer l’Histoire.
N’en déplaise aux moqueurs et aux rationalistes.
…………………………………………………………………………………………
Je regarde le ciel. L’uniformité est diaboliquement insupportable. Est-ce le temps passé à contempler les masses denses et uniformes donnant le décor monotone de ces journées d’hiver qui font que je crois que le noir absolu (on ferme les yeux) apparaît comme effrayant ? Le noir est culturellement la couleur du néant. Celle des espaces infinis. Celle de la peur de la nuit, des cosmonautes perdus dans l’espace, des frayeurs nocturnes initiales. Le blanc absolu des miraculés des NDE serait-il plus confortable ? Le bleu infini de l’azur ?
…………………………………………………………………………………….
2 Mars
Après la neige, la pluie toute la journée. Mais aussi Alain Planès qui parle de son enfance, de son amitié avec Rudolf Serkin et de son travail de claviériste à l’InterContemporain.
Une phrase durant l’entretien: « Duchamp disait : ce n’est pas l’observateur qui regarde le tableau, mais le contraire. »
……………
Le Conservatoire s’éloigne de moi. A peine un peu plus d’un mois que j’en suis parti et ses contours me paraissent déjà installés dans le flou des mirages. La venue de Kristof Penderecki a été un grand moment autour des années 2010. Il y donnait le Te Deum de Bruckner et le sien en seconde partie. Durant les répétition où nous étions très peu nombreux à avoir ce privilège de la mise en place des énormes moyens qu’exigeaient ces deux œuvres, je remarquais sa battue nerveuse et tendue, les gestes extrêmement amples comme s’il invitait à grandir une harmonie ou à souligner les contrastes dynamiques. Et puis à un moment où tout paraissait sonner merveilleusement, il eut un geste d’agacement. L’orchestre se tut immédiatement. Le maître s’écarta du podium pour venir à hauteur de la soprano et lui asséner en polonais ce qu’il pensait probablement d’une nuance ou d’une articulation qu’il n’avait pas du apprécier. Depuis Toscanini, je n’aurai jamais imaginé pareille terreur s’abattre dans l’enceinte d’un orchestre.
Le soir du concert l’exécution de ces deux oeuvres monumentales reçut un des plus beaux triomphes qu’ait pu vivre l’auditorium.
A l’inverse , j’ai pu côtoyer Jean- François Heisser, un des plus fins musiciens de la planète, lors des Académies d’été. On se rencontrait souvent dans les ascenseurs et il paraissait faire partie du personnel d’entretien tant sa modestie et son apparence étaient éloignées du parfait pianiste qui brillait sur toutes les scènes du monde. On n’a jamais fait mieux que l’interprétation où il tient sa partie du Concerto de chambre de Berg.
……………………….
4 Mars
Je me laisse volontiers surprendre. Quand il s’agit de Chopin et que l’interprétation me plait, en l’occurrence cet après-midi, le second Concerto, c’est toujours sans le savoir, Samson François.
………………………
Héloïse et Abélard se résument-t-ils à ce qu’en dit Artaud ?
……………………………………………………………………………..
Enregistrement d’un concert du 1 juin 1956/ Horenstein, aussi à l’aise dans Debussy que dans Mahler. Final grandiose de la Mer avec un pourtant modeste orchestre du Portugal (Coïmbra ?)
Le monde n’a-t-il pas commencé avec le Prélude à l’Après-Midi d’un Faune ?
………………………………………………………………………………
La fleur de safran, fleur du crocus est cultivé en Région Centre depuis qu’il a été importé des Indes par les Croisés. Est-ce celui-ci qu’on trouverait dans nos cuisines ?
…………………………………………………………………………………………
Chez les Woodabe de Guinée ou du Niger, les hommes ont la réputation d’être les plus beaux du monde. Dans les danses de séduction ce sont eux qui sont fardés, et comme en vitrine, choisis par les femmes…
…………………………………………………………………………………………
5 Mars
Casanova est un séducteur. Sade un défricheur de sensations
…………………………………………………………………………………………
Richard Strauss pourrait paraître fait d’une seule pièce, monolithique et simplement colossal, comme le début de son Zarathoustra. Ce qui le sauve, c’est la nostalgie. Elle transparaît dans le final de l’immense Symphonie Alpestre, dans Ariane à Naxos, le trio final du Chevalier à la Rose, (il disait vouloir partir de ce monde en entendant ce trio féminin) et évidemment dans les quatre derniers lieder qui sonnent comme un adieu lui aussi. Plus nostalgique encore que le Chant de la Terre.
…………………………………………………………………………………………
6 Mars
La France restera décidément le dernier pays stalinien (ou peu s’en faut). Sorti le 28 février, le premier volume des Mémoires de J.M. Le Pen (qu’on partage ses idées ou pas) n’est pas visible à la FNAC. Je savais que cette centrale d’achat culturelle se réclamait ouvertement dans les années cinquante d’une agitation trotskiste quand le courant était alors porteur. Depuis elle a éliminé toute concurrence pour impérialement s’installer dans une authentique spécialisation de haute morale et joue le rôle très jdanovien du nouveau formalisme de la bonne pensée. Ce qui n’est pas sans créer tout de même un dilemme, et même un sacré dilemme, quand on sait que la parution de ce premier volume ne tardera pas à se situer, là où la FNAC y puise la fibre de sa sensibilité et comme le cours de sa bourse et son baromètre, à savoir parmi les meilleures ventes. La morale est à ce prix. Tartuffe.
…………………………………………………………………………………………
Nietzsche disait que le Prélude de Lohengrin pourrait être perçu comme composé sous l’influence d’opiacés. Bien que l’on ne sache rien des pratiques de Wagner. Si tel était le cas, vive les opiacés.
Comme Strauss, ce long prélude s’accorde avec un adieu à quelque chose, un mystère de la séparation (celle de la matrice primordiale ? mais l’arrachement wagnérien est toujours proche d’un crépuscule), une nostalgie bleue, incommensurable.
…………………………………………………………………………………………
NOIR ET BLANC
Rien ? plus rien de ce qu’ aurait pu laisser Angela après qu’elle nous ait quitté. Même et surtout cette abondante collection de photos qu’elle était seule à constituer depuis les années 50/60, dans l’indifférence et parfois l’insouciance souriante des membres de la famille. La liquidation rapide de tout ce qui a touché sa vie matérielle, appartement, comptes bancaires, objets personnels, et ce petit trésor de mémoire qu’étaient ces photos d’anniversaires, de fêtes familiales, de tous ces instants volés à la vie qui passe, nous prive d’une sorte de patrimoine spirituel. A qui a bien pu profité la négligence d’un tel essaimage, ce type de crime contre la mémoire ?
Il ne me reste de sa bibliothèque que de vieilles éditions reliées d’un Montesquieu (Considérations sur les Romains), et d’un volume des Mémoires de Saint-Simon. Elle m’avait offert, trop tôt peut-être, (puisque vers mes douze ans) « Colline » de Giono- je vois encore la peinture de la première de couverture – Histoire de bêtes humaines, remplies de sang, de montagnes et de bergers perdus dans leur solitude.
………………………………………………………………………………………
« De Feu et de Fureur », ouvrage systématiquement anti-Trump, est hystériquement sur les présentoires de la FNAC (et sur plusieurs épaisseurs), à chaque étage et au départ de chaque début d’escalier mécanique. La stratégie de vente à la force de la matraque a toujours été la politique pratiquée par ces supermarchés à vocation culturelle sélective. Callas, Karajan, suivant les dates commémoratives les concernant, étaient indiqués par des petits pas de couleurs blanches vous accompagnant depuis l’entrée du magasin jusqu’au rayon où trouver le produit à la manière du petit Poucet.
Sauvagerie et terrorisme médiatique pour consommateur somnambule…
………………………………………………………………………………………
7 Mars
Le plafond de ciel gris qui ne nous quittait plus depuis presque un mois a crevé timidement et on voit à nouveau le ciel bleu encore froid et comme signifiant que l’hiver ira jusqu’à son terme.
……………………………………………………………………………………..
Je revois Brigitte au Conservatoire. Elle revient des Indes mais ne semble pas reposée ni détachée de ses phantasmes de persécutions. Les murs, les allées et les couloirs me semblèrent des lieux perdus de vue depuis longtemps. Je vois s’agiter ceux qui font crépiter leurs claviers d’ordinateur comme vivant dans une tension et un rythme que je perçois maintenant en observateur étranger.
…………………………………………………………………………………………
José Van Dam a soixante quinze ans. Sa voix a bien vieilli aujourd’hui. Il tire sa révérence avec un album de chansons, J’aimerais tant voir Syracuse, le Plat pays etc. Il a été un des plus grands barytons lyriques du XX° siècle. Pour le velouté d’une voix à toute reconnaissable et pour la noblesse de son timbre (Œdipe d’Enesco, Golaud). Et quel chemin parcouru depuis les années soixante dix où dans sa carrière encore naissante, il était Méphisto dans un Faust à Nice, en justaucorps et queue de diablotin…
…………………………………………………………………………………………
Ce soir les racines et les ailes n’ont jamais autant mérité leur nom. Le survol des marqueteries de vignes en Côte d’Or, véritables mosaïques d’automne sur leurs mamelons en pentes douces, de même l’équilibre et l’élégance des paysages des bords de Loire et ceux du bordelais ne paraissent jamais si beaux que vus du ciel.
Magnifique Château de Pommery, aux sous-sols et aux caves creusées dans la craie, aux diverses façades aux couleurs décalées, bleues et rouges dans le camaïeu des vignobles champenois.
…………………………………………………………………………………………
Les soirées d’hiver se suivent et mon inspiration ne s’ouvre que sur des thématiques de mort…
…………………………………………………………………………………………
Magnifique gisant rehaussé de couleurs vives, rouge et bleu, d’Aliénor d’Aquitaine et Richard Cœur de Lion à Fontevraud.
…………………………………………………………………………………………
Vivre encore, orgueilleusement pour que ma descendance se souvienne de moi.
…………………………………………………………………………………………
Y est d’une très grande sensibilité, timide et discrète. Soufflant les bougies d’anniversaire d’une petite camarade de crèche, il réussit à éteindre de son côté les premières, proches de lui, mais pour la dernière il ne réussit pas. Il rougit, écarta ses mains en signe d’incompréhension, et sans montrer sa peine, essuya quelques larmes de ses deux petits poignets.
…………………………………………………………………….
10 Mars
Je n’aime pas Cioran parce que j’ai une manière différente de craindre la mort. Chez lui, cette crainte serait d’abord initiée par une forme d’inappétence pour la vie.
………………………………………………………………………………………..
Drumming. Deux heures d’hypnose rythmique. Le percussionniste Colin Currie ne serait-il pas le plus grand ? (Steve Reich)
………………………………………………………………………………………..
12 Mars
En temps normal je me serais surpris à sourire d’un sourire quelque peu ironique et léger en entendant tournoyer une de ces mélodies mille fois répétées dans les années 90 par Andrea Bocelli.
Ce matin c’est une émotion qui m’étreint en pensant que Maman aimait ce chanteur, et que maladroitement je lui avait fait une réflexion dont la teneur consistait à minimiser l’importance d’un interprète qui passait pour une caution classique dans l’univers de la variété et qu’on considérait comme un interprète de variété, au mieux de cross over, dans le milieu plus élitiste du monde lyrique. Je comprends seulement aujourd’hui qu’elle a pu être blessée, sans jamais rien en dire, du peu de considération que j’avais manifesté pour ce chanteur dont elle ne parlait pourtant pas souvent et qu’elle écoutait discrètement avec sa sœur Lucia, assise l’une contre l’autre, sans un mot, devant l’écran de télévision. Je donnerais cher pour être sûr que du fond de l’univers, s’il était possible, elle ne m’en ai pas tenu rigueur.
Et puis les paroles qui me reviennent : con te partiro…
« Avec toi je partirai vers des pays que je n’ai jamais vus… » ………………………………………………………………………………………..
13 Mars
50 ANS DE MAI 68 qui commencent à fleurir dans les vitrines des librairies.
Mais aussi, (une remarque personnelle), cinquante et un an et soixante ans après… :
« Vive le Québec libre ! » et « Je vous ai compris ! »… L’une inconséquente, l’autre criminelle.
…………………………
Je n’ai jamais aimé mon écriture manuscrite. Une écriture contrariée durant toute une année scolaire, autour de la sixième, de l’avoir faite pencher d’un versant vers un autre penchant, pour la rendre droite… De plus, lorsque la pensée rassemble une grande combinaison d’images ou de concepts, de peur de perdre et d’oublier des nuances en chemin, ma main a tendance à se crisper.
Y aura-t-il encore une place pour l’écriture manuscrite dans ces temps de clavier qui viennent ?
………………………….
Hier, passant dans la rangée des vieux Giono, j’avais l’odeur de ce petit volume « Colline » en livre de « Poche », que j’ai toujours gardé depuis les années d’adolescence. « Noé » aussi, écrit dix ans avant le Nouveau Roman… Un parfum que n’auront jamais eu les « Folio ».
……………………………………………………………………………………….
Saint Louis était islamophobe et antisémite. Saint, mort de la peste à Tunis. Autre temps autre mœurs.
………………………………………………………………………………………..
Pour Adolf Wölfli j’hésite entre Bruckner et les Beatus catalans du X°siècle. Et une organisation de l’espace très mandala. Mais aussi dans sa sainte folie on croit sentir celui ou ceux qui ont fait les voûtes de la chapelle de Saint Chef en Dauphiné. La Jérusalem Céleste.
…………………………………………………………………………………………
Les médias pensent que le Père Hamel est un martyre de la République…
…………………………………………………………………………………………Pourquoi ne pas attribuer aux « Brèves de Comptoirs » de Jean-Marie Gourio un prix d’anthologie de Littérature Anonyme et de sociologie, appliqués aux bistrots ?
…………………………………………………………………………………………
14 Mars
Comme Bernard me demandait pour quelle(s) raison(s) je rejetais la Lettre aux écoles de Bouddha, ma réponse était : « je reproche simplement à Artaud de tomber dans le bêlement bouddhiste auquel vont succomber des générations depuis plus de quarante ans, qui trouvent que l’herbe est toujours plus verte chez le voisin. En gros, c’est un critique féroce de toute spiritualité, et là il tombe dedans comme un bleu. Est-il d’ailleurs sincère ? Je ne lui reproche pas son antisémitisme. Saint Louis était antisémite et islamophobe. Autre temps autre mœurs. »
J’ajouterai que Artaud déjecte par ailleurs toute une diarrhée anti papale (« nous n’avons que faire de tes canons, index, péché, confessionnal, prêtraille, nous pensons à une autre guerre, guerre à toi, Pape, chien ») au nom d’un pur esprit humain, bien qu’il se sente en totale adhésion avec le Dalaï Lama de façon presque risible et un brin cireur de pompes (« nous sommes tes très fidèles serviteurs, O grand Lama, donne nous, adresse nous tes lumières, dans un langage que nos esprits contaminés d’Européens puissent comprendre, et au besoin change nous notre Esprit etc. »
C’est clair, Artaud est un des pionniers pourfendeurs du christianisme occidental, et au-delà, de toutes ses valeurs, comme dans le théâtre de la cruauté celui-ci ne pourrait recevoir toute sa verdeur et tout son sens que de Bali, vierge de toute contamination par nos esprits débiles.
Contrairement à Artaud, Gauguin, au moins, a mis en conformité son renoncement à l’Occident et à ses valeurs pour vivre le mieux qu’il pouvait le ressourcement auprès des primitifs. Artaud s’est contenté de cultiver la haine de soi, d’éructer sur nos valeurs en regardant pourrir ses dents.
……………………………………………………………………………………..
Parlement, mot étrange, formé de deux verbes : parler, mentir.
……………………………………………………………………………………..
L’évolution de Daniel Cohn-Bendit, sans nous voiler la face, est une adaptation au pouvoir. Il l’a rejoint, du moins en est-il proche. Se diluant tel un quelconque marcheur dans le paysage actuel, comme tous ces députés sortis du néant sur des listes majoritaires pour cause de nécessités législatives qui n’auront aucun mal à marcher là où le sillon est déjà creusé pour eux. Ce qui s’appelle voler au secours du vainqueur…
Donc la pensée la plus normative qui soit (économie libérale, un zeste de social-démocratie, principe de taxation exhaustive, Europe sans racine, mondialisme diluant) qui situe Dany le rouge au centre même de ce qu’il abborrhait.
Il a donc bien la notion du virage à 180° qui a du, depuis bien longtemps, être son instinct de survie.
Je me souviens de ce que disait Stef de ces « gens de 68 » qui ont continué leur gueule de bois pendant plusieurs générations : ça fait long.
Pour être aujourd’hui sur les strapontins du pouvoir.
J’attends avec impatience en ce cinquantenaire de célébrations, comment Dany va s’autocommenter…
…………………………………………………………………………………..
15 Mars
Pluie sans cesse. La buée sur les vitres. Dans mes conversations avec Bernard nous avons échangé des points de vue sur le Picon, sur son origine Philippevilloise, puis Marseillaise, du Pagnol des années 30, qui comme toute réussite engendre des origines diverses… Fleurs d’oranges amères en tous cas.
Pour changer, je profite de la boisson de Thuir (et de tout le Roussillon) le Byrrh que j’ai découvert l’été dernier, parfait avec le magret de canard aux poires et miel, branches de thym. Avec ce temps on vit derrière la buée des cuisines.
……………………………………………………………………………………..
16 Mars
Encore des souvenirs qui reviennent dans mes échanges de courriers avec Bernard. Le fameux Square Christiné, celui de l’été 67. Là où il n’y avait pas d’ombre, les arbres étant des petits dans l’enfance comme nous, a poussé aujourd’hui une merveilleuse cloche de branchages et de feuilles très hautes, très touffues, qui protégerait presque de la pluie. Malheureusement l’ovale de la Place est encerclé de contenairs divers pour les détritus et pour le tri écolo. Il y a aussi une cabine téléphonique, vestige d’un temps intermédiaire.
……………………………………………………………………………………….
Encore le Big Bang. Le temps serait en marche arrière, sur l’abscisse opposée à l’espace, occasionnant la courbure en sens inverse de la lumière initiale, provoquant une rencontre explosive… Je n’ai peut-être pas bien suivi Stephen Hawking ?
Il est mort le 14 de ce mois.
………………………………………………………………………………………..
18 Mars
Cécilia me laisse au Sauveur vers midi. Le samedi je me fais souvent accompagner pour éviter le souci des contrôles. Il pleuviote. Vers quatorze heure je la vois arriver avec le petit tout mouillé, trottinant et faisant flotter un petit drapeau tricolore. Des petits moments de grâce…
…………………………………………………………………………………………
19 Mars
Les commémorations du centenaire de la mort de Debussy s’intensifient. Aujourd’hui, Pélléas et Mélisande qui succèdent à La Mer (surprenant Karajan avec les Berliner) dans l’émission de Frédéric Lodéon. De quoi verser quelques larmes en plein après-midi. C’est la version de Claudio Abbado avec José Van Dam et Jean-Philippe Courtis dans la dernière scène « Il ne faut pas l’inquiéter, l’âme humaine aime à s’en aller seule … ». L’opéra absolu.
…………………………………………………………………………………………
Aujourd’hui je me demandais pourquoi ce matin, ce 19, me faisait penser à une date comme souvent ma mémoire me les rappelle. C’est la date des accords d’Evian sur la fin de la Guerre d’Algérie. Date félonne, où unilatéralement le gouvernement français a cessé les hostilités, abandonnant et fermant les yeux sur les suites postcombustions de massacres perpétrés par les vainqueurs desdits accords…
…………………………………………………………………………………………
Grandiose violoncelle des concertos de Schnittke. Il ne quitte pas les douleurs d’avant que viennent les glissandi du sommeil
…………………………………………………………………………………………
20 Mars
Le vent aigre pour le retour de Katy. Cela faisait quelques temps qu’on ne se voyait. La neige n’a pas quitté le Vaucluse de tout ce début d’année. Nous déjeunons à la Mama. Puis allons ensuite chez Sauveur où le soleil est bien timide.
………………………………………………………………………………………..
22 Mars
Ce matin le ciel est dégagé, l’air est vif. J’accompagne Katy dans ce quartier administratif qui pousse très vite du côté des Moulins. Certains immeubles sont signés Jean Nouvel et les projets semblent tournés vers les espaces verts avec de belles échappées sur de timides jardins. Cela reste malgré tout un quartier destiné aux bureaux… Plus loin, dans la matinée, comme le temps est au beau, nous essayons à la Libération, le petit rouge d’un bistro non loin du parking des anges, en face du quartier des poissonniers. Cela semble être réellement le premier jour de printemps. Les tuiles semblent chanter sur les toits. Et nous déambulons au soleil sur l’avenue Malausséna.
…………………………………………………………………………………..
Le 22 Mars c’est le début des évènements de 68. Ce fameux Mouvement qui porte la date en question n’a été qu’un non événement ou un événement relevant de fantaisies de potaches bien dans l’air d’un printemps vif comme il pouvait y en avoir dans ces temps anciens, qui allait devenir plus turbulent quelques semaines plus tard, comme surpris de sa propre hardiesse.
A Nanterre, comme les filles pouvaient librement pénétrer dans les cités universitaires des garçons, la revendication principale était d’établir la réciprocité.
C’est une des origines de ce qui allait donner naissance à une fausse révolution et à une vraie mutation des mœurs occidentales.
…………………………………………………………………………………….
Des grèves, toujours plus. La France innove en la matière. Ce n’est plus la cessation momentanée du travail d’énormes masses de travailleurs qui se déploient en une fois en de longs cortèges, mais d’arrêts sur le long terme (deux mois, trois mois ?), d’une planification mensuelle à raison de cessations de deux jours alternatifs sur cinq, reconductibles.
Les grévistes sont réellement entrés dans une sorte de raffinement du dictat syndical moderne.
Et contrairement aux cheminots inspirant de moins en moins de sympathie, de par leur statut qui sent trop la caste des éternels nouveaux privilégiés, on ne peut aujourd’hui que déplorer la misère et la nécessité de réformer le milieu hospitalier.
Mais le tout dans ce pays est de savoir organiser le bras de fer et la terreur.
………………………………………………………………………………………..
L’universalité des pôles ne se rencontrent pas toujours, mais la gemmologie n’en existe pas moins dans des cultures dont les latitudes géographiques ont peu de chance d’influer l’une sur l’autre. Il est ainsi troublant de constater la ressemblance frappante des pratiques du Yodl des montagnes suisses et du chant des pygmées Bibayak du Gabon…
Les miniatures des Beatus de Catalogne, probablement ignorées par Adolf Wöllfli, se retrouvent dans l’utilisation de l’espace flottant comme leur jumeau spirituel dans presque toutes ses œuvres. C’est d’ailleurs comme ça que, sans mes lunettes, j’ai pris pour une enluminure de Béatus ce qui était un Wöllfli sur un présentoire de la bibliothèque municipale…
………………………………………………………………………………………..
« Nous sommes de la civilisation de l’olive, nous autres. Nous aimons l’huile forte, l’huile verte, l’huile dont l’odeur nous dispense de lire l’Iliade et l’Odyssée. » Noé. (Folio p. 57)
………………………………………………………………………………………..
24 Mars
laïc
Un professeur de Sorel-Tracy a censuré la chanson d’Edith Piaf « l’Hymne à l’Amour » sous prétexte que dans le dernier couplet « Dieu réunit ceux qui s’aiment » … Il dit ne pas vouloir expliquer le sens de cette phrase à ses élèves. Monsieur le Professeur, dans quel monde désincarné vivons nous ? Pour Piaf, Dieu est synonyme d’amour. La chanteuse a connu dans ce qui lui a été transmis par l’expérience et dans les mœurs encore en vigueur durant sa vie que Dieu pouvait être amour ! Comment cela a-t-il pu vous échapper ? Le métier de professeur ce n’est pas de faire disparaître les mots, c’est de leur rendre leur sens !
C’est probablement pour des gens comme vous que la Piaf a bien raison de se foutre du monde entier…
………………………………………………………………………………………..
Comment se fait-il que l’abbaye de Thélème, décrite au chapitre 57 du Gargantua trouve son écho satanique à Cefalú en Sicile sous la forme d’une ruine sinistre recouverte de fascinantes peintures vives et verdâtres ? Comment se fait il encore que la figure du père moderne du satanisme, Alistair Crowley, apparaisse dans le coin gauche supérieur de la légendaire pochette de St Pepper en 1967 ?
………………………………………………………………………………………..
25 Mars
C’est une journée entière consacrée à Claude Debussy. Profitant d’un dimanche, tous les producteurs ont centré leurs émissions sur la disparition du compositeur aujourd’hui, le 25, mais la date exacte c’est demain, 26 Mars. Pendant longtemps les biographes ont hésité ou négligé la date exacte. La Tribune des Critiques proposera quelle version lauréate de La Mer ?
……………………………………………………………………………………..
…C’est la version de Michel Tabachnik… Sur plus de deux cent versions enregistrées, les plus belles n’ont évidemment pas été retenues, s’agissant aujourd’hui d’une sélection des trente dernières années. Je regrette que l’interprétation de Boulez n’ait pas été plus loin dans la confrontation. Le Cleveland y est somptueux (les bois !) et donne une vision de la mer très éloignée de toute perception subjective. Le reste ne donne aucun regret, Denève, Roth, van Immersel, Rattle…
Quand je pense que le producteur de l’émission n’a pas jugé opportun de sélectionner la grandiose version de Sergiu Celibidache… Munich 1992, en public.
Simple omission ? (ce qui serait presque une faute professionnelle), où choix délibéré ?
Pas une seule des trois versions officielles de Toscanini non plus…
Sviatoslav Richter disait avoir ressenti une sorte de fascination en entendant la version de Roger Désormière pour l’avoir écoutée en boucle une centaine de fois.
La Mer, c’est la mer profonde, fondatrice de toute vie, c’est aussi le ciel qui s’ouvre à la naissance du monde.
…………………………………………………………………………………………Il est troublant de noter que Debussy a vécu au début du siècle dernier Rue Cardinet. Pierre Henry le savait-il ?
…………………………………………………………………………………………
Toujours dans la profusion d’évènements et de rééditions de ce centenaire, l’intégrale du piano, parallèlement à celle de Gieseking, l’inattendue et superlative version de Hans Henkemans entre 1951 et 1957, pour Philips, qui acheva sa carrière de pianiste pour reprendre des études de psychiatrie.
…………………………………………………………………………………………
Puisqu’on diffuse à peu près toute son œuvre, le Prélude de « Rodrigue et Chimène », écrit bien avant « Pélléas » semble être le pendant de Lohengrin dans l’œuvre de Debussy. Ce côté bleu. Ineffable.
……………………………………………………………………………………….
Brigitte avait certainement une réelle sympathie pour moi que reflètent bien les trois cartes postales/souvenirs qui accompagnaient la peinture de Wladimir Kasim :
– Etre vieux c’est être jeune depuis plus longtemps que les autres.
– Un ami c’est quelqu’un qui vous connaît bien et qui vous aime quand même.
–
– C’est en voyant un moustique se poser sur ses testicules qu’on réalise qu’on ne peut pas régler tous les problèmes par la violence…
…………………………………………………………………………………………
26 Mars
Au large du Pacifique existe un continent poubelle, un continent auquel on donne déjà le nom de continent plastique, d’un million de km carrés, donc deux fois grand comme la France. Est-ce possible ?
…………………………………………………………………………………………J’aime peut-être plus Rio Grande que Rio Bravo, mais comme c’est John Ford et Howard Hawks…
Maureen O’Hara ne joue pas dans Rio Grande, elle parle avec les yeux. Et ses yeux sont immenses. C’est presque la technique du cinéma muet.
Même les Pharaons ne pourraient mourir dans des tombeaux aussi grands que Monument Valley.
………………………………………………………………………………………
La plus grande littérature romanesque sur fond d’Histoire, c’est Salammbô ; ça commence par : « C’était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d’Hamilcar… », un million d’années avant le Nouveau Roman.
…………………………………………………………………………………..
Le fox terrier de mon enfance… Ce petit chien avait probablement été le premier animal avec lequel mes parents m’avaient fait tisser des liens d’affection. Il en reste quelque part une photo dans le jardin où l’on voit mon père qui nous porte chacun dans un de ses bras. Nous étions logés dans les dépendances de la villa de la tante Louisette (côté Deydier), dans les faubourgs de Rabat, quartier de l’Aviation, proche des cités Mabella. Ne sachant faire la différence entre les noms usuellement donnés aux humains et ceux donnés aux animaux, j’avais baptisé la petite chienne, Katy.
………………………………………………………………………………….
Un jour que je m’étais perdu vers les grands complexes de la cité Mabella, assez éloignés de la maison, la petite Katy avait nerveusement alerté Maman qui n’avait plus eu qu’à la suivre jusqu’à moi, installé et insouciant dans les bacs à sable…
……………………………………………………………………………………….
Dans toutes ces prières musulmanes, dans les rues de Paris, de Marseille, dans toutes ces assemblées de rue à ciel ouvert, ma naïveté me force de constater qu’il n’y a que des assemblées d’hommes sur leurs tapis. La femme musulmane n’a-t-elle pas accès aux louanges adressées à Dieu ? Peut être que leurs prières restent aussi dans la claustration.
………………………………………………………………………………………..
28 Mars
Puisqu’on en est au cinquantenaire, il est dit que « l’utopie de 68, c’était l’Europe » (Romain Goupil). Mince !
L’épiphanie de cinquante années d’errance voit les casseurs de société d’hier faire la maçonnerie de cette toujours déliquescente république…
Mallarmé disait « la chair est triste », comme de ces vieux d’aujourd’hui qui auraient l’amnésie de leur sang ancien.
……………………………………………………………………………………..
Les migrants sont défendus par Goupil, l’homme qui avait soutenu la destruction de leur pays.
……………………………………………………………………………………….
Arnaud Beltrame a été égorgé comme on exécute rituellement…
Les médias n’en disent rien.
Frapper à l’arme blanche dans l’Islam c’est toujours comme on sacrifie une brebis.
…………………………………………………………………………………….
Stéfane Audran est morte. Hier, avant-hier ? Je regarde “La Femme Infidèle”. Elle est sculpturale, bourgeoise et irrésistible. Avec la musique de Pierre Jansen.
…………………………………………………………………………………………
Comme je n’étais pas méritant dans les années de la petite scolarité, je n’ai jamais su la différence entre les Prix d’honneur et les inscriptions au tableau d’honneur. Je n’ai jamais eu que quelques livres récompensant une juste médiocrité.
…………………………………………………………………………………………
30 Mars
MAI 68 …
Le désir, la jouissance, l’utopie, convertis cinquante ans plus tard sur l’autoroute du consumérisme… Prenez vos désirs pour des réalité – tout, tout de suite – jouissez sans entraves – sous les pavés la plage – On sait aujourd’hui, qu’en fait de plages, pour les parisiens de Anne Hidalgo, la plage c’est Paris Plages.
…………………………………………………………………………………..
31 Mars
Edifiant Renaud Camus : « Le principal totalitarisme à l’œuvre de nos jours en Occident est né de l’alliance contre-nature de l’antiracisme moral et de la finance hors sol », (quatrième de couverture dans « le Grand Remplacement »).
…………………………………………………………………………………..
1 Avril
Noël avait été la fête de la dinde farcie. Aujourd’hui, dans toutes les grandes surfaces, c’est la ruée vers les œufs en chocolat.
Cette année, l’esprit du poisson d’avril prend nettement le pas médiatique, pour en révéler l’incontournable aspect consensuel, sur les fêtes de Pâques. Comme avec soulagement.
……………………………………………………………………………………
Je n’ai plus peur de ces levers du matin qui me menaient vers des lieux et des énergies qui ne m’appartenaient pas complètement, pour craindre en retour ces nuits d’éveil menant vers des jours trop libres d’errance et fragilisés à mesure qu’ils sont délicatement décomptés.
………………………………………………………………………………………
L’Etat achète la paix civile. La législation du cannabis en France n’est pas possible. Elle casserait le monopole de son économie parallèle, prenant le risque d’une guerre sans fin contre ses banlieues, du feu et du sang des représailles jusque dans le cœur des villes. Nos gouvernants n’en ont jamais eu les moyens ni surtout le courage.
………………………………………………………………………………………
4 Avril
L’homme est naturellement omnivore. L’homme a une conscience morale. Lequel prend l’ascendant ?
………………………………………………………………………………………
Jean-Paul Sartre, sur la première de couverture des « Mots » nous montre un adolescent laid. Il l’a toujours été. Du « Néant » à la « Cause du peuple » il a du probablement beaucoup en souffrir.
……………………………………………………………………………………
La musique de western : de la trompette avec vibrato, des cordes étirées, en valeurs longues : l’éclat et l’espace du monde.
Aucun acteur, aucune réplique n’a jamais parlé de la beauté des paysages. Du genre « Que c’est beau Monument Valley où nous sommes.. »
« 3 heure dix pour Yuma », l’interprète du générique, Frankie Laine « take that train… »… Le type même de l’accompagnement absolu de la musique de western. Celle de George Duning. En attendant Ennio Morricone…
Puisque la nostalgie des espaces est là, je ne peux oublier « The Alamo » et pour la symbolique « Le train sifflera trois fois » 1952 qui répond à Richard Anthony… : « Et j’entend siffler le train, et j’entend siffler le train… ». Entre les deux, ma naissance et mon départ de Rabat… 1964… 1964 : « Les Cheyennes » à cheval sur ces mutations d’espaces qui venaient dans ma vie. On a longtemps dit que le western finirait avec John Ford. La place de cinéma du Gaumont de l’avenue Jean Médecin coûtait 6 francs 50. je n’avais que 6 francs sur moi. La queue, par ce bel après-midi de juillet était très longue, interminable comme la déambulation des Cheyennes du film. Je dus courir jusqu’au « Prieuré » (deux kilomètres au moins, quand même !), où Maman et Lucia devaient être là pour trouver le complément de monnaie et revenir prendre la file à l’entrée du cinéma…
…………………………………………………………………………………………
Il y a des arches de pierres dans l’Utah qui sont des défis à la mathématique.
……………………………………………………………………………………….
Du bout des doigts, Claudio Arrau et l ‘« Hommage à Rameau » enfin tenu du bout du ciel…
Chouchou disait à Stravinsky : « Papa jouait beaucoup plus doucement que vous»
Le plus beau portrait de Debussy dans la vingtaine reste celui de Marcel Baschet. Puis viennent plus tardivement ceux de Jacques-Emile Blanche, (qui n’était pas le père de Francis).
Baschet a réalisé également un magnifique Lyautey.
…………………………………………………………………………………………
Y aurait aimé la gare de Rabat. Son arrière papy lui aurait fait entendre les « tchoutchou » de trains si timides qu’on aurait cru qu’ils effleuraient les rails. La gare au marchand de journaux. A l’orgueilleuse horloge.
…………………………………………………………………………………………
10 Avril
Les pluies semblent dévaster les couleurs. Cette année on ne voit pas revenir les floraisons, sauf les arbres du jardin qui retrouvent leurs pétales blanches, vite remplacés par les feuilles rouges du Prunius. Les flambées de fleurs et la grande mutation printanière se font comme derrière un voile de tristesse. La terre a tant été retournée qu’elle donne tous ses parfums comme des fruits qui n’arrivent à éclore. Je reste des journées entière derrière les murs. Je trinque aussi avec ceux de chez Sauveur, entre deux souffles de vent aigre, quelques ondées et de minces trouées de ciel.
Cet hiver les sangliers n’ont pas hésité à venir frotter leur groin jusque devant chez nous.
J’attends des nouvelles du Vaucluse. Là-bas aussi l’hibernation est longue.
……………………………………………………………………………………….
J’entends Louis Couperin au piano. J’ai toujours préféré ses œuvres jouées ainsi plutôt qu’au clavecin. La hauteur de ton et la sévérité, l’austérité de certains mouvements, y sont rendus plus profonds.
………………………………………………………………………………………..
La musique de Wölffli, est décryptée par Baudouin de Jaer depuis peu. C’est la découverte d’une candeur d’âme aussi bouleversante que le chant des baleines capturé par l’enregistrement.
……………………………………………………………………………………….
Il est aussi fou d’entrer dans le Noé de Giono que dans Joyce et son Ulysse.
……………………………………………………………………………………….
D’où vient l’expression « l’habit ne fait pas le moine » ? En la langue ancienne de Rutebeuf c’est « L’I abiz ne fait pas l’ermite », (Dit du Frère Denise le Cordelier).
Une vérité qui ne s’est jamais vérifiée…
……………………………………………………………………………………….
11 Avril
Neanderthal revient à la mode. Il aurait eu du mal à renouveler sa génération et aurait donc été dans la nécessité de composer avec le nouvel arrivant Sapiens que j’ai longtemps cru Cro Magnon ( !?). Ce qui fait un peu trop Dordogne. Cela fait étrangement penser à l’Européen actuel en défaut de natalité et de renouvellement de génération qui devrait justifier cette idéologie du vivre ensemble avec les populations migrantes du Sud…
………………………………………………………………………………………
Pourquoi toujours cette haine de soi même. Les élégants martiens, dit-on, (les terriens débarquent sur Mars, les martiens n’y sont plus !), les gentils extra-terrestres, les aliens, les animaux même… L’humain serait donc la seule espèce vivante susceptible de haine contre soi ? Tous les autres vivants commencent par la préservation de l’espèce. Ce qui serait dans leurs gènes une manifestation de l’amour de soi bien naturelle.
L’homme est fait d’ombre et de lumière, notre seul semblable réel, et la réalisation de son être passe par cette imperfection de son être. Dieu étant nié de nos horizons, le référent devenant absent, l’humanité n’est-elle pas entrée dans une grave crise de conscience, dans le sens où elle peut se détester de par cette absence de perfection originelle ?
…………………………………………………………………………………………
Le corps de Saint Louis a été dépecé en son temps. Os, cœur, viscères. Dispersé entre Tunis, Saint Denis, Canada. Dans le Quercy (Prudhomat), Notre Dame. Mort peut-être du scorbut un 25 Août 1270. A la Sainte Chapelle, le nom du roi n’est pas mentionné sur le reliquaire du cœur embaumé. A Rome, à Saint Louis des Français, un morceau de bouillonnement, de végétaux, de fibres musculaires.
A Monreale aussi, des restes subsistent. Irons-nous à cette rencontre dans dix jours ?
…………………………………………………………………………………………
Devant moi, un homme de grande taille, élégant dans son costume gris sombre, s’avance vers le tableau, se penche à presque toucher la toile. Il porte de sévères lunettes à forte monture noire, qu’il enlève et qu’il remet tranquillement. Il déambule seul maintenant, sereinement, après que Pierre Provoyeur lui eut réservé une conférence privée des œuvres du Message Biblique. Nous sommes en 1977, peut-être 78, dans une salle du Musée Chagall. Il n’y a personne d’autre que nous. Je suis du regard ce personnage altier, quelque peu pharaonesque par ce je ne sais quoi de prestance naturelle. Il a un port de tête et une chevelure nettement Trump pour l’époque. C’est le maire de New-York qui est devant moi, c’est Nelson Rockfeller.
…………………………………………………………………………………………
Elles étaient là, toutes celles qui devaient franchir un pas certain dans leur évolution. La master class, on y accède quand le niveau est déjà affirmé. Ce matin là, des sopranos et des mezzos. Essentiellement. Mais on aurait pu avoir, sur la scène de l’auditorium, des ténors surtout, puisque le maître d’aujourd’hui, c’est Michel Sénéchal. L’incomparable Grenouille pathétique de la « Platée » de Rameau (1956, Aix en Provence). Sa voix, si particulière, lui a permis des rôles de caractère, des rôles bouffes, tragi-comiques et fluides, comme Chouiski (Boris Godounov), toujours dans une diction qui faisait de lui un maître diseur. Et ce matin justement, Michel Sénéchal qui aurait pu impressionner et faire perdre leurs moyens à ces belles artistes en devenir, les rassuraient en faisant l’éloge de leurs capacités. J’ai retenu, au-delà de certains ajustements techniques de chacune des voix, que les compliments s’accompagnaient toujours d’une remise en cause de l’articulation : « …votre voix aura beaucoup d’avenir quand vous chanterez en donnant l’illusion que vous parlez votre rôle » . Ce qui revenait à dire que la technique vocale devait se maîtriser en même temps que le souffle orientait le sens des mots vers une illusion de naturel et de facilité. Il s’en est allé il y a quelques jours à quatre vingt dix ans emportant de précieux secrets.
……………………………………………………………………………………….
Michel Sénéchal, probablement le modèle de Dominique Visse.
…………………………………………………………………………………………
12 Avril
Pluie, pluie.. Comme un monde nouveau qui nous tombe dessus.
Moi aussi j’ai la dent dure. Hughes Cuénod n’a jamais voulu chanter le « Noël des enfants qui n’ont plus de maison » . Belle voix haute, mais quel idiot !
…………………………………………………………………………………………
Sigourney Weawer : « Même les gorilles protègent leur territoire »
Moi : « Les oiseaux aussi, dans nos villes, mais on arrache leurs arbres »
…………………………………………………………………………………………
La Révolution française a été synonyme de la fin des temps de la terre de France, engendrant l’illusion que le pouvoir se partageait entre tous. Les démocraties, en leurs républiques, défendent des faiblesses qu’on peut leur reprocher quand tous les cris de vérités issues d’un ordre ancien donnent à croire que sur des sables de solitude, le monde qui est le notre tombe vertigineusement, comme un instinct de mort sonne le glas de nos valeurs millénaires, s’ouvrant aux plaies de demain.
Jamais aucun roi de France, fût-il le plus faible, n’aurait accepté de faire de la France une terre d’Islam.
Ce que la République a déjà accepté. Ce que les démocraties, pour notre agonie, semblent appeler de leurs vœux. (C’est aussi la théorie du Grand Remplacement)
………………………………………………………………………………………..
Rutebeuf- Le débat du Croisé et du Décroisé (XXV) : « Si Dieu est quelque part au monde
c’est en France sans aucun doute ». C’était au XIII° siècle.
………………………………………………………………………………………..
On parle de mort naturelle jamais de naissance naturelle.
…………………………………………………………………………………………
15 Avril
Jean-Claude Malgoire est mort hier. C’est Alain Jacquot qui me l’apprend. On gardera l’impérissable souvenir de son Orfeo de Monteverdi vers l’an 2000 qui fut comme un moment de grâce et un des deux ou trois plus grands spectacles auquel il m’ait été donné d’assister. C’était Nicolas Rivencq qui tenait le rôle titre dans une version de concert, avec costume noir, entrées et sorties par les loges, où tout sur scène, décor et orientation de l’expression musicale parlait la langue de l’Angelico.
Malgoire avait été un pionnier de ce qu’on appelle encore aujourd’hui la révolution baroqueuse. Avant le concert, il était au zinc du pub de l’Opéra de Nice comme un quelconque client descendant son demi.
…………………………………………………………………………………………Milos Forman aussi est parti le même jour. J’avais longtemps travaillé son Amadeus dont je n’aimais pas le rire de son Mozart (Tom Hulce). Par contre le Salieri de Murray Abraham était grandiose d’intériorité.…
…………………………………………………………………………………………
Parmi les joyeux trinqueurs de chez Sauveur, c’est Patrick le trompettiste qui est décédé. On gardera le souvenir d’une humeur toujours égale et de son éternel chapeau sur des vêtement toujours usés jusqu’à la limite du cuir.
…………………………………………………………………………………………
Dans la rubrique des disparus, il a aussi Pierre-Emile Barbier, le découvreur d’archives à Prague, le fidèle représentant de l’association Janacek, et le fondateur de la collection Praga.
…………………………………………………………………………………….
17 Avril
Pour un tombeau d’Anatole . Mallarmé si brillant, si maître des mots, n’est ici que suffocation, balbutiements devant la mort d’un fils. Souvent dans ces bégaiements, il inclus le nous, ou plus encore, avec le Je de la première personne, la triple présence, la mère et l’enfant disparu. Comme pour ne pas, pour une fois, être seul et impliquer aussi la mère douloureuse et le fantôme de leur chair. Cet avortement de livre est plus qu’un projet auquel il n’a pas du vraiment croire, mais comme un pleur silencieux de témoignage.
………………………………………………………………………………………..
Une enquête américaine révèlerait que la paresse serait une des caractéristiques des esprits supérieurs. Que les plus diplômés ne seraient pas forcément les plus intelligents mais ceux qui répèteraient le mieux le savoir transmis. Que les plus diplômés toujours, ne seraient pas forcément les plus entreprenants mais les mieux adaptés à un encadrement déjà structuré.
Nous pourrions ajouter que l’art de perdre son temps demande des trésors d’imagination que ne sauraient se permettre les mieux organisés des réussites aux concours et examens.
L’essentiel se résumerait à l’art d’être prédisposé au bonheur. Une sorte de synthèse de la sagesse de Giono et de la conscience de notre existence relative.
……………………………………………………………………………………….
MAI 68 …
Le peuple est con, panurgesque. Cela se lit dans le regard noir et blanc de ceux, anonymes, jeunes et moins jeunes, activistes étudiants, ou hurleurs d’un peloton en mal de chef de bande dans le film de Patrick Rotman. Cohn-Bendit avec le temps porte la marque très ciselée des gestiques de Danton. Le peuple est con et féroce en France. Les fourmis organisées de mon jardin ont plus d’instinct vital et de raison que les pantins de ce moment d’acné social. Truffaut, et le grand Godard visionnaire, sur les estrades de l’ancien Palais des Festivals, demandant l’annulation du festival de Cannes pour cause de solidarité avec les ouvriers et les états d’âmes estudiantins … des fois que la Révolution passe par là.
Que retenir de vraiment tragique de cette année là ? Les émeutes universelles, le Black Power, les Jeux de Mexico ? Non.
Août, et les chars entrant dans la nuit de Prague. Le printemps avait tenté frileusement d’y fleurir avec Dubcek. L’été, lui, a été vraiment rouge. Du sang de Jan Palach. Mais c’était déjà en janvier 69… Mais la France était déjà, et encore, en congés payés…
***
A la différence de Paris, Prague ce n’était pas sous les pavés la plage, mais l’immolation sur les pavés.
Place Wescenslas.
………………………
Cinquante années plus tard, loin du Godard révolutionnaire et frénétique, pour Cohn-Bendit qui a monté les marches au tapis rouge du Festival de Cannes l’an passé, ce serait aujourd’hui plutôt « Sous les crampons , le foot ». On ne perd jamais la gouaille quand on l’a eue.
Et pourquoi pas un verre de jaune pour refaire les match au comptoir du lundi matin ? Loin des révolutions et ses gueules de bois. Le café du commerce lui irait à ravire.
………………………………………………………………………………………..
19 Avril
Les fenêtres sont ouvertes ce soir. C’est l’odeur de la terre qui monte pour la première fois en même temps que les cris des enfants dans les allées et les jardins des Hameaux. L’été arrive, compressant un printemps attendu qui a failli ne pas venir. Tout arrive souvent trop vite. Les flambées d’herbes viennent jusque sous les narines. Les herbes seront plantées, bientôt les marguerites dans les jarres, et puis le terreau nouveau, les tomates … Demain nous serons à Palerme.
…………………………………………………………………………………………
PRELUDE A LA SICILE
C’est à elle que j’ai pensé dès la fin de mes activités… Depuis des années pourtant, je savais qu’un jour cette destination aurait fatalement sa place dans un calendrier de voyage. Cocher sur une carte la destination de la Sicile n’est pas fortuit, mais plutôt une forme de nécessité qui m’entraînerait, à la fois sur des lieux où s’amoncellent des monuments chargés d’Histoire, et sur la terre même où a levé une partie de mes racines. Et pas des moindres, puisqu’il s’agit des origines du côté de ma mère qui se trouvent collatéralement issues du Sud de la Sicile. Et le nom même d’une ville de l’Ouest de l’île, Salemi, sera le nom porté par mon grand-père maternel, le Nono. Parmi les photos disparues de l’abondante collection d’Angela, figure un portrait d’elle devant la plaque d’entrée du nom de la ville. C’est très certainement une rare bénédiction de voir son nom s’enraciner dans l’enceinte même d’où coulent la source et le sang de votre ascendance. Je ne pouvais un jour manquer l’inévitable pèlerinage vers ces lieux, étant un des derniers descendants de ceux qui, depuis l’an passé, avec l’oncle André, ont tourné la page de la génération qui m’a précédé. Je m’inscris donc comme le témoin vivant et vierge d’un retour curieux vers des lieux chargés d’ombres, d’Histoire et d’ancêtres. Du plus lointain souvenir factuel, il me reste un portrait du père du Nono, qui lui ressemble comme un duplicata. Même regard lointain aux plissements des yeux malicieux et à la noblesse du port de tout le haut du corps. Mais contrairement au fils, le père porte d’énormes moustaches en guidon de vélo et des rouflaquettes interminables qui étaient passées de saison du temps de mon grand-père.
Plus évanescent, le portrait disparu aujourd’hui, de la Nonna, Lauria, la mère de la Nonina. Un noir et blanc, tout comme les vêtements sombres et austères que portaient encore en ce temps les femmes du Sud, un regard pénétrant dont je n’ai jamais su s’il trahissait une émotion vive ou une hauteur morale en conformité avec le noir d’ensemble du châle et de la robe. Le portrait est d’autant plus impressionnant, qu’au tirage, la silhouette de la vieille dame apparaît en surimpression d’un décor dont on a du mal à dire si il s’agit de la buanderie ou d’une quelconque autre pièce de la maison, avec une erreur dans le traitement photographique laissant apparaître, en troisième surimpression, quelques nuages épars. Ce qui amplifie le côté légendaire et fantomatique de cette ancêtre. Elle aurait encore été vivante un an ou deux avant ma naissance. Native de Gela, terre de forte imprégnation grecque, je n’ai jamais regardé ce portrait sans une certaine gêne devant cette disparue que j’aurais pu connaître, dont je n’ai aperçu que cette fixité de stature ambiguë, entre la mère éternelle du Sud et la rudesse d’un permanent regard antique.
Nonina, à ma connaissance, n’est jamais allé sur ses terres ancestrales, sauf à l’avoir entendu parler d’un séjour (quand ?) à Pantelleria. Mon grand-père lui, est né à Comiso, dans la Province de Raguse, à l’intérieur des terres du sud-est de l’île. Quand en est-il parti pour se trouver un jour au Maroc où se produisit la rencontre avec ma grand-mère, née à Bizerte ? Je doute que lors de notre séjour nous allions à Gela ou à Comiso. Le temps nous sera compté. Nous passerons non loin de Salemi, où est Ségeste, tout à l’Ouest, en début de voyage. La grandeur des sites antiques, baroques, byzantins ainsi que les paysages, sauront bien nous donner la quintessence de ce qui doit quelque part s’inscrire dans l’âme de cette partie de mes ancêtres.
……………………………………………………………………………………….
SICILE
Durant une semaine, le temps qui aura passé sur ce séjour, j’ai cru avoir perdu la mémoire des choses d’avant, ne vivant que d’émotions succédant à d’autres émotions comme un primitif n’organisant plus le monde, tant j’entrais par fascination, et la presque suffocation, dans la toute permanente métamorphose de la matière et de la matière spirituelle.
Vendredi 20 Avril
Dès l’arrivée cela sent l’Afrique, non pas un souffle ou un parfum arabique, mais une anarchie de formes, un laisser aller du geste et de la sonorité environnante. Parcourant l’autoroute qui mène à Palerme (à près de cent cinquante à l’heure !) défilent justement ces ensembles d’habitation où la hauteur des immeubles ne mesure pas l’orgueil architectural mais révèle, à mesure qu’ils s’élèvent, la plus grande densité de leur pauvreté.
Si il est une couleur qui semble s’être dissoute ou bien n’avoir jamais existé ici, c’est la blancheur. En revanche, s’affiche toute la gamme des ocres et des gris jusqu’au noir, comme si le modelé des maisons étaient un ramassis des terres du désert n’ayant accédées à leurs bâtis que momentanément, attendant provisoirement de changer de forme. L’horizon paraît un indistinct défilé de texture d’un jaune sali, de quelques taches verdâtres et le craquelé des habitats rehaussé par le vaporeux d’un avril passant sans transition à l’été.
Palerme apparaît maintenant en son cœur, dépenaillée, sans ordre apparent dans la circulation cahotante sous le regard de la croix démesurée pendant au dessous du rétroviseur du taxi. Puis après tout un dédale de rues et de ruelles interminables, après avoir aperçu fugitivement une facette du Palazzo Reale, les arbres et la large Via Roma qui mènent à l’Hôtel Ambasciattori. Après tout cet afflux de couleurs dans les vapeurs de poussière de la ville, l’hôtel est un havre d’ombre pour la rétine.
Par l’Avenue Vittorio Emmanuele surgit, au sortir d’une ruelle, la Piazza Bellini et les trois merveilles de Santa Caterina faisant face à La Martorana au porche et au clocher normand, et à San Cataldo, sous les premiers palmiers emblématiques. La Martorana étant envahie par les visiteurs impatients de quinze heures trente (les édifices publiques étant souvent fermés durant la pose autour de midi), nous pénétrons à San Cataldo, sorte de cube austère surmonté de trois bulbes rouges. Semblant émergé d’une oasis nord-africaine, c’est le siège des chevaliers du Saint Sépulcre. Ses merlons dentelés et ses coupoles en « bonnets d’eunnuque » signent un des plus parfaits exemples d’architecture arabo-normande. L’intérieur se divise en trois nefs séparées par des colonnes antiques provenant d’édifices antérieurs. La travée centrale, couronnée de trois coupoles à trompe est veillée par un Christ byzantin. Le pavement en mosaïque de marbre polychrome est aussi du 12° siècle. L’ensemble donne l’impression d’être à l’intérieur d’un gâteau de sel.
« Je veux de l’inutile, du majestueux, je veux des bustes en marbre sur des façades lépreuses », c’est le cri que lance l’héroïne du roman de Edmonde Charles-Roux dans « Oublier Palerme ». C’est exactement ce qui jaillit en glissant de la Place Bellini à la Place Pretoria où se dresse un bassin d’eau qui s’organise tout autour d’un défilé circulaire de divinités Renaissance dans un magnifique équilibre des balustrades, des gradins et des jets d’eau, avec en fond de décor la lèpre écaillée des pierres délavées dans leur ocre. Comme un cœur symbolique de la Sicile. En une seule image. En perspective, l’Eglise Santa Caterina.
Nous remontons loin l’Avenue Vittorio Emmanuele, jusqu’à un jardin qui débouche sur la Cathédrale. L’extérieur vaut surtout pour son chevet semblable à celui que nous verrons à Monreale. Puis, au-delà du jardin, dans un quartier où l’ombre des ruelles révèlent les signes, contrastant avec la majesté des édifices voisins, de pauvreté et d’extrême négligé. C’est à l’angle de ce périmètre qu’apparaît la façade de San Giuseppe Cafasso, et dans le prolongement, l’Eglise de San Giovanni degli Erimiti.
C’est un havre de paix, qu’aujourd’hui du moins, on ne peut qu’imaginer. Envahi par des hordes d’adolescents oeuvrant pour l’UNICEF, il nous faudra revenir pour sentir ce miracle d’oasis encerclé par les quartiers lépreux tout autour. C’est une parenthèse de fraîcheur à deux pas du Palais Normands qu’on peut apercevoir à l’entrée du jardin.
Palmiers, agaves, bougainvilliers, figuiers de barbarie et orangers déclinent une harmonie à la fois sauvage et irréellement hors du temps. De l’ancienne abbaye subsistent la nef surmontée de trois coupoles à bulbe rouge et le petit cloître à colonnettes géminées qu’enserrent parfois des lianes échevelées de végétation. C’est le miraculeux mariage de la plus harmonieuse luxuriance végétale et de la sobriété rythmiques de l’architecture.
Derrière l’église nous prenons le premier verre de vin de Sicile à l’ombre des arbres.
Quelques maigres forces nous restent pour gravir l’étage du Palazzo dei Normanni où est la Capelle Palatine.
Edifiée par Roger II au 12° siècle, l’ensemble vaut pour les extraordinaires mosaïques de cette période romane, unique témoignage de cet art à ce haut degré de perfection.
Défilent tour à tour, dans la pénombre de la chapelle, les épisodes de la Création de la Lumière et des Eaux, la Terre qui les sépare, la Création des plantes et des arbres, des animaux, tout ce qui mène à la création de l’Homme, le Repos divin. Dieu désignant l’arbre et la Création d’Eve. L’Arche de Noë, et tout un ensemble d’épisodes concernant les prophètes, certaines scènes de la vie du Christ et de Pierre et Paul, un véritable livre d’image qu’en d’autres lieux on retrouvera dans l’art du vitrail.
Après plus de trois heures de promenades, de déambulations , nous retrouvons l’hôtel où tout respire l’espace. Dans la chambre, les couloirs immenses, les très hauts plafonds, les volumes semblent ne pas avoir eu de limites pour les architectes, dans une atmosphère qui plonge souvent dans les souvenirs du « Guépard ». D’un coin de la fenêtre de la chambre, on peut apercevoir le fronton d’une église déjà éclairée pour la nuit.
Sur la terrasse au septième étage, aucune vue ne peut rivaliser avec la notre. Toute la ville défile aux rythmes des clochers, des pinacles, des dômes et des coupoles, des frontons qui apparaissent comme si la ville désirait se hisser vers le ciel, non pas comme dans les villes à gratte-ciel, mais par la verticalité des édifices d’esprit se signalant comme autant de points de repères au-dessus des maisons d’habitations. C’est toute la féerie de la nuit qui descend sur Palerme. Nous dînons dans la sérénité et la douce fatigue dans une trattoria à quelque pas de là, au « Proverbio » sur une traverse entre Via Roma et la Place Bellini.
Samedi 21 Avril
Depuis la terrasse encore, mais cette fois, pour le petit déjeuner, dans l’éblouissante lumière de huit heures du matin, le relief ocre et jaune de Palerme apparaît sur tout l’horizon qui s’offre à nous.
Par le bus 102, nous parvenons, après un parcours qui semble interminable, dans des quartiers populaires et parfois inhospitaliers, à l’Europcar pour la location d’un véhicule qui nous mènera par tout le pays.
Cap au Sud, quittant la poudreuse Palerme, la route s’élève insensiblement, traversant des villages animés jusqu’à Monreale, sur la conque d’or, de la couleur des oranges et des citrons cultivés dans cette vallée depuis l’Antiquité. Nous ne ferons qu’apercevoir les lointains de Palerme au travers d’une brume matinale de chaleur. Depuis l’entrée du village, le chevet nous signale dans toute sa lumière, la présence de l’immense vaisseau. Au pied des chevets, nous prenons conscience de la hauteur de l’édifice, d’autant que ceux-ci donnent directement sur un passage dans les ruelles adjacentes, toutes de tortuosités, avec leurs balcons étroits, les ferronneries aux vêtements qui pendent, aux cactus grimpant, aux fleurs sanguines, et aux façades bariolées et délavées par le temps. L’orgueil à plein ciel sur les terrasses dominant Palerme. La facture des chevets, comme à la Cathédrale de Palerme, est franchement arabe. La décoration se compose de trois ordres d’arcatures aveugles ogivales entrecroisées et soutenues par de fines colonnes placés sur de hauts socles. L’entrée dans la cathédrale se fait sur le flanc gauche, par une porte en bronze de Barisano da Trani.
Puis c’est l’éblouissement. Ce qui faisait la grâce et la musique de chambre de la Chapelle Palatine, fait place à la symphonie avec chœur… On peut dire que Guillaume II a atteint son objectif de faire de sa cathédrale une des plus belles de la chrétienté. Une fois la stupeur passée, on comprend que cette sensation est due autant aux mosaïques qui couvrent d’or et de couleurs la presque totalité des murs, le bleu et l’or se dégageant nettement, qu’à la perfection des proportions de l’architecture intérieure.
Décrire l’ensemble du livre de merveilles imprimées sur ces surfaces de mosaïques serait fastidieux et impossible. Comme à la Chapelle Palatine, c’est au flanc droit de l’édifice la Création qui domine. Création des eaux, de la lumière en présence des sept anges. Création de la lune, du soleil, des étoiles, des oiseaux et des poissons, jusqu’à conclure avec la création de l’Homme. Puis Noé, Abraham…
En façade, nous pénétrons dans une humanité déjà en proie aux violences et aux châtiments. Elles ne sont pas directement inspirées de l’Ancien Testament mais des saints protecteurs de Monreale, Cassius, Casto et Castense.
Au flanc gauche de l’édifice, C’est Eve et la Tentation, le thème de la Chute. Caïn et Abel, la naissance de la conscience, puis Noë encore et la construction de l’Arche. Après mille autres détails inscrits dans des myriades de couleurs , l’Histoire s’achève par la lutte de Jacob avec l’Ange.
Au chevet, dominant l’ensemble de tous ces mouvements d’esprit, le Christ Pantocrator.
Côté cloître, quatre vingt quatorze colonnettes géminées, ornées de dessins géométriques en mosaïque supportent de très beaux chapiteaux historiés dans la plus pure tradition romanes sur lesquels s’ordonne une suite d’arcades ogivales. En cette fin avril, c’est le bassin qui apporte la note d’intimité tintinnabulante, et la fraîcheur d’un peu plus d’ombre.
La Place Guillaume II est large et lumineuse, elle est le vrai cœur du village, comme une étoile en son centre, d’où jailliraient de multiples ruelles débouchant sur un probable bonheur, avec les carrioles de couleurs et le petit âne traditionnel. Et sur toute la place s’exposent éblouissantes, au presque midi, les céramiques des magasins de souvenirs.
Les paysages siciliens appartiennent à deux types bien différents, selon les régions traversées. Le plus répandu concerne les zones agricoles de l’olive et de l’orange. L’olivier, par rapport à la sveltesse de nos arbres de Provence, paraît, comme le Sicilien, court et trapu. Probablement pour plus de confort lors de la cueillette. Les orangers couvrent des espaces immenses avec une densité exceptionnelle, souvent en pente douce, parfois sur de larges plaines jusqu’à se perdre à l’horizon.
L’autre type de paysage est souvent un paysage de l’intérieur du pays, et notamment celui qui mène de Agrigento à Piazza Armerina. Sur de vaste espaces s’étendent les verts drus des herbes hautes, en cette saison, parsemés soit de myriades de parterres de fleurs jaunes, composant de miraculeux tableaux, soit d’infinis mauves ou roses, dans un cadre de mamelons harmonieux, mais aussi avec des sommets plus pentus où il n’est pas rare de voir s’y accrocher des villages aux maisons serrées les unes contre les autres donnant toute leur tonalité d’ocre brun contrastant avec les riants espaces vierges alentour.
Aujourd’hui, après le souffle d’esprit de Monreale, c’est la journée des quatre S. Ségeste, Salemi, Selinonte et Sciacca. La Sicile phénicienne.
Donc, plus encore vers le Sud. Une route torturée qui n’est pas aussi repérable que la sortie de Palerme vers Monreale. Des déviations, des croisements de routes pourraient nous faire perdre le chemin de Ségeste. Corleone est à quelques kilomètres à l’Est, Trapani et Erice, à la pointe extrême du Nord Ouest. Ségeste est au bout de nulle part à l’intérieur des terres. On aperçoit de loin le temple, comme une tache brune sur son socle d’éternité, dans l’isolement, comme un dormeur du val, troué de toutes les balafres du temps. Pour y accéder, il faut grimper une forte allée de hautes marches qui sépare de part et d’autre les hautes herbes d’avril. Celles-ci arrivent en cette saison, à hauteur de nos hanches.
Le temple est un élégant édifice dorique. Ce qui semble paradoxal, le style dorique étant en soi une émanation de pure abstraction architecturale, sans décor ni surcharge, le classicisme ionien son élégant prolongement, avant la plus échevelée fin corinthienne. C’est la première fois que je suis aux pieds d’un temple grec. Ma première impression est qu’il est bien plus élevé que je ne le pensais. Pour ceinturer un seul des fûts qui le composent, comme pour certains arbres géants, il faudrait sept ou huit personnes. La pierre laisse entrevoir les marques de l’usure, les trouées qui creusent, et bien d’autres souffrances.
Le péristyle a conservé presque entièrement intactes ses trente six colonnes non cannelées dans un magnifique calcaire au ton doré.
Et celui-ci présente des proportions et une rare harmonie, rehaussée de cette nature d’avril aux herbes d’un vert soutenu et dru, aux marguerites jaunes par millions, comme autant d’étoiles éclairant et habillant l’édifice tout alentour, de bruyères et de fenouils sauvages, de fleurs mauves et bleues, de nuages effilochés dans l’azur des lointains, en attendant les coquelicots de Mai.
Cecilia et moi éternisons l’instant photographique dans la plus odorante émanation du bonheur ou de l’idée qu’on peut en avoir quand elle sait se matérialiser dans un décor fait de tous les éléments d’un paradis terrestre.
Le temps se couvre et menace durant le trajet qui mène à Salemi. Le village n’est pas vraiment sur le chemin de Selinonte, mais je ne pouvais éviter ce détour menant aux ancêtres. Le ciel était gris, la lumière enchanteresse du plateau de Ségeste nous avait quittés, mais j’ai pu poser quelques instants devant la dernière plaque bleue juste avant l’arrivée, indiquant en caractère blanc, le nom du village qui est aussi celui que portait le Nonno.
Nous contemplons de loin, la masse brune, condensée et serrée, de ce qui dut être le lieu d’origine du premier de la lignée du même nom. Le nom antique de Salemi serait celui de l’ancienne ville de Elima Halyciae (comme une inversion phonétique !).
En son temps, dans les années soixante dix, Angela m’avait précédé dans ce geste symbolique.
A mesure que nous approchons de Selinonte, la lumière déjà déclinante de l’après-midi se fait de plus en plus rayonnante et franche. Ce site ne pouvait évidemment mériter d’être contemplé que sous l’éclat de sa force civilisatrice et le goût du sel.
Les Grecs ne s’y sont pas trompés quand ils ont choisi l’emplacement où ils édifièrent Selinonte. Trois collines au dessus de la mer, séparées par deux petites rivières dont les estuaires constituaient des ports naturels. De longues plages de sable et au fond, l’Afrique.
Une longue avenue pavée bordée de pins, petite voie Appia ( !), nous mène vers les temples orientaux. Le premier consacré à Héra, le second, le plus petit, à Athéna, et le troisième, le plus imposant, sans doute dédié à Apollon. Ce qui frappe sur ces lieux de ruines, c’est l’intemporalité fixatrice de trois éléments se conjuguant. La pierre, l’azur (mallarméen !) et la proximité immédiate de la mer.
Les longues ombres commencent à absorber le feu de la pierre sanguine. Nous parcourons les périmètres des temples sur leurs espaces intérieurs où les ombres géantes et le feu nous pénètrent tour à tour suivant l’angle où nous nous trouvons.
Rivale de Ségeste, Selinonte l’est aussi dans son environnement. Ici tout est Méditerranée, rocaille coupante sous les pieds, sécheresse des végétaux comme une rigueur et un dépouillement de la pensée.
Pour parvenir à l’Acropole, distante de plus d’un kilomètre de pierres vives, nous saisissons au passage le petit train électrique. C’est la ruine la plus émouvante, et la plus proche du rivage qu’on pourrait presque entendre si le vent en ramenait l’écho.
Ne restent dressées là que quelques enfilades de piliers, avec en premiers plans, des fûts éparpillés et suivant l’angle de vue, un coin de mer. Plus près encore du rivage, en se penchant aux confins abrupt du site, on peut voir le résumé sicilien de la végétation. Les figuiers de barbarie, les cactus grimpants, les odeurs du thym, quelques oliviers et les orangers à sanguines.
Ce qui est toujours là depuis 2 500 ans et depuis le début du monde, c’est l’immensité de la mer, le parfum du céleri sauvage qui a donné le nom à la ville et le bruit des vagues qui viennent inlassablement mourir sur la plage.
Pour le décor, un tombeau antique, un citronnier défiant l’horizon. Luxe, calme et volupté…
Après que la peau, déjà rougie par le sel et le soleil, ait retrouvée un peu de fraîcheur en longeant la marine silencieuse à cette heure, nous poursuivons sur le littoral, pour la seconde étape du périple, Sciacca, le dernier S du jour.
Ce n’est pas la plus belle ville que nous ayons choisi pour le repos de cette seconde journée, mais Sciacca est un immense balcon sur la mer et nous permet d’avancer un peu plus sur la route des temples. La ville se présente comme un dégradé progressif de maisons descendant par des escaliers tortueux qui mènent au port et au long embarcadère, qui vus de la Place Scandaliato, immense promenade dégagée et cœur de la cité, offre un espace ouvert sur le grand large.
Nous logerons chez Fazio (B and B) dans une ruelle où les véhicules ont du mal à passer, et nous flânons à l’heure du verre de vin dans la vieille ville égayée en cette fin de semaine.
Dimanche 22 Avril
La lumière matinale de ce dimanche à peine éveillé est idéale une fois sur les quais. Toute la ville d’ocre est exposée, dans les plus infimes nuances de jaune, jaune orangé, mais aussi pour densifier le tableau, de bleus tranchants, de mauves, de verts pâles et de quelques trouées de maisons blanches. L’ensemble paraissant cousu comme un puzzle safrané d’intensités de couleurs vibrantes et comme autant de fragments de mosaïques qui trouvent aussi leur double reflété dans le bassin du port. C’est toute la ville vieille et craquelée au pied de l’eau qui chante le chant de départ des « pescherecci » bleus et blancs amarrés tout au long du quai. C’est aussi la ville des céramiques, et certaines ornent de leurs couleurs vives les marches d’escaliers. Le calme du matin n’est troublé que par les premiers bistros portuaires où les quelques éclats du matin augurent d’un dimanche limpide qui va se lever.
Une course cycliste vient perturber la belle route qui trace vers l’Est. Ce sont des hordes de compétiteurs qui nous croisent en sens inverse, se doublant parfois en troisième ou quatrième épaisseur sur toute la largeur, de peur d’avoir à céder un pouce à l’adversaire, au risque de percuter ce qui vient en face. Une nuée de sauterelles n’aurait pas été plus inquiétante…
Puis ce sont les abords d’Agrigento que nous atteignons vers le milieu de la matinée, et la fameuse « Scala dei Turchi » sur un bord de mer radieux, au sable blanc et aux fortes odeurs d’algues comme autant de chevelures vertes. Nous marchons le long des rochers et des poches d’eau comme je le faisais il y a si longtemps de l’autre côté de la Méditerranée où le sel semble s’imprimer sur la peau tant la densité en est forte. Tout au bout de la plage, après les maisons et les cabanons d’été, apparaît, blanche comme un sucre monumental ou une saline, la fameuse Echelle des Turcs. Echelle, parce que l’usure de cette marne littorale, mélange d’argile et de calcaire, descend en pente douce vers la mer et se transforme en un tapis lisse et aveuglant, propice aux expositions solaires ou aux promenade qui peuvent se poursuivre sur les différents étagements de marches étroites comme des couloirs ou des rides s’étalant sur plusieurs centaines de mètres.
Le bonheur de longer cette anomalie de la nature ne nous sera pas donné aujourd’hui, l’érosion ayant fait s’écrouler depuis l’hiver dernier des pans immenses de ces roches fragiles qui viennent visiblement mourir au pied de la falaise.
Ce surnom donné à cette falaise vient d’une croyance populaire selon laquelle les pirates sarrasins escaladèrent ces rochers après avoir mis à l’abri leurs bateaux dans les petites criques alentour.
Vers midi, nous prenons un délicieux vin de Trapani, à même la plage, à Majana Beach.
C’est l’heure de rejoindre la Vallée des Temples. Les fortes chaleurs ont accumulé de méchants nuages sur Agrigento. La ville qui se profilera tout au long de notre passage dans le site archéologique, gardera, face à nous, ce côté abrupt, compact et menaçant d’un rideau d’immeubles inhospitaliers surplombant la vallée.
« Les Akragantins construisent des maisons et des temples comme s’ils ne devaient jamais mourir et mangent comme s’ils devaient mourir demain. » On peut faire confiance aux écrits d’Empédocle, le philosophe d’Akragas, qui connaissait bien ses concitoyens.
Pendant presque quatre siècle, les Grecs en ont fait « la plus belle cité des mortels » Pindare.
Le gris du ciel a remplacé le riant lever du jour de Sciacca. Le premier temple, celui de Junon, d’où commence l’Agora inférieure, surgit d’un amas de cactus et de figuiers et dresse ses colonne très haut dans le ciel blanc. La pierre en paraît par contraste tourner au carmin et à un noir pain d’épice. Les colonnes doriques sont à nu. On notera l’orientation à l’Est de tous les temples, qui correspond à un critère classique selon lequel l’entrée de la cella (chambre où était placée la statue de la divinité), devait être saluée et éclairée par les premiers rayons du soleil.
Plus loin sur la Via Sacra, le temple de la Concorde, le mieux conservé, où les colonnes s’amincissent vers le haut pour que l’ensemble paraisse plus élevé et plus élancé. La lumière du plein après-midi est électrique, ce qui rehausse sur le flanc droit, la statue colossale d’Icare tombé, en diagonale, menant en perspective au pied du temple. Magnifique union de la pierre et du bronze vert de gris. C’est une œuvre contemporaine offerte à la Vallée des Temples, par l’artiste franco-polonais, Igor Mitoraj. C’est là aussi que se concentrent le plus les groupes de visiteurs.
Le temple d’Hercule, de style archaïque dorique, est vraisemblablement le plus ancien du site (6°a. J.C.). Ses colonnes, redressées au début du XX° siècle, permettent d’imaginer, malgré l’état de leur dégradation, l’élégance qui dut être le sien.
La tradition veut que le temple des Dioscures (Castor et Pollux), solitaire, devenu le symbole d’Agrigento, soit appelé ainsi temple des dioscures, des faux jumeaux nés par superfétation, de l’union la même nuit, de Léda avec Zeus, métamorphosée en cygne pour le séduire, puis avec son époux légitime, Tyndare.
Il ne reste là que quatre colonnes. On voit plus à droite, les vestiges dédiés aux divinités souterraines : Perséphone, Démeter. La Via Sacra est remontée en sens inverse, hérissée de petits galets qui endolorissent les pieds. Les nuages sont maintenant menaçant quand nous sortons d’Agrigento. Et la route qui mène vers Piazza Armerina semée de difficultés.
Le voyage aurait pu s’arrêter quelque part sur cette route quand le véhicule est tombé dans une ornière, ou plutôt une sorte de tranchée profonde qui fit basculer et plonger tout le train avant de la voiture. Ce fut un petit miracle que la tôle n’ait pas été endommagée, nous immobilisant sur cette portion de route qui, en France, aurait nécessairement été fermée à la circulation… Pour plus de frayeur encore, une partie de l’essuie-glace s’est envolée sur une portion d’autoroute au plus fort de l’orage.
Piazza Armerina est aperçue de loin, austère, sombre sur son piton rocheux et sous les derniers nuages qui découvrent un pavé luisant. Il fait une fraîcheur de début Mars en moyenne montagne. Sur le bord des trottoirs on relève quelques traces salies de neige récente. La petite ville ressemble à un village fantôme avec ses ruelles aux maisons décaties, aux pierres noircies et aux volets clos. Comme dans tout village de montagne, des petits jardins rendent l’austérité des lieux plus souriante quand le soleil reparaît, rendant toutes ses couleurs à la façade de l’église sur la grande place, point le plus élevé de Piazza Armerina. Le nom de cette ville lui a été donné parce qu’elle fut la « Place d’Armes » de Roger de Hauteville lorsqu’il conquit la Sicile.
Certaines placettes et angles de rues, aux maisons enguirlandées de lilas et de glycine, feraient presque penser à des rues de Montmartre.
Nous nous engouffrons dans un des rares bistros ouvert ce dimanche, « le Café des Amis » où nous sommes adorablement reçus comme des pèlerins attendus depuis longtemps. Rentrant au B and B à la nuit tombée tôt, les ruelles fantomatiques, rendent une lumière humide sur toutes les pierres, donnant plus encore envie de savoir ce qui se cache de vivant derrière chaque fenêtre close.
Lundi 23 Avril
C’est un endroit unique au monde , même dans Rome ou ailleurs, par la profusion et la richesse de son trésor de mosaïques. La Villa Romana del Casale. A quelque cinq minutes de la ville, enfin éveillée sous le soleil revenu, éblouissant dans sa lumière rase.
La villa romaine représente l’extrême synthèse des trésors de la Capitale du Bas-Empire. A la complexité et à la beauté de l’ensemble architectonique contribuent les magnifiques mosaïques réalisées par les ancêtres des artistes de l’école Palatine et de Monreale.
Nous sommes arrivés dès l’ouverture, et jamais nous n’aurons eu à subir le désagrément des hordes de visiteurs bruyants, turbulents et inconscients du minimum de respect que requiert ce genre de visite. C’est comme le dévoilement progressif d’un secret ou une intrusion dans un lieu privé qui nous sont accordés durant la petite heure de notre passage. C’est la vie quotidienne de l’ancienne Rome, vibrante, turbulente comme un marché découvert, qui est inscrite dans les mouvements libres des compositions de mosaïques. C’est le cortège débridé qui mélange les scènes mythologiques des métamorphoses de Daphné, d’Arion jouant de la lyre, de l’inquiétant Polyphème cyclope, des représentations de Pan et d’Eros, des Néréides, de la Glorification d’Hercule, mais aussi d’un bestiaires familiers et parfois mis en scène avec un sens de l’humour et un naturel qui ne cherche plus à édifier mais à émouvoir et témoigner comme un cliché photographique, par la simplicité des mouvement et la théâtralisation des sujets représentés. Et puis entre les dieux mythologiques et le monde animal, les paons, les dromadaires, les tigres, les éléphants, les autruches, les taureaux et les lions, les scènes merveilleusement composées de la vie humaine de tous les jours, d’un roi pensif et attristé, le magnifique Maximilien, propriétaire de la villa, avec ses gardes du corps, le soldat contrôlant le transport des animaux capturés, la capture d’un caneton, d’un coq attaquant un enfant, la cueillette des roses et le tressage des guirlandes par des servantes, de jeunes filles tressant des couronnes, d’un petit char entraîné par un couple de flamands, jusqu’à l’extrême et émouvante simplicité de la scène des dix jeunes filles en bikini jouant à la balle.
Nous avions abordé hier ces espaces verdoyants, dépouillés de petite montagne que l’on retrouvent descendant maintenant sous le soleil, vers Catania, sur la route de Syracuse. Par une boucle menant au Nord, nous effleurerons Catania, à peine vue de loin, et nous longerons sous bien des facettes différentes le pied de l’Etna soudain apparu à l’horizon, enneigé et soufflant ses vapeurs dans l’azur que l’on confondrait avec les nuages, si à ce moment-là il y en avait eu.
Autant Piazza Armerina était une sorte de vénérable vieille dame, perdue dans les pensées enfouies et immobiles des terres intérieures du pays, dans toute la noblesse et la pudeur de ce qui ne s’exprime que du dedans, autant Syracuse et la péninsule en amande d’Ortigia apparaissent nourries de leur propre renouvellement, dans la blancheur de la cathédrale Sainte Lucie, la Place principale lissée de terrasses de café, de parasols, avec en contrepoint spatial, la merveilleuse façade de Santa Lucia alla Badia où est un magnifique enterrement de Sainte Lucie de Caravage (que nous ne verrons pas), tout un concentré en un même lieu de la fière Syracuse.
Dès l’arrivée dans la presqu’île enceinte de murailles et s’isolant de la Syracuse plus anonyme, il y a un petit air partagé entre Venise et les villes de tourisme de la Toscane. C’est le côté chic de cette ville baroque, de son pouvoir attractif facile, de son littoral ionien, loin du rugueux maritime rencontré vers Agrigento. C’est la Sicile côté vitrine comme doivent l’être les luxueuses terrasses naturelles de Taormina et son paysage de carte postale depuis le théâtre antique trouant en perspective, la mer et la majesté de l’Etna.
Nous déjeunons de poissons du jour à l’ombre fraîche d’une petite ruelle à escaliers et logeons B and B près d’un des ponts qui séparent Ortigia de la Syracuse plus moderne.
Pas une maison qui ne possède de moulures larges et torsadées à l’ionienne sous les balcons, et pas de balcons sans fleurs et sans plantes velues sur les façades d’ocre ou de gris décati.
Les ruelles centrales débouchant souvent sur le bleu de la mer paraissent parfois venues de Cartagena de India.
Et près du pont donnant sur notre hôtel, au soleil couchant, brille de tout son ocre carmin une façade particulièrement remarquable, aux fenêtres gothiques, ce qui lui donne, avec ses petits vaporettos au pied du canal à reflets gris à cette heure, un air certain de Venise.
Syracuse, Siracusa, comme on veut, est un phénomène qui doit beaucoup à l’idée qu’on se fait d’un certain idéal désuet et conformiste de vacance (jusqu’à la nostalgique et sensuelle chanson d’Henri Salvador « J’aimerais tant voir Syracuse »), où rien ne manque à l’accueil et l’attente du visiteur, à la poétique légèrement désenchantée, encadrée de la justesse architecturale, du baroque déjà européen, et des déambulations sur des avenues où les terrasses sans surprise tout le long des remparts laissent malgré tout une impression de déjà vu.
Sur une des délicieuses terrasses près du pont séparant l’enceinte d’Ortigia, nous dînons des meilleures pâtes aux clovisses jamais mangées.
Nous avons posé, en ces quelques jours, nos bonheurs et notre fatigue, entre Mar Tirreno, Mar Mediterraneo et Mar Ionio !
Mardi 24 Avril
Très tôt, encore le soleil sur Syracuse, quittant Ortigia vers le Nord de la ville, pour un passage à la Basilique de San Giovanni Evangelista. Colorée en ocre, ou plutôt badigeonnée, elle ressemble à une église mexicaine en carton dans un décor de cinéma. Probablement pour qu’elle se fonde aux couleurs à l’identique des immeubles qui l’enserrent. C’est l’exemple même du contresens d’un replâtrage hâtif et bâclé comme peuvent l’être les vraies trahisons. Cela donne d’autant plus de regret que son architecture, baroque nouveau monde, méritait mieux. Elle devait être bien plus belle dans sa matière patinée et dans les craquelures de ses robes grises de vieillesse.
C’est la plus longue étape aujourd’hui. Elle nous mènera à nouveau sur la côte Nord.
Les paysages encore, alternent entre les tapis verts parsemées de fleurs jaunes, certains de parterres mauves comme coulées versées sur le flanc des montagnes, en pentes douces, et les champs d’oliviers aux troncs courts et à quelques vergers d’agrumes assez rares aujourd’hui. Sur la route tout en lacets, de magnifiques villages trapus apparaissent dans les lointains, souvent aux sommets de pitons rocheux. Nous faisons, dans ce cadre de Sicile centrale, connaissance avec un petit âne peu farouche, qui confirme que nous sommes bien au cœur même du pays.
Et puis c’est l’arrivée à Cefalu. Vers treize heures. De loin déjà, l’anse de la ville dominée par les deux tours de l’église, et la compacité brune des maisons tissées les unes contre les autres sur une belle largeur littorale, en font un écrin harmonieux les pieds dans l’eau. Puisque nous en sommes au jeu des analogies, je dirais que Cefalu, vue de loin, a des allures de saint Tropez, peut-être par la couleur des pierres, de Saint Raphaël. En tous cas de quelque chose de varois !
L’élégance des constructions laisse supposer qu’il s’agit d’une cité balnéaire, aux maisons basses où l’absence des verrues architecturales marque un art de vivre certain. Tout respire l’envie immédiat d’y séjourner, voire d’y vivre. Les palmiers penchés, les lierres aux murs, les figuiers de barbarie et les bougainvilliers dessinent les robes végétales qui enserrent les ruelles près de la vieille ville. Nous logerons pour deux nuits dans une sorte de lotissement harmonieux, avec une petite terrasse pour le soir, à l’écart de tout trouble, à deux pas de la promenade littorale et au début des plages qui s’étendent jusque très loin hors de la ville.
La lumière du début d’après-midi est idéale à dessiner l’écran de maisons de pêcheurs qu’on peut admirer le mieux depuis le petit promontoire perpendiculaire au rivage. C’est une des vues en angle les plus emblématiques de toute la Sicile, avec au premier plan, les barques de pêcheurs qui donnent une perspective où rien n’a jamais changé de ces vieilles maisons d’écailles et de couleurs, les pieds dans le sable, que rien ne sépare plus de la mer. Nous goûtons le vin à la terrasse du Ristorante Siciliano, tout en haut d’une des multiples ruelles parallèles qui débouchent toutes sur la Via Ruggero, la plus large et la plus animée du vieux Cefalu.
Au centre de cette rue principale, large et fortement animée, c’est la Place de la Cathédrale. Dont la façade est la plus belle de style normand de toute la Sicile. Elle a été construite par Roger II, à la suite d’un vœu qu’il aurait fait après avoir failli faire naufrage lors de son retour à Naples. Le style normand est ici bien plus évident qu’à Palerme. L’impression de majesté est d’autant plus grande que c’est par une large série de marches que l’on accède à l’entrée principale d’où l’édifice domine la ville depuis son promontoire. La lumière est d’une belle intensité sur la façade occidentale rendant toute la force de ses ocres orangés. A l’intérieur, dans le chœur, les mosaïques sur fond d’or déploient des couleurs vives dont un émeraude qu’on ne rencontre nulle part ailleurs. Un immense Christ Pantocrator domine la partie haute de la conque abbatiale. Une main levée en forme de bénédiction, il tient de l’autre le texte sacré, écrit en grec, de l’Evangile de Jean, « Je suis la Lumière ». Le cloître, peut-être un peu trop hardiment restauré, présente des chapiteaux de même style que ceux de Monreale.
Nous sillonnons les multiples ruelles pavées, avec sur nos têtes, dominant de toute sa hauteur l’ensemble de la cité, l’immense Rocca qui paraît menacer de se jeter sur la ville.
Après avoir dîner au même Ristorante Siciliano à l’intérieur d’un petit patio à l’écart de toute nuisance, nous retournons, la nuit complètement tombée, sur la petite jetée donnant sur les barques échouées et les vieilles maisons. Les quelques lumières déjà allumées sur l’écran du bord de mer donnent toute la féerie discrète de Cefalu.
Mercredi 25 Avril
Comme nous n’avons pas de route à faire, le lever se fera un peu plus tard. Nous nous risquons à quelque grimpette vers le chemin menant à La Rocca. Sur les rues du haut de la vieille ville, une étrange animation se fait sentir, avec maintenant des chants vibrants et des danses où se rejoignent au pied d’une église ce qui ressemble à des pèlerins en fête. Des enfants et des religieuses entonnent des louanges entourant des ecclésiastiques dont le plus haut dignitaire n’est autre que l’évêque de Cefalu. C’est la fête de la Terre qui se confond aujourd’hui avec celle de la Libération… de 1945. L’Italie a donc elle aussi été libérée… Bientôt un cortège se forme et se met à défiler sur la Via Ruggero, évêque en tête.
Ce matin l’escalier en fer à cheval et la façade baroque de l’église San Stefano du Purgatoire reçoivent une lumière perlée qui rend vibrant tous les végétaux qui mangent l’entrée de l’église.
Des magasins de lingeries créoles et d’objets émeraudes viennent ajouter leurs notes de folies colorées dans les ruelles chauffées par la fête.
Du plus haut que nos forces nous l’ont permis, il n’était possible de grimper plus haut la Rocca que jusqu’au point de vue d’où nous apercevrons une Montgolfière au sol, dépassant les toits de la ville et destinée à se manifester dans l’après-midi.
La Cathédrale reçoit la lumière qui éclaire maintenant le chevet et les deux tours par l’Est. Nous prenons vers midi un verre dans la rue principale où l’animation est incomparablement plus effervescente que la veille. Une petite camionnette semble servir de décor comme petit marché ambulant qui irise de la couleur des fruits, de toutes les sanguines, des tomates et de tous les produits du pays, les ruelles écaillées sous le soleil.
La Sicile, c’est l’anti Amsterdam. On se cache autant du soleil que de ses voisins. Et on s’y cache d’autant par de long rideaux bariolés sur les balcons que le voisinage d’en face pourrait, suivant la largeur des rues, et si ce n’était la pudeur et le goût de l’ombre sur les choses de la vie, enjamber chez vous sans efforts.
La petite jetée a aujourd’hui beaucoup moins d’attrait, toute envahie par les touristes venus d’abondance en ce jour particulier. Malgré tout, les barques, les filets de pêche et le calme éblouissant de ce rivage demeurent un lieu qui ne laisse pas d’attirer, jusqu’à certaines poseuses discrètes, de quelque quinze seize ans, se prenant à jouer à Cinecittà.
La plus belle surprise viendra, non pas du petit restaurant, d’une rue à la fois proche de la Cathédrale et isolée des trop attrayantes terrasses, mais du petit concert donné par deux artistes, chanteurs de rue.
La voix d’abord, la tarentelle, la voix forte et venue de bien loin, celle, chaleureuse et fraternelle que j’aurais pu entendre enfant, venant d’une grande sœur. Tambourin ou guitare d’accompagnement, la chanteuse est jeune , vingt cinq ans peut-être, le jeune homme lui donne le contrechant. Se succède tout un répertoire de chants traditionnels sous le soleil. Les larmes viennent comme un léger voile.
C’est le deuxième et dernier après-midi à Cefalu, côté plage. La promenade littorale est noyée de monde comme en plein été.
Les baigneurs sont nombreux, la montgolfière, prévue pour les festivités du jour ne partira pas. Dans l’anse qui caresse la ville le long de la plage, les deux tours de la Cathédrale apparaissent, dominant celle-ci sous l’impérieuse Rocca, elle même dominant l’ensemble.
Revenus sur la petite jetée, la lumière est maintenant mate. Les murs des maisons de pêcheurs décaties se voilent à la lumière du crépuscule. Les joues de Cécilia paraissent rougies autant par la saturation de cette lumière déclinante que d’avoir été exposées à la réverbération du sable de l’après-midi.
Puis, venant dans l’autre sens, depuis la via Ruggero, par une trouée de mur voûté donnant sur la plage, la lumière, posée sur les quelques silhouettes à contre jour, paraît composer un tableau de Rembrandt. Le long des murailles percées regardant la mer, le crépuscule jaune attire les derniers promeneurs de ce jour de fête.
Je sais qu’au retour d’un séjour on ne retient que le meilleur. On oublie tout des fatigues du corps, les meurtrissures des pieds et les douleurs de l’attente, les anxiétés du manque qui nous priveraient de nos attentes, mais souvent, et c’est le cas aujourd’hui, il reste ce bonheur d’avoir partagé ces privilèges qu’on peut lire indélébilement dans les yeux de celle avec qui on les a partagé.
La nuit est tombé. Nous dînons dans une trattoria de vraie cuisine sicilienne et sommes gratifiés, sans l’avoir voulu ni cherché, d’un second récital de tarentelles donné par Maria Sun et son compagnon. Après bien des adieux nous jurons de nous revoir. La nuit se fait douce sur Cefalu.
Jeudi 26 Avril
A l’heure des premiers joggers, nous sommes sur la route de Palerme. Nous y serons vers neuf heure trente. Le ciel est légèrement voilé quand nous posons le véhicule à deux pas de Saint Jean des Ermites dont le clocher est cette fois dans son meilleur éclairage. Les bulbes rouges y sont presque brillants et la luxuriance des végétaux plus grasse et comme saturée. Les adolescents de vendredi dernier ont laissé le cloître dans un silence matinal qui laisserait presque croire qu’il nous est offert en contrepoint des oiseaux qui s’affairent autour des orangers et des figuiers de barbarie. Entre deux arbres fruitiers, une partie de la façade du Palais normands au loin , comme les Cloches à travers les feuilles de Debussy. Nous quittons ce petit paradis de paix pour marcher longtemps, et par la Place des quatre chants, nous parvenons au chevet de la Cathédrale. Dans sa plus belle arabesque d’ocre mat.
Cette fois nous n’attendrons pas pour pénétrer dans la Martorana, Place Bellini. Autant San Cataldo est tout de rigueur et de sobriété, autant la Martorana est saturé d’or et de couleurs. Jusqu’au vertige. L’intérieur est divisé en deux; les deux travées ajoutées au 16° siècle présentent des fresques foisonnantes réalisées par des artistes locaux au 18°. Cette profusion baroque se marie pourtant étonnamment bien avec les magnifiques mosaïques de la partie primitive de l’église de stricte iconographie byzantine. Probablement due aux talents de ceux qui ont œuvré à la Chapelle Palatine. Les murs intérieurs de la façade sont décorés de deisis (intercession) montrant Georges d’Antioche au pied de la Vierge et Roger II couronné par le Christ. Au centre de la nef principale s’ouvre une coupole ornée d’un Christ Pantocrator entouré des quatre archanges, Michel, Gabriel, Uriel et Raphaël., puis huit prophètes et dans les trompes les quatre évangélistes. Sur la voûte centrale, une merveilleuse Dormition ( on voit le médecin qui écoute le cœur de Marie pour voir si il bat encore !).
La Place Pretoria que nous traversons est aujourd’hui dans une lumière discrète et les jets d’eau semblent avoir cessé de chanter.
Nous continuons par la Via Maqueda jusqu’au Teatro Massimo, un des plus grands temples de l’art lyrique d’Europe à la belle façade triangulaire néo classique. Plus loin encore, sur une autre grande esplanade dégagée, le Teatro Politeama apparemment dédié à Giuseppe Garibaldi.
La fatigue commence à se faire sentir, les avenues sont longues et notre curiosité semble inépuisable. Peu après midi nous revenons où nous nous étions garé par le microbus qui dessert le centre historique après une traversée assez agitée.
Après le déjeuner à la bierrerie, derrière San Giovanni, il est temps de rendre le véhicule tout au fond de la ville et de revenir par le 102 à l’Hôtel Ambasciattori.
Le soleil de fin d’après-midi revient éclairer sur la même chaussée que notre l’hôtel, à quelque distance, la fameuse église baroque San Domenico toute de blanc et de jaune, sur la Place du même nom.
De là, il est aisé de s’engouffrer dans les ruelles populaires et commerçantes, noircies par le temps et la négligence. De loin on entend déjà les invectives, les phrases traînantes qui, on ne sait, combinent la teneur de chants de bistro, à la manière des Cris de Paris de Janequin, de vendeur d’oranges et de poissonniers, de vendeur de poulpes frais, et de bimbeloteries dans les vitrines saturées d’éclairage, toute une gamme de parlé aux tonalités presque codifiées par la gouaille naturelle, malicieuse et complice de ce peuple du Sud. Nous prenons le vin du dernier soir sur une placette où tous ces petits commerces s’éclairent, rendant une lumière saturée et artificielle qui accentue le théâtre de rue qui s’offre à nous.
J’achète, à l’un de ces étals, deux oranges sanguines qui seront à elles seules comme un raccourci de ce soleil et de cette matière quintessenciée de Sicile.
Plus tard encore, quand le vrai soir descend sur la rue qui s’anime, on voit toute la petite bourgeoisie palermitaine venir s’encanailler à même la rue pavée, le verre à la main, dans la même posture mondaine qu’elle aurait dans un salon, qui croise, en s’y mêlant, les étranges ballets verbaux et théâtraux des commerçants, au seuil d’une taverne saturée de sonorité.
Nous dînons comme le premier soir au « Proverbio » pour nous offrir ces derniers poissons du jour, avant un dernier salut à la place Bellini presque déserte, aux petits pompons de San Cataldo, et aux palmiers frémissants sous l’éclairage jaune, qui rendent presque fantomatique la nuit venue sur Palerme.
………………………………………………………………………………………..
28 Avril
L’Après-Midi d’un Faune n’est-il pas quelque part dans un décor de Sicile ?
…………………………………………………………………………………………
30 Avril
Il y avait quelque chose de Bacon, dès les premières images, mais en nettement plus puissant, plus classiquement abouti dans le trait, la composition plus forte et même la spiritualité et l’imaginaire. Dans ce qu’on appelle aujourd’hui l’Ecole de Leipzig, Arno Rink.
…………………………………………………………………………………………
1 Mai
Vouloir toujours une éternelle jeunesse, ce serait passer à côté de chaque profondeur, de chaque plénitude des différents âges de la vie.
…………………………………………………………………………………………
4 Mai
Hélène Carpentier, voix de soprano, magnifique, homogène, entendue dans des Debussy parfaitement maîtrisés, « Clair de lune », Ariettes Oubliées etc.
………………………………………………………………………………………..
Ce soir nous avons soufflé avec Y des bulles de savon dans le jardin. C’est peut-être pour moi l’aboutissement d’une vie de sagesse…
…
De 1524 à 1610 la ville de New-York s’appelait la Nouvelle-Angoulême. Découverte par Jean de Verrazane avec sa goélette La Dauphine, il la nomma ainsi en l’honneur de François I qui avait financé le voyage.
…
Le mot le plus long de la langue française :
CYCLOPENTANOPERHYDROPHENANTHRENE, qui veut tout simplement dire cholestérol en chimie.
…………………………………………………………………………………………
9 Mai
Pablo Guzman est là après un tour d’Europe des capitales, comme le font les sud américains, une fois au moins dans leur existence, en forme de pèlerinage aux sources… Nous passons une soirée pizza sur la terrasse. Hélène et le petit sont là aussi. On parle du bon vieux temps en Californie, de l’Université de Davis, de nos périgrènations dans l’Ouest. Dix huit ans qu’on ne se voyait. Il ressemble toujours plus à don Julio.
……………..
Pour le centenaire, Debussy est encore gâté. On redécouvre une Diane au bois en entier, pour voix et piano, une Chute de la Maison Usher, toujours aussi mal chantée, mais dans sa version laissée telle à la mort du compositeur, pour voix solistes et piano. Dieu qu’il a fait bon regarder ! rare enregistrement d’un chœur que nous chantions il y a trente ans cinq ans… et puis encore plus surprenant, les transcriptions de la seconde symphonie de Saint-Saëns, une adaptation de son Etienne Marcel et enfin Khamma et Jeux, par Armengaud et Chauzu.
………………………………………………………………………………………..
Ce vendredi qui suit l’Ascension nous partons avec Pablo et sa nouvelle épouse pour une virée en Provence.
……………
11/13 Mai
Passage à Uzès, puis Nîmes et Arles. En plein cœur de la ville romaine, proche de Sainte Trophime, une rue pourrait rivaliser dans la poétique des noms de rues parisiennes : Ancienne rue de la Convalescence des Hommes. Puis l’Isle sur Sorgue. Toujours les Névons, les canaux à l’eau transparente, la tombée de la nuit. Les américains sont sous le charme.
Pour la première fois, c’est sous une pluie glacée et des nuages très bas que Fontaine de Vaucluse et la Sorgue ont donné leur meilleur émeraude.
Les Carrières de lumières présentaient Picasso et les maîtres de la peinture espagnole. Jamais Picasso ne m’a paru si grand.
Nous avons visité le cœur du vieil Avignon sous un grand soleil qui inondait les multiples terrasses sur ce cours qui s’achève par le Théâtre municipal gardé par deux vieux sphinx, encadrant les marches qui mènent à l’entrée, les sculptures de Molière et Corneille dans leur fauteuil d’aisance.
…………………………………………………………………………………………
20 mai
Henri m’appelle. C’est lui qui fait enfin l’effort. Comme un au secours. On a convenu que c’est lui qui décidera d’un rendez-vous et d’une promenade salutaire.
………………………………………
Le livre de Denis Chollet est sorti. Nice, le roman des bars du temps jadis. Bernard qui en a commencé la lecture me dit qu’il considère cette périgrènation dans le temps et l’espace des bars, comme le récit de l’adolescence de l’auteur, teinté d’une vision sociologique des quartiers et des mentalités différentes (selon que le zizag se fait d’Ouest en Est de la ville) aujourd’hui disparus. Je pense qu’il s’agit plutôt d’une enquête en forme d’étapes successives de ces lieux de vie qui se sont métamorphosés comme nous changeons nous-mêmes insensiblement, mais que la véritable histoire de notre adolescence ne peut se décrire que dans les lieux réellement et assidûment fréquentés.
J’aurais aimé trouver dans son livre la vraie raison de la disparition, programmée par décision, ou par mort par abandon, de ces bistros qui ont eu un passé, une patine inscrite dans les ombres portées sur les murs, les tables et les miroirs, qu’on n’a pas su maintenir à l’existence ou qu’on a défiguré par trop d’assainissement lors des changements de propriétaire ou des disparitions pour cause de projet immobilier.
La vraie question que j’avais posé à Denis, lui suggérant sûrement la conception d’un ouvrage sur le sujet, était d’urgence devant les démolitions programmées. Pouvait-on agir politiquement sur la préservation de ce patrimoine des anciens lieux de rencontres, historiques pour la vie d’un espace urbain et de son identité, et aussi importants que l’existence d’un musée ?
J’ai connu des générations d’étudiants venir boire les paroles des plus anciens, s’en retourner vers le lycée Masséna, plus riche de savoir et d’expérience par procuration.
Imagine-t-on qu’un projet quelconque ferait disparaître les vénérables Café de Flore ou des Deux Magots à Paris ? Non pas.
Pourquoi donc ne pas inscrire au titre de la défense patrimoniale les historiques bistro(t)s en péril en France ?
…………………………………………………………………………
L’ECHELLE du « j’écoute et je bois » –sociologique-
-Ecoute du clavecin (piano) et boit du champagne
-écoute du jazz et boit du whisky
-écoute du Brel et boit du rouge
-écoute Annie Cordy et boit du Pernod
…………………………………………………………………………………………
Ce premier Juin semble la première ouverture sur l’été. Les oiseaux chantent mieux, plus fort et sans arrière pensée. Le romarin a le parfum plus vif comme s’il avait attendu le moment de se rendre enfin, plein de ses fragrances et sans retenue, à l’entrée de nos maisons. Chez Sauveur je suis fêté. Le vin coule, vif et noir, sur les crêpes de Jo. Hervé m’offre le Chouchen. J’en boirai bien frais ce soir. C’est le Festival du Livre qui va commencer. Je me réfugie simplement dans d’énigmatiques fragments présocratiques. Hécatée d’Abdère et le grand Empédocle. Hélène va rentrer avec le petit bandit de Disneyland. Katy, après ses dernières lettres pleines de feu de la fin Mars, ne donne plus signe de vie.
…………………………………………………………………………………………
3 Juin
L’ignoble et faussaire Bernard Cazeneuve, du haut de sa position de Premier Ministre sinistre, éructe que le djihad n’était en aucun cas un délit et que « ceux qui disent que les racines de la France… »
Douter que la civilisation occidentale fut une civilisation inaugurée par les débuts du christianisme (et donc une pensée en rupture avec le vieux monde antique) serait nier que la mesure du temps qui commence alors se fait sur le vecteur d’av. J.C ou ap. J.C…
Le calendrier des coupeurs de têtes, et des négationnistes de nos racines d’avant la guillotine, n’en a rien pu faire. Le prairial, la nivôse, et les pluviôses successives, tout comme les velours de la pensée de fleur du timonier Mao. (68 s’étant enlisé depuis si longtemps).
En ces temps de féminisme féroce, le seul ignoble et faussaire comparable à Cazeneuve serait le non moins Premier Ministre en son temps, Michel Rocard, assurant que les docteurs de l’Eglise s’étaient interrogés des siècles pour savoir si la femme avait bien une âme. Les docteurs de l’Eglise ne pouvant se revendiquer d’un féminisme comme concevable aujourd’hui, n’en avaient pas moins reconnu l’âme et la figure symbolique dans la pierre et le vitrail, de la plus haute d’entre elle, Notre Dame…
…………………………………………………………………………………………
4 Juin
Pluie infernale cette nuit. Ce matin encore la grisaille. Les oiseaux ont déchanté. Seul ce premier du mois nous a fait croire à l’arrivée de l’été au pas de charge. Jamais printemps ne fut aussi contrasté. Un message de Katy vers huit heures. Le premier depuis la fin de l’hiver. Que lui répondre ? Le cœur, l’orgueil et le silence ne font pas bon ménage.
…………………………………………………………………………………………
Déjeuner avec Alain Jacquot au Grand Balcon à côté de l’Opéra.
………………………………………………………………………………………
7 Juin
Quelques bouées gonflables en plastique, en forme de mosquée, fleurissent sur les plages de Cannes. Provocations ? L’été sera-t-il chaud ?
………………………………………………………………………………………
8 Juin
Le secret de longévité de Colette Maze, cent quatre ans, ancienne élève de Cortot, c’est Debussy, le fromage et le vin.
……………………………………………………………………………………….
10 Juin
Ce matin dimanche, je crus entendre les cloches venant du village. De Villeneuve, ce n’était guère possible. Peut-être, celles lointaines de La Colle sur Loup. Je me suis presque réjouis qu’on fasse encore tinter les volées du dimanche matin. Puis, me disant que j’habitais là depuis si longtemps, il était étrange que je les ouïsse si nettement pour la première fois. Jusqu’au moment où je pris conscience que le lave-vaisselle, dans sa rotation rythmée et régulière d’eau pulsée sur les verres, émettait un son comparable à un halo de cloches dans le lointain…
……………………………………………………………………………………….
De plus en plus de femmes aux membres nus tatoués. Signes des barbaries d’aujourd’hui. Modes qui font fleurir les petits salons des artistes aux aiguilles. Certain(e)s adoptent inconsciemment la tête de mort, les absurdes chimères décoratives. Ce qui était réservé à des cultures ancestrales, correspondant à des hiérarchies sociales en territoires barbares, s’affiche maintenant comme simple souci de marquer de signes, dérivant sur l’océan d’une peau qui flétrira, une originalité ornementale qui ne trompe pas sur la pauvreté surchargée des motifs revendiqués. Là où ces femmes avaient une naturelle nudité de peau et une flexibilité de mouvement en toute liberté s’ajoute aujourd’hui, en une affreuse incruste sombre, la marque d’un joug.
Lorsqu’on me demandait récemment pourquoi je ne sacrifiais pas à la déferlante, je répondis non moins absurdement : « on ne tague pas une Ferrari ».
……………………………………………………………………………………….
15 Juin
Ce matin, la fenêtre s’ouvre sur la plus douloureuse et la plus extraordinaire malagueňa d’Antonio Chacŏn (avec Ramon Montoya). Il n’y a rien de plus élevé et virtuose. Une telle intensité a naturellement engendré Caracol, Pepe de la Matrona, surtout El Nino de Almaden, et tous ceux des générations venus après lui. Seul Manuel Torre, dont nous possédons heureusement une heure de fièvre flamenca, se hisse à ce niveau. ……………………………………………………………………………………….
18 Juin
La forme d’une ville change plus vite, hélas, que le cœur d’un mortel… la phrase de Baudelaire me hante chaque fois que mes pas me mène vers ce quartier entre Gambetta et Grosso, vers cette rue des Potiers, ce square Christiné, la rue des Orangers et vers ces arbres qui rythment le temps sans qu’il ait l’air de rien, sans qu’il ait l’air de bouger. Mes promenades matinales me donnent rendez-vous , sans plus attendre maintenant le temps des vacances, vers ces rues chargées de mes ancrages dans la ville. Cette réflexion de Baudelaire sur le thème inépuisable de la pérennité du cœur flétri et de l’insensible passage des rides sur la pierre ne m’est jamais plus évocatrice que lorsque je remet mes pas, à l’heure encore silencieuse du matin, où tel éclat d’immeuble se vit amputer d’une aile, d’une fenêtre, ou d’un angle de maison jadis donnant sur la rue, que leur absence même a rendu plus aigüe la béance ouverte qui ravive la mémoire de leur existence primitive. Depuis le troisième étage de l’appartement du Pacific où nous avions vécu quelques douze années, on pouvait embrasser du regard ce qui n’était qu’une simple propriété, mais qui avait valeur d’un territoire exubérant et merveilleux, à perte de vue au soleil couchant, constitué de cèdres du Liban, de magnolias géants et de sapins anachroniques tant par leur gigantisme que par leur implantation en milieu urbain. Une petite Savoie combinée à une Césarée idéale. Maman en avait souvent compté le nombre d’arbres, et quand elle écrivait un courrier à la famille restée encore au Maroc, elle en parlait avec une pointe de fierté rassurante, comme s’il s’agissait quelque part d’une extension valorisante, et un peu comme à nous, de notre petit appartement. Depuis lequel nous dominions de vastes horizons.
C’était aussi le temps où le vitrier hurlait au coin de la rue une effroyable phrase signifiant son passage, en même temps qu’il semblait rendre le dernier souffle.
C’était aussi la migration des marchands de quatre saisons. Les fleurs du printemps, les marrons de décembre. L’odeur montait jusque dans notre cuisine.
Et les chansons d’avant qui faisaient qu’on entendait le son des maigres piécettes qui tombaient des étages.
C’était encore le temps où l’on disait aux voisins rencontrés « joyeuses Pâques » ou tout simplement « bon Noël » sans que la bouche ne se sente honteusement écorchée par de tels souhaits.
Un colonel en retraite habitait l’étage au dessus de chez nous, et lavait parfois sa grosse Mercedes à grands jets d’eau sous les fenêtres de l’immeuble. Il était sévère et hautain, du moins nous évitions de lui parler, et je crois que c’est le dernier personnage que j’ai rencontré affublé d’un monocle sous son lourd chapeau mou. Ce qui, même dans les années 60, était déjà anachronique.
Un après-midi de grand lavage, j’eus l’idée absurde, à moins que ce ne fut Stef, d’attendre que le véhicule fut complètement rendu sec comme un sou neuf, pour envoyer, depuis notre balcon, des œufs frais sur le véhicule flambant propre. Nous entendîmes, bien évidemment, les cris de surprise, de colère et d’horreur du colonel qu’on imaginait regardant l’endroit d’où il pensait que venaient les œufs frais du délit.
Le grand nettoyage recommença. Les œufs frais bombardèrent à nouveau. Même horreur, même colère. Nous restâmes blottis, accroupis derrière le muret du balcon tout le temps d’un fou rire extraordinaire qui eut du mal à ne pas nous trahir.
Pour bien mesurer de près, tout à la fois notre victoire, la colère et le trouble du pauvre militaire, l’idée machiavélique nous vint de passer par l’autre sortie (rue des orangers), simulant la surprise devant tant de furie, à quelques pas de la victime, comme si nous rentrions de promenade, constater et découvrir ce petit drame de voisinage, et déplorer une telle fatalité. Le plus difficile fut de réprimer le retour du fou rire devant la piteuse mine du colonel qui fut contraint dans un grand étonnement, mêlé encore de suspicion, de constater que nous ne pouvions être les coupables.
Depuis, le garage du colonel a été détruit, les arbres de l’immense propriété aussi, les néfliers et les boulingrins cachés sous les feuillages ont vu disparaître les petits vieux qui chauffaient leurs dernières années de vie paisible avant de disparaître eux-mêmes, remplacés par les constructions banales et sans attraits qui sont encore celles d’aujourd’hui.
Cet épisode du colonel nous faisait rire encore trente ans plus tard.
La rue des Potiers avait, pour l’histoire de ceux qui l’ont parcourue ces années-là, l’avantage d’avoir eu comme résident, en plus de moi, Jacques Pastorello, qui était au numéro 49 ou 59, dans la partie la plus ancienne et la plus étroite, montant vers la place Saint Philippe. A l’autre bout, près de la Rue de France et rejoignant la mer, le premier graffiti qui lutta contre les brûlures du soleil couchant, des années durant, avant de laisser son message Je t’aime se dissoudre définitivement vers la fin des années 70. Jamais personne n’eut l’audace d’anticiper sa complète disparition .
C’était à l’angle de l’Impasse des Violettes.
……………
C’était aussi le temps des amours. De mon premier amour qui me fit passer au statut d’homme. Un 10 Avril de 70, nus au soleil brûlant du couchant, inhibés autant l’un que l’autre, puis négligemment recouverts de la grande couverture écarlate qui n’en faisait que plus ressortir le rouge de la honte de notre échec provisoire.
C’était ce même jour, à l’autre versant de l’actualité, l’annonce de la séparation des Beatles.
……………
Ce qui change plus vite que le cœur d’un homme c’est tout à la fois la disparition des choses qui nous ont accompagnées et encadrées plus encore que l’image qu’on en gardera toujours dans les strates de la mémoire. Ces strates de la mémoire relèvent déjà du cœur de l’homme.
Il est notamment un regret que je pourrais toujours nourrir, c’est de ne jamais avoir fixé sur la pellicule les rues et les maisons de ce temps de mon arrivée dans le quartier. Pour cinquante années plus tard en constater le changement dans des clichés d’aujourd’hui. Dans l’idéal, il eut été parfait de faire de même avec les lieux quittés en 1964 et de les revoir dans les images de leur existence actuelle.
L’image étant, dans une perspective heideggerienne à la René Char, un temps perdu de vue…
…………….
C’était aussi le temps où nous avions les espaces du rêve à portée de rues. Les grilles et les divers types d’enclos protégeant les propriétés, les jardins publics et l’invasion des parlophones n’avaient pas encore cadenassé notre environnement. Il était fréquent de taper le ballon ou la balle de tennis tout simplement sur la porte d’un garage près de l’entrée des immeubles, ou d’une cour d’immeuble et d’y improviser notre vision des match vus derrière la vitrine des magasins de télévision. Tous les rêves de l’enfance passaient par la rue. La grimpette des arbres aux cerises, l’escalade des sentiers des Collinettes du quartier Saint Philippe, (aujourd’hui clôturée pour des raisons de risque d’éboulements ( !), que plusieurs générations avaient élu comme terrain et enclos des plus brûlants secrets et des plus robinsonnes aventures. Et la poursuite des filles inconnues pour leur tirer les tresses.
La rue offrait encore le reflet d’âme que le cœur de l’enfance construisait sans savoir qu’il taillait en relief, à même les choses, déconstruisant la ville de toute sa fonctionnalité pour lui substituer la loi et l’espace de ses rêves et de ses désirs.
C’était aussi vers les quinze ans, l’été qui nous venait par l’écho et les ondes radio, de cette déferlante San Franciscaine d’un été promis à l’amour et aux fleurs. Je n’osais, étant encore parmi les plus jeunes, me mêler aux plus audacieux aînés, qui trônaient sur les bancs et tout autour de l’espace magique du square Christiné (dont nous ne saurions jamais qu’il fut question d’un désuet compositeur d’opérette), rêvant par mimétisme à des musiques en couleurs et brutales, refaisant en imagination les longues allées et venues périgrénantes de Haight/Ashbury, nous moquant de ceux qui ne concevaient même pas l’existence de cet univers que nous nous appropriions, et que nous reforgions au-delà de la mer.
Je me contentais, quant à moi, de sillonner cet espace le plus discrètement et le plus lentement possible à bicyclette, participant ainsi à distance, tout en circonscrivant imperceptiblement dans le cercle et le pénétrant, ce monde que j’enviais en tentant d’en retenir par écho quelques bribes.
………………
Entre Gambetta et Grosso c’était aussi le Pub Latin, tout en haut du Boulevard Grosso. A l’autre extrémité de ce domaine de mon adolescence, le Copacabana, sous les grands arbres du Boulevard Gambetta, le glacier de la famille de Caceres durant la décennie 60/70, devenus le lieu des rendez-vous. Pour le printemps c’était à Gambetta, à la rentrée de septembre, le haut de Grosso, puisque situé à quelques centaines de mètres du Parc Impérial.
Là, c’était le défilé des filles qui sortaient en rafale du Lycée Estienne d’Orves. Les banquettes, dans la demie obscurité et le velouté des faux cuirs, étaient rapidement investies. Les consolettes y donnaient Ferré en 69 qui disaient que les Moody Blues s’en balançaient et qu’avec le temps, va, tout s’en va… Les premiers jeux de séduction venaient compléter ce qu’on pouvait apprendre par ailleurs.
…………
Dans deux ans le tram passera par le jardin Alsace-Lorraine, amputant une partie de ce poumon au cœur de la ville. C’est le jardin qui délimite l’au-delà du quartier Gambetta. Ensuite c’est la longue coulée arborée du boulevard Victor Hugo. Loin des jeux et de l’insouciance, l’Alsace-Lorraine est maintenant ceinturé de hautes grilles comme le sont les parcs et les jardins cossus de Paris, comme le sont les imposants bâtiments administratifs et les ministères. La hantise du clochard et de la seringue abandonnée sont devenues les motifs de l’enfermement nocturne des jardins publics sur eux-même.
………….
Longeant le jardin, la rue Guiglia, où habitait Josiane Roche, l’égérie de la bande. Du moins, celle qui a tant marqué de sa présence l’été de la même année, qu’on en arrivait à se singer soi-même en contorsion théâtrale et en mimiques afin de surenchérir sur ce qu’on croyait une provocation d’un supposé rival aux yeux de la belle.
C’est là qu’aux environs du 14 juillet je remarquais un jeune homme qui, comme moi, semblait attendre quelqu’un depuis un moment. Au point qu’on fit connaissance, et qu’on s’aperçut qu’il attendait la sœur de Jo tandis que j’attendais celle-ci. Tels Laurel et Hardy. Ou Bouvard et Pécuchet. C’était Patrick Scrocco. Le grand Scroc n’a pas quitté l’horizon de nos histoires communes.
……………
Et puis, plus tôt dans le temps, les matins du Lycée Masséna, c’est mon père qui se chargeait de porter le cartable lourd, plein du vide que fut ma première année de rêverie, dans l’inconscience d’avoir à changer de vie et d’environnement pour de nouveaux repères. Mes parents avaient pris ce virage exactement au milieu de leur existence et à aucun moment des années qui suivirent je n’ai entendu le mot nostalgie, ni en paroles, ni en manière de regrets d’un temps qui les avait éloignés de leur jeunesse et morcelés en deux. Je pouvais bien, à douze ans, vivre dans la douceur la transition qui s’annonçait.
…………….
La rue des Orangers qui croisent celle des Potiers a vu la Nonina y séjourner au numéro 17. Le petit studio possédait un jardinet stérile, sans herbes ni fleurs, mais de méchants graviers et présentait l’avantage d’être disponible lorsque ma grand-mère rendait sa visite annuelle à Angela qui résidait alors au Pays Basque. J’investissais l’appartement durant quelques semaines. C’était alors des nuits de rêverie. J’y écoutais mes premiers Debussy dans la fumée de l’Amsterdamer, découvrant des univers mentaux tout aussi imaginaires que peuvent l’être des récits de voyages à Java, à Bali, dans les nuits torrides de l’Andalousie, souvent dans des pays inexistants, ou dans des pays helléniques supposés potentiels. La Cathédrale engloutie m’a souvent surpris entre le sommeil proche et l’irruption des cloches que je n’aurais jamais imaginé qu’elles aient pu sonner si proches que je pensais pénétrer dans la macrostructure du son. J’étais seul et heureux comme je ne l’aurais pas plus été sur une île vierge.
…………..
Est-ce vers 70 ou un peu avant, en tous cas quelques barbes avaient poussé disant que nous n’étions pas loin déjà de l’année du bac, nous avions investi un tout petit troquet, tout en haut de l’avenue Châteauneuf, le Bar Saint Philippe, originellement voué aux ouvriers et pas plus grand qu’il n’en faut pour donner l’illusion d’être saturé à n’importe quelle heure du jour. Nous allions donc chez Jeannot, et les vendredis soir, la saturation était telle que toutes les catégories des habitués, ordinairement bien séparées par des lignes de démarcations mentales, s’estompaient complètement dans les allées et venues depuis les banquettes et les quelques tables, jusqu’au zinc qui fleurissait de pastis et de vins blancs quand les toilettes du fond ne désemplissaient pas. Il y avait peu de jeunes filles, l’égalité des sexes n’étant pas ce qu’elle est devenue, nous ne recherchions d’ailleurs pas particulièrement leur compagnie, ce qui laisse bien penser que nous n’étions encore pas loin de l’enfance mais il y avait toujours la copine d’un tel, qui automatiquement faisait partie du groupe. On pouvait se saouler tout à loisir, la plupart d’entre nous habitant à moins de deux cent mètres. Pour Jacques Pastorello et moi, il suffisait de descendre en douceur le haut de la Rue des Potiers.
………….
Nos voisins de palier, les Pinard, ayant oublié la clé à l’intérieur de leur appartement, j’eus la délicate responsabilité depuis le troisième étage tout de même, de franchir en culotte courte le balcon de chez nous pour pénétrer dans leur appartement afin de leur épargner une visite chez le serrurier.
Le lendemain, en remerciement, je me voyais offrir en livre de poche, Les Rêveries du Promeneur Solitaire.
………..
Au milieu de Châteauneuf, habitait un occasionnel de la bande. Il vivait un peu comme Proust, près de ses mères et grands mères, souffrant éternellement des dents, dont il nous montrait constamment l’évolution du mal à la manière d’Artaud, marchant ou plutôt flottant voûté dans l’espace environnant comme poursuivi par un essaim d’abeilles. Nous recevant chez lui entre deux douleurs, il nous assenait méchamment un Prélude de Chopin, tout en s’extasiant sur la mort de John Coltrane. Il trouvait la force de réciter, ou plutôt de déclamer, le Journal de Gide ou de jouer tout à la fois Titus et Bérénice.
…………..
Au Numéro 33 du Boulevard Gambetta une librairie du même nom, aussi petite qu’un mouchoir de poche a disparu, comme beaucoup d’autres dans les villes d’aujourd’hui. Pour y pénétrer il fallait saisir l’immense trente trois en anamorphose de métal que faisait la poignée du magasin. C’est le dernier vestige qui reste encore de cette librairie devenue agence immobilière. C’est de là que venaient les Pléiades que Maman m’achetait dans les grandes occasions.
…………
21 Juin
Gennady Rozhdesvensky est mort il y a quelques jours. Le plus prolixe des chefs d’orchestre. Au delà des toujours très attendus enregistrements de Chostakovitch, de Prokofiev et des Russes en général, il avait défendu amicalement l’œuvre de Schnittke, dont l’intégrale des symphonies, mais aussi, plus surprenant, il laisse des témoignages sur Georges Enesco, Bruckner et sur bien d’autres. Plus de sept cent sur l’ensemble de sa carrière. Ce qui ne fait pas loin d’un enregistrement par mois !
……………………………………………………………………………………….
Deuxième sonate pour violon de Brahms. C’est là un thème, sans doute possible, inspiré des Meistersinger de Wagner. Le critique Hanslik ne pouvait ni l’ignorer ni le passer sous silence ! Alors… ?!
…………………………………………………………………………………………
22 Juin
Longue promenade vers Gambetta, Grosso. L’Impasse des Violettes se nommait avant la rue des Canebiers, ex-rue des Chanvriers. Tant d’appellations pour ce bout de ruelle… qui jouxtait l’immense vaisseau du ferrailleur, amiral d’acier et de débris géants, de navire improbable, qu’on n’avait jamais vu qu’en salopette de travail.
Puis mes pas me mènent vers les Collinettes. L’ancien chemin vicinal est toujours cadenassé. Par contre, à ma grande surprise , un Parc régional Estienne d’Orves a été créé au nord du Lycée, au cœur même des lieux que nous fréquentions enfant. Il monte en lacets vers le sommet de la petite colline. Il fait extrêmement chaud. Je remets à plus tard la découverte de ces aménagements. Des petits boulingrins ont été installés au sein de la végétation. En octobre il doit être agréable de s’y rendre. Dès le début du sentier on peut voir le plus grand des eucalyptus qui se puisse imaginer. En redescendant, l’ancien Lycée professionnel Beausite a fait place à la rive gauche d’Estienne d’Orves. Il reste toujours de très anciennes et belles maisons niçoises autour de l’école Saint Philippe, dont celle sise au pied de l’école, qui m’a toujours fait rêver. L’église du même nom a reçu une salutaire couche de peinture vive et l’on peut maintenant bien distinguer au fronton qu’elle fut construite en 1612, donc en pleine campagne à l’époque.
…………………………………………………………………………………………
25 Juin
Macron l’européen parle américain dans ses voyages à l’étranger. Et même quand il reçoit à l’Elysée. Pour bien montrer qu’il parle la langue des banques, de même que les africains aiment à se distinguer, comme diplomates dans la dépendance, en usant du français.
Pas de vin français dans les ambassades américaines quand Trump nous reçoit. Du vin californien.
De même, la poussière supposée, époussetée sur le revers du veston de notre président, est un camouflet. (Imagine-t-on de Gaulle…)
America first. India first, répliquent les indiens. Russia first. Brittany too.
A quoi Macron répond en écho, Europa first (parce que nous ne compterions plus comme France first !) quand Merkel murmure tout de même, Germany first. Et que les Italiens, les européens de l’Est, en un seul chœur, se désolidarisent de cette Europe là.
Est-ce qu’elle va dans le sens de nos intérêts ? N’est-on pas déjà dilué ?
Défaisant la France, Macron se veut-il faute de mieux, une sorte de cornac de l’Europe ?
…………………………………………………………………………………………
Cent ans de Solitude. A chaque fois que je reprend le petit volume de ce chef d’œuvre, je lis la première page et la dernière. La découverte du village dont les objets n’ont pas encore d’appellation qu’on les nomme en les montrant du doigt. Les pierres du Macondo traversant le lit de la rivière, grosses comme des œufs préhistoriques.
Puis les toutes dernières, où le temps s’accélère, où l’histoire de la vie du héros est passée en accéléré, et où il est dit que tout ce qui y était écrit demeurait depuis toujours et resterait à jamais irrépétible, car aux lignées condamnées à cent ans de solitude, il n’était pas donné sur terre une seconde chance.
Je disais à Cécilia, longtemps avant d’aller pour la première fois en Colombie, l’admiration que j’avais eu pour ce livre exceptionnel, et dont je n’avais plus jamais retrouvé la veine dans les autres ouvrages de Garcia Marquez. Cette imagination à la limite de l’onirisme et la poésie pure qui génèrent l’enchantement comme en état d’apesanteur, est proche du décrochement du réel et s’apparente à une forme de surréalisme, à l’image du délire de Remedios dont l’âme monte au ciel sous formes d’une myriade de papillons jaunes.
De même l’ancêtre, mort depuis longtemps, qui revient périodiquement sur les terres de son domaine, au pied du chêne, parlant à son chien, et que voient seuls les esprits purs.
Cécilia a toujours été convaincue que Garcia Marquez n’a jamais été qu’un simple observateur de la vie colombienne et que les scènes du roman ne seraient qu’une faible transcription des réalités du pays.
J’ai effectivement vécu dans ce pays toutes les situations les plus invraisemblables, quasiment africaines dans l’absurde, irrationnelles et aux lisières d’une certaine forme de folie. Entre la tragédie de carton et le comique de situation de papier.
…………………………………………………………………………………………
26 Juin
Deux définitions de l’amour que je grave définitivement, après toutes celles qui s’éliminent d’elles-mêmes. La première, de Saint Augustin, qui élargit la chose envisagée jusqu’à l’infini : La mesure de l’amour est d’aimer sans mesure, qui vient rejoindre celle citée par deux fois dans le merveilleux « Pandora » de Albert Lewin : la mesure d’un amour est ce que nous consentons à donner pour lui.
…………………………………………………………………………………………
27 Juin
Parc Estienne d’Orves. La matinée est chaude, la montée vers le sommet de la colline est pentue, en lacets, et à mesure que je m’éloigne du quartier Saint Philippe, la ville déploie toute la magnificence de ses couleurs et toute la perspective de ses reliefs. Au sommet, au-delà de la Villa Bellevue, dans son splendide abandon, la végétation apparaît telle qu’elle a pu se présenter aux premiers jours de la création, avec ses centaines d’oliviers, dont le plus précieux serait millénaire. Solitaire dans son espace, comme pour marquer un rang supérieur et une dignité que lui a conféré le temps.
De clairière en clairière, le chemin, aiguisant sur ses couteaux de pierres surchauffées ses vieux relents de siècles, laisse émerger ses strates de mémoire.
Tout en bas, en fond de décor, dans les lointains de l’Ouest de la ville, la mer. Une petite Grèce inviolée où il devient possible de se hisser par les chemins de l’évasion retrouvée.
…………………………………………………………………………………………
15h…
C’est la voix de Kim Borg, d’un velours somptueux, qui pourrait se confondre avec celle du Souzay des années cinquante.. C’est une mélodie du Pélléas de Sibelius, et je ne sais pourquoi, elle me ramène à une mélodie chantée à tu tête, à l’arrière de la voiture, avec mes cousins et cousines sur la route de Khemisset : « c’est la valse brune des chevaliers de la lune… ».
C’est une après-midi finlandaise, peut-être pour mieux supporter les lourdeurs de ce début d’été. Toïvo Tuula, « Pluies dans la forêt », le Kalevala , Madetoja, Melartin et le grandiose Kullervo de Sibelius.
Hier soir, Y mettait ses doigts avec une certaine douce assurance sur les touches blanches du clavier, comme un déjà petit Arrau, déliant une bribe de mélodie, sans avoir jamais vu de pianiste auparavant.
Durant les dernières conversations que j’ai pu avoir avec Stef, on parlait souvent de la Slovénie où il rêvait de se rendre, de cette petite église au milieu d’un lac, comme d’un appendice de l’Autriche voisine. Pays qui pourrait se résumer dans le velours de son plus beau chanteur lyrique, Anton Dermota.
…………………………………………………………………………………………
5 Juillet
Radouane Faïd, terroriste et ennemi public, s’évade de prison en plein jour en costume et cravate par la voie des airs, un hélicoptère s ‘étant posé dans la cour principale de l’établissement, sans coup de feu, sans victime et dans le calme absolu – à force de voir Belmondo- La France, par le porte parole de « l’ex-Directeur de la Direction Centrale de la Police Judiciaire » nous avertit , en accord avec Madame Belloubet, Ministre de l’Intérieur, que nous en saurons plus dans un mois ( !!).
Comment peut-on réaliser une telle évasion dans un calme aussi absolu ?
Dans le même temps, un autre ennemi , d’autant plus public qu’il a été un des commanditaire de l’attentat contre Charlie Hebdo, Djamel Ghebal, sera libéré dans un mois. Par ordre et décision de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, si l’Algérie refuse –ce qu’elle a déjà annoncé- l’extradition de ce Ghebal déchu de la nationalité française.
L’assignation à résidence qui s’ensuivra est désormais étendue, non plus à la seule résidence, mais dans les limites de la commune désignée. Une victoire des Droits de l’Homme probablement.
Qu’en pensent les riverains et les habitants de cette future coexistence obligatoire ?
Question : ne pourrait-on pas s’ affranchir de cette décision? (Ne devrait-on pas s’en affranchir par dérogation ? Pour cas de force majeure dans un acte terroriste dans une France alors en état d’urgence à défaut d’être responsable d’elle-même).
Question : La Cour Européenne ne s’érige-t-elle pas au dessus du plus élémentaire bon sens dans une décision de Justice dont la France est en première ligne concernée dans le cadre de sa défense interne, et ne s’arroge-t-elle pas un pouvoir administratif exorbitant dans son abstraction militante ?
Réponse : Madame Belloubet pense que la Justice avance… ( !!?)
Nous croyons que la France avance surtout dans le Mondial. Les yeux fermés.
………………………………………………………………………………………
Blanche de Castille contrarie l’idée que la femme n’a pas l’importance que le féminisme et le protestantisme de Monsieur Rocard revendiqueraient pour elle.
Que pense aussi l’Occident d’aujourd’hui d’Isabelle la Catholique, d’Aliénor d’Aquitaine et de Hidegarde von Bingen ?
…………………………………………………………………………………………
De toutes les immenses figures lyriques de baryton, il y en a tant qui m’ont fait ployer à genoux fléchi, que reste quand même le plus exceptionnel chevalier errant et le Boris le plus clair et le plus profond de Jean-Emile Diogène.
Dans le film de Raymond Bernard, Charles Dullin était Louis XI dans la rencontre improbable et piègeuse de Peronne. Paradoxalement dans ce « Miracle des Loups », Vanni-Marcoux y sera un Charles le Téméraire muet… C’était du cinéma muet, eux des géants universels.
………………………………………………………………………………………..
L’imam de Poitiers révèle à la télévision Quatari que le nom de la mosquée de Poitiers porte le nom de la bataille de 732, comme d’une différance dans le temps, une sorte de possible revanche de l’Histoire. Bahat-al-Chouada.
………………………………………………………………………………………..
L’Islam ne représente pas un terrorisme de plus dans l’Histoire, qu’on éradiquerait avec le temps, comme ceux qui l’ont précédés, mais une plaque tectonique de civilisation et un antagonisme qui n’ira qu’en amplifiant.
L’Islam ne se lassera pas aussi vite que les Occidentaux se sont lassés depuis longtemps de leurs racines civilisatrices.
………………………………………………………………………………………..
8 Juillet
Départ du Tour de France en Vendée, dans le bas et le haut bocage aujourd’hui et demain. William Christie, qui possède une superbe demeure dans la région, à force de fréquenter les musiques françaises du 17° siècle, est devenu un parfait chouan, chapeau de paille et sécateur à rosiers à la main.
Les paysages de France seront évidemment tous les jours maillot jaune.
Le commentateur de ce dimanche m’a semblé trancher avec les habituels descriptions neutres et légèrement empruntées de ses prédécesseurs parlant des monuments, des villages traversés et des rappels historiques. S’agissant aujourd’hui de la Vendée, il rappela le rôle des colonnes infernales de la République qui génocidèrent tout le pays du temps que la Terreur passait par là.
…………………………………………………………………………………………
11 Juillet
Katy ce matin. On lui a ôté une partie des broches de son pied droit. Je l’accompagne dans ce quartier des Moulins où elle doit justifier de sa situation sociale et médicale. A midi nous déjeunons à la Mama. Elle béquillera encore quelques temps.
…………………………………………………………………………………………
Les 4 symphonies de Arvo Pärt sont une révélation. Loin des minimalismes languissants de certaines de ces œuvres. Et le concerto pour oiseaux et piano chantant de Jonathan Harvey un merveilleux hommage à Messiaen. Les Psaumes de Benedetto Marcello (canon triplex) un havre de fraîcheur au midi de la journée. L’autre visage, presque encore renaissant, de la Venise vivaldienne.
…………………………………………………………………………………………
Depuis trois jours Cécilia est en stage à Londres. Je la rejoins le 20 au matin pour un week-end prolongé.
…………………………………………………………………………………………
Encore une saillie de Cohn-Bendit, de moins en moins prophétique, de moins en moins lucide. Comme un boxeur sonné, répétant une litanie, pour son jubilé cinquantenaire, il avait appelé à boycotter le Mondial russe pour cause de risques de désordre en tous genres. A deux jours de la finale, les médias de tous horizons ne tarissent pas d’admiration devant l’organisation de la compétition et la chaleur de la population dans les stades et en dehors.
Sur l’échiquier géopolitique Cohn-Bendit a jugé la Russie irrecevable dans son champs idéologique, il en découle que tout dans ce pays serait négatif, donc ce Mondial.
On oublie qu’en 98 le même triste Dany, toujours procureur, avait demandé à ce que Aimé Jacquet, jugé incapable, soit remplacé à son poste d’entraîneur.
Les opinions changent, les réalités, les images et les déclarations laissent hélas des traces indélébiles. Mais qu’importe, devant les éternels oublieux que nous sommes, on continue de tendre les micros et à requérir les pensées et les vérités des toujours mêmes mauvais augures. Les inévitables élites.
…………………………………………………………………………………………
Proust faisait une allergie aux fleurs. Même, et surtout lorsque c’était des fleurs sur papiers peints.
…………………………………………………………………………………………
15 Juillet
La France gagne sa deuxième Coupe du Monde face à l’inattendue Croatie.
Avec aujourd’hui, le 16, la descente des Champs-Elysées, son long cortège de drapeaux tricolores, mais aussi comme une tache dans le paysage, de drapeaux algériens et de fumigènes que l’air en est saturé, de cris et de fureur joyeuse (?) cadenassés par de très lourds moyens militaires.
…………………………………………………………………………………………Le tango de Buenos Aires a , semble-t-il, de très lointaines, mais certaines, origines hébraïques.
La nostalgie ne quittant jamais longtemps la ville, vers 1900, Rosina Storchio y chante aussi pour Toscanini, Madame Butterfly .
…………………………………………………………………………………………
19 Juillet
La journée sera chaude. Je n’ai plus qu’à boucler la valise. Elle ne sera pas bien lourde. Demain je m’envole pour Londres.
……………………………………………………………………………………….
20/23 Juillet
LONDRES
Vendredi 20 Juillet
Depuis les hublots apparaissent maintenant des bocages, une marqueterie de jaunes et de verts, et pleins de petits pompons d’arbres. C’est juste avant l’atterrissage. L’Angleterre est le seul pays où une première couche de nuages précède celle qu’il faut crever encore pour voir enfin surgir le paysage. Puis l’arrivée à Luton, dans le gris de plus en plus dense à mesure que Londres approche.
Le long de l’autoroute défilent les maisons basses de briques rouges aux toits pointus. Ce sont les cités pavillonnaires précédant le gros de la ville, les petites victoriennes du pauvre en quelque sorte.
Et ce sont les premiers bus londoniens à étage, traçant dans des avenues aux maisons rouges parfois jusqu’au carmin, qui indiquent que la mince frontière entre ces cordons d’habitations et l’entrée réelle dans Londres est insensiblement rendue floue.
Pénétrer dans une ville inconnue, surtout si c’est une ville tentaculaire, relève toujours d’un constat d’impuissance. Aucun paysage, même le plus surprenant, le plus exotique et le plus inattendu, ne rend le voyageur démuni devant la nouveauté de ce qui s’offre à lui. Il semble par contre qu’il y ait comme une approche et une appropriation progressive dans la découverte d’un tissu urbain, que le film n’est pas encore commencé, que nous n’en sommes qu’au générique, tant le mouvement de pénétration dans le cœur d’une ville nous laisse sur les marges de celle-ci.
Un paysage s’offre à nous dans toute la splendeur de ce qu’il a à offrir et comme façonnée pour nous. Une ville se meut, respire et articule les moindres de ses fibres vivantes au rythme qui est le sien sans même s’apercevoir que nous l’avons pénétrée, nous ignorant et nous laissant comme le wanderer dans sa solitude initiale.
Après presque deux heures de cette longue approche, le paysage devient franchement urbain et arboré, cossu, traversant de longues avenues saturées de feux tricolores et de ces bus comme autant de globules rouges de communication au cœur de la ville.
Il est paradoxal que sur Grosvenor Road, juste avant d’atteindre Victoria Station, ce fut le Maréchal Foch en statue équestre qui m’ait souhaité la bienvenue…
Je rejoins enfin Cécilia à Victoria Coach. Après une bien épuisante et interminable enfilade de stations dans les dessous de la ville grouillante, nous parvenons à Hammersmith où nous logerons. Le quartier est situé à quelques pas de la Tamise, côté Ouest, et l’air qu’on y respire offre une brise perpétuelle sur le minuscule balcon, surtout la nuit tombée. Comme un départ vers la mer. Avec le coup de rouge de vingt deux heures, ce sont les grands larges…
Il est déjà dix sept heures. Et c’est vendredi. Une éternité de temps plus tard, le métro nous mène vers la Tour de Londres et Tower Bridge. Dans la grisaille et le quasi flou des lignes dessinant l’horizon. Puis c’est la Tamise battue de vent, ocre et jaune, sale, sans berges autres que de laisser apparaître des plages désertes de sables et de galets sous le maigre ressac du fleuve boueux. Des voiliers et quelques péniches tracent le milieu d’un horizon constitué d’une apparente anarchie d’architectures ce centre de la City.
Architecture de verre et de béton. Londres vocifère son acier et son verre dans le ciel de ses grues à la taille de mante religieuse qu’on croirait qu’elles font partie de l ‘évolution verticale pour ne plus quitter la frénésie de croissance. Londres, contrairement à Paris ou d’autres capitales, n’a pas résisté à la tentation de donner à son centre, à son cœur battant de cité, la forme du poumon économique visible et revendiqué. Comme une dépendance à la cadette devenue reine, New York. Ces deux villes parlant la même langue de la finance et des symboles de cette opulente revendication de la puissance au travers de ses architectures démesurées, ont engagé un recentrage, au sens propre, de toute la vie qui s’y voit en extension. Là où Paris a excentré, sans se plier au chant des sirènes, les murs et les hauts vertiges de verres teintés et les pinacles de ses moteurs financiers à l’extérieur de ses centres historiques, Londres les expose dans le devenir même du cœur d’une ville aujourd’hui disparue.
D’où ce sentiment de ne pas encore avoir accordé, dans son abondante volonté d’imprimer une philosophie de la dynamique, les assises ancestrales de la cité et le nécessaire besoin de vivre un devenir plus moderne.
Londres est un work in progress. D’où également un sentiment, en la parcourant, qu’on n’y reconnaît pas, parce qu’étant fluctuant en permanence, les jalons qui font que Rome, Paris ou Amsterdam ont des contours comme inébranlables. D’où le visage évolutif et sans patine aucune de cette capitale ne vivant que de son mouvement de croissance continue et métamorphosée qui lui ôte une unité de caractère facilement décelable et familière dans les grandes villes historiques voisines.
Si une ville est descriptible depuis le berceau naturel qu’est le fleuve qui l’alimente depuis la nuit des temps, nous oserions dire que Londres, dans ses horizons perceptibles depuis la Tamise est un chantier.
L’entrée du Tate Museum présente, depuis l’autre rive, celle de la Tour de Londres, un affreux parallélépipède vertical aux tonalités de pain d’épice sombre, faisant plutôt penser à une gigantesque cheminée d’usine. Du côté qui est le notre, plantée face à cette entrée, toute l’armada des bâtiments de la finance levant les bras au ciel, flanquée au-dessus d’elle, des provisoires grues d’élévation, qui comme à la Sagrada Familia, semblent faire partie définitivement du paysage.
C’est donc dix sept heures passées. Nous trouvons refuge, si l’on peut dire, dans un pub de Cannon Street, près de l’Eglise Saint Paul aperçue de loin.
Ce qui distingue les Londoniens, croyais-je, des Français, c’est que leurs soirées de bière ou de vin se font en costume, avec parfois certains qui portent cravate. Et quand le pub est sur le point de crouler à l’intérieur, d’imploser sous le poids des chopines et de l’ éclat des fêtards enfin libérés de leur semaine, la place est peu à peu investie, imperceptiblement envahie par les hordes de traders et d’employés en tous genres, debouts et serrés les uns contre les autres, comme pour un gigantesque cocktail en plein ciel ou le point de départ d’une organisation syndicale avant le défilé. On croirait que la rumeur environnante est diffusée par haut parleurs tant l’intensité est grande.
C’est la nuit londonienne qui commence. Je crois conclure de cette débauche d’espace improvisée à l’extérieur des pubs qu’elle est due à l’absence permanente de terrasses aménagées et surtout au fait, qu’ici, il n’existe pratiquement pas comme dans les pays latins, de serveuses et de serveurs. On commande, on passe à la caisse et on se fraie ensuite le chemin vers la table de son choix. Ou l’on va dans la rue…. Les cravates et les robes fendues sont de rigueur, mais ici c’est la City. Et puis on n’a pas eu le temps de rentrer chez soi. Les distances sont si grandes.
Nous sommes à deux pas du Millenium Bridge. Il semble avoir été construit d’hier. Aucun pont , fut-il celui de Céline dans son Pont de Londres et de ses amours pudiques avec Virginie et de ses beuveries de quarante pages, ne semble avoir la mémoire d’un passé où Haydn rayonnait autour des ses symphonies londoniennes vers la fin de sa vie.
Le Pont des Arts, le Pont Henry IV, le Pont Neuf , Alexandre III et le Pont de la Concorde paraissent en regard de ceux d’ici, avoir tout le poids de l’Histoire qui les a traversé. Londres ne semble avoir la mémoire que de son avenir.
Plus aucun lieu de cette Capitale ne parlera jamais l’atmosphère des récits de Dickens qu’on aurait pu avoir envie de sentir à certains moments, de ce qui émanait du Docteur Jekill ou de Jack l’Eventreur. De ses rues pavées de mauvaises intentions, de ses ombres anamorphosiques et fuyantes, de ses halos nocturnes de brumes hivernales et des pas qui se rapprochent… Il est certes une attraction touristique qui propose un parcours retraçant le lieu des méfaits du serial killer, mais cela doit probablement ressembler à un quelconque train fantôme ou à un numéro d’horreur à glacer le sang dans Luna Park.
Les Anglais paraissent avoir oublié ce passé pourtant abondamment affiché dans tous les couloirs de métro, ce passé de Chaucer, de Henry VIII, du Shakespeare du Globe, de tous les Edouard de leur Histoire, pour ne retenir encore que l’écume des évènements dans le passage protégé de Abbey Road.
Et Penny Lane a-t-elle existé ? Juste à Liverpool. Avec Strawberry Fields.
Le bus rouge nous laisse sur une place abondamment arborée, au carrefour de plusieurs avenues qui coupent la ville en segments vifs.
C’est Covent Garden qui s’éveille aussi à la nuit qui arrive. Les façades et les lampions s’allument sur Montmouth Street. Les trottoirs sont étroits et ne reçoivent que quelques tables à l’extérieur des restaurants ou des pubs. L’atmosphère y est plus franchement à échelle humaine, du moins comme on peut la concevoir à Montmartre ou dans des quartiers fleuris et pavés, jalonnée d’arbres et où les petits commerces scintillent aux vitrines. On y rencontre quelques restaurants français, le Mon Plaisir avec ses toiles tricolores, la façade de briques rouges , probablement du début du siècle passé, et ses incrustes en bas relief : ancien dispensaire français. Nous cherchons désespérément la minuscule ruelle de la Neal’s Yard, si discrète qu’elle pénètre par une entrée cochère de la Mounmouth et s’en va faire un arc de cercle pour ressortir quelques numéros de rues plus loin sur la même Mountmouth, traversant en fin de parcours un restaurant marocain lové sous des voûtes qu’on se croirait à l’orée d’une casbah. En pénétrant la ruelle et la placette en son centre, c’est tout un univers hors modernité qui s’étale devant soi. Un fragment de village hors du temps, ou plutôt d’un temps qui se souviendrait des excentricités des années soixante à San Francisco ou du côté du Londres déhanché et psychédélique. Les murs des façades de briques étalent la franchise de couleurs vives qui ne craignent pas les disharmonies criardes qui font l’harmonie même de ces constructions de poupée, qu’on se croirait au dedans d’une pochette de disque de musique pop, rehaussant une ancienne grisaille disparue pour des tonalités pures en larges bandes lézardées flashies dont les commerces, les balcons et les moulures vives des fenêtres abritent des herboristes et des pharmacies d’huiles essentielles remplaçant aujourd’hui les pilules du rêve des années soixante.
Il y a aussi quelques bistros proposant à l’ardoise des Champagne de luxe et des salons de relaxation. Malgré l’évidente proposition de tant de produits à la tendance du jour, la Neal’s Yard a le charme de la poésie éternelle des choses qui ne vieillissent pas et qui se renouvellent dans les dimensions de l’échelle humaine.
Dernier verre de rouge au Jamon, en lisière du quartier.
Plus loin, sur la place qui donne sur l’immeuble de Harry Potter tout éclairé, au moment de déclencher, apparût le profil d’une sorte de bédouine au capuchon couvrant la tête, venant habiller de son premier plan , comme dans un Boubat ou un Willy Ronis, ce qui n’aurait été qu’un banal cliché.
La brise de la Tamise souffle cette nuit de fraîcheur bienfaisante sur notre balcon.
Samedi 21 Juillet
Encore le bus rouge. Très tôt. Pour bénéficier de la douceur du matin avant les feux brûlants et la moiteur dès midi.
Londres est heureusement prodigue en arbres et en ombres. Nous longeons de belles avenues, cossues déjà, avant le marché qui s’éveille à peine à Portobello Road. Les étalages en tous genres de bimbeloteries et de friperies mènent vers les rues et les avenues adjacentes de Notting Hill.
C’est Lancaster Road, St Luke’s Mews, All Saints Road, quartier de maisons basses, simples ou luxueuses, toujours merveilleusement harmonisées dans leur diversité, souvent jalousement enrobées de végétations, aux couleurs pastels bleus et roses, parfois violemment pourpres, jaunes ou vertes et puis simplement blanches, dont l’alignement n’est pas sans se souvenir des maisons victoriennes san franciscaines.
Tout en les précédant dans le temps.
La lumière est encore douce et le quartier au rythme paisible laisse apparaître, au hasard des décorations au pochoir, des fulgurances de portraits de Bob Marley, des bistros et des petits commerces sud américains. C’est un peu le complément de ce que nous avions en miniature et comme en prototype à la Neal’s Yard qui se déploie en grandeur nature dans ce cossu Notting Hill. C’est l’alternance du classicisme victorien métissé de vifs jalons du bout du monde.
D’une manière générale, la ville porte les empreintes de l’ancien empire colonial, comme Paris et les grandes cités de France le souvenir de sa présence en Afrique du Nord.
Au coin de certaines rues, quelques cabines téléphoniques rouges, encore en état de marche. Leur existence, dans l’inutilité de leur fonction à l’heure des portables, n’est plus maintenue que pour contrepointer la marche des bus londoniens qui sont la marque même de la ville, dans ce rouge qu’ont également les costumes de la garde à Buckingham.
Londres, ville du rouge saturé.
Un autre lieu hors du temps, bien qu’entouré par de tentaculaires constructions d’acier et de verres, enlacé de voies de circulations urbaines et sauvages, la Little Venice à laquelle nous parvenons , longeant les artères bruyantes et tortueuses jusqu’à ce havre de fraîcheur aux quais pavés et ensommeillés sous les ponts et les axes de circulation. Le canal traverse, au cœur du grouillement urbain, comme une anomalie et une provocation, un temps qui se fige.
Des péniches de couleurs, de bois vieillis par l’usure, aux hublots sales de n’avoir plus pris le large depuis longtemps, succèdent à d’autres péniches en une longue enfilade de plusieurs centaines de mètres. Certaines sont fleuries, et toutes présentent ce charme d’avoir ce tapis de lentilles d’eau qui donne l’illusion d’un gazon uniforme sur lequel elles glissent avec la lenteur qui ralentit l’espace, le temps qu’il faut pour embrasser et parcourir le canal.
Non loin de ce havre de couleurs et de quiétude, nous rejoignons la Tamise, remontant vers l’Est, dans la lumière saturée de midi. Des arbres très élevés sont eux-même dominés, à l’entrée d’un parc, par un intimidant édifice classique coiffé de tourelles d’angle et de balcons dominant le paysage. C’est le magnifique White Hall Garden où la statue de William Tindale, premier traducteur du Nouveau Testament, est au pied de l’entrée de l’édifice.
En longeant encore le cours de la Tamise, c’est maintenant l’austère bâtiment du Ministère de la Défense gris et quasi carcéral, avec à ses pieds, dans l’Embankment Garden, des statues commémorant la guerre de Corée, celle d’Irak et quelques autres que nous n’avons le temps de voir. Puis, le Nouveau Scotland Yard, dans le même goût architectural, qu’il semble en être le prolongement. Et enfin le Scotland Yard victorien de Conan Doyle, tout en briques oranges qui mène au Parlement. Nous ne verrons rien de ce monumental ensemble, cœur même et symbole de la ville, pas plus que le Big Ben, perdu dans la peau de hérisson de ses myriades d’échafaudages.
Reste Westminster, assailli par les longues files d’étudiants et de lycéennes en foulards et uniformes, les lecteurs attentifs des guides pour lesquels Londres se résumerait à cette abbaye où les queues sont interminables, et le cadran horaire géant de Big Ben, aujourd’hui absent et silencieux.
Sur une très vaste Place, dans le genre Place des grands hommes, nous trouvons les bronzes de Churchill, cigare en poupe et canne à la main, quelques autres généraux de pied en cap, comme il se doit dans les codes d’expression des plus grands honneurs donnés aux êtres illustres, Gandhi presque nu et enfin Nelson Mandela, le dernier venu.
Nous fuyons la foule, changeant de cap en bus rouge où nous adoptons l’étage pour une vue plus complète, croisons de loin la London Eye, à destination de Elephants and Castle. Les éléphants et les châteaux, on comprend qu’il s’agit des Indes, et plus certainement du Rajasthan, mais Cécilia avait déjà ouvert la voie avant ma venue, et en fait d’Indes il s’agit d’un quartier à majorité latinos où les restaurants colombiens sont nombreux. On y mange comme en famille, et certaines tablées, en ce samedi, sont composées de plus de dix personnes. Nous déjeunons donc à la Bodeguita toute enguirlandée des drapeaux des pays ayant participé à la Coupe du Monde à peine achevée.
L’église Saint Paul, probablement la plus majestueuse de la ville est, avec sa coupole démesurée, dans l’axe de Tate Museum où
Picasso est exposé pour l’été.. C’est du sixième étage que, derrière les baies vitrées, l’on a la vue la plus panoramique, et presque comme prise d’avion, sur les architectures en évolution de la City et les berges ouvertes de la Tamise.
J’ai ressenti personnellement un certain malaise à tenter de résoudre une unité de vision, une harmonie assise dans le paysage qui s’offrait là pourtant dans la perspective la plus large et la moins restrictive depuis ces hauteurs de Tate. Londres, dans cette optique, apparaît jaunie, (mais peut-être est-ce le fleuve qui en donne la tonalité), morcelée dans une désespérante recherche d’un équilibre et d’une fibre architecturale qui ne s’affirme pas, mais bien au contraire, paraît s’entredévorer dans une proximité d’édifices qui ne peuvent s’épanouir, dans l’urgence d’acquérir un caractère, à défaut de s’affirmer. Arrimés les uns aux autres, les édifices de ce royaume de verre et d’acier souffrent de leur mitoyenneté.
Ce qui à New-York sera une volonté d’emporter le regard et d’imposer dans une verticalité une mosaïque d’édifices s’unissant les uns aux autres par le miracle d’un tout supérieur aux parties.
A Londres, l’implantation du gigantisme est allé trop loin ou pas assez. La personnalisation de chaque monument allant vers le ciel semble empruntée, imprévisible et improvisée, comme le serait le col d’une chemise qui nous laisserait engoncé.
En voulant imiter le modèle de sa petite sœur américaine, Londres s’est dotée d’une âme provisoire et comme transitoire. Paraissant ainsi, par paradoxe, à la traîne de New-York.
Et c’est au pied de cette rêverie sur l’inachevé de la ville qu’au bord du fleuve se découvre le petit théâtre du Globe. Shakespeare y donnait la primeur de ses œuvres. La rotondité du petit édifice et la blancheur de son revêtement peint lui donne aujourd’hui un trop plein de neuf.
A deux pas de là, un galion, faussement échoué et qui n’est peut-être jamais sorti des rives d’ici, sert à l’environnement des plaisirs de la bière et aux intempestives et inévitables animations de plein air.
Nous revenons vers Covent Garden, moins paisible que la veille, du moins plus effervescente en cette fin de semaine, son marché couvert où coule aussi la bière des toujours fidèles buveurs debout à l’entrée des pubs.
D’une manière générale, la ville est, plus qu’ailleurs, bruyante jusqu’à l’excès de ses sirènes de pompier et de ses ambulances aux stridences lancinantes qu’on ne peut s’empêcher de se boucher les oreilles au risque de ressentir une intense douleur physique.
Le métro est infernal à certaines heures, agressif et battu par d’ incessants courants d’air, ce qui n’en rend que plus douloureux le retour à Hammersmith après les quelques quinze ou vingt kilomètres que nous avons parcouru à pied aujourd’hui.
Londres est un espace qu’on ne peut conquérir que par cette souffrance de la marche qu’on s’impose. Plus encore qu’à Rome ou Amsterdam, les distances nécessitent, si l’on veut s’imprégner de la ville, les contraintes de l’élargissement concentrique. Comme à Paris, le centre est partout, et les centres sont éloignés les uns des autres.
Tout près de notre logement, et plus près encore de la Tamise, à l’entrée du pont indien, du moins que j’ai nommé ainsi, se trouve le plus délicat et le plus tranquille des pubs qui soit. Le Old City Arm. La probable patronne est Thaï, fait une excellente cuisine et se charge aussi de desservir les tables. Comme dans tous les commerces de boisson et de restauration, Londres, plus que n’importe où, économise.
Les jambes sont lourdes mais la tombée de la nuit se fait dans la douce lumière rose et orangée des reflets et des miroitements sous le pont indien.
La promenade le long de cette rive est jalonnée de maisons suffisamment éclairées que nous y pouvons pénétrer du regard jusqu’à percevoir les décors et les lumières intérieures. De l’autre rive nous voyons une sorte de palais hindou, du moins ce sont les tourelles d’angle en forme de bulbe qui lui donnent cette majesté au bord du fleuve. En plein Ouest de Londres, comme une vision de bord du Gange !
Le nocturne continue, au rose déclinant, et aux lueurs à peine perceptibles dans les lointains, que le pont n’en est plus aperçu que comme une forte ombre chinoise.
Puis encore une maison victorienne de couleur vive le long d’une allée, en écho de celles du Notting Hill de ce matin.
Depuis le balcon de notre chambre, l’immeuble d’en face est ce soir tellement éclairé qu’on pourrait, avec un peu d’attention et d’imagination, y vivre sous la brise bienfaisante, une quelconque scène de Fenêtre sur cour.
Dimanche 22 Juillet
Rollin’ in the deep ? Sur fond de grandioses architectures, à défaut d’avoir vu Big Ben, se trouve près de Victoria Station, une réplique de celui-ci, noir ébène et or, se détachant au premier plan sur les miroitements matinaux du verre et du métal.
Cap vers l’East End, loin au dessus de Tower Bridge. C’est ce qu’on pourrait appeler un quartier du Londres profond, du moins un Londres cosmopolite et dépenaillé, sans réel charme. Les maisons descendent à niveau d’homme. Plus rien de l’arrogante poussée vers les ciels de verre et d’acier. Du moins, nous les percevons dans les lointains, avec leurs grues statiques et prêtes à ordonner une prochaine étape dans leur ascension verticale.
Très vite, Brick Lane creuse une artère directrice dans ce quartier qui ressemble vite à un décor de cinéma, poussiéreux comme un village de western, tant paraissent improbables et fuyantes les rues perpendiculaires à cette avenue. C’est le Londres famélique des Bangladais, mais aussi de toutes les origines du monde oriental et africain, et c’est ce périmètre particulièrement choisi et délimité d’une ancienne usine de brasserie qui sert de vitrine à ciel ouvert au Street Art londonien. La moindre rue perpendiculaire à Brick Lane présente sur des murs décatis, des rideaux de fer métalliques, ou dans les culs de sac de cours abandonnées, des tranches de vie existentielles ou tout simplement des épisodes de rêve d’une vie meilleure. Nous sommes loin de la perfection technique d’un Ernest Pignon, le pape de ce type d’approche artistique, mais plus proche du journal intime et de l’anecdote éphémère. Les couleurs et les tracés fermes des dessins ou des coulées de peintures au pochoir rendent de ce seul relief vif et coloré une maigre espérance dans un univers de briques jaunies et salies sous l’amoncellement des abandons et des pauvretés.
A mesure que nous avançons dans l’avenue, la population se fait plus dense, quelques touristes s’étant risqués à l’aventure insolite, comme si au bout du chemin, le but fut d’atteindre le marché grouillant de cris, de bimbeloterie, de produits démarqués et d’étals de cuisines fortement odorantes.
Avec plus d’intensité encore, c’est en bout de Brick Lane que ce trouve la Truman Black Eagle Brewery, ancienne dépendance de l’usine de brasserie d’origine qui abrite maintenant un petit marché couvert de ses milles saveurs et de ses mille parfums de cuisines mongoles, lituaniennes, indiennes, d’Asie Centrale et d’autres encore du fin fond du monde. Comme un résumé culinaire du passage impériale de la grande Angleterre…
Le contraste n’en sera que plus fort quand, sortant de l’univers bariolé et grouillant de l’East End, nous reviendrons vers le ventre dynamique et froid de la City.
Depuis le début, je désirais m’approcher de ce fameux Gherkin, le suppositoire ou cornichon, qui semblait se dérober derrière d’autres architectures de même nature, tant la densité de celles-ci rivalise dans ce skyline du cœur de la ville.
Pour moi, qui est peu l’habitude d’un tel environnement à la verticale, l’impression fut grandiose. L’architecture tout en rondeur élancée sous le bleu du ciel de ce matin m’a fait réaliser que jamais je ne pourrais supporter de vivre à New York, ni même d’y passer un moment sous les accablantes verticales de ses constructions. Au risque de ne voir que Central Park ou de rester cloîtrer dans une chambre d’hôtel.
Comme souvent, bien qu’en en ayant eu le pressentiment, je me suis laissé tenter d’approcher et de lever les yeux vers ces masses formidables, et comme toujours, progressivement je fus pris de cet étrange mal de vertige qui agit sur moi, non seulement devant le vide d’un gouffre sous les pieds, mais aussi devant l’écrasante verticalité et l’affreux sentiment de la perte de ma propre pesanteur. Perdant toute notion de cette loi fondamentale, je m’imagine, dans ces moments, prendre le risque de me perdre dans les espaces comme un ballon d’hélium…
Il fallut de nombreuses minutes pour que, de retour vers des immeubles plus conformes à l’échelle humaine, je puisse faire disparaître cette angoisse du vertige et reprendre un meilleur rythme cardiaque.
Et c’est naturellement que nous avons rejoint Tower Bridge sous le ciel de midi, près d’un petit port de plaisance où nous avons déjeuner dans un restaurant indien.
Le temps se couvre et la promenade sur le pont se fait dans le fond des gris du paysage. Des navires vont et viennent sur l’eau devenue safranée de la Tamise.
Le soir venu, après quelques verres au Old City Arms, nous repassons, pour une longue flânerie, au-delà de Blue Anchor, et tout le long de Riverside de Lower Mall, sur l’autre rive du pont indien, somme toute le plus élégant et le plus beau que nous ayons rencontré, avec ses pinacles asiatiques, ses animaux, ses éléphants, ses arabesques de métal et ses décorations en bas reliefs, les reflets roses et blancs à l’heure du couchant sur l’agonie d’une Tamise crépusculaire, ses berges sauvages et les premières lueurs des pubs qui s’allument.
Sur le petit balcon, le vent léger et bienfaisant rend la nuit venue d’une douceur qui sent la dernière nuit ici.
Lundi 23 Juillet
C’est la matinée des statues, vers Grosvenor Road. Dès le lever c’est encore le plein beau temps et la promesse d’une journée torride. Grosvenor Gardens regorge d’espace verts et de statues en tous genres. Mythologiques, historiques et parfois burlesques. Comme le maréchal Foch avait été le premier londonien à venir me saluer, nous tenions à le revoir de près. Ce quartier est le lieu des ambassades et des consulats, des maisons calmes, les bâtisses sont traversées aux angles par de larges avenues où semblent se croiser tous les trajets des cars touristiques, allant et venant sur une sorte de ring, laissant peu d’espace pour la mémorisation des petits jardins que j’avais traversé vendredi dernier. A l’orée d’Hyde Park, des statues d’animaux s’entredévorant succèdent à des soldats de la Première Guerre. Plus loin, c’est Wellington à cheval, faisant face à des scènes de mythologie, Achille géant , l’épée à la main, la crinière au vent. Quelques Eros et des Adonis, flèche à la main, jusqu’à ce que notre promenade nous mène à cette scène typiquement britannique d’un éléphant soutenu, en position d’équilibriste, par un clown au chapeau d’Auguste qui le soulève par la trompe avec force contorsion.
Une belle avenue rectiligne et bordée de ces si beaux arbres dont Londres sait être prodigue nous mènerait vers le Mémorial Canadien, visiblement installé dans la paix profonde d’un parc gigantesque, mais nous éloignerait considérablement des dernières statues auxquelles nous tenons à dire au revoir.
Il est étrange de se fier à une première impression. Lorsque je pénétrais il y a encore peu dans ce quartier où le car devais me déposer à Victoria Station, j’étais persuadé que la statue de Foch était à distance respectable derrière moi. En fait, ce dernier matin, nous étions à quelques cinquante mètres de la fameuse statue équestre après la sortie de la gare. C’est le car qui avait passé de longues minutes dans les embouteillages qui m’avait donné l’impression que le temps s’était étiré. Et les illusions de l’espace avec. Nous avions donc tourné longtemps autour, pour y revenir en fin de parcours, faute d’avoir manqué l’angle d’une rue.
Sur le socle de Foch en position de parade il était écrit sur un des flanc, Il aura aimé et servi notre pays comme son propre pays.
Je n’aime pas particulièrement la langueur qui se dégage des espaces tranquilles et comme au ralenti dans les parcs. Elle me donne, à défaut d’en apprécier la douceur et la quiétude, l’impression d’une vie diminuée dans un jardin d’hôpital.
Mais n’ayant pas visité l’immense Regent’s Park, il était naturel de nous rendre, ne serait-ce que pour le traverser, le Saint James’s Park que Cécilia avait particulièrement aimé en arrivant. D’autant qu’en fond de perspective se trouve Buckingham. Et plus loin, Green Park. Le parc regorgeait ce matin d’oiseaux en tous genres. De hérons, de cygnes blancs, de poules d’eau, de pélicans et de myriades de goélands.
J’imaginais les parcs anglais dans une éternelle richesse florale et vêtus de leurs impeccables gazons, mais il faut reconnaître que les étés suffocants frappent aujourd’hui autant le pays que nos terres de Méditerranée. Tous les parterres de Saint James avaient la couleur de l’herbe brûlée et sentait la poussière du matin. Seuls quelques gigantesques arbres centenaires maintenaient l’ombre sur le parc.
Emergeant d’une perspective s’étalant loin au travers d’un long bassin tapissé d’herbes jaunes, la façade du Palais de Buckingham. C’est tout naturellement, en nous dirigeant vers lui que nous tombons sur la garde royale, sans l’avoir vraiment voulu, ni encore moins avoir prévu l’heure de la relève, dans son habituel apparat de rouge et de noir, sous un ciel à faire briller de mille feux les épées et les cuivres qui semblent danser, au flanc des uniformes, une danse de miroir.
Londres est un pays où l’on aime pas les fontaines. On pourrait y mourir de soif. Depuis les grilles du Parc de Buckingham, jusqu’à Trafalgar Square, sur une très longue avenue rectiligne, longeant Green Park, pavoisée de part et d’autre du drapeau britannique, ce qui lui donne une inimitable allure protocolaire, le Mall, aucune fontaine jaillissante, ni ici ni ailleurs, aucun bassin apaisant les fureurs de l’été. Peut-être à Trafalgar y a-t-il des bassins, mais l’eau n’y coulait pas aujourd’hui. Peut-être que les bienfaits du ciel tombant ici toute l’année en abondance dispensent la ville de se doter de ce qui fait le charme urbain de Rome et de Paris.
Trafalgar, Waterloo, l’amiral Nelson en gloire au sommet d’une colonne… c’est bien simple, dans la symbolique menant de Buckingham à Trafalgar, c’est toute la litanie des victoires anglaises sur la France qui est récitée. Y a-t-il en Allemagne des signes si évidents de nos Histoires qui se tournent le dos ?
Piccadilly Circus possède une fontaine. L’eau n’y coule pas. Seuls les détritus regorgent dans le bassin où les touristes s’asseyant sur les marches paraissent avoir atteint le but de leur voyage.
King’s Cross Station, puis le Saint Pancras, victorien en diable, du plus rouge et du plus cossu de ses briques.
C’est au Ravi Shankar, que nous déjeunons avant de rentrer boucler les valises à Hammersmith.
Londres est la capitale la plus peuplée d’Europe et la plus étendue avec Berlin, mais elle enserre plus qu’elle n’étreint le voyageur. Elle ne rend pas l’eau jaillissante qu’elle reçoit du ciel, bien que ses parcs et ses arbres soient plus nombreux que dans beaucoup de villes européennes.
Et puis je n’ai pas trouvé trace de ce quartier boisé et tranquille que j’avais eu tant de mal à situer lorsque j’étais à la recherche désespérée de Célia. En quarante quatre années, la ville s’est métamorphosée comme partout. Mais Londres a fait le pari du verre et de l’acier à l’assaut du ciel dans le cœur même de ce qui a fait son Histoire, ses contes et ses légendes, sa littérature. Elle paraît vouloir s’asseoir sur une amnésie qui serait le prix de son renouveau. Londres a brûlé, et même le fog aurait disparu. L’Angleterre est sorti du serpent de l’Europe. Probablement que c’est un bon pari. Le dynamisme et l’implantation de capitaux n’en affluent pas moins avec la création de sociétés initiées par des européens qui tentent leur chance ici.
Sans avoir le charme immédiat de Paris, de Rome ou de quelques autres vénérables ville d’Histoire, Londres n’en est pas moins, lorsque on est attentif à ses bruissements nocturnes, près de la Tamise, d’un certain pont indien, le long de ses rives à la nuit qui tombe, scintillante et solitaire à l’heure où s’allument sur ses berges, les premières lueurs des tavernes sur des reflets roses et argent.
…………………………………………………………………………………………
27 Juillet
Ce soir, éclipse de Lune. Mars en mal d’amour… trente cinq mille ans, trente cinq millions d’années ( !?) sans rendez-vous…
………………………………………………………………………………………
Rudepoêma de Villa-Lobos se veut être un portrait psychologique d’Arthur Rubinstein. Il n’est pas étonnant que ce soit si complexe.
………………………………………………………………………………………..
La Marseillaise n’aurait pas été composé par Rouget de l’Isle, mais par Ignaz Pleyel, lui-même inspiré par le thème d’un concerto pour piano de Mozart…
…………………………………………………………………………………………
2 Août
C’est une œuvre fascinante sur laquelle je ne pouvais mettre un nom. L’espace d’un instant je pensais, en me laissant surprendre positivement, à quelque œuvre qui aurait été conjointe à l’inspiration d’Iberia de Debussy, autant dans l’extrême liberté de forme que dans la fluidité de l’orchestration. C’était Khamma, ballet égyptien, composé vers 1912, qui correspond bien à la même période qu’Ibéria sans en avoir eu le retentissement.
………………………………………………………………………………………… L’UPIC
(Unité Polyagogique Informatique du CEMAMU : Centre d’Etude de Mathématique Automatique Musicale)
C’était en Février 82. Le matin qui précéda le concert de la Galerie des Ponchettes, je fus convoqué dans cette salle où quelques heures plus tard nous serions des centaines à assister à un des évènements musicaux qui ont marqué le début des années 80.
C’est Jean Etienne Marie qui me reçoit et me dit : « Vous n’avez pas même pensé à donner un titre à votre œuvre ! »
Presque sans hésiter, je me revois lui répondre, tout autant par agacement que parce que j’avais été le seul à me rendre à cette convocation : « Chronochromos ».
Jean Etienne Marie était à la fois l’organisateur de l’événement, mais aussi un des compositeurs et théoriciens parmi les plus méconnus dans la sphère électroacoustique autant que redoutés pour sa complexité dans l’approche scientifique des phénomènes acoustiques (L’Homme musical, 1976). Il était entre autres, compositeur de musique en quart de ton, créateur du Centre International de Recherche et de Musique Contemporaine et du Festival annuel des Musiques Actuelles Nice Côte d’Azur (MANCA). Il venait de la génération de Pierre Schaeffer (1910).
Ce concert avait été rendu possible par l’initiateur extraordinaire qu’était Iannis Xenakis, créateur de génie et lui-même inventeur de cet UPIC, sur lequel nous avions travaillé en stage durant quinze jours.
En gros, l’Upic est une tablette graphique, reliée à un ordinateur, avec un affichage vectoriel. L’utilisateur dessine les formes d’ondes et les enveloppes de volume, traitées ensuite par l’ordinateur. Une fois les formes d’ondes enregistrées , on peut « dessiner » des compositions sur la tablette, par les hauteurs, les durées, les attaques et les intensités ainsi sélectionnés. Combien de fois avons-nous buté et hésité sur le choix des enveloppes et des périodes !
Le but du concert était, en fin de parcours, de révéler au public les étranges possibilités qu’offrait cette organisation électroacoustique. Le stage avait été ouvert à divers groupes d’artistes représentatifs de plasticiens, musiciens et pédagogues de la région, sélectionnés par la Direction de la Culture de la Ville de Nice. Huit équipes avaient donc travaillé, dont la notre, au titre de musicologues et médiateurs en liaison avec l’Education Nationale.
Chronochromos était né dans la difficulté qu’ont les œuvres à s’épanouir lorsqu’il s’agit d’un produit collectif. Il allait de soi d’ailleurs que cette œuvre ne pouvait en être une et n’était que le fruit laborieux de quinze jours de manipulations, d’expériences et d’essais plus ou moins hasardeux. C’était au mieux le reflet expérimental de notre passage à la Galerie. Et bien qu’ayant eu la chance de travailler avec Julio Estrada, initiateur du moment, disciple et second de Xenakis dans cette aventure, j’avais de grandes appréhensions quant à la présentation de ladite œuvre devant le public.
Pour plus de confort et pour une meilleure lisibilité de nos essais sonores, il avait été prévu un montage audio-visuel de présentation par diapositives, où notre équipe figurait en plein travail devant la tablette de liaison, ou répondant à des questions de journalistes, ou tout simplement par deux ou trois d’entre nous sur des clichés, souriant afin que le public nous situe dans l’unité que composait ce groupe des musicologues. Les portraits et les images de travail devaient défiler pendant toute la durée de l’œuvre (huit minutes environ) à défaut d’avoir pu illustrer tout ça par de plus somptueuses œuvres d’art accompagnant la bande son.
Le hasard voulut qu’après un tirage au sort, la première équipe d’artistes à présenter son œuvre fut la notre. Ce qui ajouta plus encore à l’anxiété et à la prévisible déroute pressentie. D’autant que par un autre extraordinaire hasard je me suis retrouvé durant toute la soirée assis à la droite de Xenakis qui apparut comme une ombre au milieu de centaines d’étudiants, de groupies, de curieux et d’amateurs de ces musiques souterraines, assis un peu n’importe où, sur des coussins improvisés, à même le sol ou debout près de la porte d’entrée, tant la Galerie était saturée de ce public qu’on n’imaginait pas si nombreux le matin même du concert.
La légende a retenu qu’il y aurait eu autant de monde à l’extérieur qui n’avait pu pénétrer dans la salle.
Les quelques huit minutes que dura le déroulement des couinements, des ellipses et glissandis de sons, les tornades multicolores et les fusées hasardeuses si peu maîtrisées de la monstruosité qui éclaboussait maintenant tout le monde, me glacèrent le sang comme si l’œuvre devait durer une éternité. D’autant que j’imaginais le silence du public comme une politesse à l’égard de Xenakis à côté de moi, immobile et impassible. Mon désarroi était à la mesure de la honte que je ressentais.
Et dire que le Poème électronique de Varese dure huit minutes pensais-je, essayant de trouver une raison à cette folie…
Huit minutes plus tard donc, après une légère hésitation qui parut durer un temps infini, ce fut un tonnerre d’applaudissements, de cris , de sifflets d’enthousiasme que je n’osais pas même regarder Alain Jacquot ou un autre des co-auteurs qui avait commis avec moi un tel enfantement.
Inutile de dire qu’aucun autre groupe ne provoqua un pareil enthousiasme, privilège que l’on doit au fait d’être passé en premier et que la répétition des surprises ne peut qu’amoindrir la réception d’une sensation initiale. Xenakis eut la gentillesse, derrière un sourire qu’on ne put interpréter, d’applaudir lui aussi.
C’était donc l’entracte, et comme je sortais sous la nuit descendue, comme enfin libéré, je vis une horde de personnes m’entourer, dont une fille qui fréquentait comme moi Chez Jacques, qui ne me parlait jamais, venir m’inonder de son admiration, posant d’infinies questions auxquelles elle répondait dans le sens où elle n’avait jamais douté de la profondeur de ma créativité et de tant de talents cachés.
…Qu’avais-tu à dire vraiment, derrière la profondeur de tant d’énigmes ? Quelle musique ! c’était vraiment inouï !…
C’est la seule fois de ma vie que j’approchais la solitude de ceux qui sont admirés pour ce qu’ils ne sont pas.
Dans la naïveté et le manque de confiance qui étaient notre lot en ces années-là, aucune photo n’est venue témoigner de cette soirée. Pas plus que la bande enregistrée qui a longtemps dormi dans des cartons avant de disparaître…
Jean Etienne Marie, en seconde partie de concert, y alla d’une œuvre bien écrite, austère et d’une sécheresse rythmique et toute dépouillée à ce qu’il m’en souvient, sans effusion, parlant la langue démonstrative du théoricien.
Par le génie d’un seul, l’évènement méritait d’avoir eu lieu. Xenakis présenta Mycenae-Alpha.
Là, sur l’écran, pendant que le fleuve des sonorités, réellement inouïes, se déroulaient comme autant de plages de temps tantôt étirées, puis déchirées, à l’image du visage de Xenakis, la partition s’inscrivait visuellement, dans toute la complexité et la grandeur antique de la tragédie, en des myriades de signes minuscules, serrés et nerveux, en masses ondulantes et torrents compacts, en nuées stochastiques, qu’elle révélait dans la beauté même de sa graphique toute la force de ce flux acousmatique qu’aucune formation instrumentale traditionnelle n’aurait jamais su traduire. C’était beau comme le fracas que peut faire la banquise qui s’effondre, théophanique.
………………………………………………………………………………………
6 Août
Anniversaire d’Hiroshima… Je regardais avec effroi quelques youtube concernant Xenakis, notamment les habituelles réactions des auditeurs. Je reste consterné d’abord par le fait que toutes les réactions viennent d’un public visiblement anglo-saxon, familier d’un univers plutôt Rock and Roll… Pour la plupart négatives. J’en ai déduit, en fouillant bien dans le lot des réactions (souvent lapidaires), que ce public n’a d’autres références, dans le meilleur des cas, que par le biais d’images de cinéma ( Jack Nicholson dans des scènes de folies, 2001 Odyssée de l’Espace ), à défaut de situer Xenakis sur le vecteur historique de l’Histoire de la création, que d’autre part, les impressions premières trahissent bien l’absence de culture des youtubeur qui n’appréhendent ce qu’ils écoutent que si s’ensuit une émotion qui serait le garant de la qualité de ce qui leur est proposé. En simplifiant, je dirais que si une émotion me fait sortir de moi-même, c’est que la chose entendue a une valeur. La réciproque vaut également. Je ne ressens rien, donc cela n’a pas d’intérêt. Combien d’émotions, dans d’autres domaines, sont-elles sujettes à une vraie hauteur spirituelle qui les provoqueraient ? La réponse serait surprenante.
L’émotion peut être subie, au contraire, dans le cas de phénomènes les plus élémentaires et les plus consternant (foule prise en délire collectif dans certains concerts de rock, frénésie cathartique lors de match de football, grande messe oratoire nazie, etc.) L’illusion. Ce qui ne donne donc pas à l’émotion la garantie d’étalon de la qualité et de la valeur d’une chose.
D’autant que l’émotion est mouvante, sujette à évolution.
D’autant que l’émotion s’émousse par la répétition de ce qui la provoque.
Si Parsifal était diffusé dans un désert auriculaire, sans public pour témoigner, la valeur de sa partition n’en serait pas moins ce qu’elle est. Un monument musical.
Si les Variations Golberg étaient tout simplement restées dans les tiroir de Bach, elles n’en seraient pas moins les chefs d’œuvre du genre.
Si la seconde sonate pour piano de Boulez n’engendre que sarcasmes et répulsion d’un certain auditoire, elle n’en est pas moins héritière des ultimes sonates de Beethoven.
Si l’Everest était passé outre la connaissance des humains, il n’en serait pas moins le toit du monde.
Et le beauté du monde n’en serait pas moins ce qu’elle est avant la venue d’Adam et Eve pour s’en extasier.
La musique de Xenakis évoque un univers en gestation, la création du monde dans une violence aveugle, l’invention de la géologie et les magmas en fusion (Kraanerg), les abysses insondables du cœur des hommes. Elle le dit avec la force des cataclysmes.
Certes, l’émotion devrait être grande.
C’est lui qui fait corps avec Hiroshima, Auchwitz,Tchernobyl.
Xenakis, sur les cimes de la création de la fin du XX°, n’attend pas plus son heure auprès d’un public qui ne pourra jamais le comprendre que Beethoven n’élargira le sien.
Le premier jugement qu’on porte sur un événement neuf est toujours dépendant d’une série de critères antérieurs appartenant à un mode de sentir.
(Comment aimer Xenakis quand on est exclusivement amateur de variétés, de rock, ou même de Classique tel qu’on l’entend habituellement ?)
C’est le paradoxe de ce monde globalisé, mondialisé, qui formate suivant des normes qu’il entend imposer, et qui laisse fragmenté un monde qui ne connaît que le chemin que tracent les rails de nos différences.
………………………………………………………………………………………
En cinq années de Philosophie Universitaire, nous sommes systématiquement passé de Platon à Kant. Rien de mille années de Moyen Age. Pas un commentaire sur Saint Augustin. ………………………………………………………………………………………..
9 Août
DE L’ODEUR DU LIVRE A L’AMAZONIE DE LA BIBLIOTHEQUE
Comme par paradoxe, du bois des arbres qui font les livres, nous avons perdu le parfum des librairies de nos provinces. Certes l’odeur du papier neuf et celui de la colle subsistent encore. Nous sommes entré depuis longtemps, ironiquement par le plus grand des diabolismes, dans l’empire de cette Amazonie qui ne se contourne pas. Paris demeure encore un des royaumes où les professions du livre se rencontrent au cœur de la ville, où le plaisir de respirer ces parfums existe comme on respire dans un lieu ami, une maison qui vous attendait.
La première mort de la librairie est venue dans nos provinces lorsque le premier Empire trotskiste militant pour la Culture a fait main basse sur les boutiques multiples qui foisonnaient dans chaque ville, la plus petite soit elle.
Nice a connu avant ce fatal jour de Mars 82, et l’ouverture de son centre de Fédération Nationale d’Achat des Cadres (ça sonne déjà terriblement loin du Lys Rouge , ou de l’immanquable Nain Bleu, mais plutôt comme la réserve de plomb d’un arsenal prêt à dégoupiller), tout un ensemble de librairies, des plus grandes aux toutes petites qu’on visitait quand les autres n’avaient pas pu satisfaire aux désirs du moment. Dans le seul périmètre du centre de la ville se trouvaient la Sorbonne qui faisait office de locomotive et de première de la classe, le Nain Bleu déjà cité, qui se verra doublé plus tard par un Nain Jaune à quelques pas de l’Avenue Jean Médecin. Mais aussi la Librairie du XX° siècle sur le cossu Boulevard Victor Hugo, la librairie Rudin, dont Jean-Pierre le propriétaire, fut un des grands lecteurs, prosélyte et ami de Jean Giono qui lui dédiera plusieurs ouvrages. On pouvait parler avec Monsieur Rudin dans sa boutique du Désastre de Pavie, parce qu’il avait réellement lu l’ouvrage. Nice avait tant de havres du livre que je n’en dresserai pas la liste.
Il y a encore au Boulevard Gambetta ce vestige de la Librairie 33 qui subsiste au travers du 33 de sa poignée tout effilée, où ma mère achetait les Pléiades qui récompensaient aux grandes occasions.
Tout cet univers du Livre a muté en peu de temps. On pourrait penser qu’il s’agit d’une évolution, tant dans la distribution que dans la diffusion par point de vente. Ce qui n’aurait été finalement qu’un réaménagement et une rationalisation nouvelle des habitudes pour les lecteurs que nous avons été.
Mais l’empire est tentaculaire. Les librairies ont disparu, remplacées par des supermarchés du livre, du disques, de tous les produits de Culture, centralisés dans des locaux sur plusieurs niveaux mais où l’âme du libraire, du disquaire ont disparu, remplacée par l’ignorance des petits soldats de l’armée couleur moutarde, plus préoccupés d’étiqueter, de ranger, de remplacer les produits que de se voir à l’écoute du public, et de connaître vraiment ce qui se trouve être plus que de simples objet à vendre.
Une triste anecdote peut définir le niveau d’une situation qui, si elle n’était pas dramatique, serait d’un réel comique : demandant une Passion de Bach, un client se voit répondre par un des soldats de l’empire en question : « lequel, J.S. ou Offen ? »
L’Amazonie a frappé plus fort encore. On nous refuse aujourd’hui la possibilité de respirer, de palper et de feuilleter l’objet. Encore faut-il être sûr de savoir ce qu’on désire. Balzac ou BHL ?
Le vrai plaisir de la librairie était d’y pénétrer sans savoir parfois ce qu’on allait y chercher, et encore moins y trouver. Il suffisait, au hasard d’un rayonnage, de se laisser inspirer par la couverture de l’ouvrage, de passer des livres d’Histoire à celui de la littérature médiévale. Il suffisait aussi que le libraire bienveillant vous parle de ce qu’il venait de découvrir qui pouvait vous intéresser.
Aujourd’hui, l’Amazone vous questionne. Que voulez-vous ? Nous pouvons tout pour vous.
La rationalisation veut que vous sachiez , par avance, ce que vous dicte votre désir. Celui-ci n’a plus le droit à l’incertitude. C’est Balzac ou c’est BHL que vous cherchez ?
Cliquez. La boutique d’Ali Baba vous comblera.
Ma possible nostalgie se souvient que du temps des vraies librairies et des vrais disquaires, je ressortais avec un livre d’un auteur inconnu, ou à mon grand étonnement, je découvrais un opéra de Janacek parce que le spécialiste du lyrique avait su éveiller en moi ce besoin d’acquérir ce nouveau venu.
Nous revendiquons donc le droit de rêver et de se faire surprendre avant celui de savoir à l’avance. Comme devant des fruits dont on ne connaîtrait pas encore la saveur.
Avec l’Amazone vous êtes devant un bottin du trouvetout à condition, en amont, de savoir ce que vous voulez, étant entendu que vous connaissez déjà Balzac et BHL.
Et puis vous serez livré par la Poste, si tout va bien.
Le plaisir, en se rationalisant, se voit donc différer à demain ou au mois prochain….
Comme une fête à distance, un Noël sans lumières dans la boutique à rêves, et sans cadeaux pour tout de suite….
Le totalitarisme de la commande. Certains achètent même leurs chaussures sans les avoir essayées…
Et pourtant, comme en 68, nous voulons ce que nous voulons, ou ce que nous venons de découvrir, charnellement, tout de suite.
L’amateur de livres ou de musique est souvent comme la femme qui entre dans un magasin et qui en ressort avec autre chose que ce qui avait été prévu initialement.
Heureusement il existe encore des librairies. Des refuges ultimes comme la Librairie Masséna, celle de Jean Jaurès, qui vivent de ceux qui ont connu ces plaisirs de la tentation du papier qu’on touche, de la couverture qui sent le neuf et du choix hésitant.
Vais-je prendre ça ou ça ? Le cœur battant d’hésitation.
Pour combien de temps encore ?
Reste l’arrière garde ultime pour amateurs d’objets, l’archéologue du genre, le bouquiniste, comme on va à la casse.
L’amateur de musique enregistrée est dans une situation bien plus triste encore. Il n’a le choix que de l’Empire démuni d’âme ou celui du virtuel fournisseur. Et l’informatique permet plus encore.
Dans notre univers hyper matérialisé, pour ce qui est des objets de l’âme, paradoxalement ceux-ci avancent vers la totale dématérialisation. Pour la musique c’est fait depuis longtemps. Elle flotte dans les airs, sans support aucun. On peut même acquérir un air de la Walkyrie pour 1 euro ou à peine plus. On peut se composer son propre best of. On peut se composer dix mille titres de deux minute trente comme autant d’amis sur Facebook.
Le plus inquiétant est que l’électronique détecte rapidement votre profil de consommateurs et vous propose, par retour de courrier, un échantillonage de ce qui correspond à vos penchants, à ce que son cerveau déduit de votre manière de penser, par recoupement et par associations de types d’objets commandés. Le robot mis en place ne tardera pas à avoir bientôt un contour très précis de ce que vous êtes. Ce qui pourrait intéresser nos politiques en matière de profil si ces fichiers transitaient par leurs soins.
Mais le livre électronique est déjà en marche. Il n’a pas d’odeur. Il vit pour l’instant de sa vie parallèle, mais c’est sûr, l’avenir est à lui.
…………………………………………………………………………………………
Le Romantisme des amours à la Werther, et de tout ce que le XIX° siècle fera surgir de pureté de sentiment, n’est qu’une réaction à ce temps des alliances royales, ou les mariages et les unions étaient avant tout des affaires de hautes diplomaties et de stabilité pour les états. Rendre dans toute sa pureté l’idéal subjectif du sentiment à la place des impersonnelles et froides alliances monarchiques, tels ont été les modèles à venir et les moteurs du Romantisme naissant.
…………………………………………………………………………………………
12 Août
J’apprends par un article anodin que Clément Rosset est décédé le 28 Mars de cette année. Trouvé mort dans son appartement parisien. Seul probablement. Encore un jalon de mon passé qui s’en va.
………………………………………………………………………………………..
15 Août
Ce soir c’était « The Big Trail », bizarrement traduit par « La Piste des Géants ». Une des gloires du genre, souvent mésestimée (pas même cité dans « Les Cent plus Grands Westerns – Marabout »). Dans les premiers plans on ne reconnaît même pas John Wayne. La voix juvénile n’avait pas encore le timbre si caractéristique qu’on lui connut plus tard. C’était le premier rôle majeur que lui offrait Raoul Walsh (1930). Il est aux côtés de Marguerite Churchill, plus exquise que beaucoup de celles qui feront plus manifestement l’Histoire du genre. On sent encore l’actrice de cinéma muet, la présence et le regard de braise sous les sourcils à la Lilian Gish ou Louise Brooks. Le noir et blanc accusant et burinant les reliefs et les faciès, les indiens pourraient être sortis de l’imagerie ethnologique de Edward S. Curtis, et le film laisser croire à un réel documentaire sur les pionniers de la conquête de l’Ouest. Les plans larges dessinent les nuages, les avancées fantomatiques de la caravane sur les immenses plaines, les séquoias de la scène finale et la neige de l’Oregon irréels. Notamment cette scène de tempête de neige, une des plus grandioses réussites réalistes en décor naturel. C’est aussi le cœur du film, quand John Wayne dans la tourmente exhorte les aventuriers exténués : « Nous ne pouvons renoncer, nous ne pouvons revenir en arrière, c’est la vie qui nous mène. Le début de l’aventure a commencé en Angleterre, aujourd’hui nous construisons une Nation. » Griffith n’était encore pas loin dans les souvenirs. Dans les westerns qui viendront après, les décors, les scénarios très resserrés sur de maigres situations prévisibles, sentiront toujours un peu le travail en studio et l’épisode anecdotique. Là nous sommes plongés au cœur de la Conquête (la leçon d’Histoire que prodigue la belle héroïne à sa sœur : combien y a-t-il d’étoiles sur la bannière ?
Que veulent dire les treize bandes horizontales ?… Il n’y a encore dans sa leçon que vingt six étoiles…)
Le film réussit ici à fondre dans le même élan, sans laisser visible la moindre couture, la somptueuse virginité des grands espaces, l’inexorable marche en avant du convoi, l’inévitable romance, les rivalités humaines et en contrepoint, l’humour des personnages secondaires. Pas un seul duel face à face au revolver.
The Big Trail ne serait-il pas le plus pur western, celui qui justifierait l’histoire du genre ?
Mais n’est-ce pas déjà un grand poème épique ?
……………………………………………………………………………………….
Délectation, toujours dans Noë : « Le tramway d’Aix-Marseille n’est pas une entreprise de transport, c’est un pastiche mécanique d’un chant de l’Arioste ».
……………………………………………………………………………………….
19 Août
Lacan a consacré un volume entier de son Séminaire à l’Ulysse de Joyce. Sinthome. Déjà qu’Ulysse est illisible… C’est un terrain miné pour le lecteur. Du pain béni pour l’analyste. Je sais que certains Irlandais n’ont pas abondé dans la lecture et l’interprétation donnée du séminaire. Encore faut-il maîtriser Joyce et savoir contredire Lacan (et inversement). Je me contenterai d’ouvrir les coulisses de l’Envers de la Psychanalyse (volume XVII)…
…………………………………………………………………………………………
En son temps, le Président Bourguiba a dévoilé le visage des femmes. Ce qui ne l’a pas empêché de soutenir ses voisins, contre la France dans les années 57/58, les futurs maîtres de l’Indépendance algérienne, futurs promoteurs de l’Islam d’aujourd’hui.
…………………………………………………………………………………………
Au Sauveur, une inconnue, une femme volubile et belle (venant d’Evian), quelque peu sûre de ses charmes, m’affirmait au creux de l’oreille que les femmes n’avaient que des besoins et les hommes des envies. Cela n’a pas fait retomber ce reste de canicule qui finit par mourir par vague, comme l’été s’en va à coup de Desperados .
………….
Et sur le thème parallèle du bonheur, j’ai toujours su le sillon qui devait être le mien, au risque des sarcasme ou du vide qui s’opposaient par ceux qui m’objectaient des voies différentes.
Ma vie à ce jour n’a traversé que les jalons de la vie raisonnable et heureuse, bien que des folies aient nourries tant de mes nuits insolvables au grand absolu des romantismes.
Sur ces lierres traversant la permanence de mon chemin, je ne me suis jamais permis, en plus, l’insolence désespérée de ceux qui cherchent aussi à gagner au jeu !
…………………………………………………………………………………………
21 Août
DE MUSIQUE ET D’ETE
Le serpent médiéval et baroque ressemble étrangement au timbre du tuba. Avec une flexibilité plus grande. Patrick Wibart en joue aujourd’hui en virtuose. Autour du cou ça peut ressembler à un énorme boa…
…………..
Charles Valentin Alkan, musicien pianiste, sorte de Liszt français, auteur de très certaines belles Etudes pour piano, considérait le Talmud au-dessus de toute pensée spirituelle.
Il rangeait son gros volume sur le tout haut d’une étagère, au-dessus des autres livres. Un jour qu’il voulut le prendre, grimpant à un méchant escabeau, il chuta à mort. D’un simple accident de travail.
…………..
Tous les chanteurs canadiens à fort accent québécois n’en ont plus lorsqu’ils chantent. C’est le cas de Marie Nicole Lemieux. C’est ce qui s’appelle la discipline professionnelle. Ou le dédoublement de soi. Ce qui n’est évidemment pas le cas des interprètes anglo-saxons.
Mais cette Lemieux, qui regorge de ressources est aussi une remarquable imitatrice, irrésistible en Véronique Sanson dans son numéro de chevrotement vocale.
Lemieux dit n’être jamais meilleure que dans sa loge. C’est ce qu’on appelle de l’humilité.
……………
N’est-il pas vrai que la musique, l’amour, le monde ont commencé dans ce XX° siècle avec le Prélude à l’après-midi d’un faune ?
…………..
L’essence de la musique de Webern est un accès à l’inconscient incandescent de l’âme qui se cherche.
Comme aussi Pélléas.
Comme aussi la Grande Fugue du dernier quatuor en fa de Beethoven, et aussi le Ricercare à 6 de l’Offrande Musicale, une tectonique d’orgue sous les voûtes de Saint Maximin.
Et aussi Gabrieli à Venise
Et aussi Diabelli
Et aussi…
……………
L’apport de Lacan aux profondeurs de la langue : « laisser en plan/ laisser gésir ».
Entre les deux, l’énigme, la volatilité du réel.
……………
Le temps me restera-t-il pour saisir la portée des icônes absolues que sont Pandit Mallikarjun Mansur, Pandit Kusmar Gandharva, Bade Ghular Ali Khan, Faiyas Khan Sahis, Hariprasad Chaurasia. Les abysses des âmes qui tremblent.
……………
Webern, un roman dans un soupir disaient-ils. L’envers de Thomas Mann, Hermann Broch, Musil… Enfin un soupir.
…………….
Personne ne connaît vraiment Hans Roth. C’était un proche et ami de Gustav Mahler et de Hugo Wolf dans la Vienne fin de siècle. On a donné à Paris il y a peu, sa Première symphonie qui a la couleur très nette des grandes fresques de Bruckner, et certains thèmes consciemment cités de Wagner apparaissent en un tissu large et martial. Proposée à la lecture de Brahms, celui-ci n’apprécia pas du tout et le fit savoir avec hauteur au jeune compositeur qui en conçut une vraie rancune.
Plus tard, dans un train sur le chemin de Vienne, on aperçut Roth un revolver à la main, dans un état d’agitation inaccoutumé : « Alerte ! Brahms a dynamité le train ! » . Le voyage se termina donc à l’asile psychiatrique.
…………………………………………………………………………………………
23 Août
« « Nœuds de vipère », « Vipère au poing », des affaires de terres bordelaises et de landes bretonnes.
…………………………………………………………………………………………
…Et ils donnèrent cinq Sisley pour un Picasso. Approximativement.
…………………………………………………………………………………………
24 Août
Eward Curtis dit avoir photographié une danse des indiens Kwakiutl restaurant une éclipse de lune.
Les deux extrémités de la nostalgie photographique c’est d’abord Eugène Atget, dans un Paris nu et désert, dans les petits matins ou la fin du jour, qu’il n’en reste que l’architecture comme décor solitaire, tant le temps de pose est long que l’image d’un quidam en mouvement ne donne plus parfois que le fantôme de lui-même. Une ombre qui n’a plus d’existence, comme ces lumières d’automobiles traînantes en vitesse accélérée sur les grandes avenues qui font un train non identifiable de couleurs rouges ou jaunes.
Chez Curtis, au contraire, c’est la présence matérielle et active dans une nature vierge et quasi infinie qui soulève la réalité sociologique, et portraiturée de multiples fois, de groupes ethniques vivant lorsque la Terre était encore jeune.
…………………………………………………………………………………………
CLAIR (TRES) CLAIR DE LUNE
Hier encore… On parle souvent de demi-sommeil. Hier la nuit était à la pleine lune. Les grandes chaleurs nécessitent qu’on laisse la croisée des fenêtres entre ouverte. C’est par là qu’apparaît la lumière nocturne, blafarde, pénétrant en un rayon, disons de dix centimètres de large, dans la phase de l’endormissement, ce faisceau clair me traversant à hauteur du visage. Mes yeux s’engourdissaient dans un état de conscience à peu près proche du coma, c’est à dire que je voyais l’environnement de ma chambre, je sentais les ombre proches, la blancheur du rayon de lune sur les draps, et que mon corps dans cette phase intermédiaire ne semblait plus porter le fardeau de ses douleurs et ne plus sentir ce poids qui fait qu’on cherche toujours la bonne position avant de se laisser envahir par le sommeil. Au contraire, celui-ci paraissait ne plus peser, et être comme porté par une douce apesanteur. Cette fièvre hypnotique fait penser à une anesthésie qui n’aurait pas complètement fonctionné. Les yeux mi clos, je continuais de voir les clairs obscurs environnants, souvent des formes hostiles et indéfinissables, et voulant les chasser, la motricité de mes membres restait seule à avoir répondu au poison anesthésiant. L’esprit, dans cette confusion et cette absence de coordination entre la volition et son exécution, n’étant absolument pas hors de conscience, ou hors de cette conscience subtile située entre deux moments d’interprétation de celle-ci. Seule ma respiration difficile et troublée, que j’écoutais et que j’essayais de régler sur une plus grande régularité du souffle, semblait ne pas être en phase avec cette hypnose du corps. Je vivais, mais peut-être n’est ce pas ainsi que se produit habituellement le processus du sommeil, une sorte de ralenti du mouvement mental qui précède celui-ci. C’est le moment où l’on paraît lutter contre les ombres de soi-même. Dans ce demi sommeil infiniment long, cette paralysie des membres désirant chasser l’angoisse d’un danger extérieur me rend en ce moment précis démuni de toute défense adéquate. Jusqu’à ce que la diffusion de la bande lumineuse lunaire, intense et tranchant sur la pénombre, se soit vue consciemment déplacée hors des limites de mon visage, et remontée progressivement vers les espaces supérieurs de la chambre. La lune s’en allait donc poser plus loin l’opium de ses pouvoirs, me laissant dans la douce certitude que mes yeux allait enfin se fermer.
…………………………………………………………………………………………
26 Août
Cécilia propose d’aller longer le Loup. La matinée est encore bien respirable. Il n’est pas neuf heures. La berge que nous empruntons depuis les Ferrayonnes trace un long serpentin séparé de la rivière par de minces plages de galets, des roseaux et des arbres à la tête pensive. Les méandres nous mènent au travers de petits tableautins à mi chemin entre une réminiscence de Venise et un Marais poitevin alangui aux maisons calmes et aux petits canots amarrés en contrebas des jardins, jusqu’à l’hippodrome où le chemin émerge exactement entre Cagnes et Villeneuve. Après ce sont les plages, bien aménagées, de beaux restaurants protégés à l’ombre de gros arbres, où nous poursuivons ainsi jusqu’aux premières Marinas avant le début d’une nouvelle journée de lourd soleil.
…………………………………………………………………………………………
C’est une photo qui à elle seule sera la quintessence de tout ce qui a pu être dit, témoigné et pensé depuis cinquante ans sur Mai 68. Ce noir et blanc de Cohn-Bendit goguenard et provocateur face à un représentant de l’ordre casqué et juché trente centimètre plus haut et vu au quatre cinquième de dos.
La lumière d’abord, portée par le sourire et les yeux qui semblent tourner en orbites limpides, à la fois sereins et fortement recentrés sur le vis à vis quasiment masqué et donc absent de l’échange. Cohn-Bendit porte, par ce seul regard de défi, le message de transgression et de provocation que pas même les effets d’un Cassius Clay de l’époque ne pourraient exprimer dans les arènes de ses combats. Toute cette lumière met en scène non pas un dialogue, le CRS sculpturalement là pour justifier l’obstacle, le trouble et furtif échange d’un éternel face à face tout symbolique de la force aveugle à laquelle on n’attribue pas même la singularité d’un visage, mais la lumineuse proposition d’une intelligence sûre d’un avenir qu’elle semble porter du regard.
Donc d’un côté, la lumière porteuse (jusque sur le vêtement clair et le jaillissement du bleu des yeux ), de l’autre, l’ombre lourde (en effet la force n’est ici représentée qu’à titre d’anonymat casqué et sanglé comme une borne au-delà de laquelle…) qui est le dernier rempart qu’ invite à un impossible dialogue le regard de Cohn-Bendit.
Le regard semble dire comme dans la chanson de Dylan : « vois-tu, il se passe quelque chose et tu ne sais pas ce que c’est » ou dans une autre proposition de Dylan, plus explicite encore : « les temps changent et si tu n’y peux rien, mets toi de côté ».
Peut-être plus encore : « vois-tu, tu ne peux rien contre moi, le monde ancien s’écroule derrière toi »
Plus encore : « Je suis intouchable, le monde nous regarde et je témoigne ».
La force de l’ombre n’exprime rien, et pour cause, elle ne fait face que symboliquement. L’ordre n’a pas de visage, il a tous les visages de la force des lois, jusqu’à en être le dernier rempart, des décisions de justice, et de tous les garants des propositions actives et législatives depuis le temps que les hommes vivent ensembles.
La lumière posée sur le regard de défi est la lumière qui montre une coupure et une césure dans le temps et l’ordre qui en était le socle nécessaire.
Porteuse de gouaille gavrochienne , la posture ainsi immortalisée paraît chantonner du dedans un rythme inaudible en face. Comme dans l’arène le matador provoque le taureau, Cohn-Bendit a le regard qui dit : « vois-tu, bien que si haut dans toute ta force, tu n’as pas encore reçu ordre à mon égard » ou « tu n’es qu’un rouage de la force, je suis porteur de l’avenir. Essaie donc voir… ». La possible mort du Père.
Ce cliché qui a parcouru le monde résume le moment où rien n’est encore joué, mais où le face à face se pare des attributs de tous les antagonismes. Celui du socle qui était le présent du monde ancien qui vertigineusement s’exposait en cet instant même à la possible bascule vers les défis de l’avenir.
…………………………………………………………………………………………
27 Août
J’avais les portes et les fenêtres ouvertes sur le bleu du ciel, la chaleur qui ne sait s’en aller. Je montais un peu le volume sur la gigue de la Première Sonate pour violoncelle de Bach, c’était Yo-Yo Ma. Il m’a semblé que les arbres à oiseaux ont observé un répit, et que les herbes disaient vouloir encore grandir.
…………………………………………………………………………………………
28 Août
L’arbre aux feuilles rouges est mort. Il ne fleurira pas l’année prochaine. C’est une grande tristesse de penser qu’on ne le verra plus bientôt…
…………………………………………………………………………………………
30 Août
Dominique Fernandez, comme Stendhal, est amoureux de l’Italie, qu’il en a écrit le volume consacré de la série le Dictionnaire amoureux de… Le titre , Le Voyage d’Italie, ne lui aura pas fait trop se démarquer de son modèle.
…………………………………………………………………………………………
31 Août
Lundi, ce sera la première rentrée qui se fera sans moi. C’est un peu comme un grand élan qui se prépare auquel on ne participera pas. On est absent de ce grand déversement d’activité qui ne manquera pas de changer ce faux rythme dans lequel nous plongent ces quelques semaines de torpeur. Même les bétons nus des immeubles en construction n’ont pas bougé d’un pouce durant ces jours de vive chaleur. Il m’arrive même de me sentir sinon coupable mais comme dans une situation où les choses vont continuer sans que ni de près ni de loin on ne tienne compte de la part qui était la mienne auparavant. C’est donc bien ça que voulait dire personne n’est indispensable.
Le train des choses va continuer, les angoisses des uns, les incertitudes de chacun, les accommodements et les ajustements relatifs à ce nouveau départ, avec la navigation grossissante qui durera encore la saison d’automne et puis celle de l’hiver pour clore l’année.
Depuis l’enfance, on est contraint de se préparer au mieux à tant d’obstacles, qu’on rentre toujours dans diverses phases où l’on ne s’appartient pas, mais où on fait partie de ce rouage du monde auquel il faudra répondre et prendre sa part.
Quarante années et plus avant de toucher à cette rive d’inactivité et à l’absence totale de comptes à rendre.
Une liberté et une solitude au bout du quai.
Comme à sentir que l’on nous lâche enfin la bride parce que l’énergie ne pouvait plus s’aligner sur celles qui renouvellent la vie, soit parce que c’est une sorte de cadeau qu’on condescend à nous faire parce que proche est le temps…
…………………………………………………………………………………………
Le Noé de Giono fait penser à Luciano Berio dans le traitement de sa Sinfonia, où il y a une absence de transition, un fondu enchaîné et une superposition libre et sans ménagement de plusieurs thématiques.
Encore ces hallucinations de prose sans pareil, parlant des femmes de bal : « pourquoi écoutent-elles les chevaux de rapt qui galopent dans les accordéons du dimanche ? »
…………………………………………………………………………………………
Dans les Grands Entretiens de 13h cette semaine, c’était autour de Jean-Paul Fouchécourt, le Sommeil, ou mieux, le Morphée de l’Atys des Arts Florissants. Il reconnaît qu’il y a eu un avant et un après la recréation de cette œuvre en 87. Dans la mise en scène de Villégier et la chorégraphie de Francine Lancelot. Et par la prescience de William Christie.
Précisant au passage que le contreténor (anglais) est un chanteur à la technique de fausset intégral, et qu’un haute contre (à la française), celui-là même qu’on va pouvoir entendre désormais dans le répertoire de Lully à Rameau, utilise la voix de poitrine et use du passage qui permet les aigus de tête. Fouchécourt dit avoir été gêné durant toute son enfance par sa petite taille, de même pour cette raison, les rôles rossiniens lui ont toujours été interdits. Ce qui serait plutôt une chance pour lui et pour nous.
…………………………………………………………………………………………
Bataille au Ministère de l’Ecologie. Poujade disait dans les années 60 : « le Ministère de l’Ecologie c’est le strapontin des remerciements »
…………
Oh ! on a proposé à Cohn-Bendit le poste de l’Ecologie. Il a refusé. Comme Hulot avait aussi refusé en son temps l’accession à la Présidence de la République.
Propose-t-on toujours des postes ministériels aux seuls politiques qui ne postulent pas aux candidatures et aux candidats potentiels qui ne veulent être postulants ?
…………………………………………………………………………………………
2 Septembre
En plein milieu d’une phrase, je disais « t’ai-je jamais parlé de ce domaine… », avant de m’apercevoir que je venais d’écrire « t’ai-je jamais perlé de ce domaine »…
…………………………………………………………………………………………
15h. Depuis longtemps que je n’entendais plus la voix charnue, pleine , ronde et si subtilement articulée de Jane Bathori, la merveilleuse diseuse et créatrice des « Histoires Naturelles » de Ravel. Comme une sœur de Irma Kolassi, l’autre modèle rarement égalée dans ce répertoire de l’âge d’or de la mélodie française.
…………………………………………………………………………………………
Comment la République a-t-elle pu, dans la conclusion qu’en donne Platon, nous éloigner de ce qu’il dit en toute fin de l’ouvrage au centre de son œuvre :
« Et nous serons heureux ici bas et au cours de ce voyage de mille ans que nous venons de raconter » ?
…………………………………………………………………………………………
Emmanuel Macron n’a pas d’enfant. En aura-t-il un jour ? Il paraît être le benjamin des fils de son épouse…
La première Dame d’Angleterre, Madame Mathilda May, n’a pas d’enfant. Pas plus que Madame Angela Merkel. Ainsi que le premier ministre Néerlandais, celui d’Ecosse et de quelques autres qui tiennent l’Europe et ses destinées entre leurs mains.
Pas plus que le premier ministre Luxembourgeois, Monsieur Junker, Président de la Commission Européenne. Le shérif de l’Europe.
Des dignitaires qui font l’avenir d’un continent et d’une puissance économique majeure sans connaître ce que doit être le plus précieux engagement dans la vie d’un humain ! La transmission de son être profond qui donne le sens à l’action d’une vie.
Comment de tels visionnaires politiques peuvent-ils parler de l’avenir de nos enfants ?
Ne dit-on pas que gouverner c’est préparer l’avenir de nos enfants ?
Se peut-il que ce douteux hasard laisse présager une forme de coïncidence symbolique entre une Europe exsangue dans sa natalité, stérile dans ses impuissances à venir, et ceux même qui la dirigent ?
Cela donne bien la mesure toute relative de l’action de nos dirigeants qui ne voient évidemment pas au-delà de leur propre personne. Et pour lesquels le socle qui fera ce que demain sera, ne peut pas plus les concerner que de tenter de comprendre et d’infléchir par la raison et le cœur quelque chose qu’ils ne peuvent qu’envisager à tâtons, comme de grands aveugles.
………………………………………………………………………………………..
10h. Promenade avec Cécilia et Y sur l’autre rive du Loup, plus poétique encore, moins sujette aux sables.
Nous déjeunons à la piscine des Hameaux. C’est l’heure méridienne où les rares baigneurs glissent doucement sur l’eau. Les cris du plein été ont laissé place à un doux prélude à l’automne. Le ciel est d’un azur très profond après l’orage d’hier soir que les traces de nuages et les traînées des avions s’effilochent au dessus du bassin.
Y est passé devant l’école Saint Georges à Villeneuve avec son petit cartable de toutes les couleurs (il trottine voir la cour de recréation derrière les grilles de son nouveau petit univers). Il fait sa première rentrée scolaire demain matin…
19h. La pluie, doucement, mais pleine. On ouvre les portes, au Nord, au Sud. On fait souffler la fraîcheur. Le bonjour de l’automne. La terre lâche enfin ses parfums.
………………………………………………………………………………………..
19h. Seiji Ozawa dirige la 7° de Beethoven au Matsumoto festival. On ne le voyait plus. Il paraît avoir, cent, cent vingt ans…
…………………………………………………………………………………………
20h. Je comprends maintenant les gens des Andes péruviennes et boliviennes. Leurs danses qui invoquent. La pluie, le soleil. Selon. La dépendance aux dieux du ciel pour la croissance du blé, la maturité du riz.
Il devient de plus en plus incertain de revoir les saisons telles que nous les avions connues.
Ce sont les canicules qui succèdent à l’irritabilité des printemps avortés dans l’imprévisibilité la plus absolue.
Même en Colombie, au siècle dernier (à la fin du siècle 20), j’ai souvenir que l’été venait dans toute sa générosité entre décembre et février, avec une belle régularité. Nous dormions sous les nuits de San Andres, l’île du Pirate et l’ îlot de Johnny Key, n’imaginant que de très incertaines irrégularités durant ces mois de bonheur. Les seuls caprices ne survenaient qu’en Mai, aux orages dévastateurs qu’une chanson de tradition est venue confirmer le phénomène (Aguacer de Mayo –(orage de Mai)– Toto la Momposina).
Je n’ai connu dans ce pays que des armoires avec des chemisettes et des sandales pour toutes les saisons. Les parapluies existaient-ils ?
Aujourd’hui, les Andes de demi montagne autour de Pereira ne sont que pluies, mouvements fanés d’humeur terrestre et instabilités permanentes.
…………………………………………………………………………………………
La France ne peut supporter d’ouvrir les yeux. La Une goguenarde de Charlie hebdo faisait en son temps la misère de « Soumission » de Houellebecq, (l’arrivée au pouvoir d’un mouvement politique élu démocratiquement et se réclamant des nouvelles majorités musulmanes –fiction, dit on- comme on disait défaitisme en 40). La risée s’est abattue quand est survenu ce quinze janvier 2015 et l’attentat que l’on sait. C’est ce Houellebecq qui fut montré du doigt. Et bien que je n’ai jamais aimé son style littéraire, le contenu du roman en question a le mérite de projeter réellement une prospective sur une vision politique actuelle possible.
Les ventes du livre furent même suspendues momentanément.
La vindicte médiatique et la solitude qui s’ensuivent sont généralement le lot de ceux qui bravent les analyses idéologiques du jour.
Les conclusions du livre sont-elles si absurdes que ça ?
En d’autres circonstances certains auraient évoqué la liberté d’expression, mais dans le cas présent l’enjeu est si sensible qu’il n’est pas tolérable qu’il entrave le cours régulier des pensées politiques de principe.
Donc malheur à ceux qui se dressent sur le chemin des maîtres penseurs.
Parce que ses principes ne rentrent pas dans le goulot des réalités, une certaine France ne supporte pas la lumière forte.
…………………………………………………………………………………………
4 Septembre
Comme souvent, je reçois la triste Newsletter de Ben. Une diarrhée d’autosuffisance revendiquée. Jusqu’aux fautes de frappe volontaires pour justifier la spontanéité de ses fièvres. Il donne malgré tout, dans un éclair de lucidité la définition de Ben, qui n’est pas un artiste mais un brocanteur. Il met donc parfois un peu de justes proportions dans ses délires. Bien qu’il soit conscient que le masque de l’artiste est médiatiquement plus intéressant que l’obscur labeur de l’autre. Que faire de ceux qui pensent qu’il est un phare dans le paysage de l’art entre Nice, Saint Paul de Vence et les enceintes de Beaubourg ?
…………………………………………………………………………………………
Bernard m’envoie un message où il parle de l’herbe haute qui revient souvent dans mes écrits. La signification est à prendre littéralement mais aussi dans le sens de quelque chose qui a témoigné, d’une mémoire qui aurait conservé un secret, qui aurait pérennisé un souvenir enfoui dans le cœur de ceux qui l’auraient vécu. L’herbe haute, c’est l’herbe qui a eu la chance et le temps de le devenir…« Quand l’herbe est haute, c’est qu’elle a eu le bonheur de témoigner de bien d’autres bonheurs qui ont pu la fouler. »
…………………………………………………………………………………………
Claude, de chez Sauveur, m’offre contre deux verres de bière, un volume de poche de La Négresse Blonde et du Géranium Ovipare, de l’excellent Georges Fourest, avocat loin de la Cour d’Appel.
C’est toute une sublime poésie d’un âge d’or de cabaret, où l’humour au tournant du siècle savait inclure les références à Racine et aux anciens grecs.
Dieu ! soupire à part soi la plaintive Chimène, qu’il est joli garçon l’assassin de Papa !
Des quatrains et des tercets du Pseudo sonnet que les amateurs de plaisanterie facile proclameront le plus beau du recueil, ce n’est qu’un X répété qui parcourt le poème, du premier au dernier vers. Une audace à la Duchamp.
Mais aussi « incaguer la pudeur et convomir le bon goût ». Etonnamment Deleuze disait que Jarry en inventant la pataphysique avait ouvert la voie à la phénoménologie.
…………………………………………………………………………………………
6 Septembre
C’est la première fois que j’oublie la date anniversaire du départ de Maman, le 4…
L’automne se profile, la douceur est pour bientôt.
………………………………………………………………………………………
En regardant bien une certaine photo du pont de Hammersmith, je m’aperçois que je fais aussi du Antonioni (Blow Up). A l’extrémité d’un cliché panoramique, on voit apparaître, (à peine une légère focale sur l’extrémité droite), noyé dans un halo de broussaille, un couple assis côte à côte, tourné vers le fleuve (elle a le crâne rasé à la manière bonze, et lui la regarde d’un trait de désir (?), un peu comme une apparition de faune à l’heure où les nuages roses au ciel se noient dans les argentés d’un début de crépuscule. Ils sont, maintenant que je les ai débusqués, d’autant plus présents qu’il n’y a personne d’autre que cette fugitive apparition sur cette berge ombrée de broussaille, de roseaux et de fleuve impassible s’étirant sur une très longue horizontale.
………………………………………………………………………………………..Claude me prête un catalogue d’exposition Picasso. Magnifique et rare. Des photos aussi.
Sur le sable d’une plage d’Antibes, environ 1930, autour d’un pique nique, Picasso en maillot, deux femmes, deux chapeaux, quatre bouteilles de vin.
…………………………………………………………………………………………
Au vu des photos autour des années dandy, le quotidien d’Eluard était décidément bien complaisant envers Nusch. (Avec Amy Fidelin qui n’est jamais bien éloignée des autres femmes, et toutes dans des nudités et des postures totalement univoques).
…………………………………………………………………………………………
Lévi-Strauss et Yourcenar se partagent le Japon dans des visions bien différentes. Mais d’une même admiration apparemment.
…………………………………………………………………………………………
7 Septembre
J’ai enfin découvert le secret de la sainte trinité : Le cassoulet de Castelnaudary serait le « Père » (lingots, confit, échine, poitrine de porc, couenne, jarrets etc.). Le « Fils », celui de Carcassonne est à l’identique auquel on rajoute de la perdrix rouge (autant rêver). Enfin le « Saint Esprit » toulousain est fait avec de l’agneau, du mouton, de la saucisse de couenne, du confit de canard et des saucisses « dites » de Toulouse.
Encore une fois, c’est en résistant aux Anglais durant la guerre de Cent Ans et le siège de Castelnaudary, qu’on a inventé ce plat universel de cuisine française, en utilisant la cassole, plat de terre cuite, inventé par un italien vivant à proximité, et que les anglais furent boutés hors de la région par les chauriens…
Mais les haricots ayant été importé bien plus tard, après la conquête du nouveau monde, le premier cassoulet devait être un plat de fèves aux divers accommodements de viandes confites à la cuisson…
…………………………………………………………………………………………
Derrière les vitres de la cuisine, c’est le vent qui secoue un peu les arbres. J’ai de plus en plus peur chaque fois que les branches naviguent et dansent légèrement dans l’espace autour de leur tronc.
La mort des arbres m’est pénible depuis là où je les aime, plus par la nécessité de les désirer dans le décor qu’il peuvent m’offrir et la vie qui y est en harmonie avec les nuages qu’ils se risquent à toucher, que pour leur réelle existence en tant qu’espèce. C’est un égoïsme pour lequel je voudrais tant que ces décors ne se désinstallent jamais de l’environnement que je souhaiterais toujours à portée de mes horizons, jusqu’au souffle prodigué dans les milieux de la nuit. Un arbre mort est comme une voix qui se verrait appauvrie dans l’ensemble de ces tutti nocturnes. Un des disparus de la symphonie des Adieux.
…………………………………………………………………………………………
Dalila a lourdement chuté. C’était une amie de cœur qui a longtemps rythmé ma vie du côté de Carlone, au milieu des années 2000. Elle m’appelle parfois. Mon cœur est aujourd’hui relativement plus sourd qu’en ce temps là. Je lui apporte des chocolats, j’essaie d’avoir une hauteur d’intimité qu’elle disait me réserver en ce temps là… Maintenant elle lutte contre un cancer du sein. Seule. Quand je suis allé la voir à Lacassagne, on m’a dit de jeter les fleurs. Ca ne se fait plus dans les hôpitaux… Le pourtour de son épaule n’est plus qu’une longue balafre circulaire douloureuse. Je viens la voir dans ce quartier de Grosso où la Rue des Potiers est juste en parallèle.
C’est elle qui m’apprit, une nuit de printemps improvisée, qu’on disait Om Koultoum, plutôt que Oum Kalsoum. Parfois même Om Kalthoum. Les O étant souvent des U (ou). Suivant l’humeur. Ces résonances sonnent encore comme d’une violence poétique irrationnelle quand je revois la noirceur de sourcil et la terrible hauteur d’autorité maternelle qu’elle prenait, me parlant de ces hauts points de culture arabe.
C’est elle qui me fit connaître, parce que chantant inlassablement à chaque nuitée de ses séductions, les yeux humides, le répertoire des unes et des autres, la voix et le charme de Asmahane, la syrienne, la rivale de Kaltoum, plus jeune et plus sensuelle, dont on dit qu’elle aurait été écartée accidentellement dans les années 40 pour cause de rivalité. Asmahane était la sœur de Farid El Atrache, le seigneur du chant lyrique égyptien. De même, Dalila chantait le plus encore lyrique et le plus rare poète compositeur (pour lui-même et pour Kalsoum), Mohamed abd el Wahab, l’aristocrate des mots et des sons de la lyre orientale, comme elle semblait poser pierre à pierre un monument sonore de Pyramide.
…………………………………………………………………………………………
Je n’ai plus cette force de souffrir qu’on peut avoir quand on a la tendresse d’une vie qui commence, et dont les premières expériences amoureuses relèvent de l’exclusivité, et donc de cette espèce de chose en soi d’une vie qui voudrait graver comme dans le marbre ce qui relève de la première fois.
Parce que cette première fois, dans la force de ce qui l’a fait éclore, se voudrait à tout jamais.
Comme pour l’incruste des poètes qui gravent sur les arbres des je t’aime éternels se voudraient des encoches sur diamant, la sagesse des mousses fragiles sur la pierre gravée, saisons après saisons, se chargent d’en voiler la pudique défaite.
…………………………………………………………………………………………
D’une dernière question qu’on me posait au Conservatoire , réellement engageante : quel est le plus grand chef d’orchestre allemand (donc le plus grand de tous, cela va sans dire avec ce qu’il faut d’ironie…) ?
Ruminant celle-ci depuis longtemps, la lumière jaillit sans trop de difficulté, une fois admis que serait le plus important celui qui aurait le répertoire international le plus étendu.
C’est sans conteste Karajan.
On a rétorqué quid de Fürtwangler ? de Bruno Walter, de Jochum, Böhm, de tant d’autres y compris Carlos Kleiber qui d’après une enquête américaine serait le plus parfait de tous ? La réponse saute aux yeux. Tous ceux mentionnés, y comprit la génération de Nikolaus Harnoncourt, pour ne pas étendre à plus la liste de chefs déjà cités, ont une tessiture de répertoire allant, sans trop se perdre dans les marges, de Bach à Bruckner, voire Mahler, pour certains, selon la sensibilité, englobant là les seuls compositeurs germaniques sur ce vecteur historique !
Aucun de ces prestigieux chefs ne s’est ouvert au répertoire français et italien (pour ne parler que des cultures de ce grand triangle musical). Karajan poussa même, dans sa rivalité avec Fürtwangler, et leur détestation réciproque, à créer, une fois son aîné évincé, le Festival Verdi, à Pâques, dans le temple même de Salzbourg. Karajan fut le seul a s’intéresser aux problèmes techniques de la prise de son et d’une manière générale à tout ce qui concerne la technologie des moyens contemporains dans le domaine de l’enregistrement, source de transmission fidèle des exécutions publiques et des réalisations en studio. Il étendit ses choix à la musique russe. Il réalisa une des références de l’intégrale de Boris Godounov. Il en fit de même dans le répertoire français, en enregistrant, déjà en 53, Pélléas en public à Rome, puis définitivement en 78. Imagine-t-on Böhm ou Jochum dans Debussy ?
Karajan poussa la rivalité avec les autres chefs européens sur le terrain de leur arbre généalogique. Monteux et Munch dans Stravinsky et Debussy, Mravinsky dans Chostakovitch et Tchaïkovsky, mais aussi Argenta dans Falla, et Fricsay dans Bartok. Les grands finlandais (Kajanus) dans Sibelius.
Il répartit de manière égale les grandes réalisations opératiques et le simple répertoire symphonique.
Ce qu’il fit, qu’aucun chef germanique ne fit (peut-être Hermann Scherchen…), c’est d’étendre aussi largement vers les horizons du XX°, du côté de Schoenberg et Webern, Stravinsky, Roussel, Ravel, jusqu’aux lisières internationales des années 50. La culture d’un Karl Böhm lui interdisait de voir au-delà de Richard Strauss. Ce qui n’empêcha pas Karajan évidemment de prendre part au tout premier rang dans le répertoire qui est celui de sa Germanie native.
Tous ces grands allemands, tout impressionnants qu’ils sont aux yeux du grand public, ne sont pas autre chose que de bons artisans pérennisant la mémoire de leurs compositeurs. En France, un Monteux au début du XX°(dirigeant à Vienne mais aussi San Francisco), un Boulez aujourd’hui (directeur de tous les plus luxueux orchestres américains, Vienne et Berlin et dans tous les répertoires), ont une importance au moins aussi grande qu’un Fürtwangler hier, qui ne sortit jamais des sphères de Mozart, Wagner et Brahms. Toscanini, de la même génération que son homologue allemand (qui le détestait), a su avoir une curiosité de Verdi à Debussy, en enregistrant plusieurs fois La Mer, et laissant des Wagner, à Bayreuth et surtout à New-York, qui faisaient vibrer les cordes d’un secret que lui seul avait !
Karajan a donc été le premier, après guerre et au sein des élites germaniques, a ouvrir réellement, parce qu’universellement, ce qui sera le domaine élargie de la direction musicale.
…………………………………………………………………………………………
8 Septembre
« Avant de me suicider, je voudrais être sûr de l’être, sûr de ma mort… » -Artaud-
Pourquoi pas de la fin de la douleur, de la fin de la mort, de l’irrésistible besoin de comprendre ce qui règne sur cette impérieuse nuit du jour ?!
…………………………………………………………………………………………
De retour d’une lecture de René Char, on peut s’y sentir « moralisé ».
…………………………………………………………………………………………
Leroy Ladurie pose la question de savoir si notre définition de la mort est différente suivant que nous avons une connaissance historique approfondie du problème, sachant que les êtres qui y sont confrontés marchent encore vers des baumes qu’ils espèrent toujours.
……………………………………………………………………………………..
10 Septembre
Bientôt on ne pourra nourrir l’humanité déferlante en protéines de viandes et de poissons. L’avenir est aux sous sols des enfers de la terre…
……………………………………………………………………………………….
Picasso n’a pas même daigné être un grand coloriste. C’est un inventeur de
formes, un dessinateur sorcier qui peignait comme Velasquez à quinze ans. Il a
transposé l’inconscient collectif du XX° siècle dans la protéimorphose
d’un univers plastique sans limite.
…………………………………………………………………………………………
Claudio Scimone est mort il y a quelques jours. C’est un peu le Vivaldi de notre jeunesse qui s’en va.
Après sa mort, pourquoi ces « quatre saisons », lorsque je les ai en tête, ou comme cet après-midi, d’une manière inattendue, à l’occasion d’une écoute en toute surprise, arrivent à m’émouvoir, alors que cette musique ne m’a été proche que dans l’enfance de mon éducation en cours d’évolution ?
Peut-être parce que, dans les dernières années de mon passage dans les classes, je m’en servais pour illustrer la notion de concerto. Tout bêtement…
La métanoïa aidant, on peut relativiser certaines amours littéraires ou esthétiques ou revenir sur de premières émotions. C’est comme ça que René Char me semble avoir déposé dans les tiroirs de ce temps qui s’étire, plus de ruines que n’en fit dans ses écrits moindres Jean Giono.
…………………………………………………………………………………………
D’un commun accord, les médias qualifient toutes les attaques à l’arme blanche de ces dernières semaines (j’aurais du mal à toutes les énumérer) au son de « Allah Akbar », d’actes perpétrés par des « déséquilibrés ». Relevables probablement de la plus simple psychiatrie. Faits divers en quelque sorte…
…………………………………………………………………………………………
Pourquoi avoir acheté à nouveau Malone meurt ? Parce que j’en parle avec Bernard qui encourage aux absurdités désespérantes ? Parce que la tranche du précédent volume était sortie de ses rails ?
…………………………………………………………………………………………
12 Septembre
Freud disait « les femmes, que veulent-elles vraiment ? »
Sans vouloir approfondir, je suis surpris qu’il n’ait précisé « au fond, les femmes que veulent-elles…» « ou « tout compte fait, les femmes… »
…………………………………………………………………………………………Visite de l’Expo Matisse/Picasso (« la comédie du modèle ») avec Claude de chez Sauveur. De très belles pièces. Le musée me semble mieux éclairé, les lumières évitent d’écraser les œuvres. Par contre, où sont les quelques quatre cent dessins (visibles sur un méchant tourniquet il y a bien longtemps ) ? Aujourd’hui, cette partie des Matisse a disparu au regard du public… Les sépias de Picasso sont parmi les belles surprises (Femmes assises). Ce sont d’austères portraits en buste à la manière des maîtres classiques espagnols. La Piscine de Matisse (découpages de papiers bleus sur fond blanc) a fait son apparition, et les sculptures sont toujours aussi monumentales.
La thématique de l’opposition de ces deux monstres se décline en Projeter, transformer, convoiter, posséder.
On a souvent dit de Picasso que c’était un piètre coloriste. Il suffit, pour infirmer cette croyance, de regarder la première peinture de la série des Villa Chêne Roch, où un éclairage de nuit est rendu à une perfection presque onirique entre le blanc halluciné aux portes de la maison et dans l’allée qui précède, et les dégradés quasi fondus de sombres à la partie supérieure, allant du gris, des bleus de nuit, au désespérant noir qu’on croirait spirituellement de type Jean de la Croix.
…………………………………………………………………………………………
13 Septembre
Peut-être un projet de voyage vers le Japon. Pour quand ? C’est une destination qui est cochée depuis longtemps, depuis Keiko et mes cours de japonais. Depuis Mizoguchi, Kinshi Tsuruta, Junko Ueda… Je me contente des images de temples, de toris et de ces merveilleux printemps de cerisiers qui le disputent aux non moins féeriques automnes dans les parcs. La viande de bœuf de Kobé ressemble à du porphyre rose et blanc ou à un marbre lissé aux nervures abondantes innervant tout le rose pâle.
………………………………………………………………………………………… Lacan fréquentait les surréalistes (jouant même une pièce de théâtre avec Sartre, Beauvoir, Reverdy, Picasso) d’où cette indéfectible fidélité au juvénile nœud papillon, mais il écoutait aussi Maurras.
N’a-t-il jamais pu se départir de ce qui a pu lui peser dans un frère devenu prêtre ?
Que pouvons nous conclure des alpha et des oméga ?
Les débuts de nos parcours spirituels dans l’initiatique de notre croissance ont-ils un poids moins grand qu’après une vie de recherches et les conclusions qui vont avec ?
En gros, les premières approches d’une vie qui brille (parce qu’encore neuve) sont-elles moins sûres que l’analyse patiente d’une existence de recherche sur les destinées de nos vies ? N’avons-nous jamais reconnu chercher ici qu’à tâtons ?
…………………………………………………………………………………………
« Tant que tu peux revenir, tu n’as pas vraiment fait le voyage »
(Roger Munier).
Ce n’est surtout pas et rien que pour les NDE.
…………………………………………………………………………………………
J’ai relu Beckett, un peu. Il représente une dernière limite. Je veux parler de ceux, et il en fait partie, qui ne disent rien d’autre qu’après notre dissolution, nous ne sommes que sables et moins encore, dans un royaume qui n’est pas un paradis, mais un néant, une sorte de rien et de moins que rien si l’on se réfère à ce qui nous attend.
Bossuet ne disait pas autre chose.
C’est donc avoir rationnellement la certitude de ce que sont la mort, la dissolution, le néant, en ajoutant, comme il est convenu dans les philosophies et les littératures de l’absurde, que nous ne savons pas pourquoi nous avons été amené à l’existence.
Nous avons la clé de la sortie, mais pas celle de l’entrée.
La raison abdique et dit que je vais me dissoudre. Comme à la morgue, on sait pourquoi mon corps a lâché prise, pourquoi une cause certaine a entraîné la fin du processus de vie. La raison fait un descriptif, un constat. Rien de plus.
Beckett a peur comme je peux avoir cette frousse du noir, comme j’ai encore eu plus peur de sortir du ventre d’une mère, sans aucune raison, sinon celle qui m’a fait être agi dans les myriades des incertitudes.
Mais voilà, pourquoi ?
…………………………………………………………………………………………
14 Septembre
Macron gère la pauvreté de la France et la péridurale de ses vieux qu’il veut rendre exsangues.
Il assure aussi aujourd’hui, le plus officiellement, la repentance de notre pays concernant la torture, unilatéralement, durant la guerre d’Algérie.
Après le funeste 19 Mars 1962 (Accords d’Evian), la France estime que la guerre est finie (laissant au Général une décolonisation par la porte étroite) et fermait les yeux sur ces vainqueurs du FLN qui au-delà de la torture, massacrèrent, mettant dans des bassins d’eau en ébullition les algériens fidèles à la France qui n’étaient pas du côté de ces vainqueurs là, exécutant les fermiers européens qui refusaient encore de choisir entre la valise et le cercueil, effeuillant aussi de leurs choix les femmes à mener aux bordels…
De cela Macron ne parle pas. De peur de déplaire dans les banlieues tout en câlinant du côté du PC. Seule la torture de l’Armée française est passée au crible. Pas celle qui venait d’en face.
L’Histoire est toujours en effet du côté des vainqueurs.
Notre Président n’apprend-t-il l’Histoire qu’auprès de ses maîtres anticolonialistes, humanistes et moralistes d’ONG, pour notre toujours plus profonde repentance ?
…………………………………………………………………………………………
Victor Orban, jeune député en 1956, était celui qui voulait chasser les chars de Budapest. On lui reproche aujourd’hui de penser que la Hongrie est (trop ?) indépendante dans son refus d’encourager l’immigration. Il tend la main à Poutine, à Trump. Ce qui est un grand écart que nous ne savons pas faire. L’exclure donc de l’Europe ?
…………………………………………………………………………………………
15 Septembre
En écoutant la suite de l’Oiseau de Feu, où l’argument met en scène, entre autres, un Prince, une Princesse, je me disais que dans la plupart des contes de mon enfance et pour les enfants d’aujourd’hui qui goûtent ces histoires qui les font rêver, il y a toujours des rois et des reines au milieu de vastes étendues et de beaux châteaux au sommet d’une colline, que ce sont toujours ces gentils princes qui réveillent les belles au bois, que c’est toujours un autre prince qui possède la plume d’or du pouvoir de se faire aimer et de tant d’autres gentilshommes, que le monde d’aujourd’hui qui leur a coupé la tête n’a pas encore trouvé d’équivalent républicain à donner en exemple aux petits de maintenant.
………………………………………………………………………………………..
Goffette, dans « la cendre des chose », c’est Ronsard…
………………………………………………………………………………………..
En ces journées de Patrimoine, nous voyons bien que le Palais de l’Elysée n’est rien d’autre que le Versailles des Républiques. Dans son fonctionnement, ses rites et ses fastes, jusqu’au mobilier et ses vaisselles provenant des plus beaux ateliers royaux. Nos monarques contemporains pourraient-ils se contenter d’un simple appartement entretenu à leurs frais et rendre le Palais de l’Elysée comme Versailles à été rendu au public ? D’autant que c’est dans le pays des coupeurs de têtes révolutionnaires que l’exception française, au sein des démocraties, s’octroie le droit de s’afficher et de s’étiqueter dans un luxe unique en Europe.
………………………………………………………………………………………..
17 Septembre
HUMEURS ANNEES 70
Plein de films de Claude Sautet ces temps-ci, comme un passage en revue. Revoir Romy Schneider est toujours pour moi accompagné d’un certain malaise. Est-ce à cause de cette beauté contrôlée, ces cheveux domestiqués comme une austérité de façade, ce front de vestale ou de petite impératrice, cette fausse réserve au dessus d’une lave de volcan ?
Dans tous ses films, le constat de base c’est : « il faut que tu comprennes que je ne peux plus vivre avec toi », qu’elle peut aussi transposer en « je ne veux plus vivre avec toi », d’où cette couleur d’huître dans ses yeux de couleuvre qui n’auraient jamais gobé sa perle.
Sautet était-il le Bergman du pauvre ? ou inversement, Bergman faisait-il du Sautet intimiste ?
Dans ces années 70, chez le cinéaste, il y a toujours des banquets de tribus, les hommes, les femmes et les enfants serrés autour d’une table, les familles mélangées, décomposées, recomposées, et celles en voie d’évolution, les amis seuls ou accompagnés, ceux de passage, le vacarme, les vapeurs des gros plats qui sentent encore la grégarité paysanne, l’auberge espagnole, les gentils combats de mots et d’idées, les sentiments rengorgés, les regards de biais, les tirades sur la vie, les promenades au bord des chemins bras dessus bras dessous où on se raconte les petites misères. Mais toujours en tribu (Vincent, François, Paul et les Autres, César et Rosalie, Une Histoire Simple). Montand y est presque toujours meneur de troupe.
Le réflexe des réunions du Parti ?
J’ai connu ces dimanches en famille autour du pot au feu, où seul mon père ne venait pas, par choix et indépendance rêveuse, qui réunissaient les exilés, les Outre Méditerranée, chez Lucia, la tante aisée faisant le lien entre tous, pour nous mener à croire être proches les uns des autres comme dans ces temps du Maroc, et fuir ces peurs d’être seuls, isolés devant des horizons nouveaux. Les dissonances, dans ces tablées dominicales, n’étaient pourtant jamais bien loin. Ces dix ou douze à table du dimanche durèrent jusqu’à l’orée des temps plus modernes des années 80, où les cellules familiales imposèrent une nucléarisation assortie d’un égoïsme de rigueur, sinon d’une forme d’autisme social dans laquelle nous avons construit ce que nous sommes aujourd’hui.
Amassant autant notre solitude que nos caddies de supermarché.
Le fin mot de l’affaire, c’est le secret bien amené que Romy articule toujours avec délectation et presque comme en silence : « Je suis une femme libre ». L’a-t-elle réellement senti dans sa chair ?
Jusqu’au suicide ?
Ces femmes des années 70 m’ont toujours laissé une impression de malaise comme les rôles de Romy Schneider.
La petite bourgeoisie aspirant à ôter ses oripeaux d’avant 68, les femmes s’affranchissant d’un rang de dépendance enfin abolie, elles deviennent créatrices de bandes dessinées, de mode (pour les plus à l’aise, et proche de certains pouvoirs), mais bien plus fréquemment secrétaires assujetties encore à un maître dans le monde du travail, plutôt que de l’être à la maison, choisissent de toute manière d’assumer l’égalité absolue dans le couple et au-delà, dans la famille au risque de certains manquements. Avec le privilège de l’épée de Damoclès qu’elles brandissent dans le plus grand des enjeux silencieux, à savoir, dynamiter l’ordre familial au moindre retour frontal de l’insupportable tyrannie du mâle domestique et prendre la destination d’un amant de proximité.
Pas même pour un bonheur enfin conquis, mais souvent pour le petit malheur d’une nouvelle erreur de casting.
………………………………………………………………………………………..
Dans tous ces films des années pivots 68/75, c’est rarement l’accent mis sur l’aspect politique et économique qui compte, mais cette fameuse revendication des relations verticales et horizontales dans la société des humains, fausse révolution classique, mais réelle révolution que je nomme peut-être pompeusement, de métaphysique des mœurs, qui éclôt, l’air de rien, comme une fleur vénéneuse.
………………………………………………………………………………………..
18 Septembre
« Debussy à la plage ». Magnifique livre de Rémy Campos, parti d’une carte postale bien connue de Debussy à l’ombrelle et au chapeau sur la plage de Houlgate, fait surgir, comme autant de tableaux de Boudin ou de Monet, ces merveilleux clichés de la France des années 1900 au bord de mer, à Trouville, Houlgate ou ailleurs en Normandie, avec ses rites et ses codes, sa vestimentaire et ce rien qui reste encore, sur la plage, d’une gaucherie toute citadine. Debussy y est en chemise fermée, nœud papillon, gilet et veste boutonnée, chapeau vissée aux oreilles, mais n’en est pas moins père poule auprès de Chouchou. L’album a le grand mérite de présenter quantité de photos inédites d’Emma Bardac, de leur Chouchou, et de leur maison du Bois de Boulogne où Debussy passa ses dernières années.
J’ai reçu par l’Amazonie cette fameuse Messe de Notre Dame de Machaut, dans cette version superlative de Dominique Vellard. Avec « Le vray remède d’Amour » et « Le Jugement de Roi de Navarre ».
La journée est donc radieuse… au silence et loin de chez Sauveur.
22h. « The Lunch box” de Ritesh Batra. L’amour à distance et par la nourriture de séduction, par correspondance. Avec d’infinies pudeurs.
…………………………………………………………………………………………
Gérard Collomb, Ministre de l’Intérieur à ce jour, après Nicolas Hulot pour d’autres raisons, annonce une démission imminente afin d’être candidat à soixante et onze ans à la Mairie de Lyon où il est chez lui, à défaut de rester dans un gouvernement qui crisse et où il se sent de moins en moins d’avenir.
Outre qu’il considère avec une certaine légèreté la fonction d’état qui lui avait été confiée, on observe là une forme certaine d’infidélité, voire d’opportunisme félon chez les gens du mouvement du Président qui se mettent maintenant à « descendre » en marche…
…………………………………………………………………………………………
21 Septembre
le voyage programmé pour Salzbourg se dessine. L’idée m’est venue, une fois
passées les retrouvailles de Cécilia avec les anciens des années 80, de mettre
cap au sud vers la Slovénie.
…………………………………………………………………………………………
Certains Intermezzi, Ballades ou Andante du dernier Brahms des opus 117, 118, sous les doigts de Kempff, me font penser aux mystères ténébreux des terres les plus au Nord, à ce Holstein rugueux, que je ne connais pas, mais qui doit contenir tout le bleu des nostalgies et des mélusines austères de ces pays de roseaux, d’eaux mortes et de brumes.
…………………………………………………………………………………………
22 Septembre
dans les Grands entretiens d’hier, c’était Alain Altinoglu, véritable tornade des estrades, qui est le seul français (d’origine arménienne mais né à Alffort) qui aura dirigé à Bayreuth (Lohengrin), après Cluytens et bien sûr, Boulez.
…………………………………………………………………………………………
Dans la génération des belles et prometteuses mezzos aujourd’hui, Gaëlle Arquez, entendue dans l’Amour l’ardente flamme, vaut bien toutes celles que j’ai entendues, par une projection et une rondeur de chair vocale qui en font déjà une superlative.
…………………………………………………………………………………………
23 Septembre
Promenade avec Cécilia sur ces rives du Loup, côté Nord cette fois. On aurait pu remonter jusque vers les gorges et la moyenne montagne, loin en amont, tant le chemin se laisse aimer. La canicule a laissé place à un début d’automne encore chaud et poussiéreux. Jamais je n’avais si bien senti le dynamisme du village durant ces fins de semaines, avec ses quantités d’activités alentour. Jusqu’à des initiations au lancer de javelot à l’ancienne au bord de la rivière, et aujourd’hui les fameuses Journées gourmandes autour d’Auguste Escoffier, l’âme des lieux.
…………………………………………………………………………………………
FIN DE PARTIE
De Gaulle pensait que tant que le domaine de la gestion de l’économie, des finances et de l’industrie était entre ses mains, il pouvait bien laisser en pâture à son opposition de gauche, le domaine des idées, l’arsenal idéologique, donc tout ce qui se situe dans la sphère de la culture, des universités et du brassage intellectuel qui n’aura pas manqué de fermenter, comme l’avenir le lui a montré à la fin de son règne politique.
C’était une grave erreur commise à une époque où on pouvait croire que les secteurs de l’économie et des décisions sur l’industrie pouvaient seuls se tenir à la proue des réalités essentielles. Mai 68 et les dernières années qui ont précédé son départ précipité, ont bien montré que la germination en amont dans le domaine intellectuel était réellement le moteur du décisionnaire en matière de vision sur l’avenir.
C’est l’éternel débat sur prima la musica… Politique d’abord, ou économie d’abord ?
L’économie se trouve évidemment assujettie à une réflexion et donc à une orientation qui ne peut se concevoir que si elle cadre avec une vision philosophique globale menant à bien ce que lui permettront, ensuite seulement, les ressources économiques d’un pays.
Tout ce que j’ai connu durant mon parcours universitaire (je parle de la Faculté des Lettres toute dévolue à la gauche) n’était rien d’autre qu’un terreau d’idées d’opposition au pouvoir, répandu dans les couloirs, les forums, et jusque dans certains amphithéâtres où étaient inoculée, enfreignant toute déontologie pédagogique, la parole contestatrice. C’était les années Mitterrand et du Programme Commun dont il s’est servi comme d’un socle dans son ascension vers le pouvoir.
Le foisonnement des groupuscules s’identifiant aux diverses stratégies de gauche se répandaient à la suite des activistes de Mai 68, et l’on vit éclore bientôt, tout à la fois, les Stal arborant la moustache drue façon patron du Kremlin (ou de Peppone avec moins de chance), dont Jacques Duclos était le modèle du jour, les trotskistes impatients de révolutionner maintenant et partout dans le monde, dans une stratégie du feu d’artifice permanent, les maoïstes, les mao spontex (dont je n’ai jamais su s’ils étaient plus ou moins poreux que les autres), à la pensée de fleurs et à la détermination carnassière des félins du conceptuel, portant col ou pas, selon qu’on arbore ou non les couleurs des pensées de velours. Le petit livre rouge en main s’effeuillant de sentences comme aujourd’hui certains sortent l’arsenal des huiles essentielles. Les anarchistes, dont on sentait, rien qu’à la démarche, une vieille hérédité de débraillé. Probablement les têtes de proue qui deviendront les traînes savates écologistes des premiers temps. Eux portaient la pilosité intégrale et avaient paradoxalement en ces temps, mais comme il se doit, un sens très marqué du vestimentaire individualiste.
Enfin la Gauche Prolétarienne, terreau des futurs terrorismes, reconnaissable à ses camouflages militaires et sentiers qui luminent, genre « Commandante Che Guevara », tendance à l’époque Régis Debray, El Condor Passa et no passaran, n’ayant pas encore rencontré Dieu. Honnis par les ouvriers et les encartés du PC, pour raison d’aventurisme politique et social, irrécupérables dans le contexte des rapports de forces classiques…
Ce qui faisait donc, dans les débuts de la décennie, un florilège d’énergies dont on n’a jamais trop su mesurer les différences conceptuelles, mais ce qui est sûr, c’est que l’art de la nuance n’avait jamais été poussé si loin.
Comment ne pas être, ou se sentir quelque peu, sinon solidaire, ce qui n’a jamais été mon cas, mais porté ou simplement immergé par l’ (les) idéologie (s) de cet après Mai qui continuait de dérouler son automne quelque peu fané dans les campus de France ?
Et nous avions l’aveuglement de nos vingt ans…
Le monde universitaire et ses convulsions périodiques auraient pu ainsi continuer sans que cela n’entrave en rien la marche des études, les éclats de slogans, les fréquents orages de contestations et de tracts faisant partie du décor environnant.
Une première brèche, pourtant, est apparue en 72.
…
Dès 69, encore au lycée, le quartier général s’est naturellement installé en haut de Grosso, au Pub Latin, parce que sur le passage stratégique vers le Parc Impérial. Là aussi, les tribus foisonnaient. Les minets qui avaient de l’avance dans la course aux filles, les futurs poètes et les rêveurs, les agités du juke box, mais déjà émergeaient aussi quelques consciences politiques qui se faisaient les dents, avant d’en découdre plus tard à la fac. Puis des non classables qui se contentaient du flipper au fond du bar. Des silencieux, ou de ceux qu’on ne fréquentait pas faute d’avoir quelques points communs.
Parmi ceux-là, Michou. Toujours vêtu assez élégamment, genre « mange poussière » d’ Il était une fois dans l’Ouest, ou au contraire, arborant la panoplie du motard frimeur. Il avait une blondeur de cheveux et de fines moustaches qui se seraient confondues avec de la paille sans éclat.
Ses fréquentations étaient sélectives et il ne s’attardait pas après le défoulement de quelques parties de flipper.
….
La brèche, dans la forteresse d’une gauche universitaire monochrome, a vu s’ébranler pour moi toute une adolescence baignée dans ce bain qui allait de soi, en quelques minutes et en quelques images fortes.
72 avait été l’année du forcing universitaire relativement aux signatures d’adhésion au Programme Commun de gouvernement et les manifs n’en finissaient pas de se succéder pour les motifs, des plus anodins aux plus sérieux, tels le refus du numerus clausus en fac de médecine, la solidarité au procès de tel activiste universitaire etc.
Ce jour là, la consigne de mobilisation des troupes avait un rapport quelconque de solidarité avec un des leurs. Les masses étaient en ordre de marche en direction du resto-u, avant de prendre possession du parvis de la fac, afin d’y établir un meeting sous les décibels des hauts-parleurs.
Pour accéder aux marches menant au parvis, il fallait parcourir quelque cent mètres de ligne droite qu’avait commencé la troupe décidée, bras dessus bras dessous.
La rue était déserte. On aurait pu entendre le grondement intérieur de la masse mobile qui s’avançait.
Soudain, face au cortège, en sens inverse, une moto vrombissante, à petite allure mais déterminée, vint s’arrêter juste au pied des marches. L’homme à la moto était casqué, d’un de ces casques que portent les adeptes de Harley Davidson, un peu désuet , aux oreillettes en cuir souple, ganté de cuir aussi, et de lunettes noires ne laissant paraître aucun trait de visage.
C’était Michou. Michou karaté (!), dont on pouvait, sans doute aucun, reconnaître, malgré le foulard sur le nez, la fine moustache et les cheveux de paille descendant sur la nuque.
Il plaça la moto en travers de la chaussée, face la foule, le plus calmement possible, mit l’engin sur sa béquille, croisa les bras sur le torse en une manière d’attente et de placide arrogance.
(Presque une scène coupée au montage d’une propagande à la Costa-Gavras ! ou une scène de Michel Vaillant contre Bob Cramer)
Ce Michou, que nous ne connaissions que vaguement pour ses quelques passages au flipper du Pub, était une célébrité haïe des parvis de la fac des lettres. Membres actif d’Ordre Nouveau fondé en 69, karateka, activiste des jeunesses d’extrême droite, il portait en lui la froideur et la détermination de ceux qui avancent seul contre tous.
Je le vis porter une pierre dans la main gantée qui alla exploser une immense baie vitrée à l’entrée du resto-u.
Ce ne fut qu’un seul geste.
C’était fini. Les bras dessus bras dessous s’étaient désolidarisés, le sauve qui peut enclenchait la marche arrière le plus hâtivement possible, certains même détalaient, laissant au passage des chaussures et des bouquins dans la pire confusion, on se marchait dessus, direction la descente du boulevard de Magnan, descente qui était comme un symbole d’une déroute opérée dans un mouvement de panique que je n’ai jamais connu ensuite que dans les tremblements de terre où l’instinct vous dicte la plus impeccable discipline de fuite.
Restaient quelques chaussures, quelques objets épars sur la chaussée et les trottoirs en pente redevenus déserts.
Il avait suffi d’un seul, contre peut-être deux cent, pour que le masque de la singerie idéologique tombe du haut de la plus élémentaire des trouilles…
De ce jour, j’ai levé un voile, j’ai commencé à dissocier la parole et l’action.
Mais l’histoire s’est dotée d’un nouveau chapitre, suite à la déroute du matin… plus comique encore, s’il ne s’était agit d’un épisode qui se voulait grave et sentencieux.
Vers quatorze heures, des petits groupes parsemés et hétéroclites grimpaient la côte menant au grand amphithéâtre, celui qui servait aux grandes conférences, parfois même à des concerts. Le cheveu hirsute, les catogans pas toujours ajustés, je sentais une fièvre se dirigeant vers le cœur de l’amphi 84.
Il avait été décidé, dans la confusion de la fin de matinée et l’humiliation collective ressentie dans cette débâcle, que les choses n’en resteraient pas là. L’amphi serait réquisitionné (on ne sait toujours pas comment l’autorisation fut possible avec une telle célérité sinon venant d’une bienveillante complicité rectorale).
En moins d’une demie heure, à l’heure prévue, l’hémicycle était enfumé à couper au couteau. On sentait qu’un sentiment d’injustice avait mené tout ce monde à débattre du pourquoi et du comment des évènements du matin.
De nombreux orateurs énumérèrent les faits, du moins les faits perçus comme contraire à ce que l’on attendait d’un mouvement démocratique menant grève dans son plein droit. Chaque tendance politique, chaque tribu de vaillants idéologues y était représentées.
Un pull over rouge bondit sur l’estrade. L’orateur expert. Le Danton rassembleur de factions voisines et si subtilement nuancées. Enfin, l’homme de la synthèse.
La harangue se voulait être la dernière, celle pour laquelle, en fin de spectacle, est justifié l’ensemble des précédents orateurs.
« Camarades, nous ne laisserons pas impuni … le poing levé, la foudre oratoire qui sent la maîtrise du sujet, Camarades, la République des étudiants solidaires des luttes laborieuses ne saura tolérer… le poing levé, la manche retroussée nerveusement par l’autre main, dans tout l’éclat rouge de la justice s’enivrant, la convocation à laquelle le terroriste fachiste n’a pas répondu, nous voit dans l’obligation, les encouragements et les acquiescements aidant, de lancer une pétition dans les plus brefs délais, afin de poursuivre l’auteur de l’odieux attentat dont nous avons été les victimes innocentes, s’enhardissant, afin de mettre fin à l’abominable complot et aux complicités de la dictature dans ce pays, je réitère le vœu de traduire devant notre justice…. La diatribe dura je ne sais combien, le temps parut long…
En conséquence, je considère, devant l’absence et le silence du prévenu (sic), qui n’a daigné venir par devant nous, (sic) qu’à partir de cet instant, l’individu que nous avons bien identifié est condamné à mort par contumace… …………………………………………………………………………………………
25 Septembre
J’ai réussi à ne pas manquer l’anniversaire de Brigitte. Dalila m’envoie des messages. Je sens qu’elle aimerait promener dans l’arrière pays…
Katy répond à un vieux message où elle propose qu’on se voie…
L’automne arrive.
…………………………………………………………………………………………
Nina Stemme De la plus belle soie, de celle qui enrobe le vertige de la mort d’Isolde. Sera-t-elle, suédoise qu’elle est, une nouvelle Nilsson, ou mieux encore, une qui donne la main à Flagstad, dans des soupirs d’éternité ?
…………………………………………………………………………………………
27 Septembre
D’UN 19 NOVEMBRE 1978
La veille au soir, papa revenait de Maubeuge, vers dix huit heures. On avait guetté l’arrivée depuis le balcon de la rue de Carras. La voiture de l’oncle Jo s’était garée face à l’immeuble, ce qui fait qu’ils n’auraient pas à marcher beaucoup. La nuit tombe très vite en ce début d’automne et le trajet avait été épuisant pour papa. Il semblait flotter dans son pantalon, et sa maigreur, si c’était encore possible, avait progressé durant ce séjour d’un mois passé dans le Nord.
Quelques années auparavant on avait diagnostiqué, après bien des hésitations et des doutes quant au mal réel, devant des symptômes bien étranges, la sclérose amyotrophique, plus souvent nommée aujourd’hui la maladie de Charcot. Maladie dégénérative neuronale, ayant pour conséquence la fonte de tous les muscles de la partie supérieure du corps et notamment de la cage thoracique.
Occasionnant une fin par l’asphyxie.
Aujourd’hui encore elle ne peut être traitée, faute d’investissements pour ce mal moins fréquent que d’autres formes de cancers ou de maladies de même type, de celles qui mettent en alerte plus facilement les pouvoirs publics et les recherches.
L’état de maigreur était frappant. Pour quelqu’un qui le verrait pour la première fois, mon père pouvait donner l’image d’une sorte de Gandhi ou plus encore, de biafrais comme on en voyait dans les populations des années de fléau guerrier qui ravageait l’Afrique de la misère.
Jamais pourtant il ne s’était plaint. Et ce soir là, pas plus que d’habitude, il ne dit un mot concernant un état d’épuisement bien évident. A table, il fit simplement semblant de manger, prétextant avoir bien déjeuner à midi chez son frère Claude, alors qu’il est bien connu que papa n’avait jamais mangé plus qu’un oiseau qui ne sait pas encore voler. Par contre il ne parla presque pas et il alla se coucher de bonne heure.
Nous prîmes des dispositions concernant les jours qui devaient suivre, car il était maintenant certain qu’il ne pouvait plus rester sans assistance et que, pourquoi le cacher, il n’en avait plus pour longtemps.
Je me souviens que cette maladie avançait en parallèle à l’ état mental qui était le mien vers cette fin des années soixante dix, où j’écoutais beaucoup de musiques sacrées, Josquin des Prez, Roland de Lassus, des Miserere et des motets des plus mystiques. Cette nuit là, bien malgré moi, et comme par anticipation, j’avais déjà une forme de messe des morts qui travaillait dans la tête.
Maman me dit que la nuit avait été étrange, que pour la première fois, il avait eu comme une prescience de ce qui allait arriver, qu’il ne put presque pas dormir et que des questions qu’il était à cent lieux de poser habituellement revenaient durant ce que je crois avoir été son agonie. Une agonie humble, comme à l’image de ce qu’il avait toujours été.
Le matin, il demanda avec la plus grande naïveté au médecin qu’on avait dépêché par pure formalité, s’il ne souffrait pas de tuberculose. Il faut dire que papa n’avait pas conscience de la nature de son mal. Le médecin parût soulagé d’avoir à répondre sans mentir qu’il ne souffrait nullement de cette maladie, en insistant bien qu’il fallait s’enlever cela de la tête.
Sur l’ordonnance qui suivit, il n’y avait rien. Peut-être quelques pipettes, quelques pailles pour aider à boire sans trop solliciter les muscles.
C’est quand je suis revenu de la pharmacie que maman m’alerta. Durant le temps qu’elle l’avait laissé reposer seul, il était maintenant presque en travers du lit, dans une position de relâchement non seulement inhabituelle pour des membres qui ne pouvait se déployer librement, mais dans cette position largement relâchée que nous lui avions toujours connue quand il dormait.
Seulement les lunules des doigts des mains étaient maintenant anormalement bleues, d’un bleu de mer profonde.
De ce moment je ne devais plus le quitter un instant. On le mit, on ne sait pourquoi, sur le dos, les bras le long du corps, peut-être pour mieux le faire respirer.
D’une respiration qui devenait de plus en plus courte. Cela a pu durer une petite heure. Jo était sorti depuis tôt le matin voir sa belle sœur. Maman et moi seuls étions au chevet. Comme une sorte de sainte famille, sans témoin, sans personne d’autre. Comme une scène qui se devait d’arriver ainsi.
Je me revois encore lui dire le plus doucement possible des mots et des phrases se voulant apaisants. On croit toujours dans ces circonstances que la fragilité de la conscience de ceux qui vont s’en aller a besoin d’un accompagnement paisible. Comme un dernier lien. On imagine qu’ils nous entendent, ce qui est possible. Maman se tenait légèrement à l’écart avec des larmes silencieuses, et durant tout le temps que dura ce passage vers ailleurs, je restais entre mes phrases entrecoupées de silence, scrutant le moindre signe du souffle et de ce que l’on pense être encore le fil qui nous relie à la vie. C’était la première fois que je voyais mourir, et il s’agissait de mon père.
Les naissances sont généralement accompagnées des plus grandes joies et des préludes aux plus délicieuses manifestations du bonheur à venir.
Dans le cas de la mort de papa, j’ai senti pareillement, ce quelque chose de sacré qui accompagne ce qui ne se produit qu’une seule fois.
De la mort, je n’en dirais rien. Je ne saurais dire à quel moment s’est réalisé le passage, celui où on peut déjà parler au passé, et dire il est mort.
Le souffle était de plus en plus court au point de ne devenir qu’un seul mouvement bref dont on ne sait plus reconnaître si il s’agit d’inspiration ou d’expiration. Le visage était sans aucun signe de trouble apparent, les yeux clos.
Comme disait Jankélévitch, je restais en équilibre entre ce je ne sais quoi et ce presque rien préludant à la mort de Mélisande, d’un passage dont on n’a jamais bien compris l’infinitésimal moment où l’on doit parler au passé ou au futur.
…………………………………………………………………………………………
Le Bolero de Ravel, c’est comme la pureté politique. La noire se décline comme un tempo d’acier à 92, sans jamais transgresser celui-ci. Ce qui est affreusement presque impossible, parce que en montant en dynamique (le cœur humain étant ainsi), le tempo a tendance à accélérer, et les musiciens dans la masse sonore, sans le vouloir, accélèrent.
Conclusion, la fidélité du cœur, qu’elle soit de l’ordre de la palpitation ou du jugement et des promesses des humains en vient toujours à faillir.
…………………………………………………………………………………………
Bourgeois, le XIX° siècle ? Le ventre de Louis Philippe, peut-être.
Mais Clara Schumann eut sept enfants de Robert. Ce qui ne l’a pas empêchée d’avoir Brahms pendant quarante ans comme ami (?) si proche qu’il demanda à celle-ci la main d’une de des filles, à un moment où elle avait plutôt besoin de se rapprocher de son amant.
D’autre part, Robert, est mort de la syphilis (ce qu’on reconnaît seulement aujourd’hui) contractée auprès d’une certaine « Caritas », bien avant d’aimer Clara.
Certes, on a aujourd’hui le sida… Pour conquérir sa future épouse, Robert dut intenter un procès à son futur beau-père. Est-ce une vie de bourgeois ?
…..
Ce que j’aime chez Schumann, c’est sa faiblesse. Pas celle de sa maladie, celle de son chromatisme qui file sur trois mesures en dièze, qui se poursuivent après rupture, en quelques bémols. Brisures émouvantes de l’âme, de ses fissures internes qui n’ont pas à être jugées sur le plan de la seule écriture classique.
L’allegro final du Quintette, c’est Bach jusqu’à perdre le souffle.
…………………………………………………………………………………………
Les odeurs du végétal flétri sont les plus pestilentielles parce que renvoyant aux morts des plus lointaines origines.
…………………………………………………………………………………………
30 Septembre
Un Vert, c’est généralement un ancien Rouge devenu végétarien et amis des animaux. Désormais adepte de la charia. C’est le sentiment que j’ai quand j’entend le chafouin Edwy Peynel.
………………………………………………………………………………………..
Alors qu’on culpabilise tous les européens avec le colonialisme et l’impérialisme occidentaux, l’impérialisme arabe est, au contraire, présenté comme une fierté pour les musulmans. Personne ne s’avise de faire remarquer que l’islam a colonisé des territoires qui appartenaient à des civilisations anciennes, et que ce faisant, il a écrasé et réduit à néant de nombreuses cultures.
IBN WARRAQ
(in Pourquoi je ne suis pas musulman)
***
Sourate 3 verset 151
« Nous allons jeter la terreur dans le cœur des mécréants »
Sourate 9 vs 123
« Combattez les infidèles qui vous avoisinent, qu’ils vous trouvent toujours sévères à leur égard, sachez que Dieu est avec ceux qui le craignent »
***
………………………………………………………………………………………………………..
C’est un lieu commun que de dire que la science a tué la foi, qu’elle a tué les anciens dieux. Il est exact qu’elle a remplacé la foi dans la thérapeutique de l’angoisse. L’homme attend d’elle qu’elle le rende immortel dans ce monde et non dans l’autre (ce qui déjà est une forme de foi). La déception est proche car la science n’apporte pas de solution à la destinée. Elle ne donne pas de sens à la vie. Elle se contente de l’organiser, ou si elle lui donne un sens, c’est de n’en avoir aucun, dans un processus hasardeux et improbable.
………………………………………………………………………………………..
Andris Nelsons dirige ridiculement. Se tortillonnant avec une baguette qui se voudrait peindre à la Velasquez. Poussant le ridicule à dire que la 3 de Mendelshonn était une limite à l’entendement.
…………………………………………………………………………………………Les Louis, les Louis, s’agit-il des Louis ? Non pas spécialement… Je m’entendrai de loin, l’esprit loin, parler des Louis, parler de moi, l’esprit errant, loin d’ici, parmi ses ruines (Malone meurt p.67 ed. Minuit)
………………………………………………………………………………………..
1 Octobre
Des images de J.C. Junker, complètement ivre lors d’un sommet sur l’OTAN. A ne plus tenir debout. Macron et Merkel sont souriants et presque amusés. On le soutient, il embrasse qui veut bien être embrassé.
Les bonnes vieilles habitudes de l’ex-URSS…
Imagine-t-on la réaction des médias devant Trump ne mettant un pied devant l’autre ? Les cris d’orfraie.
La destitution ? le passage en psychiatrie ?
…
Parallèlement, des images de Macron toujours souriant, comme dans un vestiaire après l’effort, chemise au vent, enlaçant deux jeunes rappeurs délinquants antillais, doigts d’honneur en proue, caressants… ce qui a ravi les médias qui n’ont plus le souci de débusquer de nouvelles icônes pour magazines people.
…………………………………………………………………………………………
Charles Aznavour est mort. Le dernier des grands. Pas un geste de trop, une note de trop, ni de grimaces inutiles. J’entends encore La Mamma en 63, du côté de la cour de récréation de l’Ecole des Frères de La Salle, ou derrière les fenêtres qui donnaient au loin sur des collines jaunes et brûlantes. De la plus lointaine mélancolie.
…………………………………………………………………………………………
6/14 Octobre
L’AUTRICHE – SLOVENIE – ITALIE
Samedi 6 Octobre
L’Autriche est en vue aujourd’hui… Les années passaient et on ne voyait plus Salzbourg.
Cécilia m’avait conduit où elle avait vécu le temps de son stage d’économie et de commerce au château de Klessheim.
Des étés durant, en Août, c’était la destination du cœur. Herminie, entre temps, est devenue la marraine d’Hélène et le temps du Festival prenait des allures de fêtes autour des lacs. Les rues pavées de la vieille ville, côté Kapuzinerberg, résonnaient, avec un peu de chance, des voix de sopranos sorties de fenêtres donnant sur l’allée montante du chemin Stephen Zweig. Le soir, ces voix étaient sur la scène du Festpielhaus. On pouvait presque sentir l’évolution des phrases musicales suivant qu’on était sous la fenêtre à même la rue (était-ce Angela Doneke, Waltraud Meyer ?) soit qu’on se trouvait presque en haut de la colline et que la voix magnifiait la vue complète sur l’autre rive de Salzbourg. Dans cette ville, les rues se nomment Clemens Krauss, Dr Karl Böhm… Karajan a sa limousine qui l’attend à la sortie des artistes, Place Herbert von Karajan, lunettes noires, et vitres teintées. Un privilège pour celui qui est né à quelques pas de là. Le Parc, du côté de Parsch, se nomme Maria Cebotari, la cantatrice staussienne qui fut accompagnée par quarante mille anonymes le jour de ses funérailles.
J’avais presque oublié le goût de ces étés finissants et de ces nuits musicales où la cruauté de Salomé le disputait à la mélancolie de la Maréchale, de la Comtesse des Noces, aux surprises extatiques du Prometeo de Luigi Nono.
L’Autriche est donc en vue après le passage du Brenner. C’est le moment où imperceptiblement, la montagne change de caractère et quitte l’Italie, s’affirme plus comme alpine, verdoyante et crue, où l’alpage se désolidarise des forêts drues souvent réparties aux sommets des monts. Les chalets donnent envie qu’on y pénètre, clairsemés ou enchâssés dans l’habitat soudainement devenu d’une harmonie sereine sous le limpide du ciel vers la fin du jour qui souvent nous surprend à cette heure de notre cheminement.
Aujourd’hui c’est la grisaille qui nous a accompagné jusqu’au delà du cœur de l’Italie. La lumière dévoile maintenant timidement le paysage mouillé des environs d’Innsbrück. Généralement, lorsque nous avons passé la perspective de la ville olympique, se profile en un moment très furtif qui n’a jamais fini de nous surprendre, la petite allée menant à la Karlkirche de Volders en bordure d’autoroute, toujours dans sa meringue rouge et blanche et son bulbe caractéristique, dans des champs d’herbes à perte de vue. Les peupliers qui l’enserrent ont énormément forcis depuis notre dernier passage qu’ils en recouvrent une partie de la façade et donnent l’illusion d’ensevelir l’ensemble de l’église. En Allemagne que nous traversons pendant quelques kilomètres, comme en cette partie de l’Autriche, les églises ont toutes leur clocher en forme de crayon bien taillé vers le ciel. Le lac de Chiemsee s’endort déjà, scintillant et repu d’un automne qui n’en finit pas de décliner un été tardif.
Nous parvenons à Wisbauersrasse, chez Hermi, à la tombée définitive de la nuit. Les végétaux du jardin ont tant poussé qu’ils semblent faire un arc floral au portail d’entrée.
L’arbre géant occupe aujourd’hui toute la vue de derrière la fenêtre de la cuisine, les premières tonalités de roux et de presque rouge parsèment l’abondant feuillage qui se hisse au ciel. Du rez de chaussée du vaste chalet, l’arbre semble encore grandir comme d’un éternel élan. Nous retrouvons les longues lianes de haricots verts qui poussent jusqu’au plafond, les souches d’arbres de Merzenstein qui servent de lustre comme au travers des lumières d’une forêt, les boiseries chaudes des longues soirées d’hiver, les éternels bibelots de chats en porcelaine, de ceux dont s’entourent les femmes célibataires, les herbiers aux senteurs rares et cette douceur d’automne qu’accompagnent maintenant les petits blancs au goût de pierre à fusil.
Dimanche 7 Octobre
Déjà, depuis les store vénitiens à moitié inclinés, filtrant le jour, on devine une lumière poisseuse qui prélude à une journée de grisaille, et la sortie des vêtements pour pluie fine qui feutre le calme d’un matin encore assourdi du dimanche et le début d’une promenade à pas lents vers le centre ville.
Le petit cimetière en aplomb des hauts rochers, qui fait de Salzbourg une ville jalonnée de failles, enserre de petites tombes aux croix de fer noires, aux inscriptions de noms aux caractères gothiques de défunts d’un temps très lointain dont les fleurs vives, rehaussées par le mouillé de ce matin, serrées sur de petits espaces, sont probablement le fait de quelques visiteurs anonymes.
Dans l’enclos même de ce lieu de silence, et en contrebas du cimetière, le moulin de la première boulangerie de la ville est encore en activité, avec sa roue qui brasse le petit cours d’eau, sous le regard du saint protecteur de la profession.
La Place du Dom est presque désertée. L’intérieur de l’église, à l’austérité majestueuse, présente ses fresques du baroque le plus échevelé et une succession de grandioses coupoles comme autant de calices de Graal inversés.
Poursuivant vers le dédale des ruelles, c’est Juden Strasse et à l’inévitable cœur de la Gedreidegasse, la maison natale de Mozart qui draine tous ceux qui viennent ici pour la première fois. La façade me fait toujours penser à une fragile table d’harmonie de clavecin, par l’élégance du Mozartsgeburtshaus inscrite au fronton dans son ocre et blanc. Par un triste revers de l’Histoire, se trouve alentour une multitude de commerces de chocolat et d’objets de souvenirs à l’effigie de celui qui n’a jamais été aimé par sa ville et dont, en son temps, l’Archevêque Colloredo aurait botté le train si on en croit la légende.
Mozart n’y aura jamais été heureux.
Puis c’est le pont aux cadenas qui mène à l’autre rive de la Salzach. Sur toute la longueur de celui-ci, témoigne une infinie présence de petits fermoirs aux multiples couleurs, à la manière des papillons dans leurs danses arythmiques, cadenassant ainsi, pour quelque éphémère éternité, les messages votifs d’amour.
Au pied du pont, et comme pour en prolonger un quelconque vœu de fidélité et d’affection, la maison natale d’un autre enfant du pays qui pourrait fêter aujourd’hui ses cent dix ans, celle de Herbert von.
La statue de bronze de pied en cap, dans le jardin longeant la Salzach, a quelque peu terni depuis mon dernier passage et viré au vert de gris. Mais la baguette du maître est toujours en éveil.
A quelque pas de là, et près du fameux Hôtel Sacher, une autre maison où Mozart vécut, et pour composer une manière de trio, la maison de Christian Doppler, physicien et auteur de l’effet du même nom.
Cécilia me fait remarquer que l’air spirituel d’une telle ville ne peut qu’occasionner de telles naissances.
A l’entrée du Mirabell, le petit théâtre de marionnettes est largement béant aux travaux de réfections qui dureront jusqu’à la prochaine saison estivale. Georg Trakl a chanté éperdument dans ce cadre pourtant bien ordonné de ces jardins à la française. La vue sur le château tout en-haut du Hohensalzburg est aujourd’hui compromise.
L’autre trouée traversant le pied du Kapuzinerberg mène au Fidelen Affen (le Singe Fidèle) où Cécilia a travaillé dans les années quatre vingt et y a connu Hermi, gérante de la taverne.
La basse chantante Richard Mayr, le parfait baron Ochs, est née à deux pas, en début de siècle dernier. Les fantômes de tant de monde surgissent ici sans prévenir.
Dans l’Innerstrasse qui coupe la ville sur cette rive, nous pénétrons dans St Sebastian Friedhof et son cloître aux tombes éparses aux croix fichées à même la terre. L’une d’elles porte mention des noms de Konstanz Mozart, l’épouse de Wolgang, et bizarrement celui de Léopold, le père de celui-ci.
Wolfgang, quant à lui, n’aura eu que la fosse commune de Vienne.
C’est l’heure, en fin de matinée, du vin blanc au Mozart Winkler, exposé sur l’étroitesse d’une placette gorgée de monde, fuyant l’incessant crachin et se réfugiant dans l’éclat de la lumière jaune saturée d’humidité. Nous rejoignons Wiesbauerstrasse par des rues de maisons basses de la plus belle poésie salzbourgeoise, fleuries et comme disposées à y installer, dans leur sérénité, leur capacité d’éternité.
Comme les nuages ne quittent pas l’horizon, c’est une promenade à travers la campagne que Hermi nous propose, vers ces montagnes qui dominent toute la vallée, que traverse une très longue ligne droite, comme une saillie dès la sortie de Salzbourg, bordée d’arbres immenses et de maisons basses du côté de Clanegg, et face au mont Untersberg.
La pente est rude et le panier à champignons est encore vide. Le chemin montant mène à des sous bois et des clairières rendus au vert végétal le plus intense sous l’effet des gris que le spectre lumineux paraît creuser jusqu’au plus lointain de la forêt. L’enchantement et le silence des lieux ne sont troublés que par le souffle qui se fait court à certains moments de la pente. Hermi nous apprend que l’ail-champignon minuscule et se confondant au brunâtre de la terre, est parfois préféré, par les grands cuisiniers, à l’ail naturel.
Nous passons de la plus basse intensité de lumière sous les grands hêtres, à de larges espaces découverts pour reprendre le chemin des trompettes de la mort. C’est au plus profond et au plus obscur de la forêt que se trouvent ces trompettes, enlacées par les tapis de feuilles de hêtres et les boues qui masquent leur emplacement par grappes, d’autant qu’elles se confondent avec les couleurs de la terre. Ces grappes, une fois qu’on s’accoutume à en repérer les formes, ont réellement l’apparence des cylindres de soupapes de Maserati ! Sous les épais feuillages nous faisons la rencontre d’une salamandre noire et jaune citron, à la marche désespérément balancée, à la recherche de quelque femelle.
Plus d’une heure a passé et le panier est rempli.
Comme certaines pierres se distinguent par leur rose pâle et semblent se casser en arêtes vives, j’apprends qu’il s’agit de marbre caractéristiques de la région. Quelques lacets plus en avant de notre forêt miraculeuse, et plus haut dans le paysage où se découvre maintenant Salzbourg tout au loin, s’ouvre une ancienne carrière de marbre lacérée en de larges et dernières entraves d’exploitation. Parmi les abandons du chantier, la surprise est venue d’une multitudes de sculptures anonymes, laissées sans autres raisons aux quatre vents de la carrière. On y découvre des esclaves enchaînés à la manière de Michel-Ange, des Vénus généreuses, des saltimbanques contorsionnés et quantité d’esquisses à peine débourbées dans leur gangue. Certaines ont reçu un revêtement de peinture.
Plus haut encore, en un lieu où les chanterelles font autant de taches colorées qu’en d’autres forêts pourraient le faire la danse des papillons, c’est maintenant un endroit sacré auquel nous sommes conviés. Hermi enserre d’ailleurs tout ce qu’elle peut prendre d’énergie en enlaçant un arbre gigantesque là où nécessiteraient cinq personnes pour en faire le tour.
Plus loin, une source aux vertus énergisantes coule lentement au pied d’un vaste éboulis revêtu de mousse comme une lave verte à laquelle l’eau la traversant devrait ses propriétés bienfaisantes.
Des chamans ont ici leur territoire magnétique. Des jalons sculptés sont disposés en des lieux faisant liaison, connus d’eux seuls, comme si ces points précis délimitaient leur champ d’énergie.
Ces sculptures, en y regardant bien ne sont nullement taillés dans de la pierre , mais sont des superpositions de galets, de marbres fendus, disposés de telle façon que des figures semblent apparaître de ces empilements. Certaines, par leur forme, paraîtraient même douées d’un évident caractère psychologique.
Les lieux sacrés que nous avons découvert étaient tous deux au pied d’une sorte de coulée végétale, abrupte et faisant faille.
Trois pièces de monnaie romaines ont été trouvé en ces lieux en 1855.
Ce soir nous embouchons en sauce les trompettes de la mort.
Lundi 8 Octobre
C’est un mélange de brouillard matinal et de soleil en alternance, jusqu’à ce que se découvrent enfin les montagnes boisées. Le Schaffberg (?) semble sortir, par sa tortuosité toute de guingois, d’un tableau d’Altdorfer ou de l’arrière plan d’un Bruegel.
Le vert amande et le jaune moutarde sont très prisés pour les chalets. A de vastes pâturages aux vaches clairsemés et jamais bien nombreuses, succèdent des forêts de sapins, des monts et des villages proprets et sages. C’est la Salzkammergut, la route enchantée. Puis se découvre en contrebas la succession des lacs.
Fushelsee et déjà le rouge des arbres avec l’émeraude en miroir au creux des monts. Pour l’anecdote, le seul paysage artificiel rencontré, inattendu au bord du chemin, sont les bureaux modernissimes de la société Red Bull, dans leur décor d’arbustes et de végétaux japonais sur une petite pièce d’eau qui ferait croire à un vrai site asiatique.
Saint Gilgen am Wolfgangsee se reflète sur le miroir d’eau en glacis argenté sous la pâleur encore tenace des brumes et des reliefs tranchants des lumières de dix heures.
C’est la Romantischstrasse.
Bad Ischl, ville de l’Empereur Guillaume, traversée par la rivière du même nom, dont nous verrons furtivement une belle statue de couleurs et la somptueuse villa, et au détour d’une placette, le Théâtre Lehar, originaire des lieux.
Mais la perle du jour, la perle de toute l’Autriche, comme en un condensé de l’architecture du pays, de son environnement de lac au pied des montagnes, c’est Hallstatt.
La lumière vive et l’absence absolue de toute entrave à l’azur aujourd’hui, n’en font que plus ressortir ce joyau de village.
Mais aussi village le plus courtisé du pays où les agences de voyages lancent des milliers de chinois chaque jour. Et cela ressemble proprement à une forme d’invasion, comme le ferait les sauterelles, le temps de leur passage chaque jour recommencée.
Ceux-là confondant assurément le village réel avec un village de type ferme modèle ou village témoin où les habitants seraient de gentils figurants faisant plus vrai que vrai. J’ai appris, car je l’ignorais, que les chinoises avait le sens du nombril très prononcé. Leur civilisation est bien éloignée de la notre mais n’explique pas cet endimanchement des dames au bord du lac, talons hauts, escarpins, robes fendues de cocktail à dix heures du matin, voire fausses robes de mariée ( !) pour recevoir, non l’éblouissement du ciel et de la montagne qui se mirent dans un silence de paradis, mais pour valoriser narcissiquement, au travers de pauses, de minauderies, toutes les gammes de leur charme personnel. Les messieurs, dans des postures de paparazzi, à genoux, contorsionnés, à fleur d’émoi, flashant de leur superbes appareils leur épouse faisant mille fois le tour d’elle même comme des sushis californiens en vitrine.
Hallstatt n’en est pas moins un joyau que nous n’avions plus traversé depuis une vingtaine d’années. Sa double exposition solaire lui permet d’être admiré d’un ponton sur le lac, mesurant toute l’étendue des architectures, dominée par le clocher au cœur du village au soleil levant. C’est également sur cet axe qu’est tracé la rue principale traversant d’Est en Ouest. Dans tout le village, ce sont des maisons de tradition, c’est à dire des maisons de contes de fées, de bois lourds et de balcons fleuris, de murs immaculés, de fontaines au centre des places pavées et de ruelles montantes qui découvrent toujours plus de perspective soit sur les lacs et la montagne dominante, soit sur les toits des maisons du dessous. Avec un clocher toujours, pour habiller le paysage. On y entendrait presque une sorte de mélodie du bonheur. L’autre exposition solaire, celle du soir, rend une perspective plus resserrée, là où le village semble sortir les pieds dans l’eau, sur une grande partie de sa largeur, et offrir, au sommet de la vue, le clocher sous son autre facette.
Hallstatt étant tellement courtisé, il s’est vu récemment sur les plaques du nom des rues des indications en allemand et en chinois, disant que les photographies prises depuis un drone, étaient interdites…
Cécilia tenait évidemment à revoir l’auberge au bord du lac, Gosaumühle, où elle avait travaillé quelques mois et avait eu la chambre au petit balcon de bois sculpté que Sissi Impératrice avait occupée une nuit.
Il ne reste du lieu qu’abandon et désolation. Le lac garde sa majesté et ses éblouissants reflets jusqu’aux montagnes enneigées.
Repassant par Bad Ischl bien après midi, nous déjeunons de cerf aux groseilles, sur une belle place, au Restaurant Sissy, anciennement nommé Kaiserin Elisabeth, à l’intérieur baroque et au charme totalement désuet, où ont séjourné, (pas en même temps), Mark Twain et Théodor Hertzel.
C’est Salzbourg le soir qui s’illumine d’elle même, de son élégance de champagne. Les trépidations touristiques sur Gedreidegasse ont fait place à un crépuscule qui se confond avec les premiers éclairages des édifices publics.
Ce séjour avait été initié il y a de longs mois. Il s’agissais de réunir les anciens de Klessheim à une date qui avait donc été fixée en ce début d’octobre faute de pouvoir réunir le plus grands nombre de ces anciens pensionnaires d’une bourse d’étude octroyée aux méritants d’Asie, d’Amérique du Sud et d’Afrique. Cécilia représentait la Colombie. Ses résultats lui avait permis de décrocher cette opportunité très prisée. Durant de longues années, une très large affiche faisant la promotion de ce système de détection des futurs cadres dans le secteur de l’économie et du tourisme, représentait Cécilia en un panneau de cinq sur cinq, souriante à sa table de travail, casque sur les oreilles, dans une salle d’étude des locaux du château. Durant les nombreux séjours que nous passions ici l’été , l’affiche s’étalait avec le même éclat que s’il s’était agi d’une star du Festpielhaus. Nous en avons longtemps souri.
Donc rendez vous ce soir avec les seuls qui avaient pu honorer ce projet de retrouvailles, sur la Place Mozart, au Koller and Koller. Durant tout ce temps qu’il fallut pour remonter trente cinq ans de passé, l’anglais, l’espagnol et un peu de français furent nécessaire. Mais nous ne fûmes finalement que six.
La nuit est maintenant bien tombée sur la ville. La lumière est encore plus intense sur la façade absolument déserte du Dom. De même les rues traversant le cœur historique semblent être pour nous seuls, tant Salzbourg, hors la période estivale, a perdu le sens de la nuit.
Mardi 9 Octobre
Nous quittons Salzbourg à la première heure pour le Sud et la Slovénie. Dès l’entrée dans le pays, les paysages et l’habitat brillent d’un caractère bien prononcé. Même la forêt se différencie par le retour exclusif des bois de sapins. De même les boiseries des maisons paraissent plus usées, comme écornées dans leur vives couleurs aux avancées de fenêtres de type échauguettes.
Et puis c’est le lac de Bled qui nous prend à la gorge dans son superbe isolement. De loin, l’îlot au centre du lac, avec l’église, son clocher et la couronne végétale qui l’enserre, donne l’impression d’un mirage flottant sur les eaux ou une apparition révélée de Vaisseau Fantôme.
Nous longeons le sentier pédestre qui fait le tour du lac où l’on ne serait étonné si au détour d’un paysage de marronniers ou de saule pleureurs alanguis sur l’eau on eut entendu une mélodie de Mahler, ou mieux, la voix d’Anton Dermota dans un quelconque Brahms ou mieux peut-être, ce fameux Chant des esprit sur les eaux de Schubert. On peut rêver d’autres lieux rivalisant et respirant le romantisme, comme Neuschwanstein, ou peut-être Durnstein au bord du Danube, quelques paysages dramatiques de Châteaubriand, mais le calme extatique de cet îlot sur le bleu le plus proche de l’Angelico restera une des plus vives inspirations qui se puissent proposer.
De quelque angle qu’on se place, l’îlot à l’église attire comme une aimantation, proposant, comme pour un modèle de mode en mouvement, toute une gamme de profils infinis.
Nous prenons la « gondole » où peuvent se répartir une quinzaine de voyageurs, dont une majorité de suédois bavards. L’approche de l’île se fait lentement, les marronniers sont dans le jaune de l’automne et tirent déjà sur le rouge qui épouse la pureté limpide de l’eau bleu sur l’autre bleu du ciel. Une vingtaine de minutes plus loin nous sommes rendus au pied de l’édifice, au clocher à bulbe et au revêtement d’un blanc immaculé. Des tables et des chaises de bois nous attendent pour un temps précieux de contemplation.
De retour sur la rive d’où nous étions parti, il est temps de déguster la plus belle des truites aux câpres et au vin blanc.
Dans le lointain, on peut entendre maintenant les cloches qui sonnent éperdument depuis l’île et depuis l’autre rive du lac. Il y a ainsi des moments où vient aux lèvres le fameux « luxe, calme… »
Plus au Sud, c’est le tout petit village de Radovljica. Comme vivant au rythme des siècles passés. Le cœur de ce petit endroit est une longue rue large et silencieuse, bordée de quelques restaurants où seules deux ou trois tables vous accueillent, de quelques bars pareillement modestes avec les petits vieux vivants ici dont aucun éclat de voix ne vient troubler la lenteur de l’après-midi, mais un feutré d’atmosphère au ralenti, comme si les horloges avaient décidé de prendre le temps. Tout au bout de la seule rue apparente, aux maison décorées de fresques qui perdent de leur éclat, l’église est au fond d’une petite place semi circulaire, noyée par de gigantesques arbres d’un roux qui fait penser aux automnes de la Nouvelle Angleterre.
Et ce petit bout de village abrite le conservatoire de musique slovène le plus important du pays.
Kranj est une ville plus grande, mais l’intérêt se borne en son centre historique, similaire à celui de Radovljica, mais bien plus animé par la présence d’enfants et d’adolescents à bicyclette, de jeux et d’animation près de la fontaine de la rue principale. La ville est entourée d’une rivière, mais les rives de celle-ci étant tortueusement éloignées, nous renonçons à la vue typique qui se propose. Les maisons sont toutes de crépis pâles, et l’église, massive, qu’on l’aperçoit de très loin, est mangée au flanc de beaux lierres crépusculaires.
Ljubliana.
En fin d’après-midi, la fatigue commence à se faire sentir. Le centre de la ville a été difficile à trouver, mais nous logerons à l’Hôtel City, en lisière du cœur historique. Face à notre fenêtre, un grand immeuble sombre datant des temps obscurs mais à l’architecture classique, laissant voir le soir par de larges fenêtres la vie de ceux qui y habitent. Comme à Londres, c’est un petit fenêtre sur cour.
Utica voulant dire rue, et Cesta probablement avenue, nous nous laissons glisser dans le grouillement nocturne de la ville. La première impression est une impression d’obscurité relative dans la pourtant sensible densité d’activités et d’animations alentour. Les pavés font mal aux pieds et bien vite nous nous trouvons au cœur de Ljubliana, apparemment bien mieux éclairée puisqu’il s’agit de la place de l’église des franciscains, baroque et rose, où l’on peut voir maintenant une population très jeune, rassemblée sur les marches des escaliers, s’accoudant aux murets de pierre festonnés qui donnent sur de nombreux bras de la large rivière qui traverse à cet endroit. L’église est escortée de très hauts arbres presque nus en octobre, la recouvrant en grande partie sur sa façade, et lui faisant face, un monument sculpté tout en contorsions et d’un lyrisme démonstratif à la gloire d’un des héros de la langue nationale, Preseren, le poète romantique slovène le plus aimé. Monument qui complète l’harmonie d’une place qui a les charmes évidents des belles villes baroques.
Une merveilleuse musique traditionnelle vient aux oreilles, comme une effluve, traverser ce tableau et lui donner un ton presque déplacé au cœur de tant de sons et d’animation. C’est un simple accordéon, puis un instrument à cordes que je n’ai pas identifié (mais probablement traditionnel) et la voix juvénile et parfaitement timbrée d’une jeune fille qui distille une mélopée mélancolique et lente, assise au coin d’une rue. Je garderai le regret de ne pas être allé les voir de plus près, de leur parler peut-être, parce que je n’ai plus trouvé depuis, dans le paysage sonore, de tels instants de grâce dans tant de simplicité.
Nous dînons sous les éclairages crus d’une terrasse pavée au bord de la rivière où la fraîcheur a fini par s’installer.
Mercredi 10 Octobre
Ljubliana nocturne, et Ljubliana sous un manteau de brumes du matin. Ljubliana un peu fantômatique.
Comme à San Francisco, par de capricieux et mystérieux phénomènes, les matins de brumes tendent à s’éterniser même les jours de parfait beau temps.
Non loin de l’hôtel, à l’opposé de la vieille ville, avant la gare ferroviaire, Metelkova utica et tout autour, sur d’anciens bâtiments militaires abandonnés, le quartier alternatif de Ljubliana. Pour y parvenir, nous longeons de tristes rues rendues d’autant plus désolées qu’elles sont traversées par un matin gris, et que la lèpre des murs et de certaines façades n’en cachent pas l’aspect nettement banlieusard. Des terrains vagues arrivent, puis des maisons basses déjà colorées, balafrées de méchants graffitis, puis de plus audacieuses réalisations, figuratives ou franchement décoratives, hautes en vivacité. Certaines façades ne cachent pas les messages idéologiques dans la broussaille des superpositions et des incrustes de mots et de signes. Les arbres ont laissé choir leurs pommes depuis bien longtemps qu’elles pourrissent à même le sol.
Comme nous sommes seuls, j’ai l’impression d’avoir pénétré dans une sorte de fabuloserie à ciel découvert avant l’heure d’ouverture. Deux jeunes sur un arbre roulent un joint dans le plus méticuleux rituel, sans même s’apercevoir de notre présence. Les plus belles réalisations sont des façades et des entrées de maisons, dont l’une arbore, en une myriades de tessons d’assiettes et de terres cuites en mosaïques d’une belle harmonie, à la manière de la maison Picassiette à Chartres, comme en un éclair de lucidité auto dérisoire, Galeria Alcatraz. La plus belle, qui mériterait les honneur d’un sauvetage et une intégration dans un musée du genre (mais ne serait-ce pas contraire à l’esprit du lieu), est celle ou figure, au milieu de mosaïques toujours finement composées, un Apollon ou un Orphée à la lyre, nettement détaché, situé disymétriquement des autres représentations, et incrusté dans le cadre d’une fenêtre pour mieux se détacher de l’ensemble.
Ma plus belle surprise fut de découvrir le dessin, de belle proportion, d’une tête de Stravinsky du temps où il arborait une sorte de béret basque.
Et puis vers les onze heures la lumière jaillit. Ce que nous avions découvert à la nuit tombée dans le centre ville et sur la place des franciscains, est maintenant rendu dans les plus souriantes teintes pastels, entre l’église, les ponts et les murets de pierre inclinant aux méditations matinales. Preseren en paraît encore plus démonstratif (à la manière de Rouget de l’Isle, partition de la Marseillaise en main). La rivière même en paraît élargie, l’azur enfin, rend les édifices classiques dans un relief qui leur fait porter leur âge, nobles et imposants. Apparemment l’ombre a toute son importance. Le long de la rivière que nous arpentons maintenant, les maisons et les quais sont jalousement protégés, et à mesure que l’église des franciscains s’éloigne en perspective, les reflets des arbres et des maisons se dessinent plus fortement dans l’eau. Depuis les escaliers qui mènent à la place Kongresni et l’église des Ursulines, nous avons une vue presque dégagée, à l’exposition du matin, sur le château en haut de la colline. Nous prenons un verre de blanc sur une terrasse, dans la belle harmonie conjuguée des pierres, des maisons qui raconte leur histoire, des arbres en point d’interrogation penché sur l’eau, et des lumières à l’heure la plus favorable.
Ljubliana était dans un état d’effervescence que nous ne comprenons qu’au moment d’en partir. Elle recevait en son centre ville, un congrès mondial sur l’intelligence artificielle.
La Slovénie est décidément petite.
Sorti de Ljubliana en début d’après-midi, sur le chemin de Smartno qui se devait de n’être qu’à quelques kilomètres, on nous apprend que les Smartno (contraction slovène de San Martino) sont aussi nombreux que les Villeneuve en France (et que les différents Martin en Europe). Par chance, le notre, médiéval, se trouve sur la route que nous emprunterons sur le chemin de l’Italie.
L’arrivée à Piran se fait sous un ciel estival, ce qui n’en rend que plus éclatant la blancheur globale de la cité sous sa lumière du couchant.
L’hôtel ne pouvait pas être en meilleur endroit. Sur la grande place en forme d’ovale, large, avec sa perspective sur le haut de la colline, dominée par l’église, son clocher très nettement vénitien, les maisons baroques et la statue de celui qui semble être le maître ou le héros des lieux, Giuseppe Tartini. Notre hôtel est du même nom.
L’influence de Venise est assez décelable au premier regard. Les maisons basses s’imbriquant dans les dédales des ruelles sombres, et avec un peu de chance, des fenêtres colorées aux festons gothiques en façade. L’essentiel de la ville historique tient en une oblongue presqu’île qui se termine par un phare, devenu un petit observatoire qu’on paie un euro pour découvrir la ville basse par dessus les toits. Au-delà du phare, sur la rive opposée, des quais aux nombreux bistrots s’offrent à nous avec des chaises longues, des tables et une vue sur l’Adriatique les pieds presque dans l’eau, au seul bruit des vaguelettes qui viennent clapoter contre les rochers. C’est donc l’heure du petit blanc.
C’est là que le soleil se couche, derrière le phare en une longue et douce agonie de lumière qu’on ne perdra de vue que lorsqu’il basculera complètement, laissant sur l’horizon son halo mauve et ses derniers pales reflets jaunes.
La nuit n’est pas encore descendue, c’est la lumière impalpable entre chien et loup où les premières étoiles et l’éclairage des remparts d’une colline haute opposée apparaissent. Nous grimpons par les ruelles étroites jusqu’à ce point de vue où l’ovale de la Place principale, notre hôtel et le tortillant Tartini, le turbulent, l’espiègle, se voient également en plongée abrupte dans le jaune des éclairages de la ville. La perspective est un ravissement de couleurs douces et de dominantes bleues, des petits éclats jaunes qui sortent des fenêtres, rehaussées par les tonalités complémentaires qu’offre la mer se confondant presque avec le ciel. Au sommet où nous sommes hissés, le clocher est doucement éclairé comme une grande bougie, et de l’intérieur de la nef viennent des accents de musique grégorienne qui rendent plus poignant ce début de la nuit.
Redescendus non loin de l’hôtel, nous dînons chez Kantina, sur une terrasses à deux niveaux, sous les vignes vierges, de poissons gigantesques, de bonheur gigantesque comme une sonate frénétique, posthume et hilare du Tartini. La terrasse de notre chambre, les ferronneries torsadées du balcon donnant sur le port, le souffle de vent frais avec les notes écrites que voici, sont une dernière image sur l’Adriatique qui s’endort.
Jeudi 11 Octobre
Nous remontons maintenant après le beau crochet d’où nous étions partis. Piran étant le point le plus au sud de notre périple. La lumière vive nous ne aura plus quittés depuis le dimanche des champignons, et la route empruntée est une alternance de mamelons aux cultures viticoles que traversent de petites routes sinueuses et de beaux villages frais comme le matin. L’arrivée à Smartno, notre Saint Martin retrouvé, est au sommet de l’une de ces collines en pente douce, dominée, depuis les lacets du dessous qui mènent au village, par le clocher massif et une enfilade de maisons blanches sur toute l’enceinte extérieure d’où s’ouvre une unique ruelle pour piétons avec son auberge aux tables déjà prête pour les probables rares clients du midi. Il s’agit du plus petit village possible qu’on puisse concevoir. Il est dit village médiéval, mais je crois que par le style des maisons blanchies à la chaux et leur côté un peu basquisantes, aux balcons de bois et aux chapeaux des toitures, la plus ancienne ne doit pas être antérieure à la fin du XVIII° siècle. Quelques treilles donnant sur la rue habillent d’une poésie figée certaines demeures encore endormies, et c’est sur la placette, la seule apparemment, que nous prenons sur la terrasse de l’unique bistro égayé par les quelques habitués, le verre du vin local.
La frontière est traversée presque sans prévenir, si ce ne sont les deux panneaux bleus aux étoiles de l’Europe, signifiant la sortie de la Slovénie et l’entrée quelques mètres plus loin en Italie.
La seule impasse faite au programme slovène est d’avoir eu à renoncer à la bucolique Logarka Dolina, trop excentrée du côté de Maribor.
L’autoroute encore, puis enfin Venise…
Du moins, l’aéroport de Venise.
J’ai souvent été à l’aise parlant de Venise parce que je n’y étais jamais allé. Pensant qu’il était plus pur d’en parler par la seule imagination. C’était l’eau, les masques, les profondeurs de l’hiver, la cinquième saison de Vivaldi dont parle Orlando Perera, Casanova. Je ne savais pas que ni le silence, ni le désert des villes qu’on peut parfois aimer, n’existent pas ici, avec l’eau morte, la fièvre des foules, les fêtes galantes et les luxes qu’on imagine.
La première fois que j’eus l’idée de venir ici remonte au film de Visconti, en 71, quand Stef frappa à la porte de chez moi et émit le désir fou d’aller en stop passer deux jours sur les lieux même de la Mort à Venise. L’aventure se termina dans les faubourgs de Milan, faute de temps suffisant (je travaillais en stage d’été et nous ne pouvions perdre trop de notre temps précieux sur les routes). Ce fut comme une défaite d’avoir à rentrer à Nice par le train à la tombée de la nuit.
Plus jamais je n’eus, ou ne voulus avoir l’occasion d’atteindre enfin cette ville qui, quelque part, me faisait peur. Peur d’y loger difficilement, de lutter pour accéder en son cœur avec ses foules hagardes et resserrées, et toutes sortes de difficultés que je voyais, réelles ou imaginaires.
Depuis l’aéroport, ce n’est pas encore gagné, mais en effet, une heure plus tard, la navette nous laisse à la gare. Du premier coup d’œil, c’est toute une embrassée de la ville qui jaillit, pas tout à fait nette encore, mais comme en une fragmentation de ponts, de dômes et de canaux, d’eau et d’embarcations furtives qui se profilent. Venise comme un jeu de cartes épars qui se jette à la figure.
Parmi les mots historiques concernant cette ville unique, la plupart sont laudateurs, héroïques et souvent partagés par la conscience collective, mais peu ont rendu célèbre leur malheureux auteur comme le Président colombien Turbay Ayala vers 1978 qui, lors d’un séjour officiel, voyant tant d’eaux et de canaux en guise de chaussées et de rues, déclara sans rire aux vénitiens: « Je salue les sinistrés, les sans abris et les inondés de la ville… la Colombie est de tout cœur avec vous…» croyant à une brusque montée des eaux dans les jours qui précédèrent.
A la grande honte de tous.
Ce qu’on sait par déduction, c’est qu’il ne devait avoir de conseiller pertinent dans son entourage. Coutumier du fait, celui-ci fit un jour une déclaration de vol à ses Assurances en notifiant les marques commerciales des objets dérobés, dont une valise Sansonite, une montre Rolex et un crucifix estampillé Inri …
Bien que ce Président fut peu éduqué, je crois que ses détracteurs avaient la dent dure.
Par le Nord du Canal Grande nous suivons ce qui paraît le plus large et le plus orienté cheminement vers le cœur de la cité.
Défilent la première église, Santa Maria de Nazareth, Rio Terra Lista di Spagna, la Place et l’Eglise du même nom, San Geremia, et plus loin encore, quand la rue s’élargit, que l’on croirait une artère principale, le Ponte de Canaregio, la Calle dei colori, le Teatro Italia devenu un supermarché, et après la statue de Paolo Sarti, la chiesa et la place San Fosca pour une première respiration et reprendre souffle au pied de l’église luthérienne de Venise, Campo San Apostoli. Nous suivons quelques indications menant vers le Grand Canal que nous n’avons fait que longer jusque là, quand nous tombons sur une placette avec en son centre, la statue rieuse de Goldoni.
Mais comment continuer à prendre des notes quand tant de canaux, de lieux d’histoire, de places et de paysages de ville jaillissent sur le chemin du Rialto.
Le premier débouché sur le Canal Grande se fait du côté de la Ca’ d’Oro aimée des peintres, avec les premières gondoles, les premiers amoureux alanguis, les costumes mariniers des gondoliers, leurs canotiers et tout ce qui fait carte postale sur le chemin. Mais qu’est ce qui ne ferait pas carte postale ici ?
Et face aux pontons aux gondoles, sur l’autre rive, les hôtels et les palais aux fenêtres aux festons gothiques, Palazzo Corner della Regina, Palazzo Pesaro (Museo d’Arte Moderna), Palazzo del Camerlenghi, et la contemplation depuis la Banca d’Italia, du Rialto où débouchent à profusion les départs et les arrivées des petits périples sur l’eau, et plus loin les probables amants du jour et les vieux couples qui s’enivrent du plaisirs des glissades lentes sur l’eau trouble le long des tranchées d’ombres creusées entre de hauts immeubles aux fenêtres closes.
Par le côté de Piazza di Bocca, c’est, sans prévenir, l’éblouissement byzantin sur la Place Saint Marc, avec au fond, paraissant sortir d’un mirage de conte oriental de pastels et de ciselures, la façade de la basilique flanquée du Campanile. J’ai pensé à quelque chose comme du Rimsky Korsakov, un Coq d’Or, ou mieux Shéhérazade, ou une fable musicale, sortie soudain d’une lampe à huile dont la basilique serait le djinn. L’œil mettra du temps à s’habituer à tant de dentelles, de légèretés vaporeuses pour approcher plus avant, vers les détails et la définition de cette architecture d’apesanteur.
Sur les côtés de la place, les terrasses des restaurants offrent des orchestres mal venus de musiciens en costumes blancs et nœuds papillons jouant en milieu d’après-midi des musiques déplacées et tristes.
On souhaiterait presque un jour de pluie pour faire fuir tant de monde qui n’a d’autre tort que de faire comme nous faisons aussi, venir à la contemplation d’un des très hauts lieux de notre civilisation.
Dès l’entrée, il est frappant, malgré l’élan grandiose qui emporte de bleu et d’or mêlés, qu’il n’y ait pas ce frisson mystique que l’on peut ressentir à Chartres ou même à Bourges ou Amiens. Bien sûr, ce peut être un premier jet subjectif qui n’engage que mon sentiment, mais à mesure que défilent les extraordinaires coupoles et les surfaces de mosaïques où se déroulent tous les complets messages de la Bible qui ne peuvent qu’inspirer l’émerveillement, il manque la lumière qui viendrait comme la grâce se poser sur tant de somptuosité. En fait Saint Marc parle un autre langage. Nous sommes loin de la mystique gothique et des volumes rendus à l’état d’apesanteur, mais à la mystique de la profusion, nous sommes chez les rois mages, avec l’or, l’encens et les plus rares et riches merveilles conquises sur cette terre. En entrant dans la basilique, c’est un trésor d’or pur, de bleu d’outre-mer, comme de ce lazzulli si convoité des peintres, qui s’ouvrirait à la contemplation. Il y a, paradoxalement, comme un orgueil profane dans l’excès du détail, dans la profusion trésoriale qui l’emporterait sur la vision globale d’une lumière qui viendrait au cœur de l’édifice.
C’est à Monreale évidemment qu’on pense d’abord pour les dominantes bleus et ors. Mais le plan architecturale de celle-ci est de pure essence romane.
Saint Marc est un enfantement byzantin, et se trouve évidemment conforme à l’air respiré par cette République de marchands et procède de cette luxuriance orientale qui m’avait d’ailleurs frappée par le mirage vaporeux de sa façade. Du gothique, elle n’en garde pas l’essence mais l’accessoire, à savoir les rehauts qui lui furent rajoutés au XIII°.
Les surfaces de mosaïques procèdent, jusque dans le choix des tonalités, du hiératisme et du chromatisme ravennate.
Les cinq coupoles venant rappeler la basilique sœur de Sainte Sophie, de cette fusion de la seconde Rome, qui n’a pu échapper à son origine natale sur les bords du Bosphore.
Le palais des doges vient en contrepoint, latéralement à cet équilibre de la Place, et l’angle qui coupe donc l’édifice qui rencontre le quai du Canale di san Marco, le Molo, m’a toujours paru le plus poétique sans que je n’en ai jamais su pourquoi.
Sur le quai, il est temps de penser à rentrer. En contemplant, assis à une terrasse, le ciel qui décline lentement, le va et vient des gondoles noires et bleues sur fond de l’église san Giorgio Maggiore. Le vaporetto nous mène, après un peu plus d’une heure, au quai menant à l’aéroport.
La nuit tombée nous voit entrer dans Padova.
Ce qui peut paraître un paradoxe. En effet, pour mieux étreindre Venise, rien de mieux que de s’en éloigner momentanément. De nombreuses solutions se présentent pour accéder à celle-ci, mais la meilleure des manière de s’y rendre était finalement de se poser à l’hôtel Grand’Italia de Padoue, qui jouxte la place qui donne sur l’entrée de la gare ferroviaire, et le lendemain, rejoindre Venise, les mains libres, après seulement vingt minutes de train.
C’est ce que nous avons choisi.
Passablement harassés, la nuit padouane nous semble sereine et presque tranquille. Nous sommes dans l’axe du Corso del Popolo, et la Chapelle degli Scrovegni, où est le plus bel ensemble de Giotto avec celui d’Assise, se trouve à quelques pas. Nous dînons sur une terrasse sur ce Corso, chez Peppen, où semblent se donner rendez-vous d’élégants et d’élégantes noctambules. Des arcades nous abritent et les tables sont installées sur une large terrasse pavée. Pourquoi sous les pavés la plage, alors qu’il y a tant de belles choses encore sur ceux-là ?
Sous des éclairages blafards nous apercevrons, de loin seulement, la Basilique saint Antoine.
Vendredi 12 Octobre
Donc à neuf heures, le train pour Santa Lucia, Venise. La journée des peintures ? Probablement.
Par les ruelles et les canaux, nous parvenons assez rapidement à ce qui semble le cœur géographique de Venise qui n’en est pas moins un des plus dégagés et des plus spirituels de la cité.
Après San Giovanni Evangelista, très vite nous sommes à Campo San Rocco. Les premiers gondoliers sont là, dans la lumière encore rase de cette heure où Venise n’a pas encore la fièvre. L’église de briques rose orangées, I Frari, vaste, peut-être une des plus grandes, qui s’ouvre sur la place Campo dei Frari, abrite des œuvres de Titien, dont le retable du fond, le joyau représentant l’Assomption de la Vierge qui aurait inspiré les Maîtres Chanteurs à Wagner et qui a fait dire à Théophile Gautier « une Vierge plus légère que l’éther le plus lumineux ». C’est une peinture qui aurait révolutionné le thème en question, par la limpidité des tonalités, la liberté des mouvements, la vierge sur fond ocre jaune, très loin des représentations doloristes et assombries du genre. Mendelssohn, lui-même y est allé de son admiration, disant vouloir l’admirer tous les jours.
Parmi les autres chef d’œuvres, un Bellini représentant une Vierge à l’Enfant entourées de saints. Le campanile dei Frari est aussi plus élevé que celui de saint Marc.
Contournant l’imposant édifice, nous sommes à présent devant l’entrée de la Scuola Grande di San Rocco. Une Ecole est une confrérie pénitente (?) placée sous la protection du saint patron des pestiférés et qui a pour finalité de porter mutuellement secours à tous ceux que pouvaient aider ces Ecoles. Les Grandes Ecoles des arts et métiers du XVI° siècle verront fleurir des artistes dont celui qui représente à lui seul, de ses seules œuvres, l’extraordinaire palais Tintoretto.
Ce matin il n’y a personne. On a l’impression que la visite, dans le plus parfait silence, nous est réservée. C’est d’ailleurs tellement recueilli, qu’on n’aperçoit pas immédiatement les femmes en blouses blanches, maculées de peintures, qui restaurent sous des éclairages d’atelier, une Vierge en méditation.
De la salle du bas et de tout l’étage supérieur, cinquante deux représentations de Tintoret se déploient, soit emplafonnées, soit couvrant les surfaces latérales, enchâssées par de somptueuses boiseries dorées sur de très larges espaces Renaissance, princiers et royaux par l’esprit. L’émotion me prend comme devant cette Pentecôte de Greco à Amsterdam.
Je ne saurai ni décrire ni citer la totalité des œuvres de cette collection unique, rappelant simplement la magnifique Cruxifiction de la Salle dite dell’Albergo à l’étage, le sublime Ecce Omo et la Montée au Calvaire dans la même salle. Et comme un hommage au saint patron de l’Ecole, le Saint Roch en Gloire au plafond du même étage. D’autres œuvres viennent s’insérer, une Annonciation de Titien, un Giorgione, le Christ portant la Croix et un Abraham et les Anges de Tiepolo.
Lors de nos visites dans les capitales et les villes d’art, par principe, nous essayons de découvrir celles-ci à ciel découvert, n’ayant jamais le loisir d’épuiser, faute de temps, les richesses muséales des lieux traversés.
Cette exception faite à la Scuola Grande pourra suffire à un bonheur qui ne fera regretter de ne pas accorder plus à d’autres églises ou d’autres musées. Quand bien même serions-nous à Venise…
Sur le chemin du pont dell’Accademia, les ruelles se font plus arborées, des jeunes filles au bord du canal lisent sur des bancs dans de petits jardins sans apprêts mais irréellement simples et beaux, presque échevelés de leur naturel, la lumière de midi approchant, nous sommes maintenant au bras de canal face à l’église de la Salute, un des grands classiques du paysage vénitien. La lumière étant ingrate à cette heure, nous reviendrons au soleil couchant.
C’est sur la Place San Stefano à l’heure carillonnante de midi que nous prenons la halte du vin blanc avant de reprendre vers le Molo Riva degli Schiavoni (c’est à dire le quais aux esclaves).
L’église Saint Etienne protomartyr à laquelle je ne résiste pas, propose deux Tintoret dans l’une de ses ailes latérales, le Lavement de pieds et l’Agonie au Mont des Oliviers, parmi les plus émouvantes réalisations du parfait ténèbrisme du peintre.
Je n’aurai donc manqué, depuis le matin, et au hasard des églises traversées, que le Veronese. Et Carpaccio.
Quittant le quai, dans les premiers dédales au sortir du bord de mer, je me devais d’aller plus à l’est, vers l’église où Vivaldi faisait travailler les voix de ses jeunes pensionnaires orphelines, à San Giovanni in Brogora. C’est le quartier du Castello dont on dit que c’est le Venise des vénitiens. De là, toutes les bribes de l’Orlando Furioso, le Farnace, l’Incoronazione di Dario, l’Armida, ou d’autres ouvrages lyriques encore, ont du être chantés, inspirés, composés, face à la mer ou presque, d’où nous prenons le vaporetto de quinze heure trente pour l’Isola di Burano.
Burano, c’est d’une certaine manière, l’embarquement pour Cythère, l’appendice insulaire d’un voyage à Venise. C’est un peu Venise dans Venise. Le village des enchantements connu pour ses dentelles et dont l’église penche tellement qu’elle rendrait jalouse le Tour de Pise. Des l’arrivée, les cubes de couleurs, les petit lego assaillent les rétines. D’étroits canaux traversent les petits quartiers, qui sont en fait des îles séparées les unes des autres, et des ponts qui les enjambent. Du haut des ponts, qui sont en fait plutôt des passerelles, la perspective se perd jusqu’au bout des canaux, bordés de péniches, et de canots le long des berges. Du linge sèche aux fenêtres, des chats dorment sur le rebord des fenêtres. C’est le paradis de la photographie, de la quiétude dans un splendide isolement.
Le vaporetto est plein, et nous rentrons à Venise au soleil déclinant.
Sur le quai du débarcadère la foule est encore plus dense qu’au moment du départ. Probablement inspirée par la qualité de la lumière sur la lagune. Les gondoliers n’ont aucun répit. Les amoureux partent vers quelque probable Cythère, et la Salute, au loin, laisse encore flamboyer sa coupole avant que n’arrive le soir.
Parvenus sur le pont de l’Academia, c’est maintenant le dernier tableau, la synthèse des images de Venise qui descend dans son crépuscule, le jeu de cartes qui se défait.
L’espace d’un moment je suis devenu Antonio Canal, le Canaletto, et tout autant Guardi le fougueux, le dramatique. Je suis un autre veduttiste. Défilent en moi aussi Monet et Turner. Je dessine de mes yeux le Dôme, je hérisse de fines colonnettes les fenêtres grêles des palais, les pontons rouges et blancs, les Bucentaures aux velours sont en pleines joutes, les Scherzi de Chopin éblouissent, et puis aussi les Nocturnes qui invitent aux rêves, les clapotis nerveux comme autant de virgules sur des bleus du Veronese et la Salute qui change sans cesse ses tonalités vers le Canal. C’est le couchant qui se retire sur l’Orient de l’Occident, le flamboiement final comme en feu d’artifice sur cette cité des fêtes dans le cristal de ses pastels. C’est l’embrasement de la ville qui possède autant d’églises que de masques, de saints que de peintres.
Depuis les marches de la Salute, les rayons se font moins sentir, la lumière est au déclin, c’est bientôt les lampions et la nuit grouillante qui tombe sur Venise.
….
Venise est-elle la plus belle ville au monde ?
Oui et non. C’est une ville improbable. Une ville qui pourrait rivaliser ou se comparer à une autre a une fonctionnalité, pour ne pas dire une raison d’exister en faisant vivre ceux qui la composent et qui ont un avenir à écrire. Venise ne vit que d’être une ville-musée, un lieu de passage. Un sarcophage ouvert aux yeux du monde. Une dépouille de cité aux quelques résidents fantômes.
Son désavantage serait donc de n’être qu’un musée à ciel ouvert, en y ajoutant tout de même la dimension de l’urbanisme, ce qui fait son ambiguïté, mais les musées, c’est bien connu, ne se composent que d’objets morts.
Donc, elle serait la plus belle parure se repaissant d’un temps que le présent renvoie au miroir de ce qu’elle fut.
Korngold pensait-il à Bruges plus qu’à Venise en composant son opéra « Die Toten Stadt » ?
La plus belle ? Probablement Paris, Rome pas très loin. Venise reste dans un écrin de cristal, un témoignage.
…………………………………………………………………………………………
Elle n’en reste pas moins la ville de tous les rêves à réaliser. Un des rares espaces où ce qui est idéalisé en matière de beauté, de ciels et d’œuvres d’art trouve sa concordance dans la chair même de sa réalité.
Ici la réalité est le rêve matérialisé.
Et si l’on pouvait encore se voir un dernier impossible exaucé, ce serait qu’une fois, de temps en temps, le ville ne fût devenue qu’un simple décor dénué de tous ceux qui la peuplent. Une sorte de ville momentanément morte et désertée, à la Chirico, pour notre seul égoïsme.
…………………………………………………………………………………………
Samedi 13 Octobre
Padoue est toujours la ville de Saint Antoine qui l’inspire depuis bien longtemps.
Dans la chambre de la Nonina j’ai toujours eu souvenir d’un portrait du saint, de pied en cape, la tonsure traditionnelle des franciscains et la cordelette comme ceinture à la taille. L’auréole et le regard bienveillant sur l’Enfant Jésus. Ce portrait venait à changer certaines années, sacrifiant à un dessin plus moderne, comme les boites de bonbons Quality Street à la nouvelle année, mais c’était toujours Saint Antoine.
Ce qui ne changeait pas, c’est l’autre portrait qui faisait face, du premier petit garçon de sept ans qu’avait eu Nonina et qui mourut dans les années trente, quelque part dans une sorte de colonie de vacances mussolinienne, d’une maladie infectieuse dont on ne guérissait pas en ces temps-là. Ce n’est qu’en 1937 que naquit celui qui devait le remplacer, ne serait-ce que par le même prénom, mon oncle André.
Durant des années, et même encore une fois arrivées en France, Angela ou Lucia envoyaient un don pour un calendrier (l’Araldo) à un orphelinat de Saint André, quelque part en Italie.
…
Ce matin, la basilique est sous le soleil bienveillant et les cars de tourisme viennent des quatre coin du pays. Sur le parvis de l’entrée, déjà, la statue équestre du condottiere Guattemelata, premier bronze coulée de Donatello, depuis l’époque romaine.
Il serait difficile de décrire toutes les richesses du lieu, mais ce qui frappe dès l’entrée est la grande ferveur qui se dégage depuis la nef principale. Les padouans nomment leur basilique Il Santo, considérée ici et dans le monde de la chrétienté comme un des sanctuaires les plus sacrés au monde.
On apprend qu’Antoine est le saint patron du Portugal, des marins, des naufragés, des animaux, des femmes enceintes, des cavaliers et des Amérindiens.
A défaut d’avoir une réservation pour la Chapelle de Giotto, nous pénétrons ici où les peintures dans leurs diversités d’époques et de styles est ce qui déroute de prime abord. On arrive à dénombrer des dominantes, comme à l’Oratoire saint Georges, et les merveilleuses fresques d’Altichiero da Zevio, le plus grand peintre de la fin du XIV°, dont l’extraordinaire Couronnement de la Vierge de 1384.
La Chapelle Saint Jacques face à celle du Tombeau, chef d’œuvre de la première Renaissance italienne, du même Altichiero.
Dans l’Ecole du Saint, un Saint Antoine faisant parler un nouveau-né, œuvre de la première manière de Titien, une Vierge à l’Enfant de Stefano di Ferrara, la Chapelle de la Vierge Noire avec une statue de Rinaldin de Puydarrieux, les innombrables Chapelles Rayonnantes et la plus impressionnante, celle du Bien Heureux Luc, Luc Belludi, compagnon et disciple de Saint Antoine, des fresques de la vie des apôtres du XIV° siècle de Giusto de Menabuol.
Le déambulatoire est un jaillissement de bleu et d’or sur les murs et les piliers, qui me renvoie à de petites reproductions en bois que j’avais enfant, relatant des épisodes de la vie du saint.
Depuis le cloître des franciscains, au milieu duquel se lance de très hauts arbres, on peut apercevoir les deux clochers et, tour à tour, certaines des coupoles qu’on ne peut jamais embrasser du regard en une seule fois.
…
A défaut de Véronese, l’après midi nous verra de passage à Vérone.
Des pins géants nous accueillent et l’arrivée en ville se fait par une navette depuis le parking assez éloigné du centre historique. Nous descendons sur l’immense place aux pieds des arènes. Celles-ci, sans être aussi impressionnantes que celles d’Arles ou de Nîmes, paraissent bien conservées et la pierre au soleil a de belles tonalités de rose. L’angle le plus intéressant est, comme à Rome, celui où le mur d’enceinte extérieur se sectionne et n’achève pas la clôture complète de l’ovale.
C’est le début de la ville ancienne, par la rue principale qui, comme beaucoup de zones piétonne, ne présente pas trop d’intérêt et ne sont que succession de commerces. Nous arrivons sur une belle place, moins exposée que la précédente, mais où les maisons laissent apparaître de beaux ocres aux murs décatis et aux balcons festonnés. Toutes sortes de plantes poussent ici comme si le moindre espace donnant à l’exposition solaire était prétexte à faire de minuscules jardins. Un immense clocher semble être celui de la cathédrale face à ces maisons anciennes. C’est le marché du samedi qui se poursuit bien après midi. La plus remarquable échoppe est celle où on confectionne des quartiers de fruits aux origines les plus diverses qui composent de merveilleux tableaux éphémères aux harmonies de sang et d’or.
C’est non loin de là qu’on devine la maison de Juliette, à la densité de foule qui s’engouffre sur un mince boyau de ruelle, débouchant sur la place au Balcon.
Comme souvent, c’est sur les lieux victimes de leur histoire et de leur popularité qu’on voit les scènes les plus ridicules se produire, comme ces jeunes et bien moins jeunes femmes qui se pressent sur le balcon afin d’immortaliser leur image en Juliette. Les ridicules sont si nombreux à se presser que le temps de passage est limité.
Par contre, au pied du balcon, une bien étrange coutume veut que des messages écrits sur de petits billets d’amour et d’espoir soient exposés attendant une éventuelle réponse parmi les milliers d’autres qui réclament le même amour et le même espoir.
La petite ruelle qui mène à la maison est assaillie par une majorité de jeunes filles qui viennent aussi graffiter leur amour sur les murs, leur désespoir et leurs espérances amoureuses, composant dans les entrelacs violents des signes, des cœurs et des mots devenus indistincts, une sorte de tableaux vivants in progress.
…
C’est un peu plus au nord qu’on prend la route du Lac de Garde. Il n’est pas facile à la sortie de Vérone de rejoindre le sud de celui-ci où commencerait la vraie succession des villages sur la rive occidentale. Après avoir quitté des petites villes se succédant sans autres charmes que d’être des station balnéaires durant l’été, nous nous trouvons enfin sur le chemin des bords du lac, non loin de Salo, exposé au soleil couchant, comme le sera toute la bordure de route nous menant à Limone sul Garda.
La pierre des maisons, sous les feux déclinant de la fin d’après-midi, en est d’autant plus dessinée au pied du lac, qu’elle contraste avec le bleu profond de celui-ci, faisant une sorte d’harmonie composée de jaune et d’outremer. Après la ville de Salo, la route n’est qu’une succession de grandioses paysages sur un chemin à flanc de montagne où répondent de l’autre côté, sur la rive orientale, les dessins fortement accusés des montagnes opposées. Les fleurs et les haies de cyprès font escorte sur le serpentin de route devenu plus étroit.
Nous assistons au coucher de soleil qui passe maintenant de l’autre côté des rives, pour en apprécier les derniers feux orangés et de vert pastel mélangés sur l’eau du petit port de Maderno.
Les derniers kilomètres sont bien longs jusqu’à ce que l’on atteigne Limone à la nuit.
L’hôtel del Sole se trouve être à même le bord du lac que l’accès en voiture ne peut se faire qu’après qu’une navette nous ait conduit à un parking. Ensuite c’est la partie inaccessible et totalement réservée aux hôtels, aux restaurants et à tout ce petit coin de paradis en rues protégées et en maisons à bougainvilliers autour de la petite anse enserrant une poche d’eau pour quelques barques amarrées. Les rues sont immédiatement montantes et pavées de bonnes intentions puisque ceux-ci poussent la délicatesse d’être roses et blancs.
…
Dimanche 14 Octobre
Depuis la terrasse à l’heure du petit déjeuner, c’est toute la perspective sur le lac et les montagnes qui jaillit dans sa luxuriance.
Ce qui intrigue lorsqu’on est sur le quai, c’est d’apercevoir d’étranges piliers tout au bout de la rive, à la sortie du village, dressés vers le ciel avec une grande régularité, donnant l’impression d’un cimetière. Il s’agit des anciennes cultures du citron sous serre.
Dans le village, juste au-dessus de l’hôtel, se trouve sur trois niveaux une des dernières serres qui se visite. La « Limonaia del Castel ».
Avec quantité de variétés rares de citrons dont certaines ont grandi comme de petits melons. Ces arbres à citron sont sur des terrasses, enchâssés dans des fenêtres dont les piliers de bétons ou de bois, pour les plus anciens, tiennent lieu d’encadrement. L’hiver venu, on jette des bâches qui protègeront des rudesses du climat de montagne.
Depuis les terrasses du dessus où sont les citrons médicinaux, on a la plus belle vue sur les tuiles rouges des maisons se jetant dans le lac. Ces piliers à la verticale donne une lecture du paysage comme le feraient les piliers des temples antiques, rendant celui-ci intelligent.
Le parfum des citrons envahit tellement l’espace qu’on se croirait une écorce odorante dans le paysage.
Le village est maintenant saturé de promeneurs du dimanche et ferait croire que la densité de fréquentation est aussi forte qu’à Venise. La petite anse qui abrite les quelques barques voit défiler maintenant, derrière le petit port protecteur des maisons aux bougainvilliers et aux cactées diverses, de plus grands bateaux à vapeur qui embarquent ou déposent à quai.
Nous remontons, pour finir le voyage, par la ville de Riva di Garda.
La lumière de la fin du matin rend le miroir du lac, les montagnes et les maisons jaunes qui s’y plongent, d’une belle encre de sérénité.
…………………………………………………………………………………………
Ni d’Eve ni d’Adam disent-ils aujourd’hui, à porter ta culotte et mes pantalons, mes rêves, et aux constellations où les étoiles se sexualisent et transitent, nous vivrions administrativement dans un improbable apprentissage d’une « nature » rousseauiste « culturable ».
…………………………………………………………………………………………
J’aime « l’Entretien des Muses » de Jaccottet. Il y parle de tous ceux que nous aimons. Il ne sera pas que le traducteur de Robert Musil.
…………………………………………………………………………………………
Je regardais les ciels de la « Horde Sauvage ». Ils y étaient chargés et saturés en contraste, comme je peux le faire avec les photos qu’on peut aujourd’hui corriger.
…………………………………………………………………………………………
18 Octobre
Parlant du Musée Chagall au téléphone ce midi, il me vient une petite madeleine concernant la triste condition des gardiens de Musées. Un certain Briançon que certains nommaient sans tenir compte de la cédille, eut la malencontreuse idée de siffloter l’amour est enfant de Bohème, le jour où, ayant reconnu Jane Rhodes, seule ou presque, dans une des salles, il mettait ainsi dans la gêne la pulpeuse interprète du rôle de Carmen dans les années soixante dix. Furieuse, jetant les regards de circonstances qu’elle n’avait pas à forcer, tant ils étaient proches du rôle siffloté par le brillant gardien, que celui-ci garda durant tout l’après-midi sur les joues, comme un soufflet, le rouge de la honte.
…………………………………………………………………………………………
Avec la fin des pays d’Outre mer français, notamment de l’arrachement de l’Algérie, le fleuron, qu’une rive de Méditerranée séparait, c’est le temps du reflux de la France qui a commencé il y a soixante années et quelques. Inexorablement. Vers une fin. Laquelle ?
…………………………………………………………………………………………
24 Octobre
FRANCE D’AUJOURD’HUI ?
Pourquoi la France produit-elle de la pourriture, de la délinquance ?
…
Faut-il mettre l’armée à la porte des écoles pour éradiquer la grande faille des désillusions ?
……….
Faurisson est mort à quatre vingt neuf ans. L’opinion « autorisée » a déclaré que l’ordure est enfin morte, que le combat pour la vérité historique continuera à vomir l’opposition négationniste. Léonard ne l’a-t-il été en son temps ?
Mais qui sait que la préface à la thèse en question en est préfacée par Noam Chomsky, d’extrême gauche et homme de couleur ? Lequel écrit donc dans les années 80 que la France est encore dans la fièvre de cette fin de guerre qui n’en finit plus et qu’elle n’est pas prête à en faire une lecture sereine ?
Mais qui a lu la thèse en question ?
………
La France est fragile aujourd’hui.
………
Pourquoi la France génère-t-elle ce qui n’est plus que ce qui relève d’un tribut à la violence pour la paix sociale ?
………
Comment est-on enseignant en Histoire dans la France de maintenant ?
………………………………………………………………………………………..La Messe de Josquin des Prez « la sol fa re mi » aurait aussi pu se décliner en « la si mi fa re », ce qui dans les deux cas veut dire « laissez moi faire » (traduit parfois en anglais, leave me alone) vient de la réponse du cardinal romain Ascanio à une demande d’augmentation des gages du compositeur…
…………………………………………………………………………………………
25 Octobre
Michel Dalberto, parlant d’Armin Jordan, le plus extraordinaire chef et plus encore « buveur » au-delà du tolérable, convient qu’il fut le plus naturel des Amfortas à la plaie qui ne cicatrise jamais, dans le Parsifal de Sylberberg.
………………………………………………………………………………………
L’Histoire, sans les humains, c’est le savoir s’appropriant la géologie, le climat, la possible connaissance des astres et les origines du vivant.
………………………………………………………………………………………..
Winchester 73 cephallus
………………………………………………………………………………………..
29 Octobre
Einstein : « Ce que j’admire le plus dans votre art, c’est son universalité. Vous ne dites pas un mot, et pourtant…
le monde entier vous comprend ».
Chaplin : « C’est vrai, mais votre gloire est plus grande encore : le monde entier vous admire, alors que personne ne vous comprend ».
…………………………………………………………………………………………
31 Octobre
Pavarotti sur son lit de mort donnait des conseils à l’ami Alagna, lui rappelant de soigner mi fa sol, les trois notes de passage, qui permirent, pour la première fois, à Gibert Duprez de réaliser un ut de poitrine.
…………………………………………………………………………………………
4 Novembre
Dimanche de grisaille. C’est bien pour aller au cinéma ugc de Villeneuve. Aujourd’hui c’est Boris. Cécilia m’accompagne.
Les chanteurs ont le souffle court. Il n’y a aucune ligne de chant chez aucun d’entre eux. On a droit à une sorte de schprechtgesang là où je pensais qu’il n’y avait que dans le chant wagnérien décadent (ou celui des premiers âges de Wagner) qu’on pouvait constater de tels manques de technique.
C’était la version 1869, ce qui fait qu’on n’a pas eu l’Acte Polonais, mais un peu plus de chœurs, ce qui a été la bonne surprise du spectacle, et un Chouïski au rôle plus long et plus développé dans la noirceur. Les choristes n’en sont pas moins venus vêtus comme ils l’étaient au sortir de chez eux, ce qui fait probablement des économies dans les ateliers de Bastille et quant au décor, il n’y en avait pas, ça fait dépouillé et moderne à la fois, genre Wieland Wagner, pour pas un sou.
Et pourquoi persister à vêtir, en voulant transposer à l’époque actuelle, les protagonistes principaux en costume cravate, alors qu’on sait bien que peu de gens s’habillent ainsi aujourd’hui ?
Sauf à la City.
Sans compter le ridicule d’un Boris recevant la couronne du tsar en complet trois pièces. Et que, plutôt que d’être à un couronnement, tous semblaient sortir de chez le tailleur. Manquaient seulement quelques monocles pour faire salon.
Le dimanche s’est terminé au bord du Loup. L’eau était limpide et le débit plus fort qu’à l’ordinaire. C’est un vrai plaisir que cette promenade qui devient un peu notre promenade.
…………………………………………………………………………………………
La Nouvelle Calédonie a voté pour rester au sein de la communauté française.
…………………………………………………………………………………………
5 Novembre
Docteur Céline avait raison, le blanc se dissout dans la couleur.
…………………………………………………………………………………………
Depuis le 6 de ce mois, cela fait vingt ans que nous habitons ces Hameaux du Soleil, dans la commune de Villeneuve-Loubet. Hélène y aura fini son enfance et n’en partira qu’à la fin de son adolescence. Vingt années, c’est tout le temps passé à Nice, depuis l’arrivée à Fabron, au Val Azur et celui des Terrasses de la Madonnette.
Ici, ce sont les arbres vus des fenêtre, dont un nous quittera bientôt parce qu’il est mort, ce sont les parterres de fleurs plantés dès notre arrivée, remplacés aujourd’hui par un petit coin salon en extérieur sous le plus grand des deux arbres, les herbiers sur les petits chariots à roues, les tomates et les courgettes plantées pour l’été, puis de l’autre côté, qu’on appellera la terrasse au nord pour les banquets du soir, le petit bassin à l’angelot où s’abreuvent les pies et les chats de passage où ne marche plus le jet d’eau, c’est la perspective sur Saint Paul et le Baou, la forêt environnante. C’est là où des années durant, le derviche tourneur donnait au paysage des allures de Corot, avant d’être abattu lui aussi, figé dans la mort. Ces hameaux seront peut-être la dernière de nos résidences. Il est dur de s’arracher à une demeure, d’autant que celle-ci est la première dont on peut dire qu’elle a été à nous. La raison comprend mieux lorsqu’il s’agit de quitter une location.
Nous n’en avons pas moins ignoré de fréquenter le village lui-même, où Y est entré en septembre pour sa première cours de récréation. Villeneuve est pourtant un adorable village, avec, à son sommet, la ruine du château où fut signé le traité de la Paix de Nice, en 1538, entre Charles Quint et François Premier. Village aux dédales de rues où se gardent en mémoire les recettes d’Auguste Escoffier, natif du lieu, à quelques pas des restaurants où quelques chefs conservent jalousement des spécialités qui firent de cet empereur la gloire de la gastronomie française. Jusqu’au Carlton de Londres où il officia et dans le reste du monde. Villeneuve c’est aussi le joli boulingrin, sous l’ombre des platanes, quelques bistros de charmes aux tonnelles aux lierres grimpant, ses petits commerces qui se serrent en face de la Mairie aux volets franchement provençaux, tout de bleu pareils à ceux du Vaucluse, le Loup qui fait glisser ses colonies de canards, avant la boucle parfois torrentueuse qui descend en direction de la mer. L’implantation d’activités culturelles s’est, depuis cette deuxième décennie, largement développée, avec sa médiathèque et ses espaces de plein air, ses journées gourmandes et ses traditionnelles journées médiévales, mais je n’en ai pas moins gardé cette attirance pour Nice où je continue quotidiennement d’avoir des attaches, et des lieux de rencontres, le Sauveur aujourd’hui, la Dégus hier, la vieille ville qui a son rythme de village, puis tous ces quartiers de mon enfance que je visite en solitaire, et plus loin près de la fac des Lettres, ce plateau de Carlone où se sont dessinées tant d’affections passées.
…………………………………………………………………………………………
10 Novembre
Laurent Obertone, La France Interdite . Courageux, d’autant plus que sa voix se répand dans le désert et la surdité médiatique.
…………………………………………………………………………………………
Encore deux ouvrages de Michel Pastoureau. Une histoire symbolique du Moyen Age occidental, et le très beau le roi tué par un cochon.
…………………………………………………………………………………………
Polaris de Thomas Adès. Une œuvre foisonnante, large de couleurs et qui se souvient bien de Messiaen.
…………………………………………………………………………………………
17 Novembre
GILETS JAUNES
Pour la première fois dans l’histoire de la contestation et des manifestations de rues, des Gilets Jaunes se sont constitués spontanément, initiés par quelques propositions de base dans les réseaux sociaux contre la politique du je taxe tout ce qui bouge et je ne sais faire que cela. Pour la première fois la spontanéité d’un mouvement national d’envergure n’a pas été encadré par les syndicats officiels et reconnu par le gouvernement. Pour la première fois, les médias, habituellement plutôt bon enfant dans les commentaires à chaud, n’ont eu de cesse de répéter que cette volonté de paralyser le pays n’était pas légale. Evidemment il devenait flagrant en cette journée du 17 que le gouvernement de Macron et les médias aux ordres préfèrent négocier avec la légalité de la CGT et des organisations complices, bien qu’en en étant l’antithèse, dans un jeu de dupes où l’équilibre des revendications et le lest lâché par le pouvoir trouvent aisément à contenter les uns et les autres. Même quand la lie des banlieues s’invite à l’embrasement et à l’affrontement avec les forces de l’ordre.
Au lieu de cela, pour la première fois, en plus de deux cent points de barrages filtrant et de ralentissement de l’activité sur le territoire, ces gilets jaunes n’ont jamais manifesté violemment, autrement que pour avancer sur l’Elysée. Pacifiquement. Deux cent quatre vingt mille personnes, hors syndicats, ont demandé la démission du chef de l’Etat.
C’est devenu de plus en plus l’objectif.
Paradoxalement, le Ministre de l’Intérieur, jadis ancien voyou joueur de poker et protégé d’un caïd de la pègre des Alpes de Hautes Provence (« il était comme un grand frère, il m’appelait l’étudiant ») dans sa jeunesse de dérive, se trouve aujourd’hui être le rempart à la spontanéité d’un mouvement national non légal.
Le fusible du Président Macron.
Qui décidément ne peut cacher sa fascination pour les rappeurs exhortant à toute sorte de haine et à un entourage, privé ou non, qui touche à la voyoucratie.
Les myriades de petites taches jaunes se sont dispersées dans le calme, quelques irréductibles auront tenté de passer la nuit dehors en attendant un nouvel élan pour ce dimanche, mais dans le silence assourdissant et arrogant d’un Président qui sait si bien ne pas transiger.
…
18 – 20 Novembre
Encore des ralentissements aux abords des autoroutes, un Premier Ministre déclarant que l’action à mener était la bonne, qu’il fallait comprendre les objectifs gouvernementaux et que rien ne saurait raisonnablement détourner ceux-ci de l’efficacité de leurs plans d’action pour l’avenir.
Pas l’ombre d’un Président en ce dimanche, probablement quelque part en Allemagne et en Belgique, expliquant en vue des élections européennes, les dangers de la lèpre nationaliste.
…………………………………………………………………………………………Ce 19, cela fait quarante années depuis le départ de mon père. Le temps s’est engouffré sans que j’y prenne garde.
Pareillement, un même 19, je recevais, l’année suivante, la liste des résultats du concours pour ce poste de Médiateur que je n’ai plus quitté depuis.
…………………………………………………………………………………………
Dans le froid arrivé sans trop prévenir, c’est le mouvement lent et quasi opératique de la 8 de Mahler qui se lève sur ce dimanche.
…………………………………………………………………………………………
L’enseignement des langues mortes, de celles qui ont été les racines structurelles de notre langue encore vivante, n’est plus en vigueur que pour une élite perdue dans les méandres d’un parcours éducatif qui ressemble à une maigre compagnie mettant les pieds sur un territoire désertique dont on ne sait pas trop quel avenir faire fleurir sur tant d’aridité.
De cet avenir, nous constatons, par contre, une mise en place, dans les secteurs de l’éducation prioritaire, des langues d’origines pour tous les ressortissants du Maghreb, comme une reconnaissance de langue à faire survivre, et quasi première langue au sein de l’Education Nationale, une sorte de bilinguisme proposé, auquel l’accent porterait plutôt vers celle d’origine.
Ce qui revient à constater que l’enseignement du Français apparaît, dans une perspective proche, comme à apprendre et à maîtriser par défaut, une langue seconde et qui ne s’enracinerait que par le bon vouloir de ceux qui désireront à l’avenir la parler. L’urgence étant de sauvegarder dans ces secteurs marginaux de la vie des banlieues le parler habituel pratiqué dans les communautés de ces zones sensibles. Ce qui revient à constater, qu’au lieu d’éduquer dans un tronc commun cimentant les populations qui se destinent à recevoir un avenir sur notre territoire, un clivage voulu et entretenu par ceux-là même qui devrait imposer essentiellement l’effort d’apprentissage de notre langue.
C’est là l’aveu des responsables de notre éducation sur l’échiquier des priorités à donner en matière d’enseignement.
Donc, d’une part, le latin et le grec relégués comme disciplines annexes, comme en soi facultatif, pour de marginaux futurs chercheurs, comme autant d’archéologues d’un savoir suranné et plus du tout comme base de compréhension et lien avec notre français, et d’autre part, l’activation de structures favorisant des langues à maintenir vivantes et prioritaires dans le contrat établi par cette même Education Nationale.
……………………………………….
Demain verra l’enseignement d’une Histoire de France vue en contre plongée de celle enseignée jusqu’à nos jours (quoique perdant déjà misérablement des pans entiers de son parcours), ne narrant le sens de celle là que sous un angle qui ait auparavant ménagé les sensibilités de ceux à qui elle est proposée.
…
Grégoire de Tours est le seul auteur qui témoigne des origines du vecteur temporel de notre histoire commune, celle des Mérovingiens dans l’Histoire des Rois Francs, traduite du latin.
Maillons de plusieurs siècles donc, distillant la fin de l’Empire romain et la naissance du Haut Moyen Age.
On pouvait, il y a encore quelque trente ans, trouver l’intégralité des ses écrits dans des éditions accessibles. Il est devenu introuvable. Peut-être seulement dans l’ombre silencieuse des bibliothèques, au rayon des curiosités hautement improbables.
Pour nos fameux archéologues du savoir.
Mais certainement plus dans le contexte régulier de l’apprentissage de l’Histoire de France.
Pour rester plus près de nous, quelle vraie vision de la Colonisation, de la Guerre d’Algérie donner à un programme d’Histoire qui ne se censure pas ?
………………………………………………………………………………………..
22 Novembre
C’est la Sainte Cécile. Le froid toujours, qu’on en aperçoit le Baou sous un épais tapis de nuages compacts et Saint Paul figé dans ses pierres.
…………………………………………………………………………………………
23 Novembre
Un bien discret billet dans un Journal en provenance de Normandie :
« Un migrant accusé de viol sur une jeune lycéenne est ressorti libre du Palais de Justice de Coutances ». Selon son avocate, il n’était pas en possession des « codes culturels » lui permettant de comprendre son acte.
« …La Cour a estimé que l’accusé n’avait pas conscience d’imposer un acte sexuel » ( !?)
Le violeur aura-t-il donc accès aux codes avec suivi psychologique post-traumatique ?
On peut en conclure que c’est un appel aux épanchements par ignorance, et à la récidive pour d’autres candidats au viol.
D’autre part, il y a comme un silence abasourdissant du côté des animations féministes. Pourquoi ?
…………………………………………………………………………………………
LIVRES ETC.
Bernard m’écrivait ce matin. Une question qui soulevait un couvercle de petites madeleines de Proust : « Que serions nous devenus sans les livres ? »
Il semble qu’ils ont toujours été là. Depuis les livre de l’enfance avec les dessins qui faisaient rêver et dont l’incruste de certains n’a jamais quitté la sphère profonde de mon cerveau.
Le livres ont été probablement une seconde respiration. Naturelle chez nous. Comme certains font du grand bleu ou de la montagne à plus de huit milles. On y a déjà été préparé par notre éducation.
Bien que mes parents n’aient jamais rien lu, ma mère m’avait mis entre les mains « l’Etranger » de Camus. (Rendant parfois service à la librairie Horizons d’Angela, c’était le prix Nobel qui l’impressionnait. Camus était entouré d’un bandeau comme un trophée publicitaire de lauriers romains, dû à son Prix : « Prix Nobel 1960 »).
J’avais commencé doucement avec la trilogie de Pagnol (les souvenirs) que je n’ai jamais reniée. Mais Camus c’était le début du questionnement. Vu que ça me plaisait, ma mère remettait ça avec « l’Homme Révolté ». Elle ne se rendait pas compte de ce qu’il y avait là dedans.
Mais c’était parti ! Dans l’Homme Révolté que j’ai lu jusqu’à ces dernières petites forces qu’on a à quinze ans, je voyais défiler tous les noms encore ignorés de moi qui s’imprégnaient sur la rétine et allaient devenir ceux qu’on a fréquentés jusqu’à maintenant, pêle-mêle, Marx, Freud, Bakounine, le Hauts de Hurlevent, Hamlet, Dostoïevsky, Netchaïev etc.
La plupart d’entre eux n’étaient encore que des sésames possibles pour plus tard. Donc pour y accéder un jour, j’avais lu TOUT le livre. N’en comprenant pas grand chose. C’était comme un exercice physique que je m’imposais d’une discipline nouvelle.
Evidemment, quelques semaines plus tard, je devais ressembler à Hamlet. J’avais des vêtements noirs et je m’étais appris à devenir taciturne. Artifice ou effet réel de la lecture je n’en saurais rien.
Toujours est-il que mon père disait à ma mère de bien surveiller ma croissance.
On croirait presque mon destin ressemblant à ce début des « Mots » de Sartre que je pasticherais ainsi : ma mère comme mon père n’ayant été élevé dans la sphère de l’esprit, ils s’en remettaient à moi pour s’y hisser.
La littérature et le pendant aventureux et buissonnant de la musique se renvoyaient, comme dans un miroir, l’inévitable bonne croissance d’une éducation comme la notre.
On avait chez la Nonina un méchant électrophone sur lequel mon tonton André mettait à longueur de journée le « Hound Dog » d’Elvis Presley avant d’aller faire du hoola hop la nuit à « l’Entonnoir ».
Ce n’était pas très spirituel, mais c’était mes débuts dans le monde auriculaire.
Puccini, ou plus encore, la Cavaleria Rusticana, la très sicilienne, c’était plutôt le Nono qui en était friand bien que maçon. (On a toujours constaté que chez les italiens ce sont les ouvriers, les maçons ou les gens de petites extractions qui étaient les meilleurs critiques et les fans les plus redoutés des stars du lyrique).
Je n’ai d’ailleurs entendu Puccini ou Mascagni que rarement, lorsque le Nono était souriant, et par sa seule voix d’homme de plus de soixante dix ans, qui outrait les effets. Il a existé un enregistrement des débuts du magnétophone, lors d’un anniversaire familial, où sa voix, qui se voulait sanguine des émotions du moment s’est effacée avec le temps.
Je trouvais ce lyrisme bien curieux et je mettais ça sur le compte de tous ces mystères d’Italie et de Sicile qui m’échappaient. Il n’y avait naturellement aucun enregistrement de voix d’opéra à la maison.
Mes tantes ont tempéré tout ceci en mettant entre mes oreilles les symphonies 5, 6, et 9 de Beethoven. C’étaient Furtwängler et Bruno Walter. Les références ! les dieux de l’époque qui le sont toujours. Je les écoutais après le bain du soir en recopiant mes devoirs ou les après-midi de solitude, parallèlement à la séance des Beatles.
Ma mère m’avait acheté en 45 t ( !) la Toccata en ré mineur de Bach, par Cochereau aux grandes orgues de Notre Dame, qui était en solde aux 3J des Galeries Lafayette.
Ma préhistoire auriculaire.
Mon premier vinyle classique acquis par mes soins, venu presque au hasard, (j’avais aimé l’illustration de la pochette d’un détail du plafond de l’opéra de Paris peint par Chagall), était l’Ouverture de Rosamunde avec le Songe d’une Nuit d’été. George Szell dirigeait Cleveland.
C’était tout cela…
Mes premiers outils, mes chances.
…………………………………………………………………………………………
Ce soir le Freischütz sur les ondes. Celui du fils Carlos. Je connais aussi celui d’Erich Kleiber le père, mais aucun des deux n’a su rendre hommage autant que le Saint esprit Jochum.
Et la « Gorges aux loups », dans sa vision cataclysmique, est l’acte de naissance du Romantisme théâtrale qui a permis à Berlioz toutes les géniales outrances de la Damnation.
Wagner saura aussi y reconnaître ses racines.
…………………………………………………………………………………………
SUITE DU 17 NOVEMBRE – 23 –
Un cancer s’installe. Il n’y a pas d’anticorps. Les métastases avancent. Le cœur de Paris est l’organe ciblé.
Le Palais de l’Elysée.
Devant les dangers des bords de routes et d’autoroutes la loi a exigé le port de gilets jaunes, et même jaune fluorescent. Ils y sont…
…………………………………………………………………………………………
D’AUJOURD’HUI
Un homme nu à l’arc de chasseur sur une terre aride d’Afrique a transpercé de sa flèche un autre homme venu l’évangéliser, pour y mourir. Ce qui a été reçu avec quelques sourires humanistes d’ici
…………………………………………………………………………………………
Einstein n’a jamais eu la preuve de sa théorie de la relativité, comme Beethoven n’avait jamais entendu sa dernière fugue en si b mineur.
Les abîmes ne se sondent jamais.
…………………………………………………………………………………………
Nuit de bleu, d’éclairs jusqu’à nos carreaux. Comme des larmes de ciel qui viendraient à dire la dureté du temps ; ça pourrait durer une éternité.
Dans le noir, j’écoute la 7° de Bruckner, les verrous fermés, les vitres en sanglots de pluie.
…………………………………………………………………………………………26 Novembre
Daphnis et Chloé, le final de la 2° suite. Jean-Claude Hermenjat est la flûte de l’Orchestre de la Suisse Romande dans la bacchanale finale. Que pourrait-on faire de plus fluide et de plus sensuel ? C’est évidemment Armin Jordan le maître d’œuvre.
…………………………………………………………………………………………
27 Novembre
TRANSITION ECOLOGIQUE ?
Nous dépendions jusqu’à ce jour, et pour quelques temps encore, du pétrole des pays arabes pour l’usage de nos véhicules, pour demain dépendre des batteries électriques composées en Corée et en Chine. Sans compter que cette option du lithium commence conséquemment à dévaster une grande partie de la Bolivie, là où poussaient hier à perte de vue, tomates et poivrons.
…………………………………………………………………………………………
2 Décembre
Paris a aujourd’hui de nouveau déterré ses pavés, les affrontements se font dans la pire violence. Paris est à feu et à sang.
L’Arc de Triomphe balafré et investi jusqu’à son sommet. La France dans le brouillard et à un tournant dangereux.
Le mouvement des Gilets Jaunes a montré ses contradictions évidentes. N’étant pas, au départ, dans la cohésion habituelle des revendications sociales classiques, il est dans le champ d’action qui n’a d’autre objectif commun maintenant, dans un bras de fer où chacun se sentirait perdant si il cédait, que de demander le départ du chef de l’Etat. Pour mille raisons. Pas seulement pour ce qui, à l’origine, était un refus de constater une régression du train de vie et du pouvoir d’achat, mais comme s’il y avait une prise de conscience tardive, devant l’éternel chantage souvent exercé au second tour des élections, que ce n’était pas le bon locataire de l’Elysée qui était sorti des urnes l’an passé. Que l’orientation donnée, purement technocratique, devant les graves défis qui se profilent à l’horizon de notre pays ne correspondaient pas ou plus du tout à l’attente de celui-ci. Le désordre est installé par un rejet des structures institutionnelles qui divisent.
Terribles leçons et terribles conséquences dans l’histoire des démocraties.
………………………………………………………………………………………..
Déjeuner avec Cécilia au Dragon d’Or. Le temps est couvert mais la lumière du bord de mer donne des reflets d’argent à l’embouchure du Loup où le cygne blanc règne sur le banc des colverts.
…
C’est Aïda aujourd’hui à l’ugc du village. Très belle production de Salzbourg 2017, avec Anna Netrebko, Muti et la Philharmonie de Vienne.
…
Dans la soirée, le Concerto pour chœur de Schnittke. Peut-être ce qu’il y a de plus beau avec les alliages des textures chorales mises à nu par Penderecki (Utrenia, Credo). Inspiré, lyrique, à l’égal des œuvres pour chœurs de Chostakovitch, du Requiem de Ligeti, mais plus proche du ciel.
…………………………………………………………………………………………
Je me méfie des détestations irrationnelles comme de la peur qui rentrerait dans le noir de la nuit.
…………………………………………………………………………………………
6 Décembre
Les Alpes Maritimes manquent de carburant. Cinquante années après Mai 68, il y a comme un parfum de fin de monde, de lassitude structurelle dans le paysage. Plus profondément encore que dans cette fin des années 60, le malaise et le mal être font prendre conscience que la France est malade de façon récurrente de cette France d’en haut, de son incapacité à faire vivre un projet mobilisateur qui dégagerait une énergie et des aspirations auxquels tous pourraient adhérer.
Mais peut-être sommes nous vraiment aux prémisses de la fin de notre monde.
Je me réfugie dans ce beau texte de Alain Corbin le village des « cannibales », qui a priori n’est pas une lecture consolatrice, mais la clarté et la vigueur d’analyse de ce fait divers cruel et monstrueux dans sa verdeur -qui n’est pas sans rappeler le final du Parfum de Süsskind- peuvent éclairer les quelques après-midi de solitude qui me préparent au départ de ma petite famille vers la Colombie.
…………………………………………………………………………………………
Dans la dernière parution des Territoires inconnus, c’était justement la Colombie des indiens Kogis qui était à l’honneur, avec ces petits êtres fragiles vêtus uniformément de chasubles blanches et perpétuellement sous les effets de la feuille de coca, dans des paysages édéniques, à la végétation grasse et aux eaux abondantes au dessus de la Sierra Nevada de Santa Marta.
…………………………………………………………………………………………
12 h
Depuis trois semaines déjà que les gilets jaunes occupent le terrain, des pénuries commencent à s’installer. Le manque d’essence déjà, inquiète les usagers, la peur de la paralysie générale aussi. Les stations sont souvent désertes et fermées. L’alimentation n’est plus réapprovisionnée. Plus grave, certains syndicats de police appellent à la grève en fin de semaine.
Le Président de la République a du battre retraite hier soir au Puy en Velay, poursuivi par des manifestants…
…………………………………………………………………………………………
8 Décembre
Très tôt. Le ciel est pur, quelques étoiles encore dans le paysage, sans nuage. Et il fait presque doux. Je dépose Cécilia à l’aéroport.
C’est aussi la fête des lumières un peu partout dans le monde.
…………………………………………………………………………………………
Le quatrième samedi de violence dans les rues de France. A Nice, deux cortèges se rejoignent à la Place Garibaldi. Les Gilets jaunes et les écolos à lunettes de forte myopie, le sifflet et les inévitables percussions brésiliennes, le paillassou à l’effigie du chef de l’état, et les femmes très affûtées dans l’exercice des déhanchements. Il fait un temps radieux. Les uns veulent cesser d’être pauvres, les autres voudraient que la planète redevienne l’éden qu’elle a été un jour. Vers vingt heures, à Paris, ce sont les nouvelles images de feux et d’aciers calcinés, de pavés arrachés, de cuirs et de visages masqués.
Sommes nous ainsi le seul pays au seuil extrême de pauvreté dont l’ultime haine revendicatrice et vengeresse pourrait nous affranchir ?
………………………………………………………………………………………
13 Décembre
Les dents me font souffrir. Le temps a viré aux nuages noirs. Le froid fait sortir l’artillerie des gros vêtements. Je suis bien seul. Hélène m’appelle fréquemment. Cécilia quelque fois. Mais la distance est un temps qui ne se résorbe pas…
…
« The Fighting Kentuckian », sous l’anesthésie de l’ibuprofène, est un western comme je les aime. Film de George Waggner de 1949 avec John Wayne et son inévitable pelisse de castor et Oliver Hardy en faire valoir. L’action se déroule en Alabama et narre un épisode peu repris dans l’histoire du western, celui des exilés de Waterloo ayant participés eux aussi à la Conquête des territoires de l’Est. Il y a un plan extraordinaire où l’on peut voir John Wayne avec l’ombre géante d’un buste de Napoléon en fond de décor. Les forces morales se retrouvant du côté du héros amoureux de la fille d’un général et des exilés français contre les intrigants fermiers et politiciens de la ville de Demopolis. Les paysages esquissés ne sont jamais en plans larges, mais laissent deviner les arbres et la végétations luxuriantes du territoire au cœur même de la ville aux balcons, aux colonnettes des arcades, et aux ferronneries ciselées dans le genre Nouvelle Orléans. Ce qui devrait relever du genre Eastern.
Mais ce petit chef d’œuvre aurait pu rester un pur joyau dans l’histoire du genre pour la seule scène où l’on voit s’égayer un petit orchestre dont chacun des musiciens force son talent jusqu’à la pitrerie et que le violoniste se met à jouer avec ses dents sur les cordes ! Ce qui donne probablement la clé et l’origine des fameuses facéties de Jimi Hendrix…
………………………………………………………………………………………..
14 Décembre
L’Histoire du Climat de Le Roy Ladurie se présente, dans son premier volume, comme un monument de concision et de documentations sur la formation des glaciers et des canicules du XIII° au XVIII° siècles. Pourrais je venir à bout de ses sept cent premières pages ?
…
L’auteur semble faire partie des climato-sceptiques, c’est à dire qu’il ne cautionne pas les professionnels du catastrophisme climatique.
…
Parallèlement aux catastrophes du climat, dans la course à la transformation de nos habitude en matière d’économie d’énergie et de sauvetage de la planète, et accessoirement pour notre prétendue sécurité, pourquoi nous inciter à acquérir une Audi A8 qui ne devra pas dépasser les quatre vingt à l’heure et nous interdire (bientôt) de rouler avec une 2CV qui ne peut atteindre QUE les quatre vingt à l’heure ?
Pourquoi tant de fadaises politiques et administratives quand on sait les milliers d’avions qui volent sur nos têtes, nuit et jour, la ronde des gros navires polluant chacun autant que cinq mille véhicules automobiles.
Et comme la terre est ronde, en permanence.
…………………………………………………………………………………………
En dehors des Gnossiennes et des Gymnopédies, ce qu’il y a de mieux chez Erik Satie, ce sont les titres de ses œuvres. Morceau en forme de poire, Prélude à l’ouverture de la porte héroïque du ciel, Embryons désséchés, Marche franco-lunaire… tous seraient à citer. Pour ce qui est du contenu, tout le monde n’a pas la bienveillante admiration de Cage pour sa musique. Il était d’une extrême pauvreté. Un peu à l’image de sa musique. On pourra sauver Socrate.
…………………………………………………………………………………………
Blancs et noirs, le futur prochain pour les futurs de l’espèce.
…………………………………………………………………………………………
16 Décembre
Les végétaliens, profitant d’un beau dimanche parisien, se font « marquer » au fer rouge comme le bétail afin de se poser en symbole de la défense de la condition animale.
Ils furent donc très nombreux, parqués sous des tentes, à vivre du dedans ce frisson de douleur fumante dans leur propre chair.
La métamorphose risque bientôt d’être complète d’autant que certains de ces militants arborent déjà, depuis longtemps, de magnifiques boucles de métal en travers du naseau.
………………………………………………………………………………………
19 Décembre
Au sortir du sommeil, des lumières.
Pastichant, peut-être malgré lui, le Dieu de la Genèse qui dit « Au commencement était le ciel et la terre », Proust inaugure la grande saga du Temps avec « Longtemps je me suis levé de bonne heure ». Partant de là, Dieu va déployer l’ordre et les multiples strates de la Création, comme Proust déploie tous les modes du souvenir et du monde introspectif.
De même Dante décrit l’ascension vers l’univers infini , « nous sortîmes à revoir les étoiles… purs et prêts à monter aux étoiles… l’amour qui meut le soleil et les autres étoiles », et Pétrarque se consume, implosant inversement dans l’introspection de l’univers du désir et de l’amour à portée de main impossible , sachant que le préalable absolu qu’est Béatrice, étalon de pure perfection ne peut se sentir et se réaliser que dans les couches successives d’un univers de diamant inaltérable qui dévore du dedans le poète.
…………………………………………………………………………………………
Matin de pluie
Revoyant, au prisme de certaines études contemporaines, le Deuxième sexe de Beauvoir, il paraît évident que c’est un certain féminisme qui a engendré celui de l’auteur plus qu’elle ne l’a engendrée elle-même. C’est après le succès littéraire de l’ouvrage aux Etats-Unis qu’elle viendra s’appuyer sur ces thèmes chers au féminisme.
L’ouvrage n’ayant jamais auparavant été un succès en France.
Yourcenar a une attitude bien plus personnelle et plus subtile qui reproche à celle-ci de fonder un militantisme féministe basée sur la seule haine et opposition à l’homme, ce qui devrait seulement être la reconnaissance d’une complémentarité irréductible aux deux sexes.
Pour qu’elle conclue finalement : ce modèle d’égalité espérée, est-il une aspiration légitime pour la femme que d’envier celui qui part le matin à sept heures pour une froide journée dans le souci et le fracas d’un monde de labeur et de contraintes harassantes ?
Etait-ce l’idéal rêvé de la nouvelle condition de la femme ?
…
D’autre part, le couple Sartre/Beauvoir y est de plus en plus ouvertement suspecté de supercherie et d’ingratitude.
Sartre, dans « Les Lettres françaises » publie une vindicte contre Drieu La Rochelle (« Drieu ou la haine de soi »), le traître, l’infâme, oubliant que c’est lui qui est à l’origine de sa libération après son incarcération en Allemagne.
D’autant que Sartre écrivit de 1941 à 1944 ( !) dans la revue Comediae, organe littéraire collaborationniste et fera des chroniques régulières sur Radio Vichy, y invitant par la même occasion, Beauvoir.
Que les « Mouches » et « Huis clos » maintes fois donnés devant des parterres d’officiers allemands, sablés au champagne en fin de représentation, n’auraient pu être autorisées sans l’organe de la censure allemande.
Que Sartre et Beauvoir ne constituent pas un couple modèle.
Elle ne fut pas la Résistante qu’elle dit, elle est simplement évincée de l’Education Nationale pour lesbianisme avec une élève.
…………………………………………………………………………………………
début d’après midi
L’hiver arrive. Chacun écoute ses plaies et ses joies. Le Sauveur a mis ses bâches contre le vent aigre et la pluie triste dans le petit carré extérieur où nous faisons verre sur verre.
…Il y avait des ténèbres à la surface des abîmes, et l’esprit de Dieu se mouvait au dessus des eaux.
…………………………………………………………………………………………
20 Décembre
La Suisse n’a jamais été dans l’Union Européenne, ni même dans l’Europe d’avant. Est ce un pays parasite au cœur géographique de cette Europe ?
Il semble qu’il est plus difficile pour l’Angleterre de sortir de cette union que d’y entrer pour d’autres (tous les petits pays de l’Est et tous les postulants). Seule la Suisse semble heureuse de son identité. Paradoxalement , elle se situe au centre des pays les plus influents.
Le seul pays qui, par un second paradoxe, n’est pas près de rentrer dans cette union est celui dont le général de Gaulle disait qu’il faisait partie naturellement et intégralement de l’Europe de l’Atlantique à l’Oural: la Russie.
……………………………………………………………………………………….
21 décembre
MUSIQUES
C’est l’hiver ce soir. Ca commence par une dent arrachée ce matin. La première. Il y a un début à tout…
Je fais lentement un grand tour du cimetière de Caucade entre les allées de cyprès géants.
Pourquoi les cyprès se marient-ils si bien avec la paix d’un cimetière ?
Mitsouko Uchida joue les Chants de l’Aube. L’œuvre ultime, dépouillée, géniale, que Clara ne comprenait déjà plus. Une œuvre du meilleur Schumann que même les schumanniens négligent trop souvent. Cela va à merveille avec ce froid et cette douleur. Et toutes les autres douleur
…..
Carolyn Widmann interprétait le Concerto pour violon (Aufgang) de Pascal Dusapin. Probablement le plus important écrit en France depuis le Poème de Chausson… C’est aussi vaste qu’un nocturne dantesque, dans le sens où Dante élève l’âme dans sa nuit vers les astres en mouvement les plus éloignés de nous.
Céleste et nocturne…
…..
J’ai encore sous les yeux la photos de 1935 de Erich Kleiber avec son fils Carlos et de Veronika la petite sœur. J’ignorais, et je l’apprend par quelque lecture, que le père disait à Carlos bien plus tard, qu’il dénaturait sa famille ( !!) en dirigeant de la manière qui était la sienne. Sur la photo déjà, le petit boudeur avait du mal à garder la main dans celle de son père et semble vouloir s’en libérer. Mais malgré ces incompréhensions, c’est sur la partition annotée de la main de son père qu’il dirigeait la Symphonie inachevée de Schubert.
…………………………………………………………………………………………
23 Décembre
Bernard est à Nice. Nous déjeunons à la pizza d’en face, après quelques verres au Sauveur. J’ai des nouvelles depuis la Colombie. Ma petite famille est sur le retour.
Un dernier message d’Hélène avant l’embarquement de Bogota.
Il faisait encore nuit. Le coq a chanté dans les lointains, trois fois, quatre fois.
…………………………………………………………………………………………
Don Victor Carranza, le roi de l’émeraude en Colombie, depuis ses domaines miniers, entourés de quelque quinze gardes du corps, disait « nous prenons des risques mortels pour satisfaire la vanité des hommes »
…………………………………………………………………………………………
24 Décembre
CAÏN…
Je cherchais dans le Bible, dans au moins deux traductions, dont celle de Jérusalem, l’œil de Caïn et la naissance de la conscience humaine. Il n’en est à aucun endroit fait allusion. C’est dans le poème de Hugo, la Conscience qu’apparaît la notion morale de l’acte criminel de Caïn. Ce que nous apprenions dans les petites classes, dès l’enfance.
Dans la Genèse, il est dit simplement que Caïn dans sa colère tua son frère Abel.
Dieu répondit alors « Qu’as-tu fait ? la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu’à moi » et il frappa le sol de Caïn de stérilité.
Caïn dit à l’Eternel : mon châtiment est trop grand pour être supporté. Tu me chasses de ma terre… je serai errant, et quiconque me trouvera me tuera. L’Eternel lui dit : si quelqu’un tuait Caïn, Caïn serait vengé sept fois »
A aucun moment il n’est dit que la conscience de Caïn criminel renvoyait un écho du meurtre de son frère. Au contraire, il est dit qu’après avoir été frappé du fléau de stérilité, Dieu dans son grand paradoxe, viendrait à maudire ceux qui attenteraient à la vie de Caïn.
C’est donc dans l’interprétation toute chrétienne du XIX° siècle de Hugo qu’est soulevé le cas de conscience indélébile découlant du fratricide.
Dans le poème hugolien, Caïn fuit donc l’œil sinistre, sans repos, sans sommeil ; il atteignit la grève des mers dans le pays qui depuis fut Assur.
…. « je veux habiter sous terre
comme dans son sépulcre un homme solitaire
rien ne me verra plus je ne verrai plus rien
on fit donc une fosse et Caïn dit « c’est bien ! »
puis il descendit seul sous cette voûte sombre
quand il se fut assis sur sa chaise dans l’ombre
et qu’on eut sur son front fermé le souterrain
l’œil était dans la tombe et regardait Caïn »
………………………………………………………………………………………
25 Décembre
L’AMOUR EN SILENCE
Mon ami Henri a été victime de ce qu’on nomme si souvent, au cinéma ou dans les amours parisiennes, l’amitié amoureuse, sorte d’amas sentimental pour solitaires, où l’amour, n’est pas tout à fait l’amour ou encore à l’état embryonnaire, demandant à se faire une place, et l’amitié une fragilité qui ne dure que le temps d’une possible relation. Le tout risquant, comme cela arriva dans la relation de Henri avec celle qui apparemment ne partageait pas cette illusion, de finir dans l’incompréhension et l’amertume. Voire la dépression et le vide absolu en conséquence ou quelque chose comme ça.
On ne joue pas la tiédeur dans les sentiments ni le mélange des genres.
Paradoxalement les deux types d’approche, amitié et amour, sont antithétiques.
Si c’est l’amitié qui se dégage d’une relation, celle-ci ne peut que devenir plus forte et plus profonde, bravant de plein front les difficultés par la compréhension, l’acceptation et parfois au-delà même de la conception réciproque des choses.
« Un ami c’est quelqu’un qui vous connaît bien et qui vous aime quand même ».
L’amour c’est l’embrasement, le désir et tout à la fois le risque de se perdre dans le vertige de l’autre. Y compris par la bascule dans l’incompréhension.
Mais aussi par la torture du doute.
Ce qui n’a pas semblé avoir effleuré de ce sentiment immunitaire la relation de Henri dans cet amas sentimental confus et faussement maîtrisé, mais a, par contre, en fin d’histoire, décuplé la douleur de la chute.
L’amour, rouge et palpitant n’est justement jamais dans la tiédeur, dans les certitudes placides, mais dans ce qui ronge par le doute.
Je parle de l’amour d’un homme pour une femme, et non des différentes catégories d’amour dont celle des parents pour les enfants qui pourraient aller jusqu’au sacrifice et à l’abnégation. Mais cette forme de don de soi peut aussi aller dans ce sens entre un homme et une femme…
L’amour plein, qu’il soit consommé, partagé ou non, est une déclaration permanente, par le geste, l’intention, l’immolation et la projection sur le futur.
A l’aveugle.
Et dans le meilleur des cas, s’il est partagé, que la personne aimée soit compatible sur le long terme.
Ce qu’on appelle tomber sur le bon numéro.
Là où Henri a triché avec lui-même, c’est qu’il a entretenu un rapport qu’il a cru profond (il a toujours aimé le silence des profondeurs), là où il fut seul dans sa relation à y voir cette possible existence d’une amitié qui était au fond amoureuse tout court sans se déclarer jamais.
Par fierté, par pur orgueil.
En face de lui, une autre forme de tricherie s’est installé chez une femme qui a entretenu des années durant ce que son intuition lui faisait reconnaître comme un naufragé en quête de désir et d’amour brûlant dissimulé. Qu’elle a toujours feint de ne pas voir, entretenant par là le faux partage de ce sentiment trouble et ambigu.
Jusqu’au jour banal, comme il arrive souvent, au moment le plus inattendu, l’illusion a fait place à l’affreuse réalité, et à la pire déconvenue.
Le masque tombé.
Leur relation étant tout de même assez familière, elle lui demanda de venir à Fontvieille (depuis Nice) garder le chat, le temps d’un bref séjour à Paris pour voir sa mère.
Et là, Henri découvrit de façon tout à fait anodine, dans une ancienne boîte de biscuit, une armada de lettres et de cartes postales d’un amant qui était apparu après que ladite relation d’amour/amitié se fut installée entre lui et cette femme.
D’où la tricherie. Et la chute du plus haut de l’illusion.
S’il n’y avait eu qu’une saine relation d’amitié entre Henri et elle, pourquoi aurait-elle eu des scrupules à révéler la présence d’un homme avec lequel elle avait un type de relation différent et de sentiment infiniment moins trouble ? Pour garder l’amant réel et entretenir coquettement l’image valorisante d’une femme qui tient au mors son chevalier servant.
Ou, parce que elle même, dans le trouble de ses sentiments, ne pouvait discerner, au cœur de cette ambiguïté, la part venant de Henri comme un effet de miroir qu’elle a laissé grandir dans l’étau du non dit et ensuite dans la franche décision de prendre un amant, faisant donc avec un autre ce pas qu’elle n’a jamais voulu (ou su) franchir avec lui.
…
L’amitié amoureuse est donc un état transitoire, impressionniste, sans démarcation bien précise, avec une possible bascule dans l’amour, ou, à l’opposé, la défaite amicale pour celui ou celle qui auraient désiré le combat vivifiant des joutes absolues.
…
De Schumann ou de Liszt, incontestablement le syndrome Henri se retrouverait plutôt du côté du premier que du second.
Schumann, trop timide, a toute sa vie eu un seul amour et encore a-t-il fallu qu’il résiste le plus élégamment au père de Clara jusqu’à le poursuivre en justice.
Liszt, dans ses amours, faisant foin des conventions, n’a jamais hésité à se déclarer envers et contre tout, quitte à enlever Madame d’Agoult devant le tout Paris pour vivre ses amours en Suisse et en Italie.
…………………………………………………………………………………………
Je n’ai pas vu Hélène. Ni le petit brigand des cœurs. Ils ont dormi jusque tard durant ce jour de Noël.
Le chapon a rissolé, solitaire.
…………………………………………………………………………………………
Notre Dame des Landes, les Gilets Jaunes… la France ne s’aime pas.
…………………………………………………………………………………………
ENCORE THE ALAMO
………………………………………………………………………………………………………..
27 Décembre
Midi avec Bernard chez Sauveur. Nous descendons quelques ballons de rouge. Il repart demain. On se sera tout de même vu pour dire l’essentiel sur ce temps qu’il reste à faire encore de route, de voyages, de parcours tout en sachant qu’il ne faudra manquer les sentiers imprévisibles.
…
« Un automne romain ». Récit de flâneries et de rencontres de Michel de Jaeghere en octobre 1996, durant le temps que l’on pensait être les derniers jours de Jean Paul II. Récit nostalgique au sein d’opulentes antichambres de Monsignori d’une Rome tout éternelle autant que d’options cardinalesques à venir dont dépendra son orientation spirituelle.
Une certaine fermeté dans le trait, les entrelacs de l’Histoire qui se conjuguent aux réalités opaques des arcanes du pouvoir ne sont pas sans rappeler les stendhaliennes Promenades dans Rome.
…
Louis Jouvet disait : « le trac vient quand on commence à avoir du talent ».
…
Je reçois un colis avec des enregistrements de Chopin par Cortot. Les Préludes, les Nocturnes et les Ballades.
Sur les portraits du pianiste je suis frappé par la ressemblance avec le visage de Louis Jouvet. On ne fait plus de tels caractères physiologiques. Chaque deux générations, voire chaque génération portent en elles des secrets de développement qui leur sont propres.
Pensant au visage de mon père sur son lit de mort, j’ai du mal à me dire qu’il est parti à cet âge où la vie laisse espérer encore un bel automne. La vie semblait avoir pesé lourdement sur ses épaules. De même, j’ai du passer la soixantaine pour reconnaître qu’au travers de certaines expressions je peux me glisser dans ce modelage que la vie travaille au burin et commencer à lui ressembler.
…………………………………………………………………………………………
29 Décembre
Depuis plusieurs mois j’ai cessé toute relation avec Katy. Il était devenu impossible de poursuivre dans une impasse. Je n’ai plus répondu à ses messages de menaces, et de délation de la fin octobre.
Le dernier courrier auquel j’aurais répondu et qui méritait encore un adieu, qui sonnait comme une invite à me départir de mes derniers silences, est celui qui disait : « quand le temps est venu et que les mots s’usent, le silence raconte ».
…………………………………………………………………………………………
ce matin, à l’issue d’un rêve tout était clair :
Racine était un homme qui écrivait des pièce de théâtre à l’ombre de cabinets de travail. Molière était un homme de tréteaux. Contrairement à Racine, qui fut éduqué à Port Royal, il est passé par le collège de Clermont, collège des Jésuites, puis fit deux années de Droit à Orléans avant d’entrer définitivement dans la vie de comédien.
Quant à « l’affaire Corneille », à savoir Corneille auteur des pièces de Molière, elle est née dans des esprits enflammés qui auraient mal interprété un séjour de celui-ci à Rouen, la ville de Corneille, sans savoir que toutes les troupes se rendaient dans cette ville qui était une plaque tournante du théâtre.
En fait, Molière et Corneille était en forte hostilité jusqu’à l’arrivée et la montée en puissance de Racine. C’est alors seulement que Corneille et la troupe de Molière ont collaboré. Molière n’est pas à Corneille ce qu’Ajar est à Gary…
…………………………………………………………………………………………
NIETZSCHE MANQUE LE DEBUT…
je lisais une présentation de la Généalogie de la morale où Nietzsche imputerait à la morale chrétienne les sources de toutes nos souffrances et, par là, d’une impossibilité de vivre au-delà de ces valeurs du bien et du mal qui infléchissent nos pensées et qui seraient loin d’être une marque d’humanité mais plutôt un symptôme d’une civilisation malade.
Pourquoi imputer au seul christianisme ce qui, déjà dès le chapitre sur Adam et Eve, dans l’Ancien Testament nous livre la notion de désobéissance fondamentale à l’ordre divin et par là la notion non moins fondamentale de péché originel sur lequel repose le socle de toute faiblesse humaine ?
Et tout l’Ancien Testament est ensuite peuplé de ces foudres divines, de ces malédictions, de ces rivières de sang, de serpents et de fléaux pour qui ne respecterait pas les lois de l’ordre divin.
C’était le temps de l’enfance de l’humanité à laquelle devait répondre une éducation sévère et nécessaire.
Le Nouveau Testament atteste plutôt d’un âge plus mûr de l’humanité où le libre arbitre de l’homme débarrassé de l’ignorance en vertu de la loi du cœur le rendra à même de penser et d’aimer en toute responsabilité et en pleine conscience.
…
Nietzsche avait tant aimé Wagner que cet excès d’amour s’est inversé en haine pathologique après que celui-ci eut écrit Parsifal tant la beauté de ce dernier chef d’œuvre semblait aller si loin de ses imputations larvaires et de ses propres approches du monde.
…………………………………………………………………………………………
30 Décembre
C’est un peu chez Jacques Audiberti que nous avons rendez-vous ce matin. Ce dernier dimanche de l’année est plein de soleil qu’on ne pouvait manquer de s’extraire de cette tentation du repli hivernal.
Le vieil Antibes est une forteresse d’où domine de loin le Château Musée Picasso.
Le dédale des ruelles est déjà animé. Certaines vieilles maisons portent le poids de leurs lierres roussis et les cals de l’hiver qui se découvre largement ce matin.
Le Château domine une minuscule corniche d’où l’infini n’est pas loin, vers le soleil levant.
Jamais la Méditerranée n’a plus parue être une mer close, un lac.
Nous logeons le peu d’espace imparti aux promeneurs et passons devant la maison, face au port, où vécut et mit fin à ses jours Nicolas de Staël.
Puis c’est l’église baroque, toute neuve d’un badigeon ocre et blanc, encore dans l’ombre et frileusement flanquée du clocher cubique vu du plus loin qui se puisse à l’est, aux pierres sans apprêts, qui contraste par sa rudesse à l’élan de la façade de l’église.
Le sommet du clocher seul est baigné de lumière et les arbres nus semblent griffer la pierre de leur nudité d’hiver.
Le Château abrite donc depuis un promontoire face à l’est, le Musée dévolu à Picasso et à quelques artistes composant la collection permanente.
Aujourd’hui, par bonheur, c’est une exposition temporaire entièrement consacrée à Picasso, dans le cadre d’une demande de l’Etat à tous les pays d’Europe d’harmoniser leurs expositions autour du peintre, comme on l’avait déjà honoré à Londres et à Paris au musée d’Orsay.
A part l’architecture d’Orsay, le château d’Antibes ne pouvait être une meilleure parure pour recevoir Picasso.
Dans son écrin de lumière et à flanc de mer, le balcon aux sculptures de Germaine Richier, maigres et élancées, féminines jusque dans leur tréfonds expressif, comme à l’île de Pâques, antiques déesses tournées vers l’intérieur, en manière de recevoir les visiteurs, donnant le dos à la mer, leur offre un fond infini du bleu le plus serein durant cette matinée de paradis.
Quelques voiliers et quelques avions trouent au loin la sérénité absolue et balafre l’azur de leur sillage.
Aux étages baignés de larges fenêtres où la mer semble s’inviter, les vases aux sourires de femmes, quelques baigneuses sculpturales, la fameuse entrée aux escaliers torsadés de la villa chêne-roch, et tout l’étalage de la luxuriance légendaire de la Côte d’Azur.
Dans l’une des salles du milieu, une des toiles les plus impressionnantes, monumentale, celle des deux jeunes hommes à la flûte de Pan.
Puis la série des faunes dansant, des satyres et des centaures, de dessins de plus en plus épurés, quelques souvenirs de cubisme allégé, un baiser torturé dont on ne perçoit qu’improbablement les visages, les bouches et les lèvres, dans un magma de contorsion et une débauche de couleurs en fusion.
Au dernier étage, solitaire sur tout un pan de mur, Ulysse au pied du mât, et les sirènes investissant de leur chant le navire.
Depuis les fenêtres, la longue pointe du Cap d’Antibes.
Puis les céramiques sur les thème de l’oiseau, les taureaux toujours, cette fois dans l’arène, les natures mortes et les ultimes sculptures.
C’est l’heure de plonger au cœur même de la vieille ville, de traverser de belles places, de longer le marché couvert débordant et odorant, de faire la rencontre inespérée d’une sculpture des amoureux de Peynet et de se fondre au gré des entrées de restaurants, de devantures de magasins de bibelots et de tout une saturation d’ivresse d’avant la fin de l’année. Cécilia me fait découvrir une minuscule boutique de produits de terroir et dans le prolongement, le colimaçon plongeant vers un non moins minuscule petit café, à cette heure encore déserté, comme hors du temps, où quelques tables rares proposent de recevoir l’absinthe. Où Van Gogh tient une bouteille d’Absente et où est indiquée sur une plaque à l’identique de celle des rues de Paris, la route du Paradis menant au toilettes à usage limité et lecture tolérée.
…
C’est l’heure de manger la souris d’agneau avec le gros rouge du Var dans un bistrot bar tabac sur la place du marché encore débordante.
…
Puis c’est une déambulation sur le port, entre navires de croisière et voiliers d’oiseaux fins. La chaîne enneigée des montagnes préalpines domine de ses nombreuses cimes les plus lointains horizons et se mêle en quelques mille nuances d’azur le large paysage mi marin mi alpin d’où la plus belle trouée se trouve être sur le bord de mer, vers les Marinas du retour.
…………………………………………………………………………………………
Ce soir c’est le splendide Guerre et paix de King Vidor. C’est ce qui pouvait convenir le mieux avec cette fièvre de lumière qui a laissé ces traces aujourd’hui.
On pourrait presque encore se croire dans un western.
…………………………………………………………………………………………
31 Décembre
Ce soir, cette nuit, la maison est sage. Y a remplacé sa maman à la même place à la table de fin d’année.
Hélène téléphonera ce soir. Elle réveillonne avec Rodolphe et des amis dans son hameau.
Le cycle des années, des fêtes, des nuits, continuent.
Comme le fantôme des disparus.
Demain, sur le clavier, il faudra déplacer un peu le doigt pour sauter le 8 et toucher le 9…
Demain c’est une nouvelle marche à gravir.