Carnet 2019
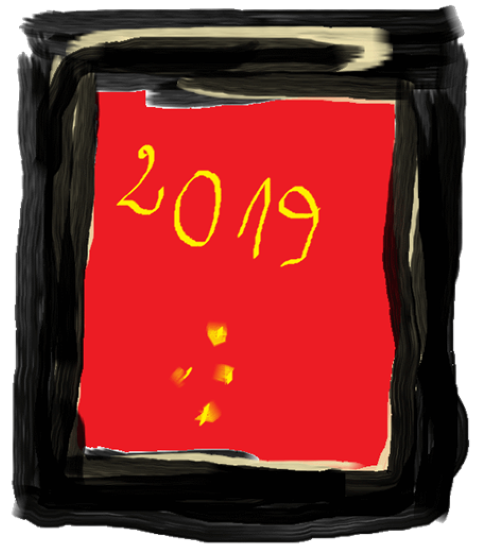
–
1 Janvier
Ce qui déplaît dans le miroir c’est la mauvaise image qu’il risque de donner.
Ce matin, ça peut aller. Et ce qui est le plus à craindre c’est le mélange du champagne avec les rouges. Même en quantité raisonnable. Nous l’avons été. Même le petit Y a trinqué de ses quelques bulles. Il a trouvé que ça piquait. Mais ce matin il est fiévreux. La ballade des jours fériés est compromise.
11 heures
Le temps est radieux, le soleil blanc, je baladerais donc seul un moment, vers le Vieux Nice.
Et comme dans les meilleurs entrées de théâtre, je tombe nez à nez sur Claude de chez Sauveur, Place Rossetti, le centre du monde en quelque sorte.
D’autant qu’il semblait porter, comme on s’éclaire de la lanterne de Diogène, depuis le fond de la Place où il m’aperçoit enfin, les livres de Michel Audiard qu’il cherche à me remettre depuis quelques jours.
« Je les avais pris avec moi à tout hasard ».
Je venais de voir « la Chute de l’Empire Romain » de Anthony Mann. Ce qui m’a mené à une saillie que Audiard aurait pu commettre :
« Chez les romains tout de même, il y a les Commode et les Sévère ».
…………………………………………………………………………………….
20 heures
Pour savoir ce que veut dire je t’aime, que l’on a tous prononcé un jour ou l’autre, ce n’est que quand il devient impossible, parce que la bouche s’en écorcherait, de jamais plus le dire à la femme qui a traversé notre temps, que l’on sait enfin ce que c’est.
……………………………………………………………………………………..
3 janvier
Y a un problème d’oreille. Il est question de kyste et de surdité. C’est la raison pour laquelle il articule mal à son âge. Peut-être faut-il envisager une opération…
…………………………………………………………………………………….
4 Janvier
Boulevard Gambetta vers midi avec Fabrice. Nous déjeunons à la Goulette d’un excellent couscous royal. Le décor est harmonieux et le vin du Maroc est celui que buvait mes grands parents. Une belle parenthèse dans ce début d’année qui ne quitte pas le soleil.
……………………………………………………………………………………..
6 Janvier
Nous avions fini l’année dernière par cette belle surprise d’une matinée à Antibes.
Ce dimanche encore, c’est vers le Cap, buriné de beau temps accentuant les reliefs, que se fait la promenade du jour.
Ce n’est qu’un labyrinthe d’allées secrètes protégeant des demeures insolentes de luxe dans le plus discret isolement. C’est l’Eden Roch au cœur même du cap, à mi distance d’Antibes et, sur l’autre rive, de Juan-les-Pins. Puis la Villa Aujourd’hui, célèbre architecture Art Déco au pied d’un petit port naturel où sont amarrés quelques voiliers posés sur le varech et des rochers escarpés qu’on y peut à peine poser les pieds.
Nous suivons le sentier qui part de la Garoupe pour longer sur un chemin étroit, extrêmement tortueux mais bien balisé, tout le rivage qui enserre le Cap de ses roches hostiles, fines comme des lames de couteaux à flanc de falaises, où même par temps calme comme c’est le cas aujourd’hui, la pression de quelques vagues vient frapper les creux dans un battement grave et sourd qui laisse à penser ce qu’entendent les riverains les nuits de grandes mers !
Dans ce décor aussi serein par la douceur d’une telle matinée que par la sauvagerie de sa chaîne d’aiguilles, on aperçoit dans le lointain de l’Est toute la chaîne de montagnes enneigées, surplombant la quiétude de la mer. Sur fond de voiliers, de palmiers et de baigneurs.
De pêcheurs et de restaurants en bordure de rivage qui en profitent pour faire les travaux d’aménagement avant l’ouverture de la saison.
Avant de pénétrer dans le vieil Antibes, une reproduction sur céramique de la « Pêche de nuit » de Picasso surplombe un balconnet longeant la mer, donnant l’impression que le tableau vient d’émerger des flots.
L’esplanade du marché est toujours pleine de ces promeneur du dimanche, saturant les terrasses ensoleillées au pied des bars à vin, des bièreries et des moules frites qui ne désemplissent pas. Nous trouvons refuge au même bistro que la semaine dernière qui propose aujourd’hui la meilleure des blanquettes de veau.
Les poumons pleins de cet air de la mer, il est temps de rentrer pour la Tribune qui passe en revue la Cinquième de Beethoven et son éternel thème du Destin…
………………………………………………………………………………………
9 Janvier
3 BLUES
Je regarde, au pied de la grande armoire du couloir, parfois à l’entrée de la chambre, les petits chaussons laissés par Y et les chaussures de ville de Cécilia, comme attendant de partir marcher sur un chemin de promenade. Pourquoi, lorsque je croise ainsi des chaussures, usées et comme à l’état de sommeil, me vient cette attendrissement particulier que donnent de simples chaussures, délaissées par leur usager ? Une vieille réminiscence d’humilité de ces anciens souliers que l’on faisaient attendre la nuit du sapin de Noël ?
…
L’angoisse peut prendre n’importe où et n’importe quand.
Mais il est un lieu paradoxal qui agit sur moi comme un baume, avec une presque sérénité qu’on imagine peu dans les allées de cimetières.
Il fut un temps où j’avais refusé l’achat d’un appartement avantageux parce que je n’imaginais pas vivre depuis la terrasse dans cette perspective de cyprès et de crucifix de pierre à partager le voisinage permanent avec cette grande demeure des morts.
Evidemment la paix et le silence s’y brassent à perte de vue, comme face aux grandes immensités désertiques ou sur les rivages de la mer.
C’est aujourd’hui ce même cimetière de Caucade, celui des vieilles familles niçoises, qui agit sur moi avec cette tranquillité que dispensent les lieux de promenade où l’on sait que l’harmonie du silence et celui des attributs habituels du monde des morts comme les cyprès, les allées de gravillons et les caveaux n’effraient plus le promeneur qui trouve là une raison de s’entretenir avec lui-même dans cette plénitude de solitude que ne vient jamais troubler aucune ombre mortelle.
…
Ce que j’ai trouvé de plus triste et de plus douloureux jusqu’à aujourd’hui, au-delà des mots pour le dire, c’est le regard des enfants qui n’ont pas reçu d’amour. J’avais été confronté bien souvent à ce phénomène qu’on appelle les enfants en foyer, les enfants abandonnés.
Ce sont les même insondables misères qu’on peut voir dans le regard des animaux en vitrine de chenil. Avec souvent moins d’empressement chez les enfants, à venir vers vous et distribuer tout ce besoin de tendresse à partager. Ce sont les mêmes insondables injustices qui se lisent en un mélange tout à la fois de crainte, d’un désespoir innommable mais sûr, fatal et irréversible, comme on peut le surprendre dans ces yeux de détresse où s’inscrit ce secret de l’irréparable.
Katy m’a appris beaucoup sur ces déserts de l’amour perdu des enfants.
Comme pour la blessure d’Amfortas, il n’y a pas de remède. C’est comme naître avec une faculté manquante et la certitude que la croissance de toute les forces ne sera qu’incomplète.
Il est une autre certitude dans le cas de l’infirmité originelle de ces sans amours, c’est qu’aucune possible Atlantide, aucun trésor de pirate enfoui au secret du cœur ne seront jamais rencontrés sur leur chemin.
………………………………………………………………………………………
midi
Je vois Alain Jacquot au Grand Balcon. Le ris de veau aux truffes avec le Sancerre à température y est toujours excellent. Nous reparlons de ce passé commun du temps d’Anne Pignard. De ce concours que nous avions réussi, qui nous avait ouvert les portes de ces quarante années à venir.
………………………………………………………………………………………
12 Janvier
Glacial. L’eau du bassin au petit ange est dans la glace depuis plusieurs jours, qu’on y pourrait sauter à pieds joints sans que celle-ci ne rompe. L’azur n’en est pas moins à couper en relief. Chez Sauveur on trinque, on fait venir les petits paninis de chez Jo. On grelotte un peu. L’hiver triomphe.
………………………………………………………………………………………
Dimanche 13 Janvier
C’est Carmen aujourd’hui. Celle de Elina Garança. Une blonde lettone (?) géniale et volcanique au pays des brunes. Les regards, dès les premiers plans, en font une andalouse qu’envieraient beaucoup de vraies méditerranéennes. Et puis Alagna qui a du soleil dans la voix. Je n’aime pas toujours le style, le ton un peu débraillé, veste à carreaux et mocassin blanc. En fait cette italianité qui, si elle est indispensable au solaire, n’est pas de mise dans certaines articulations et la couleur même qui font la spécificité du chant français dont Thill avait le secret (élève pourtant de De Lucia…). Mais cet après-midi, la magie opère.
Et puis quel Don José aujourd’hui pourrait avoir ce niveau d’éclat dans l’incarnation du personnage ? Certainement pas Kaufmann, barytonant et aux trop nombreuses voyelles écrasées.
La magie a opéré, malgré les craintes d’une mise en scène qui, dans cette œuvre, incite trop aux extrapolations et aux plongées dans notre monde contemporain. Du féminisme à coup de sabots aux pires réactualisations des univers politiques militaristes.
Ce qui fut d’ailleurs le cas durant tout le premier acte où Calixto Bieito transpose les remparts de Séville en univers franquiste militant et sans nuances, aux limites de l’obscène, que rien ne justifie dans les paroles et la relative nonchalance de la musique durant cet acte. Les interventions des rôles secondaires de Zuniga et Morales, tendus et comme pris à froid, laissent un étrange malaise devant tant de violence, d’affichage délibéré de bestialité tatouée.
J’entendais dire parmi les spectateurs qu’il y avait un décalage d’univers flagrant entre l’image hideuse, forçant le trait, et la plastique musicale de l’œuvre.
Mais comme après le pire des orages, le choix de la mise en scène se voit justifié au second acte où les Mercedès des gens du voyage d’aujourd’hui ont remplacé les mules et les chariots sur les chemins montagneux de la contrebande. La taverne de Lillas Pastias symbolisée par une seule berline Mercédès, les portes ouvertes aux quatre vents par lesquelles l’on entre et on sort, où l’on monte sur le capot au rythme frénétique de la gnole de mauvaise vie.
Le troisième acte faisait d’ailleurs apparaître de grandes concentrations de ces mêmes véhicules dans un improbable lieu de passage, sous les éclairages glauques d’une nuit purement gitane.
L’Escamillo du jour est le Boris déjà vu il y a deux mois.
A Bastille on ne badine pas avec les contrats. On travaille au forfait.
Le dernier acte, quasi wagnérien dans un dépouillement à la Wieland Wagner, propose le seul cercle symbolisant l’arène close, où le drame final se resserre sur la fatalité de mort des deux amants.
Garança et Alagna ont été physiquement jusqu’au bout d’eux-mêmes.
Carmen a prouvé que l’universalité de la musique de Bizet peut traverser les plus folles visions interprétatives sans que l’impact émotionnel ne s’en trouve altérée.
C’est ce que j’ai senti à la réapparition des lumière dans la salle.
Durant trois heures, la lave rouge, noire et incandescente de cette musique solaire qu’a dirigé Sir Mark Elder, expose sans temps faible un drame continu qu’on a du mal à rencontrer dans tant de Rossini ou de Puccini où entre un air de bravoure et le suivant il se passe des rivières d’ennuis inutiles.
………………………………………………………………………………………
La promenade au bord du Loup se fait courte, dans la frilosité des roseaux et des herbes saturés d’hiver avec la lumière pâlie de la mi janvier qui fait que la nuit n’est pas encore tombée à dix sept heures.
………………………………………………………………………………………
19 Janvier
Claude de chez Sauveur ne tient pas à me laisser sans lecture. Mais cette fois j’en aurais pour un bon moment. Il m’apporte le Dictionnaire historique des rues de Paris en deux volumes. Documents inestimables d’articles sur l’origine, la création et l’évolution des rues, des Places de Paris, de leurs noms successifs qui se sont faufilés diversement suivant les hasards de l’histoire. Des plans aussi et d’extraordinaires photos, presque toutes de la fin des années cinquante, sur du papier rugueux, d’autres infiniment plus anciennes, de l’époque de Eugène Atget peut-être. Il est étonnant qu’un tel travail de bénédictin soit l’œuvre du seul Jacques Hillairet. Homme d’une seule passion, celle du Paris des rues, du cœur et des entrailles grouillantes de leur vie, dans de dramatiques noirs et blancs, mais aussi du temps qui les a traversées, de l’âme des noms qui chantent et qui disent tout à la fois l’érosion et la pérennité de celle-ci. Rue du Mal de la Mule, Rue des petits carreaux, du Chat qui pêche, des Coupes-Gorges…
D’origines souvent médiévales, énigmatiques, ces noms n’en sont que plus poétiques qu’on a perdu la clé de leur signification.
Comme à Ville d’Avray, ce fameux bois de Fausses Reposes.
…………………………………………………………………………………………….
24 Janvier
Toscanini disait : « il y a ceux qui ont la partition dans la tête, et ceux qui ont les yeux sur la partition »
……………………………………………………………………………………………..
26 Janvier
Katy apparaît chez Sauveur. Orageuse et comme suppliante. Elle semble toujours accrochée à une relation que je voudrais apaisée et définitivement ancrée dans le passé.
Proche et encore fragile. Je suis contraint de fuir. Elle travaillerait à l’Hôtel Brice.
…
Je me réfugie mentalement dans le mouvement lent du concerto en sol de Ravel. Il a toujours évoqué le plus primitif sentiment de mon enfance.
Cette longue ligne droite menant à la ferme Paul Deydier, bordée d’arbres à l’horizon infini, délimitant, à la manière de Monet, ce rideau d’espace qui défile ou mieux, qui s’égrène, coupant ainsi l’espace entre ce qui est du côté perceptible de ma vision et la limite symbolisée par l’alignement des peupliers coupant la ligne de vision, pour n’en laisser que le défilement lent et mélancolique.
Dans le concerto, cela s’exprime le plus adagio possible, et sans doute aucun, par la simple succession de la mélodie désincarnée du piano, de la flûte aérienne et par le redoublement du hautbois, de la clarinette et du cor anglais sur un maigre tapis de cordes, sereinement, comme la remémoration du sentiment même de l’enfance qui défile, revenu aux sources d’une impression première, dans une alchimie d’où aucune explication ne saurait éclore.
………………………………………………………………………………………………
27 Janvier
Michel Legrand est mort hier ou avant-hier. Ce qui donne à la France d’aujourd’hui l’occasion, comme c’est souvent le cas, de rendre des hommages disproportionnés en regard du choix des disparus. Ce qu’elle ne sait faire pour Pierre Boulez ou pour Henri Dutilleux, elle le réservera pour Georges Moustaki ou pour Michel Legrand. C’est la loi de la chansonnette, du plus grand nombre d’affligés supposés, et dieu sait si leur voix compte.
C’était donc l’occasion de revoir ces Demoiselles de Rochefort où la mièvrerie et la pale ombre d’un West Side Story se seraient glissées dans le costume vieilli d’un Courrèges sonnant faux, déjà démodé, où la musique de Legrand a cruellement souffert d’avoir voulu sans pudeur se prendre pour celle de Bernstein.
Il est des œuvres dont on dit qu’elles n’ont pas vieillies. Ces Demoiselles dans leurs chapeaux ne cachant guère la misère, furent vieilles et prétentieuses dès même leur naissance.
Mais peut-être ne suis-je pas assez bon public.
………………………………………………………………………………………………
Les Parapluies de Cherbourg c’est plutôt le premier opéra à voix basse.
Ou peut-être l’opéra aux filets de voix.
On y aurait croisé Jane Birkin au coin d’une scène qu’elle aurait eu ses adeptes.
Michel Legrand s’est appuyé, jusqu’à en faire rire, sur un modèle que je ne nommerais pas, pour faire une mélasse mélodique continue, à des années lumière de son modèle.
Le plus somptueux restera le soin très cru porté aux papiers peints, aux intérieurs désuets et féeriques en harmonie avec les costumes qu’on pourrait croire à des décors de Matisse. Et la neige qui tombe derrière la vitrine du magasin de parapluies.
La bourgeoise épousant le petit homme d’affaire, le mécano épousant la femme de chambre. On n’a rien inventé depuis les Noces de Figaro.
……………………………………………………………………………………………..
Les volets n’étaient pas clos cette nuit. Trois étoiles étaient grosses comme des boules de Noël. La lune en a profité pour montrer tous ses croissants successifs.
……………………………………………………………………………………………..
Hélène est en Thaïlande avec le petit et Rodolphe. Il y fait évidemment très chaud.
………………………………………………………………………………………………
1 Février
L’être-là heideggerien c’est le chemin habituel qu’on a coutume de faire quotidiennement, qui nous habite et qui nous abrite aussi dans la traversée de ces lieux et de ces parcours, comme autant de haltes ou d’étapes.
En 73, les nuits du Tube, en 74, successivement le Porter et le Pastrouil furent des îlots sur le chemin, donnant un sens (au sens de giratoire) , une perspective ou tout simplement une espérance à ce temps passé comme être-là du moment. Des points de chutes nocturnes. Un quartier aimé qu’on traverse plutôt qu’un autre sur le parcours d’une journée…
………………………………………………………………………………………………
Comment sait-on si l’on est à l’automne de sa vie ou déjà passé à l’heure d’hiver ?
………………………………………………………………………………………………
2 Février
Il est des nouvelles matinales qui ressemblent à ces pluies qui n’en finissent de rendre certaines journées affreusement opaques.
Comme je l’entends ce matin, nous sombrons de plus en plus absurdement dans les travers d’une idéologie du sauvetage de la planète. On parle aujourd’hui du coût écologique de la population. Un ancien représentant des Verts, Yves Cochet, en perte de vitesse aujourd’hui, préconise de réguler les naissances dans notre pays afin de mieux accueillir, et plus massivement, les migrants. Même les chinois des temps tyranniques n’y avaient pas pensé.
…
Michel Audiard disait « Les cons ça ose tout. D’ailleurs c’est même à ça qu’on les reconnaît ».
Avec sa variante « Avec l’âge on voit moins les lettres de près, les cons on les voir de loin »
………………………………………………………………………………………………
3 Février
GEOMETRIE ES-TU LA ?
PI : 3,14
SPINOZA ES TU LA ?
Bernard invente, pour le cartouche du menu de mes livres de poésie, l’extraordinaire notion de RECTANGLE ARRONDI.
Affirmation :
Après l’arrondissement des angles, les révolutions
géométriques en cours révèlent, avec cette maintenant nouvelle loi sur les
rectangles qui nous aveuglaient depuis si longtemps de sa clarté, que, comme
toutes les révolutions, elle tombait sous le sens.
On lui donnera ton nom.
A défaut de vendre des livres de poésie, tu auras démontré que dès demain il
sera possible de faire un cercle carré.
Déjà le Newton d’alors, Pastorello, nous avait montré la loi faisant entrer
plusieurs triangles à partir d’un seul – démultiplication spatiale de bouts de
bois- (les pédants diront sui generis) : le tétraèdre, à mon grand ébahissement
d’alors.
Mais c’était dans des années où le monde était encore neuf.
Et qu’il était en plein réinventement de lui-même.
Parce qu’il faut dire que dans l’arrondi du rectangle, il y a une part certaine
du cercle, lequel se recompose parfaitement en reformant chacune des 4 parties
dudit cercle, lequel ne devient cercle que de manière quasi abstraite, dans
l’imaginaire du penseur géomètre, puisque dans le rectangle arrondi on ne se
sert que d’un quart du cercle chaque fois pour aller dans le sens du rectangle
qui s’arrondit, lequel cercle n’a donc, dans le cas de son démembrement
momentané, qu’une existence virtuelle et toute abstraite.
Un peu comme Hawkins parlant de la courbure du temps.
D’où la notion de circulaire ou de circulation. Ce qui n’a rien avoir avec sa
forme compassée et dénaturée en mode administratif.
Tout au plus peut-on parler d’arc de cercle.
Et qu’un arc bien tendu aboutit in fine à la réapropriation du modèle nouveau
qu’est l’arc boutant soutenant le menu des livres de poésie.
Lequel se révèle dans toute sa force, comme le pôle sud et le pôle nord qui
n’ont ni la tête en haut, ni la tête en bas , (ni queue ni tête dirons nous)
mais une existence d’encadrement.
Ce qui est magnifiquement suggéré avec la révélation des rectangles qui loin
d’être carrés ont la souplesse de s’arrondir afin de conserver, comme en forme
d’humilité (ayant aboli tout l’aigu agressif des angles droits), s’ouvrant sur
l’infini perspective des livres de poésie ainsi nouvellement mis à disposition.
Discours d’intronisation de la nouvelle loi sur les rectangles arrondis–
(longtemps confondus à tort avec les rectangles ronds, ce qui est une absurdité-)
p.s. Que nul n’entre dans ces livres de poésie s’il n’est géomètre.
Réponse de Bernard :
Tu ne signales pas la quadrature du cercle, qui est un exercice impossible mais qui a agité beaucoup de mathématiciens, avant qu’on prouve que pi est une nombre irrationnel et même transcendant: beau palmarès pour un nombre. On l’a longtemps appelé la constante du cercle: admirable.
Réponse :
Mais je ne fait QUE parler de la quadrature du cercle,
puisque celui-ci enserre par les côtés le rectangle.
peut-être s’agit-il de l’encerclement du carré
En l’occurrence ici, du rectangle.
Ou la mise en cadre du rectangle.
Par le cercle.
PI est effectivement un nombre fascinant, puisque contenant dans sa vérité, une
in-finitude et un non-achèvement, non replié sur son unité mais ouvert
pour jamais, ce qui le rend parfait et développable à l’infini.
Peut-être que la beauté et ses mystères participent d’une telle
non finitude.
En fait, dans la beauté le fascinant est aussi dans l’imperfection et le rendu
ouvert.
Un visage de femme parfait nous rendrait mort par foudroiement .
Quelque chose dans le cerveau ne l’admettrait pas.
Et c’est rassurant.
Le cerveau arrive à concevoir l’irrationnelle perfection au-delà de la
perfection mathématique.
On dit que dans la plus pure des émeraudes demeure une fracture au coeur même
de la pierre.
Une sorte de larme.
–
Pour en revenir à l’esprit de géométrie qui se fête donc le 3 février, il n’est pas inutile de rappeler que les fragments de cercle enserrant les rectangles (dits arrondis) lorsqu’on les pousse à dévorer l’espace qu’ils enserrent arrivent à (re)former un cercle complet, annulant le rectangle.
Poussant le resserrement vers le centre, on arrive au point. C’est tout…
– ………………………………………………………………………………………….J’ai
attendu 46 ans pour avoir un jardin. Il est petit mais il résume l’essence de
tout jardin.
Un peu ce qu’est le bonsaï au séquoia.
……………………………………………………………………………………………………………..
L’historien et le romancier ont besoin d’être lus. Le poète a besoin d’être aimé.
…
Mozart disait : « je donne tout de moi parce que l’essentiel est d’être aimé »
…
On doit lire Céline à l’âge qu’il convient. J’étais mûr pour le lire à la trentaine passée.
Mais c’est à chacun d’avoir la chance de ne pas le faire trop tôt.
C’est une lecture meurtrière.
…
L’année 2018 aura été pour moi comme on parle de Jésus Christ…
Avec un avant et un après.
……………………………………………………………………………………………..
15 h
Toujours tout un Walhala de nuages courroucés au dessus du Baou de St Jeannet. C’est dimanche.
Le mouvement lent du concerto pour piano de Dvorak habille la grisaille.
…
16h
3° symphonie de Bruckner. On s’accorde à dire que les grandioses œuvres de Bruckner sont écrites avec beaucoup de clarté, dans l’ambitus du plus aigu au plus grave. Comme écrit pour l’orgue. Mais pourquoi n’a-t-il jamais écrit une seule note pour l’orgue de St Florian dont il était le titulaire ?
…
Les crépuscules, surtout après toutes ces pluies de la semaine, font ici un bandeau méphistophélesque rouge orangé du plus bel effet sur les maisons au bas de St Paul.
Et puis un centaure de nuages surplombe la vallée qui s’endort.
…
Sous le feuillage du citronnier, j’ai touché, les yeux fermés comme aux oeufs de Pâques, la pleine rondeur de maigres et fermes citrons. Leur parfum était comme ceux de Limone sul Garda.
………………………………………………………………………………………………
4 Février
Comme je suis enfermé depuis samedi soir, qu’il fait une grisaille, je réponds encore à Bernard qui ne se contente pas de faire de la géométrie, il pose des questions concernant les voyages. Pourquoi va-t-on si loin ?
La première idée c’est qu’ à l’origine, c’est l’instinct qui pousse l’homme des bois à sortir de son périmètre naturel de chasse et de fécondation du clan.
Les vrais voyageurs étaient Marco Polo, Pierre Savorgnan de Brazza, les grands défricheurs de l’Afrique du XIX° siècle, ceux qui voyaient des horizons vierges et qui ont contribué à leur donner un visage.
Goethe, Montaigne, Chateaubriand, et tout le XIX° siècle littéraire, se sont nourris des parfums d’Orient, du voyage à Rome, des pèlerinages jusqu’au tombeau de Jérusalem pour y trouver un brin de l’essence d’eux-mêmes.
Luigi Nono rapporte qu’un pèlerin du XVI° sur le chemin de Tolède laissa un grifitti sur un mur brûlant de la ville où il était indiqué qu’il n’y avait pas de chemin, mais qu’il fallait cheminer.
(“ No Ay Camino, Ay che Caminar “).
La devise du vagabond, du Wanderer ?
Aujourd’hui, le monde moderne propose à la curiosité de tous un séjour au bout du monde comme on propose un tour de manège.
Certains arrivent même à collectionner ces tours de manège comme on établit un tableau de chasse. On fait le Cambodge, le Kenya, on ajoutera plus tard la Colombie Britannique, puis on ira surfer à Hawaï.
Plus on est sédentaire, plus on fait rapetisser le monde.
L’essentiel est de retrouver le chemin du retour.
Peut-être, mais c’est peu probable aujourd’hui, en reviendra-t-on, comme le disait du Bellay, « plein d’usage et de raison » ? …
……………………………………………………………………………………………..
6 Février
C’est avant six heures du matin qu’on peut distinctement entendre les premières conversations d’oiseaux. Une sorte de prélude au printemps. Il y a encore quelques jours, et même jusqu’à hier, les assemblées ailées se donnaient un peu plus de sommeil.
Hélène aussi nous fait lever un peu avant l’heure. Elle nous a téléphoné vers sept heures, (treize heures en Thaïlande), où s’étalent le luxe, le calme, toute une volupté et la palmeraie du lotissement à ce moment de la journée. Le petit Y qui grandit vite, ne veux plus se faire photographier. C’est dit…
……………………………………………………………………………………………
7 Février
On déplore avec vérité que le grand chant wagnérien entrait en décadence à la fin des années soixante. Maria Callas (dont je viens de mettre la main sur sa seule prestation en la matière…) pouvait même, dans les années cinquante se permettre de chanter Kundry avec Boris Christoff en italien, sans que cela ne perturbe les puristes. On a bien chanté Carmen en allemand pendant tant d’années…
Là où ce problème de décadence devient flagrant, c’est au cœur même d’une des plus historiques productions de Boulez/Chéreau, dans l’ouvrage le plus exposé de Wagner, le Ring du centenaire, 1976. L’extraordinaire travail de détails de Boulez et celui de visualisation de Chéreau ne put masquer le déficit de voix à ampleur bien au-dessous de ce qui était le quotidien des troupes de Bayreuth ou du Metropolitan de New-York, une ou deux décennies auparavant.
Pour tempérer le jugement porté sur le seul problème de l’étendue et de la puissance des voix en ces années là, il ne faut pas oublier que des chanteurs comme Windgassen, venu de l’opérette, savait, dans les années cinquante, faire vivre les mots, projeter la voix avec une science du bel canto que n’avaient pas les interprètes d’une époque antérieure où généralement les grandes voix ne manquaient pas.
L’âge d’or du chant wagnérien a été un âge exceptionnel qui ne doit pas masquer que durant ces quelques trente années, pour les célèbrissimes Melchior, Flagstad, Schorr, Hotter et tant d’autres, la puissance vocale de certains Hopf ou Aldenhoff ne sauraient plus être crédibles pour les auditeurs d’aujourd’hui.
La puissance vocale ne saurait seule être matière à beau chant et musicalité. Si Melchior, Flagstad et ceux ayant fait parti de ce temps qu’on a estimé au zénith de l’art wagnérien l’ont été, c’est parce qu’ils avaient cette grandeur de voix ET la science absolue du beau chant.
Je me souviens d’une artiste comme Gwyneth Jones, qui fut de l’aventure historique de Boulez à Bayreuth, qui bien que n’ayant le format vocal des reines de l’âge d’or, tenir encore le rôle d’Elektra, un des quatre rôles dévorant du répertoire, et triompher quelques vingt ans plus tard à l’Acropolis de Nice.
…………………………………………………………………………………………….
10 Février
Retour d’URSS de Gide. Avec Retouches au Retour d’URSS. Un opuscule mince mais reflétant la pensée d’un des maîtres de l’entre deux guerres. Avant la déferlante Sartre.
Cette espèce d’aimantation exercée par une idéologie à laquelle toutes les faiblesses de leurs auteurs se trouvent cristallisées dans des espérances qui ont duré tout de même soixante quinze années. Aragon, Sartre, Gide et de moins prestigieux gros poissons.
Le droit de se fourvoyer sur la nature humaine sans endosser les crimes des éclaireurs d’avenir.
…
En regard de ces tromperies que l’Histoire a mis en lumière, et par un renversement de la duperie, dans le genre un seul contre tous, il est des faussaires de génie comme le plus stupéfiant d’entre eux, van Megheren, qui a su prendre au piège la terre entière, tout à la fois les spécialistes de Vermeer, les critiques et les amateurs d’art tout autant que Goering qui acheta autant de faux que Megheren lui proposa.
Ce fut, ce que j’appellerai une duperie nécessaire. La Hollande avait besoin d’un surcroît de fierté nationale, et le fait de déterrer autant d’inédits du plus prestigieux de leurs peintres les plongea dans l’aveuglement d’un phénomène bien connu, celui du vouloir y croire.
A bien y regarder, comment tant d’amateurs ont-ils pu être aveuglé par la facture de cette série d’œuvres religieuses ?
Le seul examen du regard de Jésus parmi les docteurs et ceux des personnages qui entourent le Christ dans la Femme adultère, laisse paraître un trop criard psychologisme qu’on a bien du mal à trouver dans les Vermeer attestés qui traitaient ses personnages, généralement dans des intérieurs somptueux, avec autant d’objectivité, de réalisme froid qu’il le faisait pour les meubles, les teintures, les velours et tous les apparats de la mise en scène de ces intérieurs de bibelots, de lumière de musique de chambre où les humains n’ont pas plus grande importance.
Loin de ces scènes christiques d’où n’apparaissent aucun décor ni l’ombre opulente de la maison hollandaise.
VMEER était lui une sorte de Cézanne avant l’heure.
………………………………………………………………………………………………
10 heures
La lumière grise de ce dimanche rend le Loup à sa tonalité d’émeraude, qu’elle pourrait bien rivaliser, si ce n’était son miraculeux nimbe si particulier, à la douce transparence poétique de la Sorgue à Fontaine de Vaucluse.
Les courbes de la rivière dégagent des plans d’eau peu profonds où roulent des galets blonds et des sables immobiles.
Des poches profondes dans la pleine anse des sinuosités, que surplombent les arbres dénudés, renvoient l’émeraude sombre et mouvante de la surface délicatement ridée par de subtiles courants que l’on croiraient architecturées pour l’harmonie d’une fête des yeux et la quiétude de l’esprit.
………………………………………………………………………………………………
14 Février
Lumière jusque dans les tréfonds des reliefs dans la forêt en ouvrant les volets.
C’est une matinée de marche avec Mickey. Depuis la Place Masséna jusqu’à Sainte Hélène. J’en profite pour lui montrer le merveilleux intérieur des Gloria Mansions. Puis le Rex Art Déco de la Place Franklin.
Il est ravi.
………………………………………………………………………………………………
16 Février
Déjeuner au Vieux Four avec Fabrice et Stephan l’Allemand. Le Bordeaux y est excellent. Le temps radieux. Le Carnaval sera donc épargné par les foudres, le vent et les orages cette année.
La terrasse au soleil de la rue Bonaparte donne un petit air de voyage, d’escapade, au cœur même d’une Nice que je fréquente peu.
………………………………………………………………………………………………
18 Février
TERRITOIRE : FRANCE
ESPECE : HUMAINE
GENRE : INDETERMINE A L’HEURE ACTUELLE
HIER ENCORE : homme/femme
Dans les formulaires des fiches de famille de la Mairie de Paris, et demain dans toutes les communes, il est aujourd’hui indiqué, dans les déclarations de naissance, la présence de deux parents. Indistinctement : PARENT 1 , PARENT 2 , en lieu et place de PERE ET MERE.
La France est un pays formidable qui revendique très fort un sens moral inébranlable, lorsqu’il s’agit d’interdits et d’obligations fortement encadrés par des lois, va aujourd’hui jusqu’à idéalement transformer la nature dans ses déterminismes les plus évidents pour soutenir une idée chère à Jean Jacques Rousseau qui a toujours trouvé que cette vision historique et sociale était le fruit d’une sorte de diktat culturel, nous dirions, d’une classe sociale dominante, contre la vraie Nature et nous priverait par exemple des bienfaits d’un choix d’appartenance à un sexe, suivant le penchant, la tendance qui ressortiraient de l’expérience intime de tout un chacun.
Ce que les doctes moralistes nomment la théorie du genre.
Cédant à certaines castes minoritaires imposant une forme de chantage à la discrimination, il est constaté que si la nature a injustement imposé de mystérieuses lois internes à son propre développement, ce à quoi nous tentions de nous conformer depuis toujours, se révèle maintenant d’une caducité qu’il serait bon de réformer à des fins théoriques, civiques et autoritairement déviantes. A des fins d’égalité. Plus justement d’égalitarisme. La France n’aime pas ce qui dépasse. Il devient donc injuste que la nature qui offrait à l’homme et à la femme d’engendrer un fruit de leur union ne fut pas, par de savants passe passes juridiques, rectifiée dans le sens d’offrir à tous la possibilité de choisir le ventre d’une pondeuse afin de connaître ce que la nature n’offrait jusqu’à ce jour qu’au travers de ses lois les plus inexorables.
Après le mariage pour tous, les enfants et la famille pour tous. Par le plus grand détournement de l’ordre des choses.
La France d’une certaine morale se voit donc paradoxalement revenue à ce colonialisme tant abhorré qui est aujourd’hui non plus manifesté par l’implantation sur des espaces territoriaux lointains, mais par l’exploitation des ventres du tiers monde et de toutes les misères sociales issues des énormes écarts économiques qui régissent la planète. Y compris sur notre propre sol.
A des fins de satisfaire ces discriminés de la nature, minoritaires et homophiles.
Au nom du Droit. Droit d’avoir ce que la nature ne nous offre pas.
Paradoxe de la Nature et de la Culture rousseauiste !
Les nouveaux adeptes d’une nature bienfaisante offrant le choix d’un genre, par l’expérience de notre humanité, s’opposent à une culture qui les auraient injustement tenus à l’écart d’un développement propre à chacun, nient paradoxalement ce que cette même nature a de règles fondamentales et intransitives.
C’est par le tour de force du passage au Droit, donc par une dimension culturelle et non pas naturelle, que ces revendications exercent un nouveau pouvoir civique donnant accès à toujours plus d’espace politique à l’horizon des identités minoritaires.
Bien loin du Droit naturel dont parle Hegel.
La France est décidément le pays du droit administratif où la nature a de moins en moins d’espace.
Si nos hommes politiques, au nom d’un certain droit, pouvaient, pour des fins complaisamment électorales, nous faire accéder à ces ailes qui nous manquent pour voler, nous rendant injustement discriminés par rapport à l’oiseau et à un Icare triomphant, certains n’hésiteraient pas à inscrire cet audacieux projet dans leur catalogue de promesses.
…………………………………………………………………………………………….
19 Février
Il y a, dans ces milieux homophiles, des défilés de garçonnets d’une dizaine d’années, sur des podiums de grands théâtres ou de palais des congrès, vêtus en drag queens, sous les regards attendris de leurs parents d’adoption.
Il y a des présentateurs de télévision qui expliquent leur juste combat pour adopter, à grands frais naturellement, deux enfants asiatiques, contre les lois interdisant l’acquisition d’enfants comme de simples marchandises.
Il y a Monsieur Frédéric Mitterrand, qui adopte deux petits tunisiens enfreignant les mêmes lois de bioéthiques…
Il y a un Ministre de l’Education Nationale, prosélyte militant, qui ordonne, dans une circulaire adressée aux chefs d’établissements du primaire, d’inscrire en première priorité dans la finalité de l’éducation des enfants, la lutte contre l’homophobie …
Il y a des diktats qui viennent de très loin…
………………………………………………………………………………………………
23 Février
Ce matin j’avais dans les oreilles les tarentelles, les valses et les languissantes mélopées de film de Nino Rota. Je suis toujours pris par la trompette du clown blanc de Fellini, seul dans l’arène de sa solitude. Par toutes les mélancolies de ces années d’or du cinéma italien qui est aussi, en parallèle, celui du possible temps de nos nostalgies de sexagénaires ?
C’est en repensant à ce séjour de l’an passé en Sicile, passant près de Corleone, aux portes de Salemi et aux silences des ruines de Ségeste ou celles de Selinonte que je me vois être le dernier d’une lignée aujourd’hui disparue.
J’entends, le dernier de ceux élevés dans la sphère de la Nonina de par la fratrie, la descendance et par le cheminement qui commença, en ce qui me concerne, dans les années cinquante à Rabat.
J’ai vu en quelque peu de temps s’en aller ma mère qui suivait de trois mois sa sœur aînée, puis Angela et André, l’oncle et petit dernier du cercle des enfants de ma grand-mère.
Comme sur le rivage d’une plage longtemps fréquentée, il ne reste qu’une sorte de silence marquant plus encore le seul clapotis des vagues sur des sables maintenant rendus à leur éternité. Loin des bruits et des fureurs. Loin des fêtes et des cycles de saisons qui paraissaient ne jamais devoir un jour finir.
Me trouvant seul de ce lignage sur cette rive, c’est à Cefalu, dans une ruelle menant vers la Cathédrale, que me revint au travers de la musique d’une chanteuse de rue, en un condensé, la clameur fantomatique de tous ceux disparus, de tous ceux du même sang et du même nom. Et qu’une sorte d’oppression me saisit avec des larmes venant de loin.
Je serai donc le dernier sicilien de ce lignage, moi qui me suis toujours défendu de l’être.
C’est une plongée, déjà un peu troublée, dans le miroir d’une vie automnale qui me renvoie à la fois aux racines et aux premières feuilles mortes de l’existence. A la presque responsabilité d’avoir à respirer, à vivre pour tous ceux qui ont cessé de le faire.
Dans ce sentiment d’une solitude singulière qui est celle des vivants portés encore par le spectre de tous et qui se voit, rassemblant et fondu en un seul, le miroir de tous mes précédents.
……………………………………………………………………………………………..
Dimanche 24 Février
Comme le temps persiste au beau, nous y ajoutons aujourd’hui la couleur et l’enthousiasme de la lumière des peintres.
Depuis plus de cinquante années que je réside sur cette Côte, je ne suis allé qu’une fois ou deux vers ces villages de peintres, du temps de ma tante Lucia qui avait alors un véhicule.
D’abord Vallauris, pour la chapelle encastrée dans le vieux château, où sous les voûtes en bel appareil, Picasso a laissé un ensemble de panneaux d’isorel, épousant le mouvement ogival de la voûte, consacré au thème de la Guerre et de la Paix.
Proche de l’esprit de Guernica, mais plus épuré, plus dans l’esprit du joueur de flûtiau et des satyres qui l’animait dans ces années cinquante/soixante, avec une idée d’antithèse entre la grâce des Parques, des bergers, de la danse furieuse et des jeux d’enfants s’opposant en vis à vis aux sombres et métalliques désordres des minotaures et des ombres de sang du chaos des guerres.
Le reste des salles du château est consacré à de magnifiques céramiques et à des vases où l’esprit des goulots nazca n’est pas étranger.
Pour le reste, Vallauris devient une sorte de casbah qui oublie ses peintres et ses potiers.
Cela consolera certains en tous cas d’avoir vu disparaître l’esprit taurin des férias du temps de leur splendeur.
Puis Mougins. Perdus vers Mougins le Haut, collines de résidences à échelle humaine, plongées dans de verts espaces arborés, nous retrouvons le chemin de Mougins-village, comme au temps des artistes qui en firent leur espace d’inspiration.
Là encore Picasso y est vivant à chaque coin de galeries et nous accueille sur le boulingrin de la grande place qui flanque le cœur du village, par une énorme tête de bronze.
Les fontaines y sont nombreuses et depuis les terrasses de café et aux abords des restaurants les jets d’eau sur les bassins laissent entendre de paisibles tintements en harmonie avec le rythme lent de la vie des pierres et des lierres. Les rues se nomment Bocuse, Vergé, Escoffier. Une Place porte le nom du fameux commandant, natif du village, qui donna plus tard le nom de la capitale du Tchad, Fort Lamy.
Nous essayons, sous le soleil doux du début d’après-midi, le petit vin de Provence.
C’est l’heure des grandes quiétudes entre l’ombre silencieuse, les balcons fleuris, les tortueux serpentins des ruelles, les chats dormants, les jets d’eau et l’écho des éclats du dimanche.
Le MACM, le Musée d’Art Classique de Mougins est une création récente de 2011 sur les lieux d’un ancien moulin à huile. Un don et un hommage du collectionneur anglais Christian Levett, au lieu qui vit l’inspiration des peintres s’épanouir et les premières colonies grecques créer ce littoral privilégié.
Partant de la crypte, consacrée à toute l’étendue connue de l’égyptologie, de l’ancien Empire (2686-218 av. J.C.) à l’époque ptolémaïque (320-30 av. J.C.), le coup de foudre, la perle de ces trésors rendus au silence, les sarcophage en bois polychrome de Djed-Hor-Uefankh, prêtre d’Amon, datée autour de 1000 ans av. J.C. et celui , sublimissime, d’Arhénius décoré de multiples scènes figurées et de citations du Livre des Morts, d’autres sarcophages hiératiques, des masques et des bustes, tout comme aux autres niveaux du musée, une ordonnance, une juste science dans la présentation des œuvres que l’on aurait pu y dormir comme au meilleur temps de Belphégor, en rêvant à des mondes disparus, protégés par les armes en ordre de bataille, les casques chalcidiens, corinthiens, illyriens, pyliens, et phrygiens, les cuirasses aux reliefs de poitrine, les lampes à huile éclairant la mi obscurité d’antiques catacombes, remontant le temps vers les gloires de la Grèce et de Rome, protégés par Ulysse coiffé du casque de type pilos décoré d’une couronne de rayons et de fleurs de lotus, des bustes d’Eschyle, Ménandre, Socrate et d’Alexandre le Grand, des empereurs romains, les féroce et les sages, Auguste, Tibère, Claude, Néron, Adrien, Marc-Aurèle et Domitien. De pied en cap, celui que j’ai préféré, Hadrien au geste auguste.
Aux salles consacrées aux Dieux et Déesses, en contrepoint, répondant à des siècles de distance, le XX° siècle, non moins tumultueux de Braque, Picasso, Picabia, Dali, Henry Moore, Masson, Matisse, Yves Klein et pour trait d’union parfait entre l’univers antique et notre monde, un Rodin tout en souffrance.
Près de deux heure plus loin, laissant la pénombre et son éternité de beauté, nous voilà dans la lumière encore chaude d’un milieu d’après-midi sur la grande place aux jeux de boules, enserrant du haut de notre promontoire toute la vallée vers les cols de Vence et les collines environnantes.
………………………………………………………………………………………………
25 Février
L’origine de l’expression « en deux coups de cuillère à pot » pouvait avoir une explication facile à admettre. La première venant de la rapidité avec laquelle on servait les repas aux soldats de la guerre de 14/18. La seconde, subtilissime mais non moins prétendument historique, viendrait de Jeanne d’Albret, épouse de Antoine de Bourbon qui, devant la rapidité avec laquelle elle mit au monde le futur Henri IV, aurait eu cette phrase spontanée : « elle n’aura pas perdu de temps, elle l’enfanta en deux coups de cul, hier à Pau ».
Ce qui évidemment se transforma en une expression déviant progressivement vers le sens d’une célérité plus largement accessible à tout un chacun.
Il m’est aujourd’hui d’autant plus facile d’adhérer à l’explication de l’origine béarnaise que la première fois que j’entendis l’expression, c’était par la bouche de l’oncle basque, Louis Toulet.
……………………………………………………………………………………………
26 Février
La civilisation occidentale d’aujourd’hui s’affirme et affirme sa liberté par la transgression.
Par avancées successives contre un ordre antérieur établi.
La thématique de la nudité peut éclairer l’évolution et les contradictions qui s’attachent au nu. D’une manière globale, l’homme issu de l’hémisphère nord s’est toujours vêtu pour des raisons faciles à comprendre. De la peau de bête aux diverses transitions du vestimentaire. L’homme d’Afrique sub-saharienne, pour des raisons non moins compréhensibles, a toujours adopté à l’opposé, une quasi-nudité.
Par liberté, la femme nouvellement émancipée de l’après 68, a enlevé le haut dans une démarche transgressive signifiant le rejet d’une attitude ancestrale prohibant par nécessité de dévêtir les parties intimes ou supposées l’être.
Et c’est par paradoxe, que l’on pourrait y voir la contradiction de la femme occidentale réduite, par rapport à l’africaine, à une demie liberté, le bas n’ayant encore jamais passé l’interdit moral et culturel.
Voir dans le dépouillement symbolique du corps une avancée vers plus de liberté met en lumière une cruelle réalité où seul le transgressif du dévoilement du corps prend valeur de culture nouvelle.
La femme occidentale sur les plages du début du XX° siècle, coiffée de chapeaux lourds, de cols à dentelles et de manches fermées jusqu’aux poignets n’en était pas moins libre que celle d’aujourd’hui qui rivalise faussement avec l’africaine.
La liberté n’étant pas réductible à la seule symbolique.
A l’opposé, une femme africaine vêtue, si c’était possible, avec la robe de mariée de ma mère, par désir de changer d’us et coutume, donc de réduire sa valeur culturelle antérieure, ne démontrerait pas pour autant une avancée de sa liberté, mais ne serait au contraire considérée par sa communauté que comme transgressant l’ordre et l’équilibre social du groupe.
Vouloir démonter les mécanismes culturels en les assimilant à un plus ou moins de liberté est un leurre.
Le fameux Déjeuner sur l’herbe de Manet révèle exactement l’éclairage de la transgression. Ce n’est pas la nudité de la femme en soi qui pose scandale, mais la proximité des deux messieurs qui restent vêtus.
Le hiatus est criant de vérité. Ce n’est pas un plus ou moins de liberté que d’aller vers le nu, mais une manifestation contre le seul ordre culturel qu’on a cru faire vaciller.
La semi-nudité des femmes sur les plages d’après 68 ne troublèrent que le temps de l’effet de surprise.
Les seins tombant, on a vite remis les soutiens-gorges. Le pragmatisme du culte de la beauté a plus vite repris ses droits que la nudité d’affirmer sa liberté.
Les nus de Michel-Ange n’ont jamais provoqué non plus d’érection parmi ses admirateurs.
Le hippie aux cheveux longs de protestation des mêmes années ne fut qu’un symptôme de révolte contre l’ordre ancien. Un transgressif.
La femme occidentale s’est trompée de registre. La liberté n’est pas de faire le n’importe quoi à laquelle on l’a assimilée. Le conducteur dépassant les deux cent à l’heure sur l’autoroute ne démontre pas la force de sa liberté, mais sa folie.
Kant a bien délimité les contours de celle-là. Il redécouvre les vieilles branches du Décalogue et les interdits nécessaires de l’Ancien Testament renommés impératifs catégoriques qui sont autant de balises à la vraie liberté, laquelle est de suivre l’ordre raisonnable dans la pratique d’elle-même. N’entravant pas, au demeurant, la liberté de l’autre.
La mode est également un transgressif. Mais un transgressif collectif mineur et maîtrisable, délimitant le mode de sentir d’un groupe ou d’une classe sociale, bien que toutes les classes aujourd’hui adoptent universellement certains usages (le jean’s , l’amour des animaux, la cuisine végétarienne, l’écologie dans son principe).
L’Occident s’est éloigné de certaines vérités qui garantissaient sa liberté, le rendant plus fort. Dans les assauts répétés qui constituent le doute même de sa nature, elle n’en précipite que plus rapidement son déclin.
N’était-ce pas Jean-Paul II qui disait, « seule la vérité vous rendra libre ? »
……………………………………………………………………………………………..
Je voudrais dans ma poésie des tonalités épiques et bibliques. A la Jean de la Croix.
………………………………………………………………………………………………
17heures — je surprends un rouge gorge au bord de la vasque de la fontaine. Hélène avait nommé ses canaris Titi et Toini. Y a appelé son petit chien Tito et sa mamy Cécilia, Tita.
Une sorte de tendresse et d’harmonie héréditaire.
………………………………………………………………………………………………
J’assimile de plus en plus la musique de Respighi à Rome, comme la moindre mandoline de Vivaldi m’est aujourd’hui d’une vraie mélancolie parce que c’est Venise toute entière.
……………………………………………………………………………………………… 28 février
Hélène m’appelle. Ils sont rentrés hier de Thaïlande. Après un beau séjour.
………………………………………………………………………………………………
13 heures
Je me penche depuis la cuisine sur le dallage de la terrasse. Elle a été rafraîchie hier. C’est redevenu tout rose. Comme mes pensées. Mes pensées qui me disent que j’ai commencé mes premières tentatives poétiques il y a cinquante ans.
… Josiane Roche. Le Parc Impérial. Octobre 1968. « Comme on voit certaines roses … »
Puis 1969 qui inaugure une trilogie majeure de ma vie avec 1970/71. La plus belle envolée, le florilège d’un lâcher de ballons vers l’avenir. L’écriture va naître, mais maigre et irrégulière, comme une source au débit incertain jusqu’en 1974. Puis le silence de dix années. Absolu. Où je me suis nourri de tout ce qui pouvait nourrir un poète sans poème, prêt à engranger tout ce que la vie lui offrait de nouveautés et de découvertes. D’architectures romanes, de Moyen Age et de cinéma japonais, de peintures, de lâcher prise, de voyages en 4L, d’années de philosophie, d’Université et de Pub Carlone au soleil couchant, au risque de se perdre dans des nuits de fausses détresses, de retours vers ces traces de l’enfance au Moulinet, un peu de photographie et l’apprentissage de la musique.
Debussy comme un socle pour toujours.
Dix années de silence. Une vie neuve de nouvel adulte, d’équilibre, avec le premier arrimage d’un rythme régulier auprès de Danièle Prost, celui des premières expériences professionnelles, le Musée Chagall, puis plus tard, l’entrée aux Animations Musicales au Centre Culturel de Cimiez. La route qui s’éclaire de son propre chemin..
Et puis la rencontre avec Cécilia lorsque Danièle fut partie.
Ce fut le second souffle d’un printemps qui pourtant ne m’avait pas encore vraiment quitté.
Et puis un jour, Mallarmé que je redécouvrais dans un tiroir de meuble de la cave. Il m’arrivait souvent de remonter à la maison des livres poussiéreux comme si c’était la première fois que je les rencontrais.
Et Saint John Perse, et Eluard… C’était le retour à la conscience de l’écriture possible, les balbutiements neufs des nouvelles Couleurs de l’Aube, et bientôt René Char, la poésie de Provence, le Vaucluse.
Et toujours, jusqu’en 2005, cette écriture irrégulière de source ingrate. Je me justifiais en pensant que ce maigre débit était un syndrome à la Webern, que je travaillais exclusivement dans le diamant ! Dans la pureté de la rareté…
Puis sur la route de Grasse, à la borne de l’Hôtel des Parfums, le Damas qui ne demandait que ça, ce fameux matin de septembre est née la limpidité d’une source régulière venue comme une confirmation, (celle que j’avais connue dans mon éducation religieuse, la main du parrain sur l’épaule du confirmé, en l’occurrence ici celle de mon inspiratrice mauresque d’alors, et un peu plus tard, la confiance de mon ami éditeur Bernard), que je ne faillirais pas à la nuit de l’écriture.
………………………………………………………………………………………………
Hier c’était Rome et Respighi, cette Piazza Navona où quelques noirs et blancs demeurent de mes quinze ans. Cette Rome où j’aimerais tant revenir. A ma marraine qui m’a fait découvrir les fontaines et les pins de Rome, à Rabat et son odeur de librairie (enfant, je lui disait toujours devant la Librairie Horizons « plus tard je viendrais travailler ici avec toi ». Il me reste d’elle, à défaut de cette collection de photos qui était le patrimoine photographique des évènements de notre famille, ce courrier reçu ce jour, de ma part d’héritage d’assurance-vie qui, comme par un étrange échange de notre passage ici-bas, servira à mes propres obsèques.
………………………………………………………………………………………………
Ce soir, les fenêtres de la chambre nord grincent, en les faisant jouer et en les fermant, comme les quarante quatre variations et un soupir de Pierre Henry.
………………………………………………………………………………………………
1 Mars
Lucia, ma tante Salemi, a épousé un mari de dix sept ans de plus qu’elle. Son petit frère André, secrètement adoré, avait dix sept ans de moins qu’elle.
………………………………………………………………………………………………
3 Mars
Montée dans le haut de Cagnes, le vieux village qui domine tout le tortueux complexe entre Cagnes sur mer, Villeneuve et toutes les communes qui donnent l’impression qu’on n’est pas sorti de l’une qu’on se trouve déjà dans une autre.
Le petit Y est fasciné par le vocable même de château. Une entité imaginaire, close sur elle-même, débouchant probablement sur les plus élémentaires des songes.
Il attend de voir apparaître le chevalier. Qui ne se manifestera que dans l’arbre généalogique de la famille Grimaldi, en armure et en blason sur la poitrine. Il ne l’a pas tellement apprécié. Il dira plus tard à sa mère que celui-ci était allé à la piscine.
Les ruelles, toutes en pentes ascendantes ou descendantes, rythmées par les cyprès et parfois de gigantesques cactus en perspective à l’angles d’autres ruelles, font de ces labyrinthes pavés de petits tableaux provençaux d’ombre et de lumière, où manquent seuls les bergers, où les noms des rues sont les noms de la famille Clergue (comme ceux du Montaillou de Le Roy Ladurie), mais aussi de certains chevaliers Gautier et quelques Grimaldi du Moyen Age, (Y ne s’était peut-être pas trompé), et curieusement à un angle de rue, Aucassin et Nicolette…
La plus ancienne demeure paraissant être datée de 1315, restaurée en 1924.
Ce château qui domine de manière presque écrasante tout le village, présente une multitude de pièces, de salons, de chambres, vidés de leur mobilier et décorés de croûtes d’artistes probablement chers aux cœurs des anciens propriétaires mais proposant, aux multiples fenêtres ensoleillées, des perspectives aux quatre coins de la vallée. Il abritait il y a encore quelques années un festival annuel de peintures contemporaines. Je me souviens d’une belle expo sur Paul Jenkins que j’étais allé voir avec Cathy Sémerie-Bes dans les années où nous travaillions ensembles.
Bizarrement l’entrée de la discrète église au clocher indiquant 1797 (en pleine post Révolution) présente son entrée par une rue du haut débouchant sur un premier niveau (ailleurs ce serait la tribune) plongeant sur la nef et le chœur. Elle est si sombre que Y n’a pas envie de poursuivre plus loin.
La place principale est large, l’hôtel, qui vaut bien l’Hôtel du Nord dans sa capacité à faire rêver, ne montre pas plus de quatre fenêtres sur sa façade et sûrement pas plus de chambres à proposer. Nous prenons un verre sur une des nombreuses terrasses avant de rejoindre le vieux Vence où nous déjeunons. L’après-midi s’étire entre les ruelles aux chats dormants, aux brocanteurs du dimanche pareillement somnolents à cette heure de quiétude sur la très belle place de la Mairie aux couleurs ocres et blanc d’une vive architecture locale.
J’ai aperçu la Galerie Chave et la Fondation Emile Hughes. Mais malheureusement la Chapelle Matisse, un peu à l’écart de la cité historique, est fermée le dimanche.
………………………………………………………………………………………………
5 Mars
Saint François était donc un homme d’écologie avant cette affreuse appellation devenue aujourd’hui le nœud improbable de toutes les tendances politiques.
L’écorce des vieux arbres, les oiseaux et leur rapport cosmique firent de lui le lien serré avec le catholicisme.
Un peu comme dans une vision ressourcée du Paradis perdu, François voit la nature vierge et indissociable des lois de l’Esprit.
Un grand cyprès millénaire atteste de cette union des frères franciscains continuant d’entretenir le sens sacré des racines qui crient jusqu’à l’érection des parties visibles et vertigineuses qui s’élèvent en questionnement vers le ciel.
………………………………………………………………………………………………
L’arbre a son complément forestier, le champignon. Son poisson pilote qui exhale la qualité particulière du bois. Les extraordinaires trompettes de la mort ne se conçoivent que dans les feuillus humides des bois de hêtres. Le cèpe aux pieds des chênes, les pied bleu, pieds de mouton et les sanguins de nos régions dans l’humidité pourrie des pins de Méditerranée. Le champignon est la sentinelle de l’arbre et à son tour l’émanation de celui-ci, l’attestation de la profondeur de ses racines, le goût et la senteur du fond de la terre mêlée aux feuilles roussies d’automne. C’est la nourriture des profondeurs terrestres remontée en offrande à la surface même de la terre. La faisandée excroissance du délicieux et âpre mariage des humus et des fibres devenues en bataillon, la chair même de l’âme de l’arbre…
……………………………………………………………………………………………..
7 Mars
Ces jours-ci je me retrouve à écouter toute une pleine brassée de Schumann. Ce n’est pas un secret. J’ai toujours détesté reprendre dans les oreilles les œuvres que je connaissais par cœur. j’évite donc de les réécouter.
(Combien ai-je souffert en 1980 et dans les années qui ont suivi, m’obligeant de répéter (pour le faire aimer !), ce fameux Oiseau de Feu ?!)
Avec Schumann, pas de risque, ça me semble toujours un début de tête à tête entre le Carnaval de Vienne et moi. Toutes ces ruptures, ces phrases inachevées que je me laisse surprendre sur la suite à donner…
Magnifique Bavouzet (Carnaval de Vienne, l’opus 111 (3 pièces de Fantaisie) et la grande sonate. Luisada avec les Danses des Compagnons de David et la grande Humoresque. Peut-être suis-je aussi induit en séduction par les prises de sons actuels. Mais surtout, lorsque l’Humoresque défile, c’est toujours comme si c’était la première fois, tant les surprises regorgent.
Et cette année est une année Berlioz. J’ai tellement considéré « l’extase » de la Damnation de Faust de mes vingt ans comme un absolu de l’écoute, dans le noir, des nuits entières, me rendant dépendant de ce frisson à l’approche de certains climax, que je m’en suis détaché, par une sorte d’usure. Et je ne veux plus recommencer, ni pour Berlioz ni pour des musiques qui pourraient me rendre trop fort le chant des sirènes. Le chant de la chair. Berlioz en était le prototype.
Avec la musique contemporaine, c’est souvent un dialogue cérébral qui met fin à la dictature du sentiment ou de ce fameux « bercement » que croyait être la mission obligatoire de toute musique, le père Frère, alors Président du Festival MANCA.
Avec Pélléas, mon autre référence nocturne de ces années d’apprentissage, c’est heureusement la continuité du flux qui innerve et conditionne toute approche auditive rendant moins dépendants ces climax et ces pics d’intensité garantissant d’une plus grande résistance l’écoute répétée de l’œuvre. Mais avec Debussy, je ne prend guère le risque de la saturation. Pareillement avec Wagner dont on ne vient heureusement jamais à bout.
Donc un Pélléas tous les deux ans, sans plus. Malgré la découverte d’un live de 1960 au Met, dirigé par Jean Morel dont l’élève Slatkin disait que sans la guerre, il eut été le nouveau Pierre Monteux…
(Le Met de ce soir là réunissait V. de Los Angeles, G. London, Resnik, Theodor Uppman, génie foudroyant, et Tozzi (la basse qui me donnait ces fameux frissons dans le Songe d’Hérode de l’Enfance du Christ … de Berlioz).
Plus j’aime, plus je me défile ! Peut-être est-ce une philosophie qu’il faudrait adopter avec les femmes vénéneuses… Paradoxe.
C’est aussi parce que j’ai revu ce chef d’œuvre de « Gilda » hier au soir…
………………………………………………………………………………………………
8 Mars
Maintenant c’est sûr, c’est avant six heures du matin que l’oiseau soliste commence le récital. On sent bien derrière les volets encore clos que la petite assemblée qui a élu l’arbre de mon jardin est attentive aux récitatifs secco que leur prodigue le maître chanteur. Des phrases assez courtes en points d’interrogations, des stridences confidentielles, parfois montantes, parfois descendantes, toujours surprenantes, et évidemment un génie rythmique toujours renouvelé.
L’opération se renouvelle, quand mes oiseaux s’en sont allés, sur l’olivier des voisins, avec le même cérémonieux matinal. Je ne saurais dire, comme Messiaen, de quels voyageurs du ciel il s’agit, mais le printemps est bien là.
Hier soir nous sommes allés au Théâtre d’Antibes avec son escalier ascendant à la Guggenheim. L’espace restaurant tout près du toit est chaleureux, avec une immense bibliothèque et des chandeliers très 18°, des hôtesses jeunes et un vin de qualité.
C’était « le Château » d’après Kafka. La vidéo était des plus réussies (Paolo Correia), d’une sensibilité rappelant les géniales mises en scène de JP Ponnelle à Salzbourg, toute cette poésie des chants de la nature, les feuillages frémissants, l’eau, les arbres et le scintillement léger des argentés du minéral dans sa Flûte enchantée, son Tristan et son Orféo. Les comédiens débitant ici le texte adapté de manière lapidaire (l’interprète féminine…) dans des tonalités monocordes.
………………………………………………………………………………………………
J’avais décidément mal vu le panneau, trop distraitement, et je me félicitais d’y lire :
PARIEZ L’INFINI, où il fallait lire,
PARIEZ L’APPLI N°1
J’ai pensé l’espace d’un instant que sur les autoroutes on se mettait à la poésie…
………………………………………………………………………………………………
Révélation que ces Messes, Hymnes et Magnificat de Jehan Titelouze, exhumés depuis peu.
Une extraordinaire intégrale de l’œuvre d’orgue, dont il est un peu le père en France, a été enregistrée sur l’orgue historique de l’église paroissiale de Bolbec.
………………………………………………………………………………………………
Dimanche 10 Mars
Sortie dans le Var. Un grand classique pour les 06 que nous sommes. C’est soit le Var, soit l’Italie, soit le nord provençal. Donc hier le 83 et Aix , déjà dans les Bouches-du-Rhône. Tout ça est bien administratif. Saint Maximin , nous y sommes restés très peu. Des travaux dans tout le centre historique. On prépare l’été et le futur. Donc nous n’avons pas entendu l’orgue. Le chevet de la basilique avait été nettoyé comme un prélude probablement à tout un programme de revalorisation de la pierre.
Par contre, découverte de la route Montagne Ste Victoire, site de France. La route dite de Cézanne. Aux Deux Aiguilles.
C’est vrai qu’on marche sur d’affreux sentiers caillouteux à terre rougeâtre et qu’il faut faire attention aux chevilles et aux genoux. Mais en avançant, on approche de plus en plus frontalement sur la panoramique de la montagne grise et plissée, au milieu des thyms et des romarins.
Le ciel était changeant. Quelques trouées de bleu sur des nuages où s’engouffraient des bouffées de soleil pâle, poussés par le vent du nord. Cela fait de belles photos avec les genêts jaunes et les fleurs de Mars à peine naissantes. On a du galoper cinq, six kilomètres comme ça, dans le silence de la pierraille. Mais c’était ce qui est le plus approchant de ce que le peintre a du connaître. La lumière rend la pierre insaisissable, dans des gris laissant des coulées de blancs entre ses plis et ses fractures. Les sentiers sont odorants. Un soir qu’il prenait par surprise l’orage, il a pris tout son temps pour remballer et s’est retrouvé au lit avec la fièvre. Une semaine plus tard il était mort. 1906, à soixante six ans. Dans toute cette garrigue on sent l’esprit de cette montagne. Le peintre y est accroché pour toujours. Que cherchait-il dans le gris hostile du massif ? D’autant que ça faisait loin de la maison. A pied.
Voilà quelles étaient mes pensées.
Le Jas de Bouffan, la maison familiale, a disparue. Reste un "jardin" de platanes qui forment une allée, celle menant à la maison disparue. Aix m’a déçu aujourd’hui pour la même raison que St Maximin : des travaux de partout. On se refait une beauté pour l’été. Mais la ville reste belle, une des plus attractives que je connaisse. Par contre le Cours Mirabeau a perdu ses arbres séculaires sur une grande partie de son parcours. Malades dit-on. On a l’impression que ce magnifique centre est devenu chauve. Ce début de printemps m’a fait l’effet d’une entrée rude dans l’hiver plus que cet octobre d’il y a quelques années où l’azur donnait une autre image à cette ville, semblant rentrer paradoxalement dans le printemps qui nous fuit aujourd’hui.
Et puis là où est l’immense fontaine d’où commence le Cours, la statue de bronze de Cézanne de pied en cap, est comme perdue au milieu du rond point, alors que son attache d’origine était un petit square tranquille. Déplacée à cause des travaux. La cathédrale St Sauveur est toujours aussi belle avec ses statues, un peu comme à Reims, son cloître discret et Sciences Po juste en face. La pierre granuleuse ici a la couleur du pain d’épice marron. L’orgue était magnifique dans son vert amande. On ne pourra voir le chef d’œuvre de Nicolas Froment, le Buisson Ardent, aussi beau que l’Agneau Mystique de Van Eyck. Mais le gardien du cloître nous aura laissé le temps de faire le tour du minuscule carré de chapiteaux et de colonnes à la pierre rongée, dont une torsadée comme dans l’art byzantin au cloître de Monreale.
Dans la nef, c’était l’après-midi des Confirmations. De personnes adultes, « oui, je réponds à l’appel »…
Place de l’Evêché, j’ai vu la cour où l’on donne les représentations d’art lyrique en Juillet. Presque minuscule. Place Gabriel Dussurget.
Mais c’est déjà dix sept heures. Aix est truffée de places et de placettes où l’on débouche au coin d’une rue, sans prévenir, saturées de promeneurs et aux terrasses animées. Des jeunes surtout.
Après l’église Saint Jean de Malte flanquée du musée Granet, la Place aux quatre Dauphins, comme un bassin romain.
A l’entrée de l’église, sur une des chapelles latérales, une exposition de miniatures, de gravures de Monique Ariello Laugier, inspirée des Echelles de Jean Climaque le Sinaïtique. Elle vit dans les montagnes de l’Ubaye.
Ce fut la surprise du jour.
Trente deux gravures merveilleuses d’inspiration, à lire de bas en haut comme il se doit en montant les échelons de l’Esprit. J’en ai été si touché que je m’en vais écrire à l’artiste, née comme moi à Rabat !
Jean Climaque (climacus) dont le nom n’est pas sans rappeler pour nous les fameux degrés des climax musicaux…
…
Il y a tout de même un point commun à Aix avec l’incertitude des Normands.
Je demandais à une jeune fille, il y a trois ans, où était la cathédrale, réponse : "laquelle ?"
Je demandais aujourd’hui au garçon de restaurant la même chose , réponse : "je ne sais pas, je ne suis pas d’ici, je viens d’arriver, je connais la mairie qui ressemble déjà à une cathédrale".
Troisième personne questionnée : "oui, oui, elle est à l’angle de la rue ! »
Ce n’était pas la cathédrale. On est rentré à la nuit tombante.
………………………………………………………………………………………………
12 Mars
Il y a quelque jours, dans la discrétion, s’en est allé Michael Gielen, un des défenseurs de la musique d’aujourd’hui. A plus de quatre vingt dix ans. Comme Boulez, Prêtre. Un âge qui semble un seuil au-delà duquel…
………………………………………………………………………………………………
midi
J’apprends par Gilbert Bessone que Cathy Bes est en fin de parcours. Elle ne répondait plus au téléphone. Je n’osais trop non plus la joindre, sachant qu’il lui était difficile d’aller au-delà des premiers mots d’une phrase. Elle dort pratiquement toute la journée. La morphine seule soulage la douleur. Ce seront bientôt les soins palliatifs…
………………………………………………………………………………………………
Le Prélude et la mort d’Isolde, l’accord non résolu dès le début de Tristan, sont les plus éthérés narcotiques jamais relevés du fond des gouffres.
…
Les Hymnes et les huit Magnificat de Jehan Titelouze, aux orgues de Bolbec, nous mènent vers de larges brassées de vitraux, de la lumière la plus proche du matin des cathédrales.
………………………………………………………………………………………………
17 Mars
Comme dimanche dernier, des passages de gris laissent quelques clairières de bleu dans le ciel. La lumière est capricieuse. Nous partons en compagnie de Y pour Tourettes-sur-Loup qu’on ne voyait plus depuis qu’une agence nous avait proposé un appartement sans charme en lisière du centre du village. Je reconnais vaguement le Café des Sports qui semble la principale source d’animation sur la place où nous déjeunerons à midi.
Plus avant dans le temps, nous y avions passé un lundi de Pâques avec maman et la famille Boddi, dans un beau parc aménagé, qui semble avoir disparu pour quelque parking, depuis lequel nous disposions d’une vue panoramique sur l’aplomb du village et en plan intermédiaire, un pont qui le longe.
Le clocher domine la grande place aux platanes dépouillés, puis les porches sous les diverses tourelles (tourettes aujourd’hui) nous indiquent qu’on pénètre dans le cœur et les dédales des ruelles anciennes.
Tourettes n’a rien à envier aux autres villages perchés d’arrière pays. L’appareillage des pierres est souvent d’un ocre vif qui cimente en jointures les pierres séculaires, et l’intérieur des maisons est presque toujours accessible aux regards des visiteurs. C’est le charme de la quiétude et du repli, loin des éclats du littoral. Les chats somnolent sur les margelles des fenêtres.
Par temps ensoleillé la lumière doit trancher la pierre et lui rendre ce relief acéré qu’ont les boyaux de rues montantes et descendantes, coupés à vif et reliés par les marches d’escaliers.
Les cactus et, à certains endroits, les mimosas finissants donnent, comme à Cagnes, l’illusion d’habiller et de rendre africaines ces ruelles à peine troublées par la curiosité des promeneurs du dimanche.
De vieilles pierres sont fréquemment réemployées sur des maisons plus jeunes, quand ce n’est pas le portail entier des 16 ou 17° siècles qui vient encadrer une entrée.
Un balconnet rude de bois séculaire semble même provenir d’un lointain souvenir d’église.
Un ange aux bras coupés, dans l’élan de tendre les bras vers nous, a lui aussi trouvé sa niche à mi hauteur d’une bâtisse abandonnée.
C’est, comme à Mougins, un village qui propose la gourmandise. Des restaurants étoilées présentent de lourdes tables sous les voûtes de pierres, dans de très petits espaces faiblement éclairés, souvent à mi obscurité, fait comme des nids d’intimité et de poésie. Des ateliers d’artisanat et des commerces d’art complètent les quelques activités permanentes à la pleine saison.
Depuis l’exposition sud du village, on peut apercevoir sur la table d’orientation, une vue exceptionnelle, si ce n’était ce ciel plombé d’aujourd’hui, une panoramique plein sud allant jusqu’à Golfe Juan, le Pic de l’Ours et très loin aussi, du côté de l’Italie.
Tourettes se déclare le village des violettes dont la couleur est présente dans la moindre incruste de marches d’escalier, sur la pierre de pavement, aux devantures des échoppes, aux ferronneries des enseignes des boutiques de savon, et bien sûr en tant que fleurs dans les jardinières aux fenêtres des maisons, jusqu’à certains parasols sur les terrasses de cafés.
Tourettes a bien l’élégance discrète de ces villages somnolent de notre arrière Alpes Maritimes
Le viaduc de l’ancien train des Pignes est toujours visible en contrebas de l’escarpement sud.
La mer est au loin perceptible par trouées successives.
………………………………………………………………………………………………
18 Mars
Dans Ulysse, Mr Deasy dit à Stephen Dedalus : « L’Irlande est le seul pays qui n’a jamais persécuté les Juifs, savez-vous pourquoi ? Parce qu’on ne les a jamais laissé entrer ». Dans Nestor.
……………………………………………………………………………………………..
La ponctuation est un peu comme la respiration en musique, la barre de mesure, une indication rythmique au travers du sens, incluant les incises et menant dans le parcours de la phrase, des propositions jusqu’à la chute conclusive de celle-ci.
Mais la ponctuation est une gêne grave pour l’écrivain. Je rêve, bien que tant d’auteur aient partiellement ou entièrement déjà écrit des œuvres sans point ni virgule, d’un rêve d’une liberté et d’un élan qui ne serait plus brisé, où le lecteur compréhensif et intelligent saurait pénétrer sans trop de mal dans la succession des pensées de l’auteur.
………………………………………………………………………………………………
Boulez, dans sa détestation extrême -en public- n’aimait-il pas et haï André Jolivet ( avant de présider les cérémonies du 20° anniversaire commémorant sa disparition…) pour avoir été le premier compositeur français à rendre, dès 1935, un quatuor à cordes dodécaphonique cohérent ?
………………………………………………………………………………………………
19 Mars
NOUVELLE VI ( NOCTURNE A L’ARCHE DE NOE )
C’est venu comme ça après la soixantaine comme un tic la peur de la mort ancrée depuis toujours la mort excessive à mon âge c’est devenu aussi normal et banal que le chien qui lève la patte pour la soulage une sorte d’instinct dont on ne fait plus même attention et que certaines bêtes sont déjà même plus mortes que leur maître qui me parle à l’heure où j’écris laquelle bête reste tout le temps qu’on boit aux pieds des tables des maîtres que nous sommes à boire elle non sinon dans une vasque quand on ne l’a pas oubliée quand on ne lui a pas écrasé la patte ou simplement marché dessus pour une douleur voire un enfer canin je n’ai jamais aimé les animaux les chiens surtout à cause qu’ils ne sont malgré ce qu’on en dit sur la même échelle et bien qu’on pense que leur fidélité absolue qu’on ne soupçonnerait chez aucune femme est la qualité évidemment recherché par leur maître je n’aime pas en parler je reste en silence quand Gribouille vient poser ses poils mouillés frétillants sur le bas du pantalon je fais des efforts à serrer les dents en manière de sourire chacun ses petits désespoirs c’est donc la peur de la mort qui est là que j’en parle de chiens comme quand on rencontre les vieilles qui promènent le leur et qui me salueraient si j’en avais un solitude c’est donc venu comme ça la solitude-esclave du chien la fidélité de l’animal comme je devenais fidèle à cette idée de ma fièvre de l’hypertension qui me mesure de la force de ces flux de petites cisailles de valvules ou de scarifications sculptées par les battements du cœur c’est d’autant plus venu comme ça petit à petit depuis le temps que ça gronde mes échographies sont dans l’obscurité si ce n’était le sourire du pathologue qui me rassure qui me parle de ceux qui combinent les diabètes et bien des soucis plus engagés que les miens la mort me vient donc comme une obscurité une espèce de nuages qui plombe dès que j’ouvre les volets pas tous les jours mais enfin comme enfin j’ai toujours eu foi en l’espace la respiration régulière des rythmes du temps le jaunâtre des champs de blé où parfois les corbeaux figent lentement (la vie aurait-elle un sens ?) ce n’était donc qu’une qualité de lumière qui défie les us la sensibilité la terre respirent les sillons qui cautérisent les yeux s’étaient fermés aux quintes supérieures vers le ciel vertical où la mort le revolver nous parlaient du noir ce noir de Soulages rimbaldien et auguste c’est revenu comme ça cette odeur de noir des nuits de paupières lourdes cette soixantaine hésitante à hisser les degrés mais quand tu ris je ris aussi disait Catherine Ringer c’est la mort qui t’a assassiné Marcia tu es en cendre en cendre rien qu’à toi douce et exquise Soulages rimbaldien zen zébré et japonais calligraphe je l’avais caressé du regard aux vitraux de Conques humbles et lumineux monacal noir vague et intempestif
Aujourd’hui le réveil a été le cauchemar de ne plus savoir que traverser les landes désertifiées d’une mémoire de tous les nocturnes comme un défilé chez Noë Ainsi la Nuit de Baudelaire qui hanta les nuits d’un quatuor à cordes de Dutilleux à l’âge où je suçais encore la vitalité des lendemains cette nuit là j’étais tombé en panne d’essence en un lieu obscur une forêt proche ayant perdu la droiture du chemin une faible lueur indiquait le poste d’essence un peu sur la gauche blafard sans personne jusqu’à l’ombre qui passa plus noire encore que la plus noire nuit qui me demanda de quel Gas il aurait été temps de me préoccuper qui insista me disant que nul ne franchisse ce seuil sans perdre toute illusion c’était ce vieux Charon heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage avec le mien qui menaçait de franchir plus loin la bande blanche séparant mon chemin de la nuit plus à main droite de la scène qui se déroulait sous mes yeux je quittai donc la lugubre enseigne cet îlot de minuit obsédé par l’idée de la bande blanche au-delà de laquelle la forêt engloutit je retournais dans un autre tableau de Edward Hopper après avoir cheminé loin longtemps rencontré des ligne à pointillés que je considérais comme une invite à la forêt je sus y résister trouva refuge au cœur noir de la nuit pour un autre îlot bien plus éclairé et non moins blafard en plan rapproché cette fois en face de moi plutôt en diagonale était un homme accoudé au zinc et une femme silencieuse qui semblait lointaine sous le chapeau à larges bords et une voilette qui ajoutait à la distance le barman silencieux aussi à cette heure où la fermeture paraît toujours imminente ne se souciait pourtant pas des naufragés la lumière des néons comme celle du bec de gaz à l’extérieur ajoutait aussi à figer le rythme improbable de la nuit à la rendre fluide comme un temps qui pourrait s’accélérer et déboucher sur un petit matin comme s’arrêter en forme de bobine de film qui aurait cassé mais quand tu ris je ris aussi mais tu aim’ tellement la nuit la petite musique provenait d’une source qu’on ne distinguait pas mais qui épousait le lieu que je ne sais si la chanson disait tu aimes tellement la nuit ou tu aimes tellement la vie les deux paraissant dans ces circonstances n’avoir aucune importance l’homme but à nouveau une sorte de gin se serrant plus encore près de la femme comme si ma présence devait impérativement lier plus les deux personnages contre une éventuelle avancée de l’intrus que je paraissais être nous ne dîmes un seul mot durant le temps de cette scène dans cet îlot paraissant nous même deux autres îlots et même trois bien que nous restâmes immobiles et que le troisième le barman en mouvement n’arrêtait de ranger les caisses de bières vides du jour et de la nuit maintenant très avancée puis il y eut un long cheminement toujours en lisière de la forêt quittant ce Nighthawks urbain de Hopper pour ces longues nuits obsessionnelles qui revenaient dans le paysage et la fatigue aidant c’est bien plus en arrière dans le temps que l’obscurité prit forme avec la même acuité la même composante de noir qu’aujourd’hui seules les maisons en bordure de route avaient maintenant des toits de chaume et depuis les chaumières une lumière humaine comme un lait de l’enfance irisait vers la route où je me trouvais c’était plutôt une nuit qui tombait douce et pleine des promesses des sommeils réparateurs après les travaux dans les champs les personnages qui revenaient d’un pas lourd dans le harassement comme sauvés et épargnés un jour de plus sur les landes du labeur se dirigeant vers le havre des maisons où la lumière faible mais chaude rendrait la nuit moins épaisse et les dérives de la chair promise un réconfort avant le sommeil et le jour prochain je me pris à marcher en un temps ralenti comme ce temps des temps où la vitesse ne tentait pas encore de braver et de défier la mort où la mort n’avait encore délimité les domaines de la forêt et ceux plus rassurants de l’autre côté des bandes blanches j’errais librement de cette liberté comme dans un espace où rien ne menait à rien dans une pénombre avec ou sans clair de lune mais des lumières aux fenêtres préludant à une plus grande attention n’étant pas balisé par les délimitations qu’avait gravement et sentencieusement indiquées Charon c’était ainsi que défilaient les extatiques nuits d’été sur la route les paysages de nuit paisibles de meules de foin de bergers et de clairières d’arbres séculaires de François Charles Cachoud le Corot de la Nuit savoyarde loin de mes rêves tristes et entêtants de rêveries et de douleurs il n’y en eut plus dans cette apesanteur qui vint d’une nuit transfigurée où le poème disait que l’enfant n’était pas de toi mais que je saurais te le confier et que tu saurais l’aimer au-delà de la nuit et de nos solitudes comme une rencontre dans le noir des nuits éternelles où nos corps de fantômes se pénétraient sans plus peser de leur douleur terrestre comme un amour qui ne saurait exister ayant besoin de l’opacité de la nuit bienfaitrice et discrète et sidérale cette désespérance n’ayant plus même de cri possible dans cette rencontre dans l’espace de Munch hors de l’angoisse dans la communion des êtres indissociables d’eux-mêmes comme les âmes déjà mûries d’un autre monde Ah dire ce qu’elle était est chose dure cette forêt féroce et âpre et forte qui ranime la peur dans la pensée et loin de tout sentier égaré revint loin aussi du pur amour désintéressé l’angoisse primordiale qui n’a ni couleur ni persistance dans la forme et le contenu sinon comme l’est l’œil de Caïn une tache imprimée sur la conscience des jours et le temps qui les traverse d’où se dressent des cathédrales sous des ciels d’orage des cathédrales de prières sous les lambeaux du tourment que c’eut pu être sous ces cieux la nuit de la cathédrale d’Abbeville de Boudin les départs pour l’ailleurs des effets de nuit de Monet départ pour la cessation de l’angoisse pour l’ailleurs au-delà des quais immobiles de la peur de la maladie du temps la mer toujours recommencée
que ma quille éclate que j’aille à la mer
je m’éveillais ainsi de la confusion des nocturnes sur des rivages encore palpitants et tremblants de la conscience revenue à la veille qu’il me semblait qu’on aurait pu encore faire entrer d’autres nuits dans la maison de Noë du plus beau et du plus immaculé des noirs abstraits et immatériels de ceux qu’on ne peut que concevoir dans l’idée même et toujours vague d’un néant ensevelissant mais la ligne blanche reste la démarcation rationnelle hors de la forêt obscure et son palais de terreur le jour et la nuit l’un en haut l’autre en bas entre chien et loup en quelque sorte mais combien vide est ce ciel d’en haut alors que tant de lueurs de lumière dirais-je depuis le lampadaire sous les arbres peut-être des chênes dans la perfection du nocturne mais il ne s’agit pas du dégradé d’un crépuscule d’un fondu entre ces moments bien distincts de vingt quatre heures il y a bien un jour et une nuit pleins d’eux-mêmes d’un vide de ciel parce que peut-être on ne peut rien en attendre sinon ces pauvres nuages sur la pâleur du bleu d’un ciel auquel on ne croit déjà pas d’une fadeur évoquant les petits désespoirs de la foi contre la fascination du monde émergeant de la nuit propice de la nuit de lumière de celle crée par la main et l’ingénierie de l’homme qui masque la vie au seuil de l’entrée de la maison de la maison silencieuse d’où émane le désir d’en savoir plus il ne s’agit pas ici de la démarcation de la forêt d’avec la rassurante ligne blanche mais d’un seuil de désir et de vie pleine protégée derrière le mur de façade dans l’obscurité chaude qui n’en accentue que plus ce désir d’y pénétrer comme ces seuils qui invitent dans les maisons victoriennes de Londres ou de San Francisco Magritte propose l’invention d’un moment inexistant qui est le jour entier et la nuit entière dans une seule et même vision pourtant crédible d’une nuit qui n’est plus celle de la peur et de son corollaire mortel et d’un jour finalement désacralisé dans sa paradoxale et rare ouverture sur un ciel muet Quel est ce froid que l’on sent en toi Marcia ? C’est la mort qui t’a assassinée ce n’est pas l’Ecole du Cirque depuis longtemps Orphée a franchi le fleuve de l’oubli la forêt traversée au-delà de la blancheur de la ligne parti de la station service prévenu par Charon le Rempart il a été pris du vertige par l’éternité de quelque sarcophage le poète a chanté éperdument de cette voix au pouvoir de charmer d’ordonner les pierres dont les Rolling Stones serait méchamment le dernier avatar mortel puisque déjà croulant d’ériger de séduction l’architecture dans le labyrinthe d’Eurydice de faire se coucher et se lécher les pognes les lions comme courber les plus effroyables âmes de la mort à condition que la lumière ne fut jamais plus sur la face d’Eurydice avant l’aube de leur délivrance O ouï Monteverdi des buccins de ténèbres et d’anges noirs laqués de la lyrique nocturne auquel répondit bien plus tard dans le dernier délire syphilitique Robert Schumann dans ses Chants de l’Aube qui furent son dernier crépuscule avant le tourbillon et la plongée dans la douleur de la folie comme Nietzsche et Hugo Wolf poètes de nuit et puis prodigieusement dans cet embarquement de Noë je vois Pessoa je lui dis tout ne va pas trop pour toi rentre il fait froid la route indiquée est dangereuse sais tu je vais bientôt à Lisbonne j’espère voir un peu de ta nuit tu m’avais dit qu’elle avait des étoiles surtout en venant par la mer le Portugal est latin mais il n’est pas de la mare nostrum il va vers les grands larges il s’est perdu s’est fracassé aux récifs d’Amérique on lui tourne le dos quelle idiotie depuis il s’est aussi endormi endolori avec ses ânes ses femmes noircies ses vignes puis ensuite calfeutré jusque dans ces quartiers de pleureuses qui chantent les mèches au vent la douleur de la mort tu sais c’est partout pareil comme les mélodies du monde qui souffle j’ai eu le mal d’en finir j’ai connu ces moments où sans espoir on entend la nuit parler des moines qui disaient « les voleurs d’état seront toujours pires que ceux qui te prennent ton caleçon quand tu nages dans la rivière tu seras pendu eux seront brandissant des sentences contre toi » Pessoa s’en fut comme une ombre qu’il a toujours voulu être je ne l’ai plus revu je sais qu’il a pensé franchir la ligne blanche je l’aime bien comme Manuel celui qui a dit que la Conquistà de Hernan Cortès n’était autre que la nouvelle et palpable Atlantidà celle qui repartagerait le monde en deux je me suis endormi dans la bataille de Guernica Picasso avait raison les chevaux ont toujours les mâchoires ouvertes de fureur et d’agonie quand la douleur de la mort frappe aux naseaux c’est pareil chez les humains il a mis une lampe au dessus de la scène pour qu’on voit les faenas les contorsions des géométries de la mort il aimait les taureaux les règles de l’art le sang peut-être cet artiste savait mieux que personne les règles de Charon la ligne blanche la forêt il a dansé sur nous comme dirait Nougaro je sens bien que je prends trop de sucre c’est mortel pourtant je n’aime pas la sensation du sucre je suis comme beaucoup d’homme je suis plutôt salé on en meurt de tout ça le sel de la vie nous fait mourir je parle de ça parce que je découvre une artiste qui peint la nuit la nuit tout court enfin comme Cachoud le savoyard la nuit animée des humains qui n’en peuvent mais parce que la nuit est un symptôme je cherchais le mot un symptôme et les artistes écrivent la nuit et souvent il y a statistiquement aussi des chances si on peut dire de mourir la nuit moi la nuit je n’en connais que ce qu’on peut en voir derrière les vitres de la fenêtre de ma cuisine j’y vois St Paul de Vence comme un gros candélabre qui se verrait bien sur scène mais ce ne sont pas ces nuits que les petits bretons du côté de Crozon peuvent apercevoir parce que là ce sont les étoiles qui entrent en jeu et en Provence on a des étoiles aussi mais il faut quitter les villes et les lampadaires les tentations de Charon les stations d’essence prendre non pas la forêt d’après la bande blanche mais le champêtre le paradis perdu disparu depuis qu’on s’est égaré de la nuit la vraie lumière je revenais d’Amsterdam il y a deux ans j’ai aimé les tulipes celles qu’on appelle les prématurées parce qu’elles ne vivent que très peu venant avant la maturité des autres j’y ai vu dans son propre musée l’homme à l’oreille meurtrie le chapeau de paille sans soleil comme le jour des corbeaux qui aurait pu me dire voilà la nuit de Provence voilà la nuit étoilée celle que seuls les aveugles maintenant voient du dedans de leur nuit loin du monde de l’électricité ce monde de l’angoisse et de l’aveuglement là aussi il y a le ciel cette fois étoilé dans des boules de Noël tournant sur elles-mêmes d’une blancheur qui surpasse l’angoisse des cobalts de la nuit qui nous disent que nous tournons éternellement dans des boucles lumineuses où tous nos défunts nos proches et mêmes ceux que nous ignorions depuis la nuit des temps se montrent quand je garde mes mains sous ma nuque couché dans ces champs de rosées étoilés comme dans la promesse du Paradis au dernier vers déjà parrainé à l’entrée de l’Arche à la dernière lumière l’amour qui meut le soleil et les autres astres dans cette vision de la sphère étoilée c’est le ciel le haut du ciel qui embrase et la nuit réelle des humains qui s’ensevelit dans l’espace de la vie terrestre un peu à l’envers de ce que Magritte a vu
et puis voici la clarté
revenus des forêts des noirs torpeurs de cette ligne de démarcation d’avec les morts une petite bourgade portuaire du Japon une femme qui lorsqu’elle sent monter ce feu qui brûle dans le fond de son ventre comme une déesse marine fait porter par tous les canaux les murs les espaces de la maison son eau tiède par-delà les gouttières à pleine suée jusque sous le pont d’où les vieux pêcheurs s’assemblent secrètement parce que les poissons y sont plus abondants qu’ailleurs une sorte de pêche miraculeuse sous le pont rouge l’amant de la femme fréquemment sur le chalutier se voit souvent aveuglé par l’immense miroir que celle-ci dirige en sa direction signifiant le retour pour lui vers la maison à l’heure où s’installe pour elle la tyrannie du désir c’est de la pleine sève le ruissellement de la fertilité l’amour traversant dans toujours plus de contorsions l’oubli momentané de la forêt du crêpe des deuils pour un jour descendre dans une sorte de grotte un repli des entrailles de la terre et s’y enfouir où d’un même jet se confondent en une énergie mêlée la fontaine du désir la mer le geyser de la femme le Déluge ………………………………………………………………………………………………
20 Mars
C’est le printemps. Depuis quelques années c’est à cette date et non plus le 21. Est-ce, comme la teneur en alcool des vins qui montent en degrés depuis quelques années, l’écorce de la terre qui change ?
………………………………………………………………………………………………
Gilbert Bessone que j’ai appelé hier, pour tenter de voir Caty Bes assez vite, me confirme son état inquiétant. Un protocole d’assistance à domicile a commencé. L’acharnement de la chimiothérapie aussi. A quoi bon ? Sa maman est près d’elle. Elle ne quitte plus sa fille qui n’est que pleurs quand elle a un moment de lucidité.
………………………………………………………………………………………………
Le roi de Chine, ou l’empereur du soleil levant, arrive à Nice ce samedi, dans un Boeing de haut de gamme, gros, très gros, avec son lit personnel et quelques multiples effets (baldaquin ?) pour passer le week-end, logé au Negresco. La ville sera évidemment paralysée. Reçu par notre monarque républicain, je suppose que la rencontre se fera sous le signe d’une stratégie à adopter pour gagner les européennes en encourageant la racaille à tordre de l’acier et dépaver la plus belle avenue du monde, ou peut-être vendre au meilleur prix Paris et ses aéroports en échange de quelques menus contrats industriels. Pendant que Paris brûlait dimanche dernier, le monarque jupitérien skiait à la montagne photographié à la table d’une terrasse, lunettes noires et sourire serein, buvant de l’excellent rouge avec sa cour à la santé des français. On retiendra ce trait particulier de cynisme arrogant venant de celui qui restera pour l’avenir le Caligula contemporain.
………………………………………………………………………………………………
Fauré disait, du temps que Ravel était son élève « vous me décevez beaucoup mon petit Maurice » après que celui-ci eut écrit son quatuor à cordes. Un des plus extraordinaires qu’on ait écrit. Ce n’est qu’avec le temps qu’on mesure les errements du jugement, même des plus avisés. Mais Fauré ayant également composé un quatuor à la fin de sa vie n’ était pas plus conscient d’avoir lui-même écrit un de ses chefs d’œuvre. Il l’aurait déchiré si quelques amis avisés…
Les compositeurs français, d’une manière général, ont chacun écrit, avec le genre quatuor à cordes, ce qui se fait de mieux mais n’y sont jamais revenus. Debussy, Ravel Fauré, Dutilleux, Boulez, Roussel, Jolivet. Un seul, quand les allemands travaillent en série…
………………………………………………………………………………………………
On voit ce soir de premier jour de printemps, sur la vasque du bassin, près de l’angelot enlaçant le dauphin, une colombe à leur hauteur, me regardant de son profil, sans plus de crainte. Jour de grâce.
…
L’arbre prunius a donné son dernier souffle de fleurs avec ses dernières parures rouges qui ont suivies. Là où auparavant les branches étaient fièrement déployées au ciel, celles-ci paraissent mortellement repliées en un reste de carcasse amaigrie comme, en son temps, la capacité respiratoire de mon père. L’arbre nous dit à sa manière un au revoir comme s’il avait conscience qu’il mourra définitivement et sut que je pouvais comprendre son arrachement à la terre.
…………………………………………………………………………………………….
nuit
La liberté chez Rousseau doit être garantie par les institutions. Pour Nietzsche, contre celle-ci.
……………………………………………………………………………………………..
Le jour où j’ai perdu la timidité je fus pris d’une sinistre ironie. Peut-être par redoublement de timidité.
……………………………………………………………………………………………..
21 Mars
Madame Lagarde, Présidente du Fond Monétaire International, préconise que, passé quatre vingt cinq ans, on ne médicalise plus les malades. Dans un pays où hypocritement on dit refuser l’euthanasie. Cela m’a fait pensé à ce Japon médiéval de la Balade de Narayama où les vieux devaient gravir la montagne pour mourir dans les neiges de l’hiver.
La Belgique a évidemment fait savoir qu’elle envisageait la proposition favorablement.
………………………………………………………………………………………………
Dimanche 24 Mars
Grasse, capitale mondiale du parfum. Ville arabe.
………………………………………………………………………………………………
nuit
Dans Guernica, Picasso a su reprendre l’esprit de l’Apocalypse de Saint-Sever et d’autres Beatus catalans.
…
Beatus de Liebana, moine enlumineurs du VIII°, siècle soutenait cette thèse qu’on a nommé l’adoptianisme qui niait la consubstantialité du Père et du Fils (que n’avait pas admis en son temps le Concile de Nicée, 325) pour ne faire du Christ que le fils adopté par le Père. Le pape et même Charlemagne s’en mêlèrent…)
Lors de notre passage dans les Pyrénées nous avions visité la cathédrale d’Urgell où sont consignés d’admirables manuscrits enluminés par Beatus, un des plus grands artistes visionnaires commentant l’Apocalypse, douze siècle avant Picasso.
Mais nous n’avons pu accéder à ces chefs d’œuvre qu’au travers de vidéos assez sommaires.
Que donner pour tenir entre les mains le Beatus de Facundus ?
………………………………………………………………………………………………
26 Mars
C’est tout Paris qui vit en ce moment à l’heure de l’Egypte. Toutankhamon qui passe de villes en villes. De capitales en capitales. Le Louvre en est chamboulé. L’Egypte rend fou les musées. Il n’est pas un déplacement de sarcophage, une bandelette exhumée qui ne soit rendus à la fascination universelle. On avait eu l’émotion du déballage de Ramsès il y a quelques décennies.
C’est vrai que trois mille ans et plus ça donne une notion approchante de l’éternité, du moins de la taille de notre passage ici bas.
Je suis un peu égyptien aussi. Les gens ne le savent pas toujours. Je n’en tire d’ailleurs pas vanité. Il m’arrive de loin en loin d’abord, puis plus fréquemment à mesure que je vieillis, d’acheter non pas un livre mais deux fois le même, et presque en cachette. Encore faut-il évidemment que ce fut un livre ou une édition particulièrement précieuse, que le texte ou les textes en question soient des œuvres majeures pour moi, mais j’en conserve toujours un qui gardera en quelque sorte une espèce de virginité puisqu’il ne sera pas lu mais placé en bon rang dans la bibliothèque. Il ne sera jamais ouvert, sauf le premier jour, pour en vérifier l’odeur encore forte, l’ampleur d’un tel trésor dans sa masse et son épaisseur, et il trouvera ensuite sa place définie entre deux autres volumes ou en fond d’alignement d’un meuble de bibliothèque. Pour se faire oublier, pour attendre une relative éternité dans le monde des chefs d’œuvre à portée de ma main. Et puis il y a l’autre qui sera en quelque sorte le livre d’usage, celui que je manierai avec d’autant plus de liberté que le premier sera là à témoigner comme dans une petite Bibliothèque Nationale, dans sa solitude, sa vaine existence, morne et inutile, à attendre une autre vaine existence supposée où la matière n’en sera peut-être plus, et que le volume pourra se mouvoir d’une seconde vie. Hypothétique. C’est mon côté égyptien, égyptien malade supposé. Il m’est donc arrivé de pérenniser certains livres d’art, quelques œuvres complètes de Hérodote et Thucydide, de René Char ou encore de Julien Green parce que les volume V et VI de son Journal correspondaient à la fin de mon adolescence et aux années soixante dix quatre vingt que je pouvais observer en miroir ce que fut ma vie à cette époque et ce que l’écrivain avait dit concernant ces années-là. Cela me rend malade, et coupable quelque part, d’avoir à établir et à vivre sans que j’en fus contraint, ce genre d’absurdité. Il y a en moi ce je ne sais quoi de conservateur de musée que j’ai été dans la vie réelle, dans le sens où celui-ci a charge de rendre dans le meilleur confort et l’état le plus d’origine l’objet à offrir aux regards du monde.
Vanité des vanités. Mais c’est ainsi que je pense déraisonnablement pouvoir arrêter le temps. Plus la défaite du corps, l’approche de la fin de la vie s’annoncent à grands symptômes inexorables, que l’idée d’arrêter ou du moins de croire à la cessation du phénomène, se fait plus intense pour le vieux collectionneur que j’ai toujours été.
………………………………………………………………………………………………
Etre écrivain ne consiste pas seulement à écrire des livres et à tenter de les faire vivre aux yeux des autres, de gagner sa vie en les vendant, mais d’avoir la douloureuse expérience de voir un de ses propres ouvrages aux mains d’un lecteur assis sur un siège de métro. J’ai imaginé la scène, un jour d’affluence, un jour où il est difficile de se concentrer sur un de mes livres, où quelque hasardeux lecteur se fut embarqué dans le Prélude d’Icare par exemple, la réaction que j’aurais pu avoir, sentant le peu de concentration du lecteur, de lui dire « concentrez-vous, je sais bien ce n’est pas le lieu idéal, vous avez eu bon goût de vous être attardé et d’avoir choisi ces poésies, mais croyez moi, elles méritent un peu plus d’attention. Faites donc un effort, replongez vous donc dans votre lecture. Merci…
………………………………………………………………………………………………
Ulysse m’ennuie, je reste dans l’Intranquilité.
………………………………………………………………………………………………
15 heures
Mais déjà Wagner. Quand on parle de Wagner il s’agit de mesurer le souffle. On entend différemment la phrase musicale que chez d’autres. Comme les nageurs qui savent l’économie du souffle. Le fleuve, la force du courant. C’est comme ça qu’on approche le Séjour de Siegfried sur le Rhin. Une des grandes interprètes d’Isolde disait « il n’y a pas que le souffle, l’inspiration infinie. Encore faut-il avoir les chaussures adéquates pour tenir trois heures sur scène »… parfois même le schnaps avec. Aux entractes.
…
Wagner je l’aime, il est ce fleuve dont même le vibrionnant Chabrier, retour de Bayreuth, pensait qu’il était un billet sans retour dans la galaxie du lyrique laissant les pèlerins dans l’exsangue futur de leurs improbables créations. Comme des stupéfaits n’ayant mot à dire.
Wagner a été une sorte de pharaon qui fit mieux que les pharaons. Ceux-ci tentèrent de s’éterniser en des sépultures et des embaumements qui devaient les faire passer du bon côté de la mort. Wagner s’est éternisé dans la plus vivante des folies possibles. Le temple de Bayreuth rendu possible par la folie lucide et complice de Ludwig II. Pas un seul compositeur, artiste, d’aucune époque n’avait jamais crée son mausolée, un lieu qui ferait perdurer la mémoire et la célébration d’un propre culte permanent rendu chaque été, au sommet d’une colline déboisée largement pour la cause, le travail de l’acoustique impeccable et unique, et la communion des fidèles qui se feraient pour les temps à venir.
Même les dieux profanes des temps désacralisés de nos plus vaines gloires d’aujourd’hui, n’ont pu mieux faire que de construire des demeures d’une grande vulgarité rivalisant avec d’improbables parcs d’attraction pour engloutir leur solitude dorée.
Wagner seul…
………………………………………………………………………………………………27 Mars
Je viens de quitter Ludovic Thézier. Quelle chance dans cette semaine radiophonique d’avoir un tel invité. Les mauvais esprits diront que pour une fois on entend un chanteur intelligent. Et non seulement il est intelligent mais il m’a ému, pas qu’en chantant, mais parlant de Boris Christoff et surtout de Georges Thill dont il dit que la fin du premier acte de Werther ne relève plus de l’art du chant mais d’une dimension spirituelle qui est une limite dont le chanteur n’est peut-être pas conscient. Enfin, c’est moi qui met des mots sur ce que j’ai cru comprendre de Thézier. J’aime bien ce Thézier. Une voix qu’il dit modestement de baryton avec de beaux accents et une assise de basse certaine. A l’aise donc de tessiture, et de timbre quasi italien. je l’avais découvert dans le rôle de l’Etranger de Vincent d’Indy. Une voix bitteroise (Bacquier) ou toulousaine bien qu’il se dise marseillais. Je l’ai entendu aussi dans un opéra de Bernard Hermann (d’Hollywood), celui qui a fait toutes les musique de Hitchcock et qui a composé un vrai opéra qui tangue entre Debussy et Britten, sur le thème des Hauts de Hurlevent (ça fait rêver tous les Pélléastres). Ce qui n’est pas si mal…
………………………………………………………………………………………………
Je me fais bien à ma nouvelle vie. Je m’ausculte, je compte le moindre de mes battements, des fois qu’ils me paraissent ambigus. je me refais une retape médicale un peu dans tous les sens, une révision en quelque sorte. Mais surtout le matin, j’écris. C’est ma thérapie. Elle semble fonctionner. Comme Simenon, dont la sagesse n’est plus à vanter, je fais ma (mes) page (s) entre sept heures et dix heures. Quand j’ai fini, j’ai la nette impression que j’ai reculé un peu les échéances, que je domine la situation, qu’il peut bien arriver des empêchements ou de la tristesse dans la journée, elle n’aura pas été vaine.
…
Je lis des histoires à dormir la nuit de Rabindranath Tagore, venues de l’autre nuit sanskritique. De squelette, de mort et de désir. De fantômes.
Un texte de Pasolini, navigant à l’été 59 avec sa petite Fiat le long du littoral Ligure. Solitaire et rare, comme celui qui meurt sur une plage au pays des Vitelloni.
…………………………………………………………………………………………….
J’ai publié le Livre des Répons auquel je crois. C’est un livre qui a été conçu après la mort de ma mère, et en épilogue j’y ai écrit mes propres Leçons de Ténèbres, avec évidemment les lettres hébraïques qui pulsent la suite des paroles. J’en ai vendu combien ?… sans aucun suivi éditorial de la part de la maison l’Harmattan.
Qu’importe. Pessoa aura écrit une odyssée de la solitude, j’aurai écrit des Répons pour pas de lecteur.
Peut-être pour ma descendance, ce petit vif de petit fils qui ne cesse de m’étonner. On lui signifiait il y a quelque jours qu’il ne connaissait pas encore l’anglais, il répondit "Oui, Ice Tea". Imparables enfants. Il n’a pas quatre ans.
…………………………………………………………………………………………….
Le soir les oiseaux sur les arbres d’ici ont une tonalité bien plus grave et plus vive que le matin. Comme un cœur qui a battu éperdument tout le long du jour. Comme si demain il fallait faire mieux et aller bientôt dormir.
Une sorte d’oraison sur les branches du prêcheur prénocturne, fa dièze mi fa, Messiaen, le sommeil…
…………………………………………………………………………………………….
Tout le monde me donne des livres. Chez Sauveur, c’est Claude qui m’apporte fréquemment le complément de nos conversations. Même lorsque les sujets débattus paraissent légers ou n’exigeant pas qu’on s’y attarde, il arrive le lendemain vers midi avec un ouvrage sur les épices thaïlandaises, sur la folie des riches qui ruinent les pauvres, des livres de Hubert Reeves apprenant l’univers à ses petits enfants, un panorama sur les huiles essentielles, des monographies sur Picasso, des poèmes de Georges Fourest, et même le monumental dictionnaire des noms de rue de Paris.
En retour je lui paie souvent son verre de bière.
La plupart du temps je ne fais que les parcourir et quand ils commencent à trop envahir la maison, je les refile à la petite dame qui les revend à même le sol, à l’entrée gauche de la cathédrale Sainte Réparate.
….
On m’a proposé ce matin, en cadeau de la librairie Masséna, pour l’achat de deux volumes de la collection de voyages des éditions arléa, un choix entre un petit volume de nouvelles de Conrad et un ensemble de 155 haïkus écrits par autant de libraires dans tout le pays. J’ai choisi ces petits poèmes, même maladroits ou sans intérêt, pour m’en aller vers moi-même, retrouvant le souffle de tous ceux que j’avais écrit.
………………………………………………………………………………………………
29 Mars
C’est tellement le printemps que ce soir la colombe s’est hissée au-dessus même de l’angelot au dauphin, au sommet de la fontaine, sans plus aucune crainte. Les oiseaux savent toujours les jours les plus beaux.
………………………………………………………………………………………………
Une association de haute moralité fait momentanément suspendre « les Suppliantes » d’Eschyle, dans un cadre universitaire, pour des raisons racialistes . La France associative, pointilleuse et hystérique…
………………………………………………………………………………………………31 Mars
C’est bientôt l’avril. Plus je sais que dans le soir de la vie la finitude qui m’est promise est la seule certitude dans le cercle de mes croyances, plus je me voudrais immortel. Un désir d’immortalité qui n’est pas nouveau. Déjà, depuis longtemps cette maladie égyptienne, ces symptômes d’une durée qui n’en finirait pas, d’une bascule vers l’éternité, se fait intensément croissante.
La certitude de ma petitesse n’atténue pas la démesure d’une telle extravagance. Bien au contraire, elle en décuple l’irraison comme le pauvre, au jeu de hasard, espère plus que les autres, la plus folle des espérances.
Pas de petits gains mais le grand banco.
C’est ainsi la folie égyptienne. Ne plus vouloir la mort et savoir plus que d’autres l’éternité à venir. Le silence ensuite.
Je me fais sombre. Et pourtant, depuis le désoeuvrement qui est le mien, je ne peux pas nier l’extrême liberté de choix et d’orientations qui se lèvent chaque matin.
Parfois je me dis que je n’ai pas opté aujourd’hui pour les meilleures couleurs de la journée.
Ce qui fait, dans la largeur de mon absolue liberté, comme l’ombre d’un souci.
Je suis orphelin de mes espérances sur l’éternité, à proportion de celles-ci disparaissant à l’effeuillement du temps.
Donc immortel dans l’impossible.
Egyptien malade par défaut. Pas par excès d’égyptianité.
Je suis fantôme de toutes les présences successives de ma vie, de tous leurs épisodes, au travers de bibliothèques, de livres et de gigantesques panneaux de musiques enregistrées comme autant de repoussoirs contre la cessation scandaleuse de la vie d’aujourd’hui et cet impossible au- delà du rideau qui clôt l’acte final.
…
Scriabine aurait parlé d’un « Acte Préalable », le plus fou, à toute exécution d’un art total au-delà duquel…
……………………………………………………………………………………………
Ce que j’ai toujours aimé le plus dans le corps d’une femme, ce sont leurs avants-bras, l’axe absolu du poignet et de la main prolongé de ce long segment avant le bras, comme le col du cygne, avec en plus, l’animalité de leur pilosité discrète dans les mouvements qui précèdent ceux de la chair supposée.
………………………………………………………………………………………………
Ce dernier dimanche du mois nous allons avec Y au Parc Karol de Roumanie. C’est le dimanche des œufs de Pâques cachés dans les buissons. En fait, c’est hier que les cloches avaient déposé les œufs… Heureusement Cécilia avait prévu, devant l’affluence de ce grand événement, d’en déposer discrètement sous quelques plantes et des fleurs au pied d’un arbre. Y a pu ainsi cueillir deux petits œufs et un bien plus gros comme un petit miracle tout en lui précisant qu’il avait eu de la chance d’en dénicher encore car le ciel n’en avait plus en réserve.
Nous déjeunons à l’ombre du petit mini golf dans la plus grande quiétude de l’après-midi déjà avancé.
Le Musée d’Art Naïf me paraît plus beau, les arbres ont encore grandi, les larges cyprès bleus grossissent tant que l’allée centrale semble avoir rétrécie. Nous faisons quelques photos avec le petit et les quelques sculptures métalliques installées depuis quelques années au hasard des pelouses. Je lui fais ma petite conférence privée : la Fleur soleil, le coq géant sous verre, les magnifiques Rimbert, les Bauchant, tout me revient en mémoire comme le jaillissement d’un temps fécond au cœur de mon existence.
J’apprends que Madame Devroye-Stilz a pris sa retraite, s’est remariée et vivrait à Dijon. La porte menant aux ateliers et leurs petits miracles de poésie musicale est close. Celle de mon bureau du côté de la Conservation aussi.
………………………………………………………………………………………………
1 Avril
Tourettes-Levens. J’attends Gilbert à Saint André de la Roche. Cette banlieue de Nice a meilleure allure. Des aménagements ont été réalisés depuis longtemps. Je reste un peu au bistro près de la Poste. A cette heure c’est tranquille et agréable. Treize heures. La belle façade de l’école a toujours ses couleurs et des motifs baroques en trompe l’œil.
…
(courrier à Alain Jacquot)
L’après-midi passée à Tourettes n’a pas été de toute quiétude. Nous étions trop proche de Caty pour feindre une visite anodine.
Cela a plutôt ressemblé à un adieu anticipé. Elle n’est pas dupe de ces petites visites qui se sont faites ces temps-ci (Jean et Gilbert, puis Gilbert et moi etc.).
…
Ami
Nous sommes allés, Gilbert et moi, voir Caty ce lundi. Une grosse chaleur nous accompagnait, et le fameux chemin pierreux qui mène tout là haut ne s’est pas arrangé depuis le temps.
Je n’ai pas pris le risque de monter avec la voiture.
Caty est alitée depuis je ne sais combien de temps, mais le masque de l’épuisement se voit dès l’entrée. Elle verse des larmes fréquemment, sa lucidité lui rendant la situation d’autant plus cruelle.
Les phrases prononcées ne sont que des lambeaux. Ce sont les yeux qui expriment le plus les réponses à nos échanges.
Parler du vieux temps avec elle, c’est parler d’un monde qui avait encore des couleurs et qui ressemblait à la vie, un temps sans nuage.
Parler de l’avenir avec elle serait presque maladroit. L’après-midi a donc été une sorte d’exercice où notre présence se devait de jongler entre le passé à petite dose et le présent au travers des fenêtres
où sont les chiens les chats les moutons les chèvres les chevaux les clapiers et les bergeries les chiens qui viennent vous renifler toutes les deux minutes… Une sorte de petite arche de Noë (j’en suis reparti au bord de l’allergie).
Non, ce n’a pas été facile. La maman est là, heureusement, ce qui leur permet de garder ce lien qui ne se défera plus jusqu’à la fin. Je crois d’ailleurs qu’elle est à demeure depuis deux ans déjà.
Caty ne tient plus à revoir ses amis du théâtre qui ont cru bon de lui infliger durant plus d’une heure des scènettes de leur cru que cela en était presque indécent…
Des problèmes de mobilité aussi.
Plusieurs chaises roulantes dans la maison. Un lit médicalisé avec commande de positions. Son bras droit est devenu inefficace et presque paralysé. L’autre en prend le chemin.
Voilà, il était difficile de sourire sans une certaine crispation..
Ce qui atténue les horribles angoisses ce sont les dosages de cannabis que son mari a pu se procurer par la Belgique où la législation en matière médicale est moins horriblement tartuffe qu’ici.
Nous nous sommes quittés vers dix sept heures promettant de revenir bientôt, comme on le fait dans ces circonstances…
…
Je suis dans le "Livre de l’Intranquilité" de Pessoa. Un très grand livre. Il rejoint à sa façon Proust et la grande littérature du "monologue intérieur".
…
Je serai à Lisbonne dans pas longtemps, son fado et sa blancheur.
Amitiés.
On lui prend la main, on ne nomme à aucun moment le mal qui l’a frappée. Malgré tout, des souvenirs sont évoqués. Les spectacles que nous avions crées, les années d’activité consacrées à l’art et à la danse. Je lui donne les dernières nouvelles du Musée d’Art Naïf. Plusieurs fois les larmes reviennent sans un bruit, dans le silence des plus grandes détresses, comme si trop de lucidité faisait revenir incessamment ce bout de chemin qu’elle doit, de quelque manière, voir et traverser sans plus quitter son périmètre le plus intime, ses chaînes…
……………………………………………………………………………………………..
Jean Barraqué, amant de Michel Foucault… C’était le temps où l’on s’organisait, on se structurait…
On n’écoute plus sa sonate de cinquante minutes. De sérialisme plein. Mais d’une sensibilité solitaire comme les rochers qui prennent les vagues sans répit.
On l’aimera encore un jour. Pour moi, c’est fait.
……………………………………………………………………………………………..
3 Avril
On dit toujours vouloir laisser une meilleur planète à nos
enfants. On ne pense jamais à laisser de meilleurs enfants à la planète.
………………………………………………………………………………………………
8 Avril
CE QUE JE SAIS EN SONGE D’IMPROBABLE DES QUATUORS DE GORECKI
Je l’avais perdu de vu ou est-ce lui qui disparut sans tambour ni trompette dans les années de braise vers la fin quatre vingt. Ce premier quatuor à cordes, le Genesis, avait en lui le soufre et l’aridité de ceux qui ont la connaissance des limbes, en un seul mouvement, dans l’élan eschylien du feu dérobé aux dieux, dans la première fougue de la Kraanerg, l’ « énergie accomplie » de Xenakis, prométhéenne par le magma d’où aucun galbe, aucune emprise formelle ne se meut, mais une vie embryonnaire massive au plus brûlant d’elle-même signifiant à la fois la détermination de sa future existence et la colère divine du larcin primitif. La volcanique vérité des souffles aveugles par paroxysmes de déréliction, le chœur d’acier se mouvant en un tissu continu d’oripeaux d’énergie dérobée.
Le second essai s’est aussi éloigné du Penderecki de la Natura Sonoris que des nuées originelles xénakiennes.
Comme un second âge, celui d’un fleuve régulier, matriciel, l’homme au questionnement sophocléen, de celui qui rompt le cercle des connaissances vers la vérité et le sens, par l’épée et la ruse, héritière d’Ulysse, qui s’approprie les sécrétions des lois du cercle. C’est l’âge d’harmonie extirpé des chaos, accédant aux sphère de l’intelligence, loin des hasards et des probables, de même qu’il n’est aucune île qui n’ait un jour un navire l’accostant sur sa route, rompant le cercle vierge de celle-ci comme la rencontre des conquérants avec le nouveau monde, infléchissant les lois de l’île au cœur même de ses ténèbres.
Ce que Hegel a su comprendre dans le rêve d’embrasser la totalité des temps se déroulant dans l’histoire des humains, connaîtrait un troisième âge avec le dépassement de cette adéquation formelle de l’harmonie du second âge, par le déséquilibre du tragique d’Euripide, menant aux lois de la seule subjectivité consciente qui romprait à nouveau la fragile vérité qui s’en ira dérivant vers de plus en plus de relativité.
C’est donc l’âge inaugural du mythe, par la symbolique de l’architecture qui n’entrevoit qu’aveuglément la destination des forces primitives (le temple, la géométrie, pour seul signifiant de vérité sans visage).
L’âge du fragile équilibre ensuite, de la sculpture, de faire correspondre la volonté d’une pensée à la formalisation la plus directe de celles-ci.
Enfin l’âge du dépassement de ce fragile équilibre qui drainera les ombres et les lumières de la peintures et de la musique dans l’enfermement subjectif et solitaire de l’arbitraire artistique.
Eschyle, Sophocle, Euripide. Architecture, sculpture, peintures musicales.
On pourrait dire aussi en une fulgurante progression : dorique, ionique, corinthien.
Ages symboliques, classiques, romantiques.
Les quatuors à cordes de Gorecki caressent ici, comme en songe, les différents âges de l’humanité.
……………………………………………………………………………………………..
9 Avril
« Petit éloge de la fuite hors du monde », de Rémy Oudghiri, ou l’art de fuir pour mieux pénétrer notre monde. Il aurait pu faire une compilation très élargie de l’histoire même de la littérature. Il n’y a qu’à ouvrir les livres et les exemples pullulent. De Gauguin en Pétrarque, de Le Clézio en Flaubert, fuir la société de nos semblables, abandonner les fragiles équilibres de la vie bien réglée, c’est toute l’histoire de la littérature qui est ainsi fixée. On peut en dire autant des aventures de la peinture et du monde des arts d’une manière générale.
Le voyageur devant la mer de nuages de Caspar Friedrich en est une illustration parfaite.
………………………………………………………………………………………………
10 Avril
Tous les ans j’y pense : Paul Mac Cartney a annoncé voilà quarante neuf ans, à cette date, que les Beatles se séparaient. Les autres lui ont reproché de ne pas avoir attendu la fin de la promotion de leur triste dernier album.
J’entendais ces nouvelles à la radio, emmitouflé et nu dans une méchante couverture rouge sous le soleil non moins rouge d’une fin d’après-midi avec Danièle Belmonte.
…
Lettre à K
…
Je ne pouvais pas répondre plus longtemps au téléphone ce midi. J’arrivais chez moi, j’allais garer la voiture.
je n’étais pas au QG. Je n’y suis pas allé aujourd’hui.
C’est vrai que ton message d’hier m’a fait plaisir. Je ne suis pas en marbre…
Mais j’ai réfléchi. Est-ce bien raisonnable de nous revoir ?
Notre histoire est plutôt derrière nous.
Que peux-tu espérer ? Que puis-je espérer ? Nous avons eu quatre à cinq années en dents de scie. On se voyait de temps à autre.
Je t’ai eu dans le coeur et ça ne s’en va pas comme ça, c’est vrai…
Mais je crois que le temps a passé. La violence a fait beaucoup de mal. On se verra peut-être dans un autre lieu (mais pour quoi donc ?) Pour parler de nous une fois encore ? Si tu m’as aimé et continue de m’aimer encore comme tu le dis, il serait bien, par respect pour nos souvenirs, de ne pas aller plus loin se faire encore du mal.
Je te laisse le soin de réfléchir à tout ça. Je ne suis pas encore prêt à te rencontrer dans la sérénité.
je t’embrasse.
…………………………………………………………………………………………. En écrivant je prenais le risque de n’être ni Kafka ni Neruda, mes carnets s’exprimant à la largeur des rivages, dans les petitesses et les partitas de ma vie ouvertes aux mers et à celles qui furent dépositaires de mes existences, galets après galets. J’en reviens à ces premières métamorphoses du Parc Impérial, sans savoir qu’il fut le mouvement premier de ma vie de diamant.
…
67/69, ce sont les fontaines de Rome et les pins de la Via Appia aussi qui furent le lien de mon enfance à aujourd’hui, et l’échappée vers les soleils de mes dernières années de petit homme.
…
Maintenant c’est à peu près sûr, il y a cinquante ans, dans ces jours d’Avril (le 7, le 9 ?), que Stef gravissait les marches d’escalier (ou l’ascenseur) de ce 42, rue des Potiers où je vivais.
L’année 2019 sera marquée par cet écho cinquantenaire, durant tous ces mois qui vont maintenant s’égrener.
……………………………………………………………………………………………ANGELA ENCORE
C’est la fin d’un cycle qui n’en finit plus. Déjà je n’avais appris que bien tard la disparition d’Angela aux Feuillantines, qui fut aussi la maison de retraite de Maman et Lucia.
De l’héritage, rien n’est revenu aux membres de la famille puisqu’elle n’avait que la jouissance de l’appartement aux deux jardins de Saint Laurent du Var après la disparition de Louis Toulet. La propriété est donc revenue après sa mort, en Juin 2016, aux deux fils de son mari.
Un courrier nous a annoncé bien plus tard qu’elle avait souscrit une assurance vie dont je viens d’hériter de la part me revenant.
Et il est surprenant que, d’ordinaire, les glacials échanges de courriers de cabinets notariaux qui nous emplissent de cet ennui obligé fait de toute la saveur des poussières administratives, m’aient trouvé ce matin-là dans la douce fébrilité de quelqu’un qui vient d’ouvrir largement une fenêtre sur le ciel.
La somme est à peu près conforme à ce que j’attendais de ce compte vie d’une tante qui, tout en étant à l’abri largement, ne vivait pas sur un grand train.
La surprise vint plutôt de voir dans la liste des ayants droit, le nom de ceux qui, tout en étant inséparablement liés à l’histoire de la famille, devinrent au fil du temps comme de parfaits étrangers dont l ‘existence ne tenait qu’à ces seuls noms précisément et que l’accumulation de ceux-ci en une seule et même page me faisait penser à un improbable casting notarial.
Hormis mon cousin Georges Salemi, pour lequel des liens d’affection réels existent, qui garde avec nous une relation certaine à l’occasion des cérémonies de baptêmes (mais y en-t-il encore ?) et les décès de nos parents collatéraux, je vis défiler les noms de ses sœurs, mariées aujourd’hui, et de ceux et celles d’une branche oubliée et lointaine, plutôt d’une demie branche vivant sur l’ île de la Réunion ou à Madagascar, mais qui, par cet effet d’héritage, devenaient aussi fortement présents que si la tante Angela eut toujours été choyée par eux.
Cette part de compte/vie inattendue me servira à établir un protocole décès pour Cécilia et moi. La vie se chargeant de rétablir l’ordre des choses.
………………………………………………………………………………………………
11 Avril
PIERRES
C’est Roger Caillois et conjointement Pierre Henry qui m’ont mis sur la piste des pierres. Je suis d’essence égyptienne comme il a été prouvé, et l’amour des pierres ne sera jamais que l’extension de l’impossible sentiment d’éternité. L’éternité n’étant jamais suffisamment longue et durable, les pierres, dans leurs raretés d’espèce, figurent comme une sorte de promontoire sur l’éternité.
Etonnamment, ce n’est par des pierres existantes, mais plutôt par des pierres abstraites, que le goût pour ces morceaux d’éternité me fut révélé au travers de ces Pierres Réfléchies du compositeur. Probablement un de ses hauts chefs d’œuvre que même les initiés à sa musique omettent de citer parmi les plus intimes et les plus brillantes réalisations électroacoustiques. Se déclinant en jardins possibles, en diaspres et rêveries de roches perforées, d’adoratrice du soleil, de cristal noir, de gemmes et de pierres blessées.
Les premières références aux pierres se révèlent dans les divers passages bibliques, notamment au chapitre 29 de l’Exode, en ce qui concerne les pierres ornant le pectoral d’Aaron, ainsi qu’au chapitre 21 de l’Apocalypse pour l’évocation de la Jérusalem Céleste.
Le pectoral d’Aaron est un vêtement rituel, orné de douze gemmes, porté par le Grand Prêtre après que Moïse a reçu les Dix Commandements. Les assises de la Jérusalem céleste, cité idéale de Dieu, reposent sur douze rangées de quatre pierres précieuses.
Les œuvres grecques et latines sont une base de référence pour les traités minéralogiques qui paraîtront au Moyen Age. Les œuvres d’Aristote et de Pline l’Ancien feront une larges place à la mythologie avec son cortège de dieux et de déesses.
Selon les voyageurs de l’Antiquité et du Moyen Age, les diamants se trouvent dans « la vallée des diamants », située quelque part en Inde, protégée par des serpents dont le regard tue. Aristote affirma qu’Alexandre le Grand avait imaginé introduire un miroir dans la grotte aux pierres, et lorsque le regard des serpents croisait leur image dans le miroir, ils mouraient instantanément. Marco Polo reprend la légende dans un passage du Livre des Merveilles.
Le diamant est la troisième pierre de la deuxième rangée des pierres du pectoral d’Aaron. « Le diable déteste cette pierre parce qu’elle résiste à sa puissance » (Hidegarde von Bingen). La fameuse « chevalière », bague sertie d’un diamant portée par les chevaliers du Moyen Age assurait l’invincibilité. Le Régent, le diamant le plus pur de tous, fait partie des joyaux de la Couronne de France.
Lors de mon premier séjour en Colombie, je vis pour la première fois des émeraudes. Des émeraude enchâssées, mais aussi de grosses pierres à l’état brut. Sur la via Jimenez de Bogota, de longues files de revendeurs d’émeraude en tous genre et de couleurs allant de la plus claire, comme de l’eau de rivière, à la plus sombre sont proposées sous le manteau. Toutes étant frappées de la fameuse fêlure au cœur même de la pierre.
A l’époque romaine les émeraude venaient d’une mine de Pologne. Les gisements d’Amérique du Sud, et principalement de Colombie, ont commencé d’être exploités au XVIII° siècle.
L’émeraude est la troisième pierre nommée dans le pectoral d’Aaron et la quatrième dans l’Apocalypse.
L’émeraude appartient à la famille des béryls et Marbode de Rennes la décrit comme « d’un vert qui surpasse tout se qui verdit dans la nature ». Elle aurait des vertus ophtalmologiques. Néron se serait servi d’une lame taillée dans une émeraude pour lire afin de compenser sa myopie. Pierre propice à la méditation, elle est la parfaite pierre de la lucidité.
Le saphir, c’est le bleu de la robe de la Vierge Marie. A partir du XII° siècle, le bleu est la couleur des rois de France.
Edouard le Confesseur, roi d’Angleterre au XI° siècle, est accosté par un mendiant auquel il fait l’aumône de son saphir. Bien plus tard, des pèlerins revenant de Jérusalem, lui rapportent la bague. Elle leur a été remise par un mendiant qui n’était autre qu’un apôtre du Christ et qui leur dit attendre le roi au ciel dans les mois à venir. Le roi meurt six mois après.
Le saphir fait partie du pectoral et il est une des pierres des murailles de Jérusalem. Une autre légende dit que le talisman de Charlemagne fut donné en cadeau au calife Haroun-el-Rachid et qu’au XIX° siècle on retrouve le pendentif offert à l’Impératrice Joséphine lors d’un voyage qu’elle effectue avec Napoléon en Terre Sainte.
En sanskrit, le terme rubis signifie « la reine des pierre ». En latin ruber désigne la couleur rouge, le sang du Christ, si bien que les rois arborent la pierre sur leur couronne.
Marco Polo a évoqué des pierres de grandes qualités rencontrés de nombreuses fois du côté de la Birmanie, dans la vallée du Mogok.
On a longtemps confondu la spinelle, de la famille des oxydes, au rubis.
Le nom vient du terme « épine » en référence aux cristaux pointus. Les rubis de la Couronne d’Angleterre seraient des spinelles de moindre valeur que le rubis.
« Je te donnerai une bague enchantée. Quand tu en retournera le rubis tu seras invisible comme les princes dans les contes de fées ». Les Chants de Maldoror. Pierre aux vertus de l’invisibilité, pierre du cœur et des sentiments. Pierre de l’amour.
Le Lapis-lazuli est la pierre de l’Orient. On la trouve uniquement dans les hautes montagnes. Le principal gisement se trouve dans le nord de l’Afghanistan. La pierre a fait l’objet d’un intense réseau commercial entre l’Afghanistan, la vallée de l’Indus, la Mésopotamie et l’Egypte.
Le bleu de la voûte céleste ayant de tous temps fasciné, elle symbolise la puissance des dieux. Le lapis évoque la vision intérieure. Les auteurs de romans fantastiques parent les mains des vampires de bagues ornées de lapis, ce qui leur permet de ne pas être brûlé par le soleil.
Connu depuis sept mille ans en Mésopotamie, il est cité dans l’épopée de Gilgamesh. On a retrouvé de splendides objets taillés dans cette pierre dans la célèbre ville d’Ur, capitale de l’ancien empire sumérien du III° millénaire avant J.C.
En Egypte les masques funéraires sont incrustés de cette pierre.
Broyé en poudre, il sert de pigment bleu pour la peinture. C’est de lui que les peintres des fameux Livres d’Heures du Duc de Berry, celui des Belles Heure des frères de Limbourg et celles d’Etienne Chevalier enluminées par Jehan Fouquet, font émerger ces bleus sublimes que tous les puristes continuent d’utiliser.
« Je te ferai atteler un char de lapis-lazuli et d’or », Gilgamesh, 2650 ans av. J.C.
…………………………………………………………………………………………….
12 Avril
PESSOA
Le Livre de l’Intranquilité commence ainsi, sans surprise aucune, comme un livre de sagesse de Montaigne : « Je suis né en un temps où la majorité des jeunes gens avait perdu la foi en Dieu, pour la même raison que leurs ancêtres la possédaient sans savoir pourquoi ».
…
Mais que dit parallèlement le Gardien de Troupeau ? :
« Il dit (de Dieu) que c’est un vieillard stupide et malade,
toujours en train de cracher par terre
et de dire des grossièretés
la Vierge Marie passe les veillées de l’éternité à tricoter des bas
et le saint Esprit se gratte du bec
perché sur les fauteuils qu’il laisse empouacrés
tout au ciel est stupide comme l’église catholique
il me dit que Dieu n’entend goutte aux choses qu’il a créees
si tant est qu’il les a créees, ce dont je doute… etc »
…
Ce qu’il y a dans le forcé et chaotique du poétique de ce texte de Pessoa n’est pas sans rappeler le ton des Feuillets d’herbe de Walt Whitman, avec un je ne sais quoi d’emprunté et d’un moindre souffle épique , ou est-ce simplement du à quelque faiblesse de traduction, que le contenu vient étrangement à faire penser à l’Antonin Artaud des dévotions sans réserve à l’orient quelques pages plus loin, toujours dans ce Gardien :
« … tout le reste de mon être tend vers l’Orient
l’Orient d’où vient toute chose, et le jour et la foi.
L’Orient pompeux et fanatique et chaud.
L’Orient excessif et que jamais je ne verrai
L’Orient bouddhiste, brahmanique, shintoïste
L’Orient qui a tout ce que nous n’avons pas
L’Orient qui est tout ce que nous ne sommes pas
L’Orient où, qui sait, peut être le Christ vit encore
aujourd’hui
où Dieu peut-être existe en vérité et commande à toute chose… »
…
Litanies d’un parfait convaincu…
Peut-être que de vivre à l’extrême pointe de l’Occident on idéalise cet ailleurs de l’Orient…
…
Pourquoi donc tous ces mystères de foi et de création, de Dieu et du monde, seraient rendus possibles et souhaités sous les auspices de l’Orient, fussent-ils pompeux et fanatique, alors que sur les côtes et sous les fenêtres du Portugal, aux portes ouvertes sur une nouvelle Atlantide, Pessoa conclut par l’invective, le désespoir et le refus de l’Occident ?
Est-ce comme Artaud, (où manque seule ici l’invective papale), l’effet d’une chétivité de corps et une faiblesse héréditaire dont toute l’intranquilité ne serait qu’un long gémissement sur soi-même, ou un air du temps qui n’a pas manqué de frapper l’ensemble de l’Occident, ou plus métaphysiquement, serait-ce l’antique jérémiade du juif qu’il était ?
………………………………………………………………………………………….
13 Avril
BORDIGHERA
Plein soleil ce samedi. Il aurait été impardonnable de se contenter d’une tablée, fut-elle joyeuse, chez Sauveur. Un besoin, un appel printanier nous incite à changer quelques habitudes, et c’est du côté de San Remo, vers le Ponente, que nous nous échappons. La vue matinale depuis le promontoire autoroutier sur l’anse de Menton est un spectacle dont on ne se lasse jamais, la perspective à cet endroit fut-elle fugitive au passage au-dessus de la ville. Nous passons Coldirodi sans plus nous attarder aujourd’hui pour filer vers la longue descente sur San Remo grouillante et saturée par la circulation qu’on ne peut pas même trouver à garer.
L’église russe est encore dans l’ombre et accablée d’échafaudages comme un martyre de Saint Sébastien, percée de flèches, de poutres de bois et de métal sur tout son pourtour.
Bordighera est beaucoup moins encombrée, comme somnolente. Autant San Remo offrait une frénésie chaotique de fin de semaine, autant l’arrivée à Bordighera et la montée vers la ville historique se fit dans une sorte de dolente et douce paresse de fin de matinée. Les trottoirs, et c’est une des caractéristiques dans toute la ville, sont composés de briquettes rouges orangées, en damier alternant avec des briques noires ou mauves suffisamment colorées en tous cas, tout le long de la montée vers les jardins.
On croirait, durant cette escalade vers la vieille ville, que nous sommes à Rome, tant la densité, la multitude et la hauteurs des pins enveloppent la petite place qui prélude à l’entrée de ce qui fut une citadelle.
Mais la merveille, qui saisit au détour d’une ruelle pentue, est le gigantesque ficus des Indes, multiséculaire, qui impose son ombre sur une surface immense. Les racines en terre doivent s’étendre sur un espace non moins impressionnant, tant les ramifications des nombreuses divisions du tronc projettent de branches comme autant de boas imaginaires et tortueux dont la moindre de ces branches aurait la circonférence d’une cuisse d’animal fabuleux. Il y a comme une sensualité et un sentiment de force immobile dans le mouvement ondulant de leur déploiement dirigé tout autant en largeur que vers le ciel. Ce qui donne une impression d’assise et de gravitation extrêmement trapue.
L’entrée étroite sur une tranchée abrupte de la ville vieille se fait par une porte d’encadrement qui demeure comme un rare vestige de l’ancienne enceinte fortifiée. L’ombre alternant avec les trouées d’ensoleillement dans le dédale sinueux où se succèdent de petits bistros, et des restaurants de poche jusqu’au débouché sur une grande place d’où émerge le vieux clocher et une église au centre de la place. L’intérieur baroque, sous le patronage de San Ampelio, possède un orgue qui n’est pas sans rappeler ceux qu’on rencontre sur le chemin des orgues de Provence.
Des femmes tressent les rameaux pour demain dimanche.
Face à la mer, sur un promontoire, visible de très loin, la maison Charles Garnier, blanche et éblouissante avec sa haute tour où on distingue un escalier en colimaçon et ses multiples fenêtres donnant sur la mer.
Nous remontons, vers l’intérieur de la cité, par le chemin Monet, sinueux et pentu, au milieu des cactus, des glycines, des orangers aussi abondant ici que les citrons à Limone, et des premiers coquelicots aperçus entre les pierres des murs qui suivent le sentier.
Celui-ci semble grimper sans fin dans la plus folle poésie végétale, probablement jusqu’au sommet de la colline d’où le peintre avait une vue d’ensemble sur le panorama qui embrasse toute la ville au travers des arbres aux branches caractéristiques des peintures de Monet, tortueuses et comme électriques, avec la baie pour tout horizon. Nous ne poursuivons pas au-delà de la Villa Pompeo Mariani noyée dans la plus luxuriante forêt de cactus, de glycines, et de palmiers dans la paix la plus totale.
Nous déjeunons de ces fameux gamberoni que les ligures préfèrent aux langoustes, à l’ombre de la terrasse de la trattoria Garibaldi, un de ces délicieux restaurants dont la Ligurie a le secret des délicates décorations.
Bordighera a ce charme qui combine à la fois le luxe insolent d’une végétation dont on comprend que les artistes ont pu vouloir s’inspirer, une lumière intense, et des rues où les moindres maisons gardent cette particularité d’être dans l’harmonie des couleurs, la libre ouverture sur des terrasses ou des balcons tout en gardant une modestie d’architecture qui côtoient les riches demeures dont Garnier a pourvu en partie les quartiers modernes.
Dans un des jardins isolés, redescendant le chemin Monet, nous avons la chance de voir un gigantesque massif de glycine, enveloppant presque totalement une large villa dont un des murs de façade possède un très grand médaillon incrusté d’une Vierge à l’Enfant de della Robbia.
Nous prenons un dernier verre de frizzante sur une des terrasses du bord de mer, à l’ombre de grands cèdres.
………………………………………………………………………………………………
15 Avril
C’est comme à l’annonce d’une mort, le temps se fige. Notre Dame de Paris brûle. Déjà ce soir la charpente est détruite, la fameuse forêt du XII° siècle n’est plus qu’un brasier. Demain le constat sera terrible. L’orgue, les verrières des grandes rosaces nord et sud n’auront probablement pas résisté. Les lances d’eau ne cessent durant toute la nuit d’arroser les tours de la façade occidentale. Le monde entier est dans l’émotion, la nuit est interminable. Le plus haut symbole historique et charnel de Paris, s’en va en fumée.
………………………………………………………………………………………………………….. 18 Avril
Courrier à Monique Ariello :
…C’est vrai que la mobilisation du monde entier sur l’évènement de Notre-Dame paraît secondaire et est sans commune mesure avec le reflux de la foi entamée depuis longtemps , jusque dans la vocation des prêtres..
Ce qu’on a coutume de nommer la crise de la Foi.
Aussi je réfléchis à ce phénomène interne à notre monde catholique et je crois que les racines du mal se trouveraient quelque part du côté des conclusions de Vatican II.
Je vous remercie de m’avoir envoyé votre interview radio. C’est un bon complément à ce que je connais de votre travail. Merci aussi d’avoir porté de l’intérêt à mon Livre des Répons.
L’Italie, nous y allons plus souvent depuis que j’ai cessé de travailler et j’ai pu découvrir Venise l’an passé. Cette ville m’avait toujours fait peur, je ne sais pourquoi. La difficulté d’y loger, la densité des touristes etc..
Mais depuis que j’ai découvert la Scuola Grande di san Rocco avec ses 52 Tintoret, je rêve d’y retourner.
L’atelier de restauration travaille même sous les yeux des visiteurs !
Et puis la vue au soleil couchant depuis le Pont de l’Académie sur l’église de la Salute ne se raconte pas…
Je crois aussi que je vais faire un tour vers les écrits de Jean Climaque
…………………………………………………………………………………………….
Demain nous serons dans le sud. Plus au sud que chez nous. Nous prenons un vol de début de nuit. Vers onze heures trente nous serons à Lisbonne.
En attendant, pour être encore un peu dans la délectation des brumes germaniques, je plonge loin dans la glorieuse lyrique du temps de Strauss. La Salomé de Cebotari, l’Elektra de l’unique Rose Pauly…
…
Pauly, élève de la Marchesi, elle-même élève de Manuel Garcia.
…………………………………………………………………………………………………………..
Nuit du 18
LISBONNE
Maintenant c’est sûr, je suis au seuil de mes soixante sept ans. Il n’est pas concevable de perdre le temps qui reste. Le vol a du retard. Nous devions embarquer vers vingt et une heure. Le vol pour Lisbonne partira trois heures plus tard. Ce sera finalement un plein vol de nuit. C’est suffisant pour aiguiser la réflexion. Comme le pèlerin du seizième siècle qui écrivait sur les murs de Tolède « il n’y a pas de chemin, il faut cheminer », j’arrive à tisser des chemins pour le proche avenir. Pas trop loin dans le temps toutefois, l’avenir s’étant rétréci à pas de géant. Ce printemps s’inaugure par un premier jalon à destination de Lisbonne, avant Porto et Séville. Il n’y a pas de hasard, la capitale lusitanienne est tournée vers le large, vers l’ Atlantique, ses souffles effrayant au sortir du Tage, la nostalgie d’être éternellement tournée vers l’ailleurs des grands voyages, vers des terres qui furent longtemps inconnues. Et puis les collines, qui sont ici plus abruptes qu’ailleurs. Comme un défi.
Depuis l’avion qui caresse le ciel proche de la ville, les lumières féeriques partagent celle-ci en deux comme un gâteau d’anniversaire à l’endroit où le Tage coule dans sa nuit d’encre.
L’arrivée dans la ville se fait dans le feutré du taxi qui avale les interminables avenues fantomatiques des deux heures du matin de ce vendredi dix neuf Avril.
Depuis la fenêtre et le balconnet de la chambre d’hôtel, rua Vitoria, après une nuit très courte, on aperçoit plus haut sur un sommet de colline, la partie supérieure des ruines du Couvent des Carmes. Déjà, sur le large promontoire, un fourmillement de promeneur s’est levé tôt pour la vue panoramique et sans pareille depuis la haute plate-forme de l’Ascenseur (Elevator de Santa Justa).
La Place du Comercio est un peu décevante. Bien que très étendue et ouverte sur le Tage, large comme déjà jeté dans l’océan, ce cœur du sud de la ville ne paraît pas les dimensions qui le caractérise quand on en a une vue aérienne. Le ciel est d’un gris sale que la faible différence de tonalité entre le ciel, le fleuve, et les enfilades de rues tirées au cordeau à cet endroit, semble banaliser et uniformiser tout le paysage urbain.
C’est donc le fameux petit tram 28E que nous prenons et que nous laissons nous guider à l’aveugle pour plonger dans la Lisbonne de montagnes russes qui parcoure une première trouée vers le nord ouest de la ville, traversant les rues et les placettes peu arborées dans ces parages, menant vers le quartier d’Estrella, son église, ses commerces timides, et les quelques bistros ouverts. C’est jeudi, mais on se croirait un dimanche du temps où les commerces étaient résolument et interminablement fermés.
Ce séjour à Lisbonne sera évidemment marqué par le rythme de la fin de la semaine pascale, avec ses conséquences de vie ralentie et les contraintes imprévues imposées aux visiteurs.
Le petit 28 est aussi nerveux qu’un taurillon de race et nous brinqueballe en tous sens, ce qui n’est pas la meilleure manière de se laisser aller aux charmes des premières impressions d’une ville. D’autant que durant la demie-heure que durera le trajet, une cohorte d’italiens exubérants n’en finira pas de se répandre en exclamations.
Après la traversée assez lugubre de rues et de ruelles où le tram semble avoir juste ce qu’il faut de place pour passer, nous arrivons sur l’esplanade du terminal de la ligne, avec comme seule curiosité à offrir un sombre ensemble de sculptures en l’honneur et à la mémoire de don Bosco.
Repartis en sens inverse, le visage de la ville se prend à sourire plus, à mesure que le soleil apparaît timidement, là où commencent les premières maisons aux façades de faïences, souvent bleues sur blancs, parfois partiellement décorées, parfois présentant tout une façade d’azulejos.
Les parcs, les arbres, ont maintenant plus d’épaisseur durant cette chevauchée qui traverse des quartiers dont les noms nous échappent encore.
C’est toute une colline, celle qui voit surgir Alfama la tortueuse, le plus ancien quartier de la ville, la Cathédrale , la Sé, austère et romane, contournée à son flanc gauche par le goulet montant ou descendant, puis au point culminant le barrio En Graça, avant de redescendre vers l’autre terminal du 28, après des avenues redevenues austères et à nouveau assaillies par le gris du ciel. Lisbonne est maintenant affairée, réveillée, sortie de ses ébouriffements matinaux.
Notre première halte se fait au sommet, à En Graça. La lumière est maintenant progressivement rayonnante, Lisbonne ayant quitté sa timidité matinale pour un florilège de couleurs réfléchissantes aux maisons. Et sur les petites places l’ouverture sur les étroites descentes sillonnées par les rails du tram. Au loin, au large, par certaines béances dans la perspective des toboggans, la mer et ses horizons.
Je pensais, avant de partir, que le Lisbonne de Pessoa pouvait être un guide essentiel à la traversée de quatre jours pleins. Ce qui aurait pu être un guide idéal. Une sorte de révélation d’une ville parcourue par son meilleur ambassadeur comme son meilleur promeneur solitaire. D’un solitaire de l’intérieur déployant pour nous la meilleure poésie de la ville. Sauf que la lecture d’un tel projet nécessite un plan avec soi afin de lire parallèlement l’énoncé du guide et sa projection graphique sur le plan. Ce qui est assez rapidement inconfortable.
Sinon il ne s’agit que d’un déploiement de phonèmes en forme de noms propres, d’axes géographiques et giratoires, d’intersections et d’avenues abstraites débouchant sur de non moins abstraites et mystérieuses ruelles à l’angle de statue ou de monuments qui nous attendent comme un aveugle qui entendrait défiler devant lui le nom des lieux qu’il désirerait voir.
C’est donc dans l’improvisation au gré de l’instinct du voyageur que nous poursuivons de descendre ce que nous avions gravi en repérage avec le 28.
C’est l’antique Lisbonne de la nostalgie. Cela est inscrit sur le devant des petites boutiques, dans la douce désuétude des entrées de cafés et l’étroitesse des trottoirs, dans la vertigineuse pente que les premiers habitants ont du gravir pour se hisser vers ces horizons d’où viendraient les vents du large et les chansons des femmes qui pleurent l’antique tragédie du monde.
De minuscules restaurants affichent des plats de morue et de tout ce que la mer peut offrir. On annonce souvent, en gros caractères, que la nuit venue ces tragédies de fado seront largement répétées pour ne jamais oublier que le lisboète est nostalgique comme d’autres sont volontaires ou silencieux.
A En Graça de nombreux axes signifient que les tortueux dédales de rues se démultiplient comme autant de bras d’avec la trouée principale. A hauteur de l’église du même nom, c’est un plateau qui casse en deux la pente et offre un belvédère sur l’ensemble de la ville, avec ses toits oranges, ses clochers baroques dans les lointains, des blancheurs infinies de maisons et à l’horizon, le port, la mer.
C’est le temps de la contemplation sous les pins qu’on croirait romains, les tables à touristes, les petits squares et les pavés des ruelles alentours formant colimaçon entre deux niveaux de la colline.
C’est la Calcada da Graça, comme son nom l’indique, l’église baroque de l’Enfant Dieu sur le Beco dos Frois. Plus bas encore, l’autre extraordinaire vue sur tout le sud et l’est de la ville, le panorama de Santa Luzia. La particularité de ce promontoire donnant sur l’échappée du bas de la ville est qu’il est constitué en forme d’arc de cercle sur lequel s’étire des murets de faïence surmontés de piliers circulaires qui rythment la promenade, à la manière des temples grecs, enguirlandés de bougainvilliers et de végétaux dont cet écrin de pierres et d’enlacement résument l’âme même de Lisbonne. Le cœur de la ville semble ici s’être donné rendez-vous.
Puis c’est le Teatro romano, à l’angle de la Rua do Saudade, la bien nommée, la tristesse de la pluie froide. Nous trouvons refuge dans le musée d’antiquités romaines que nous parcourons distraitement, bien à l’abri dans un petit pavillon circulaire, dit pavillon des fresques, le temps que le ciel se dégage.
Dans le sillage des rails, c’est maintenant, plus bas encore, la place de la cathédrale sous ses arbres maigres et ses petits pavés. Sous le gris électrique de l’humidité récente, la matité de la pierre tire sur le jaune délavé et l’ocre. Nous goûtons les premier beignets de morue avant de rejoindre l’intérieur de la Sé qui est saturée de pèlerins dont on ne sait si ce sont les cérémonies du Vendredi saint qui les a réunis ou si c’est la nécessité de s’abriter du ciel encore menaçant que le parvis comme l’intérieur sont maintenant investis. Nous n’échappons pas à cette double circonstance de nous abriter et de nous recueillir parmi les multiples fidèles de ce jour. quinze heures, heure de la Passion.
Depuis l’arrivée, j’ai toujours l’impression que la terre tremble sous mes pieds, comme jadis à l’aéroport de Bogota, après plus de dix heures de vol, je sentais le sol se dérober sous l’effet de la grande fatigue.
Deux grands orgues se font face à la croisée du transept depuis deux cents ans. Issus d’une facture due au néerlandais Fentrop, réalisés dans la tradition hispanique, avec une batterie d’anches en chamade.
Il reste aujourd’hui celui que nous entendons, côté évangile, l’autre, côté épître, est resté muet.
L’orgue se fait donc entendre doucement, ponctuant le déroulement de la cérémonie. Celle-ci est d’une grande sobriété, une lente procession dans la travée centrale, des ecclésiastiques qui s’humilient de tout leur long, les chœurs faisant alterner des psalmodies légèrement dissonantes (en rappel de la gravité du jour) avec des parties plus réconfortantes et comme totalement dépouillées.
Je ne comprend pas un mot de portugais. Il me semble que les chuintantes des paroles sur le parvis aient investi le lieu autant qu’un ballet de parapluie, de kway ruisselants et de cliquetis de tram qui continuent leur ascension tout là-haut.
Descendant toujours l’Alfama, sur le peu d’espace que laisse le trottoir, un arbre prend toute la place, le Bel Sombra au tronc surdimensionné, hideux d’une certaine manière, dont certains bulbes composant la base sont aussi gros que des ballons de football.
C’est la valse des restaurants, des petits commerces de bimbeloteries et de souvenirs. Lisbonne regorge de ces petits riens (ici de qualité très attractive) comme les carreaux de faïence, les magnets et les fameuses reproductions, allant des plus modestes jouets à l’objet de collection, de son tram 28.
Le pavé est encore luisant, nous revoici sur les avenues rectilignes, quasi romaine dans leur architecture, Augusta, de Aurea, de Prata, pour ne pas nous égarer, respectivement, l’Auguste, l’aurifère et l’Argentée, piétonnes et assaillies de tourisme facile. Toutes convergeant vers la Place do Comercio, rendue au plein grand soleil.
L’esprit d’une ville n’est jamais le même selon qu’il est perçu sous le soleil ou dans la grisaille de la première impression. Lisbonne n’a pas dérogé à cette règle. Valparaiso m’avait semblé laide et dépenaillée comme Neruda disait d’elle lorsque nous y sommes entrés sous la grisaille. Lisbonne est soudain devenue, après que le soleil fut apparu, une ville que je commençais à sentir par tous ses pores, ses fleurs et ses pierres, ses calvaires montant et ses places dégagées, ses sinuosités intimes et ses emphases urbaines, ses gloires de pierres et ses parfums au détour des ruelles.
Depuis la Rua Vitoria où nous sommes logés, Alfama l’ancienne est à quelques centaines de mètres. Pour y parvenir nous avons appris à traverser le tunnel d’où partent les métros bleus et verts, et à poursuivre en pente raide les escaliers mécaniques qui vous hissent quelque cent mètres plus haut au sommet de Chiado.
Dès la sortie de la bouche de métro, le soleil de la Place vous happe. Les gros nuages ne sont là qu’en suspension, battus par des nappes de vent qui découvrent le ciel.
Fernando Pessoa est assis à sa table de bronze et semble nous attendre depuis toujours, la main posé sur un verre, le regard vers le lointain. A deux pas de là, en perspective, dans une posture à la Voltaire, aux gestes de conteurs et au sourire malicieux, en un bronze vert de gris, courbé et sarcastique, « Antonio Ribeiro Chiado, poète moine portugais du XVI° siècle, qui a jeté son froc aux orties pour devenir une espèce de vivante incarnation de la verve et de la joie de vivre de l’époque et finir dans la peau du poète le plus aimé du peuple ». Fernando Pessoa.
Le hasard a-t-il voulu que ces deux grands noms de la vie de Lisbonne se retrouvent figés pour toujours à quelques pas l’un de l’autre ? Mais déjà des badauds et des touristes veulent aussi s’asseoir à la table de l’homme intranquille. L’intérieur du bistro « O Brasileira » est un peu comme les deux Magots ou le Flore, une sorte de mythe inapprochable.
Plus haut, au Largo Bordalo Pinheiro, une façade en trompe l’œil, avec les quatre éléments « l’eau, la terre , le commerce et l’industrie » … et le Largo do Carmo, place arborée avec ses petits pavés, d’une poésie toute montmartroise, les ruines de son couvent déjà fermées, et à deux pas, du moins ce qui semble en perspective lisbonnaise une proximité de plusieurs centaines de mètres, la plate forme où les hommes sans vertiges de l’Elevator contemplent la ville. Le soleil est au couchant lorsque nous abordons le tout rose Teatro de la Trinidade.
Les ombres du fado sur l’Alfama se dessinent déjà. La morue s’invite à toute les tables et sous toutes les déclinaisons. C’est sous le portrait d’Amalia Rodrigues et la voix d’une chanteuse peu convaincante que la nuit commence, depuis le balcon de Santa Luzia où s’allonge Lisbonne.
Samedi 20 Avril
Le gris plombe le ciel au petit matin, ce qui ne semble pourtant pas démentir l’idée d’une journée ensoleillée.
…
Trois cent morts dans diverses explosions criminelles dans des sites chrétiens au Sri Lanka en cette veille de Pâques…
…
C’est tout au Nord, après plusieurs rames du métro bleu et au delà du Parc zoologique que le bus nous mène en un endroit isolé de maisons basses et de jardins à l’entré du Palacio Marquès de la Fronteira. Lieu intemporel, encore déserté par les visiteurs.
Dès l’entrée c’est la symphonie des bleus de faïences et du bleu à la Klein sur les murs des jardins harmonisés par les mousses et les coulures noircies de l’eau des fontaines.
Ce qui était un pavillon de chasse au XVII° siècle est aujourd’hui Palais isolé, fortement influencé par la Renaissance italienne, habité par le Marquis, douzième du nom, de la Fronteira.
Ce matin nous sommes seuls jusqu’à une heure bien avancée de la matinée. Un bassin au cygnes noirs, peu farouches, encadré de statues de personnages mythologiques donne bien la note renaissante à l’ensemble du jardin.
Les azulejos du palais illustrent la transition de la polychromie présente sur les murs et autour de la fontaine de fraîcheurs à la monochromie dans le jardin classique. La partie la plus impressionnante et la plus illustrée est celle du Bassin des Chevaliers et la Terrasses des Rois où les faïences relatent les faits historiques de la famille qui se reflètent magnifiquement dans le bassin quand le soleil perce les nuages.
La meilleure vue sur le jardin classique est en haut de l’escalier baroque.
Le jardin de Vénus est plus poétique et plus secret encore, dans une végétation plus luxuriante et bien plus débridée. Les grenades rouges répondent au rouge cinabre de la bâtisse. Les feuilles de bananiers masquent les faïences du côté privé de la résidence, et les murs bleus, de ce bleu Klein si vif, donnent une impression caraïbe à ce jardin échevelé.
La façade de la chapelle du jardin de Vénus est incrustée de graviers et de coquillages, de morceaux de verre, de nacre et de porcelaine chinoise brisée. On dit que le marquis s’est servi d’assiettes volontairement brisées pour ne pas avoir à les utiliser à nouveau…
Le pavillon de chasse est devenu la résidence principale des marquis successifs après le tremblement de terre de 1755. Mais au cours des siècles, le domaine s’est retrouvé petit à petit dans la ville. Le stade de Benfica apparaît au loin…
Et c’est justement Benfica que nous traversons en bus avant de rejoindre une correspondance, le 259, qui se fait attendre interminablement. Dans ce quartier c’est tout le Portugal populaire et inchangé depuis des décennies qui défile au travers de ses commerces désuets, peu éclairés, aux charmes simples et pauvres qu’on a pu connaître dans l’enfance.
Nous traversons le Parc de Monsanto, gigantesque, que nous ne faisons que longer vers le sud de la ville, jusqu’à ce quartier de maisons basses, coloré et vivant en bordure du Tage aux alentour du Monastère de Hieronimus.
Ici, tout a la blancheur réfléchie par l’immense portail sculpté du monastère et par la chaleur de midi.
C’est sur l’emplacement d’un ermitage dédié à la Vierge de Bethléem (Bélèm), fondé par Henri le Navigateur, que le roi Manuel I entreprend en 1502, en remerciement du retour de Vasco de Gama, de bâtir ce magnifique monastère destiné aux religieux de l’ordre des hiéronymites.
Le musée des antiquités, en prélude à la visite, sur une aile à l’entrée de l’édifice, présente un ensemble d’antiquités romaines, de mosaïques, de stèles, de têtes et de bustes, et surtout un ensemble égyptien de sarcophages d’époque Ptolémaïque. Ce qui fait qu’en quelques semaines nous nous retrouvons dans l’obscurité des musées, sans compter l’exposition parisienne que nous n’irons voir, où l’Egypte est à l’honneur.
L’intérieur de la nef surprend par le raffinement et la virtuosité de la voûte. La décoration des piliers, de la voûte et de tous les murs en fait, par la méticulosité et l’extrême ciselure en dentelle de la pierre, le pur chef d’œuvre de style manuelin. A l’entrée de l’église on peut voir le tombeau de Vasco de Gama.
Le cloître possède une richesse sculpturale impressionnante et s’étage sur deux niveaux. Depuis 1985, sur un mur du second niveau, se trouve maintenant le tombeau de Fernando Pessoa.
Ce qu’on ressent en premier, traversant les allées, c’est l’impression d’espace, de blancheur que la pierre réfléchit au soleil, et l’extraordinaire harmonie de proportion malgré la grandeur de l’ensemble. De magnifiques sculptures de Saint Jean, de Saint Pierre, et d’autres apôtres que je n’ai pas identifiés, se trouvent aux angles de chacun des cinquante cinq mètres de côté.
Le quartier proche du Tage et tout autour du Monastère, qui fait effet de gravitation, l’animation est extrême qu’on croirait être dans un centre ville. En fait Lisbonne présente autant de visages que chacun d’eux présente de caractères différents. Celui de Bélèm est, à cette heure, saturé de touriste et de visiteurs aux terrasses des cafés qui cherche l’ombre et la fraîcheur des intérieurs. Il est malgré tout étonnant de voir des foules disposées sur plus de cinquante mètres faisant la queue pour ces fameux petits Pasteis de nata lisboètes, qui sont une pâtisserie de crème anglaise sur un tapis rond de pâte feuilletée.
C’est à quelques minutes du monastère que l’on aperçoit le Musée des Carrosses.
D’un grande sobriété d’architecture, qui contraste avec la luxuriance des voitures d’apparat qui se présentent sur deux immenses salles au premier étage. Il n’existe à mon sens aucun autre musée de ce type dans le monde.
Je pense même que si un souvenir de Lisbonne se présente à ma mémoire ce sont encore de vagues images de ces véhicules chimériques qui se seraient imprimées dans la conscience de l’enfant de quatre ans que j’étais.
Le plus ancien carrosse étant celui de Philippe II d’Espagne, et donc datant du XVI° siècle. L’ensemble de la collection allant de ce XVI° au début du XX° siècle avec les premiers attelages de voitures de pompiers.
Je me suis contenté de noter les noms de presque tous ces véhicules qui paraissent aujourd’hui d’une civilisation antidéluvienne. Et pourtant, c’était presque hier…
Carrosse de Francesca de Savoie, carrosse de Philippe II, Landau de Philippe II, Berline de la Couronne, Litières du XIX° siècle, voitures de promenade, chaises de poste, berline de la reine Maria I, berline de parade, carrosse du cardinal Joao da Motta, carrosse de Mariana Victoria Silva, berline de la maison royale d’Espagne, berline de la maison royale du Portugal, carrosses de don José du Portugal, des Infantes du Portugal, des enfants de Palhava, carrosse de triomphe (le plus excentrique, s’il se peut), carrosse de la couronne, carrosse du Pape Clément XI, carrosse du roi Joao V, carrosse de Marie Anne d’Autriche, carrosse des Patriarches de France offert au Patriarcat de Lisbonne, carrosse de Marie France de Savoie….
Certains châssis étaient si étranges qu’ils semblaient avoir été taillé dans le bois en ciselures rococos à l’extrême, rivalisant entre elles dans ces temps où le décoratif s’exerçait aussi à l’extrême, bien loin de nos critères de lignes épurées et fonctionnelles. Les dorures et les peintures ajoutaient à en faire de réelles œuvres d’art.
Il est déjà quinze heures.
Nous trouvons un restaurant qui, malgré l’avancée de l’après-midi semble ne pas désemplir. Et je n’hésite pas à choisir le plat de poulpe entier !
Le soleil commençant de décliner, l’heure devient propice pour les clairs obscurs des ruines du Couvent des Carmes. Le taxi nous dépose sur la si jolie Largo do Carmo déjà dans l’ombre des arbres.
Comme à Jumièges qui lui ressemble, dans le cas de ces ruines, nous sommes dans l’axe est-ouest, avec les murs de chaque côté. Le ciel est à découvert, bien bleu, sans nuage. La nef est à nu, comme les deux collatéraux. On a presque la tentation de rester là, les yeux dans le ciel, après toutes ces fatigues du corps accumulées. Malgré tout, l’herbe n’est pas comme dans les ruines rurales, ici ce sont des plaques de gazon artificiel où se vautrent les touristes…
Il y a même un miroir qui fait face au chevet pour faciliter les selfies…
Dans la partie musée, dès l’entrée, un pèlerin médiéval en buste, un gisant remarquable qu’on pourrait croire de la même facture que le Jérémie dansant de Souillac, puis dans un désordre organisé, des antiquités Chibcha, des mexicains aux plumages de cérémonie, des stèles hindous, des sarcophages égyptiens
Encore Alfama qui nous prend dans la tombée de la nuit. A l’ouest cette fois. De belles rues qui montent, une placette rose en demi-cercle, que je prendrai plus tard en photos, avec un peintre accroupi de dos, qui lui même peint la place rose, comme un jeu de poupée russe…
Et puis le plus émouvant, ce fut cette petite église qu’on a cru dans l’abandon de Pâques, où j’ai pensé un instant voir une assemblée d’alcooliques associés, tant les quelques fidèles répartis de part et d’autre du demi cercle paraissaient pauvres et humbles, et gauches dans leurs mouvements, comme on pourrait imaginer les premiers fidèles dans les catacombes. Je m’aperçus que c’était l’église orthodoxe qui célébrait dans l’ombre et l’extrême timidité, quand j’eus aperçu enfin les icônes au-dessus du minuscule autel.
Les rues d’Alfama sont de la plus belle poésie nocturne. Comme des Rembrandt en plein air, avec l’écho assourdi des trams qui montent et des petites places qui s’animent. La vue sur le port depuis Santa Luzia, avec les premiers navires de croisières qui arrivent pour Pâques, porte le regard jusque tout là-haut, l’église San Vicente de Fora, paraissant bleue dans son habit de nuit. Comme des fantômes, nous goûtons cette si silencieuse quiétude des rues pavées et jaunes. Il n’y a presque plus personne dans les ruelles. Croiser un couple de passants semblent sonner comme un tintement de cristal tant la nuit devient limpide et fragile.
A une fenêtre de rez-de-chaussée , comme si la nécessité devait le mettre sur notre chemin, quelqu’un nous indiqua le « Conquistadores » pour y dîner, sur une petite esplanade, de la meilleure morue et de la bouteille de vino verde qu’on servit pour nous sur une table d’intimité, à l’écart des autres, en manière de salon improvisé, le dos au mur écaillé et les yeux dans les étoiles.
Dimanche 21 Avril
Peu de monde dans les rues. C’est Pâques. Par la ligne bleue du métro nous descendons à la Praça de Espanha qui est plutôt un grand carrefour, un tentaculaire point de croisement des directions. C’est là qu’on aperçoit le Musée Gulbenkian, une architecture qui ressemblerait à une Fac quelconque. Les jardins sont ouverts mais le musée fermé.
Les avions passent très bas au-dessus de la ville.
Nous reviendrons demain. En sens inverse, nous descendons à Place Marques de Pombal.
La Place est tout le symbole de la Lisbonne républicaine. Elle est située entre l’Avenida de la Liberdade et le parc Eduardo VII. La statue a été érigé en 1934. C’est l’hommage à un homme d’état qui conduisit le pays vers les Lumières, ayant gouverné entre 1750 et 1777. La statue en haut de la colonne, la main levé posée sur le lion, symbole de pouvoir, les yeux tournés vers Baixa, le centre ville que Pombal fit reconstruire après le tremblement de terre.
C’est une sorte de Champs-Elysées au cœur même de la ville. Sur la droite de l’avenue aux jardins labyrinthes taillés à la française, une très longue promenade rectiligne, séparée par une allée d’arbres qui donne l’ombre, mène au monument célébrant la Révolution des oeuillets.
Au milieu, le drapeau du Portugal, le plus grand d’Europe. Plus encore sur la droite, une église austère et rose avec des azulejos géants représentant des batailles et des scènes d’amour. Dans un coin du parc, une magnifique maternité de Botero de 1999. De là, la perspective vers le centre ville et la vue embrassant tous les jardins est impressionnante.
Par le métro encore, le port. En attendant le 259 qui mène au musée des azulejos. Un petit bar en terrasse pour un mauvais verre de rouge, avec face à nous trois grands bateaux de croisières. Les beignets de morue y sont excellents. Nous sympathisons avec une petite dame alerte qui vient de faire le trajet à pieds depuis Fatima. Elle est de la Réunion. Et nous accompagne dans notre déconvenue de constater ce second musée fermé, lui aussi. Par contre, le quartier au nord du musée est un havre de tranquillité, de construction basses, de villas fleuries, de chemins arborés, avec à certains endroits des échappées sur la mer.
De retour sur le port, cette fois nous affrontons Alfama depuis le petit bistro. La pente est horriblement dure, mais nous découvrons par une autre face ce vieux quartier coloré où les maisons jaunes vanilles côtoient des maisons bleus ciel puis d’autres rouges carmin, le linge pendant aux fenêtres, et ainsi, à bout de souffle jusqu’à l’église San Vicente de Fora qui domine la colline et qui était perçue la nuit d’avant depuis Santa Luzia toute éclairée dans des tonalité bleues au sommet du plus vieil endroit de la ville.
La plus belle maison de faïences est certainement sur une de ces petites places comme il y en a tant dans Lisbonne, où les carreaux alternés de bleus et de jaune se voient au travers de poivriers et d’arbres grêles donnant une fragilité et une poésie ineffable à cet environnement paisible.
Des escaliers descendant comme une tranchée vers le bas de la colline laissent apercevoir les lointains jusqu’à la mer, les toits rouges, les maisons blanches.
Nous nous séparons de la petite dame qui poursuit vers le Castel de Sao Jorge, et nous vers Bélèm.
Une rue montante, pavée toujours, et des graffitis criards mais s’harmonisant aux aspérités des arbres crochus. Une tranchée marginale qui m’a fait penser à ce quartier alternatif de Lljubiana.
La tour de Bélèm fut construite aux environs de 1515 par le roi Manuel I. Elle évoque l’Afrique en plein Lisbonne et servait à abriter les capitaines du port tout en voyant passer les caravelles en partance pour la Guinée.
A quelques centaines de mètres du Monastère des Hiéronimus, la tour a les pieds dans l’eau et de petites vagues viennent lécher la jetée. C’est la presque rencontre du Tage et de l’Atlantique. La lumière, au soleil déclinant, donne des tonalités de sable à la pierre qui est comme rongée par le sel. Le vent froid souffle aujourd’hui, et se pose en rafale comme un baume sur la peau.
Après un verre de rouge sur un minuscule terrasse face à la tour, le taxi nous laisse sur En Graça, en haut d’Alfama, où nous avons posé les pieds pour la première fois vendredi.
Descendant la rue étroite du tram 28, un miraculeux bistro ouvert sur l’étroite portion de trottoir où sont réunis des amateurs de fado. C’est chez Jaime, O Jaime, ou Tasca do Jaime. On entend à l’intérieur la voix forte et venue du fond des âges, cachée dans l’ombre, d’une femme qui chante Lisbonne, le vent et le temps des amours. Je n’en sais rien en fait, mais je suppose. Il n’y a que sept ou huit tables, les afficionados s’entassent tout le long du zinc ne laissant plus aucune possibilité d’atteindre le comptoir, des faïences tapissent tout le fond, deux luths et une guitare. On croirait être chez Sauveur (qui cultiverait plus frontalement l’amour du chant…). C’est le cœur même du fado. Tous ici le respire. Sur la table où nous arrivons à nous asseoir, des affiches, des coupures de journaux des années quarante. Des noms, probablement des mythes. Hermina Silva, Natalia dos Anjos, Guilhermo Janeiro, Noemia Cristina… C’est déjà la fermeture. Aujourd’hui on ferme tôt.
A mesure que la nuit arrive, nous descendons le plus lentement possible, sur les étroits trottoirs, suivant la ligne du 28, passant insensiblement de En Graça à Alfama.
Lisbonne est la ville des Largo. Le Largo c’est la Place. Il y en a finalement plus que dans les nombreuses villes dont on vante leur qualité et leur célébrité. Discrètes comme à l’invite d’un rendez-vous, larges et opulentes comme celle du Comercio, presque parisienne comme celle de Chiado au débouché du métro, ou montmartroise comme celle do Carmo.
La nuit venue, les éclairages rendant leur lumière jaune sur les terrasses des place de l’Alfama, nous nous installons sur l’une de ces terrasses d’un petit resto en équilibre entre deux numéros de rue en pente, jusqu’au moment où une intempestive sri lankaise (?) nous proposa une bouteille de vin pour patienter et ne revint plus.
Nous dînons finalement sur le trajet du 28, dans ce minuscule endroit que nous avions aperçu dès le premier soir et qui semblait un cabaret immense. La raison qui le laissait croire est qu’il n’y a que neuf tables dans la pénombre des éclairages de chandelles, mais que tout le mur du fond est tapissé de miroirs, ce qui décuple l’impression d’espace, laissant l’illusion d’un très grande profondeur. La morue y est encore excellente et la chanteuse de fado Maria Estrelle Soares, vient nous parler à l’entracte de son tour de chant avec des accents de tragédiennes, bien plus convaincante que celle du premier soir. La nuit de Pâques est redevenue calme et silencieuse sur le chemin du retour.
Lundi 22 Avril
Le parc du musée Gulbenkian est vaste et abrite des pièces d’eaux où s’ébattent des canards, des tortues et quelques cygnes. C’est un havre pour les rêveurs et pour ceux qui attendent l’ouverture du musée. On peut y flâner sous l’ombre d’une végétation luxuriante, de forêt de bambou, d’arbres anciens, de bancs de pierre et même d’un théâtre véritable aux fauteuils en pierre, ce qui laisse supposer que des spectacles sont donnés en saisons et que la scène est permanente. Dans le fond du parc, au lieu où s’expose la partie contemporaine des œuvres du donateur, une très belle sculpture en bronze de la Tristesse de Hein Semke.
L’intérieur de la partie principale du musée est exceptionnel, tant par la qualité que par la quantité et la variété des œuvres proposées. De toutes les cultures et de tous les horizons. De l’Egypte aux tapis persans, des faïences ottomanes aux incrustes calligraphiées des vases, des manteaux perses aux niches de céramiques du treizième siècle, les laques japonaises, les jarres et les paravents chinois, les boîtes Edo, les Inro qui servent à transporter les objets essentiels comme les pièces de monnaie ou les bijoux de femme, jusqu’aux boîtes à pique-nique japonaises du XVIII° siècle.
Le mobilier ancien, principalement français, un impressionnant buste de Louis XIV de Jean Warin, une bibliothèque du XVI° siècle, du mobilier du XVIII°de Meissonier, de Desforges, une horloge de Bernard Burgh, une commode de Cressent notamment, des œuvres de Martin Carlin, Jean-Joseph de Saint Germain, des fauteuils, un paravent de la Savonnerie, des horloges de Desparges et d’Antoine Foullet et tant d’autres.
Dans les salle de peintures, surgissent dès l’entrée un Carpaccio, la Sainte famille, deux Rembrandt dans les ténèbres, un Nicolas Lancret, les Fêtes Galantes, beau comme un Watteau, des scènes de ruines romaines de Hubert Robert, un Fragonard, et puis aux rayons des livres rares, Une Antiquité expliquée et représentée en figurines de Bernard de Montfaucon, suit une salle aux Turner et Gainsborough qui côtoient un très beau Troyon, les Pêcheurs, Daubigny et Millet, Théodore Rousseau et Diaz de la Pena, et retour aux livres, des éditions originales de Balzac, La Physiologie du Mariage, Eugénie Grandet, mais le plus émouvant ce sont les livres enluminés dont un a particulièrement attiré mon attention, celui d’un livre de philosophie et de sagesse de Boèce, traduit à l’intention de Jehan de Meun. Ensuite, de magnifiques Corot, comme le Pont de Mantes et la vue de Château-Thierry qu’on croirait peint avec des cils tant il y a là de finesse de trait et de délicatesse.
Des Degas, dont un autoportrait, la lecture de Fantin- Latour, Un Bourgeois de Calais la corde au cou, solitaire et gigantesque de Rodin, esseulé au centre d’une salle, et l’extraordinaire Enfant aux Cerises de Manet. Le portrait de Madame Monet de Renoir, et les bateaux sur Honfleur de Monet. Le miroir de Vénus de Burne-Jones, et à l’entrée d’une salle à lui seul consacré : « Votre père était un ami très cher, et au regret de l’avoir perdu s’ajoute la peine que nous éprouvons devant la disparition d’un grand homme…
Sa place est parmi les plus grands dans l’histoire de l’Art de tous les temps et sa maîtrise si personnelle, son exquise imagination, feront l’admiration des élites futures. » qu’on peut lire en entrant dans la salle des Lalique…
A la sortie, mais comme la visite semble circulaire, nous l’avions aperçue dès l’entrée, la magnifique sculpture du Printemps de Jean Goujon.
La partie contemporaine assez dense est surtout consacrée aux artistes portugais dont peu présentent un grand intérêt. J’ai noté parmi ceux hésitant entre avant-garde et tradition, un très beau bronze de Francisco Franco, un Joao Moniz Pereira (la fatigue), et un sans titre de Julio Resende représentant deux belles jeunes femmes à la fenêtre. Enfin une Grande Sauterelle de Germaine Richier.
La visite du Gulbenkian aurait pu durer plus des deux heures que nous lui avons consacrée.
A la sortie, dans les jardins, un canard peu farouche m’a carrément et insolemment frappé à l’épaule en prenant son envol…
Puis c’est le retour au port, son verre de vin vert et ses navires repartis pour la suite de leur croisière.
Le musée des azulejos est définitivement fermé malgré une deuxième tentative…
Restait à découvrir en ce milieu d’après-midi, la Place do Rossio, vaste et animée, aux nombreuses terrasses et commerces, avec ses deux très belles fontaines de bronze vert aux personnages mythologiques, donnant sur des immeubles de couleurs , ce qui compose une harmonie tout à fait surprenante. La statue d’une célébrité occupe le centre de la place au sommet d’une colonne tellement élevée que finalement ce n’était pas faire honneur à cette célébrité qui restera pour nous anonyme.
Et comme Lisbonne est décidément la ville des places, nous faisons une pose à l’ombre d’une terrasse sur le beau dégagement oblongue, à deux pas du Rossio, rythmé d’arbres fraîchement plantés, pour un Porto de dix ans d’âge.
Comme souvent, à la fin des voyages, on aime à retrouver ce qui nous a le plus attiré et ce qu’on a aimé le plus, c’est dans le cœur de cette Alfama dont les ressources semblent infinies, que nous flânons encore dans les tortueuses ruelles, prises cette fois sur une perspective nouvelle, que nous parcourons Rua Marques de Ponte do Lima avec ses arbres fleuris.
Je l’appellerai toujours la rue du printemps fleuri. Ses échappées vers le haut, vers le bas de la colline, s’harmonisent aux faïences des maisons bleues, jaunes, aux murs parfois graffités, renvoyant plus encore un florilège de couleurs inattendu dans ces hauts de Mouraria. C’est le Lisbonne cabossé des enfants qui jouent et qui crient dans la rue et aux fenêtres, c’est la nuit qui descend lentement.
Pour le dernier soir, nous sommes « Chez André », repéré dès la première fois à En Graça, avec sa devanture colorée annonçant les fados de la nuit. Deux grandes chanteuses (Maria de Lourdes Guedes ?) vont pleurer successivement la nostalgie d’ici comme nulle part ailleurs.
Sur le chemin du retour vers l’hôtel, c’est la pluie qui est là, faisant luire le double serpentin des rails du 28, comme une rivière turbulente, le pavé devenu dangereux, les lumières vertes, bleues et hagardes de ce Lisbonne halluciné.
Mardi 23 Avril matin
La pluie n’a pas cessé. Il fait froid. Les trottoirs sont maintenant glissants, et pour rejoindre le peu qui nous sépare du tunnel du métro, nous marchons comme sur un lac gelé. C’est le dernier débouché, l’au revoir sur Chiado, le sourire malicieux du poète Ribeiro, et Pessoa qui est bien seul sur la terrasse du Brasileira. C’est le vent, et le silence des parapluie qui se hâtent.
Les lisboètes rentrent dans leur nostalgie.
…………………………………………………………………………………………….
…
Honegger avait écrit son troisième quatuor à cordes Pâques à New-York. J’aurai relaté des Pâques à Lisbonne.
…
Je n’ai pas l’instinct du chasseur. Je suis d’Atlantique, j’ai l’âme du poisson, celui du pêcheur qui connaît la valeur du sel.
…………………………………………………………………………………………….
29 Avril
Lauwrence Böhme me fait parvenir la traduction de son livre sur le Vieux Nice. Pour que je corrige les erreurs et éventuellement la tournure des phrases.
…………………………………………………………………………………………….
1 Mai
ENQUETE SUR UNE MORT POSSIBLE DE L’AME
Notre Dame de Paris a perdu sa charpente, vieille de huit siècles, faite d’arbres immenses, de forêts environnantes, de chênes surtout. Les bras de celle-ci pouvaient dépasser un mètre de diamètre, et étaient devenus inatteignables à la sensibilité du temps, durs comme de l’acier.
Notre Dame a perdu sa charpente. Nous avons vibré en découvrant tous les images de désolations présentant ces flammes bleues dans la nuit de ce printemps.
On nous a dit, dès les premiers instants, par la bouche du Président de la République, que cela serait reconstruit dans les cinq ans.
Passé le moment de larmes et d’émotion, il nous a été donné des explications sur les causes de l’incendie. D’abord, un foyer occasionné par quelque négligence d’ouvrier.
Puis un possible court-circuit d’ascenseur qui n’aurait fait de mal qu’à un fétu de paille. Puis plus rien. Les causes étaient reléguées à l’arrière des considérations des jours qui ont suivi.
L’essentiel était maintenant de savoir l’avenir à donner à Notre Dame.
« Nous avons le savoir faire, nous la sauverons. Notre Dame sera à nouveau Notre Dame dans cinq ans », ce qui ne pouvait mieux calmer l’émotion du moment.
Je me souviens de la mauvaise et désinvolte prophétie de Bernard le lendemain. J’ai peur de trahir l’exacte froideur des propos, mais pour résumer sa presque vérité, voilà : « On s’inquiète pour trois fois rien. Demain les touristes verront les travaux qui les intéresseront autant que la Cathédrale avant les faits, et viendront voir l’évolution de ceux-ci. En plus, pour donner un coup de jeunesse, le toit sera en verre et l’ancienne charpente en béton. Peut-être (mais là c’est moi qui insiste sur le mode sarcastique de Bernard), avec un peu de modernité, on pourra disposer d’une plate-forme circulaire permettant une vue imprenable sur l’île Saint Louis… ».
Je n’ai fait que sourire. La science fiction n’est jamais loin chez Bernard. La réalité non plus.
Dans les écoles de criminologie, la première question posée est cette exclamation « trouvez l’argent ! », en d’autres termes, « à qui profite le crime ? »
Oui, à qui ?
L’émotion passée, on réfléchit.
Des vidéos (probablement des rétifs aux explications sommaires, des anciens responsables de section de pompiers, des chimistes (des complotistes ?) ont montré et démontré qu’une charpente de cette nature ne pouvait propager un feu de cette nature en un temps si court.
En tentant l’expérience de mettre le feu à des poutres de vingt cinq centimètres de diamètre seulement (en plein air, avec des combustibles efficaces – durant plus d’une heure- la poutre ne présentait pas plus qu’une trace de brûlé sur l ‘écorce, une écorchure si on peut dire, sur elle même).
Le bois de Notre Dame était devenu avec le temps aussi imperméable que l’acier.
Quand les pompier ont été alerté à Notre Dame le feu était à son comble ! Quand donc ont sonné les alarmes après le départ du feu ? Pour prendre une telle ampleur le départ d’un tel feu demanderait des dizaines d’heures en condition « naturelle » ! Tel n’a pas été le cas… Les pompiers ont été sollicités après que le feu ne fut désespérément rendu au ciel de Paris comme une traînée de poudre.
Ils ne vinrent que pour accompagner en quelque sorte ce qui pouvait être sauvé, des accessoires (la couronne d’épine nous a-t-on dit sans dérision), les rosaces, les vitraux et les grandes orgues, de manière aléatoire, sans certitude, et soulager la pierre des façades durant la nuit.
Alors ?
Alors il aura fallu un départ de feu bien plus orienté.
L’ignorance dans laquelle nous sommes sollicités pour poursuivre les certitudes que l’on veut bien nous faire admettre, ne peut que me faire penser au pourquoi d’une telle célérité du Président de la République de faire de ce désastre un chantier qui, orgueilleusement, ne serait que de cinq années.
C’est là que Balzac, César Birotteau, entrent à nouveau en scène.
Nous apprenons, et c’est sans complot (?) que Madame Hidalgo, la femme qui veut que le parisien devienne piéton ou vélo vert, peut-être même hollandais, vient de vendre le parvis de Notre Dame… (Qui ne vaut rien en soi, sinon d’être la plate forme qui regarde la façade de la cathédrale).
Mais son sous sol vendu à Auchan (et à une autre société) servirait évidemment à une structure de centres commerciaux.
Notre Dame coûte plus à la ville de Paris qu’elle ne lui rapporte.
Notre Dame n’a plus de fidèles. Que des chinois, des touristes. Le christianisme étant dans une vertigineuse décadence.
Cinq années a dit Monsieur Macron. Pourquoi tant de certitudes ?
Cinq années, c’est 2024. Paris Olympique. Paris by night !
Les verrières et les prophéties de Bernard…
Les ascenseurs aussi, parce que les gens de sécurité nous disent déjà que sécuriser la montée et la descente de la cathédrale ne peut se faire qu’à la verticale, ce que ne saurait permettre les montées par les marches d’escalier actuelles.
Notre Dame, oui, nous l’aimons. Mais il faut que la vieille dame de Nougaro et du sonneur de cloches Quasimodo meurent.
Notre Dame moderne donc, centre culturel.
Pour de nouveaux Veaux d’Or.
…
Le départ du feu plus orienté ?
La fameuse thermite (seul procédé : mélange de fer et d’oxyde d’aluminium) qui fait les soudures des joints des rails sur les réseaux du train en peu de temps, faisant monter la température de n’importe quoi à faire fondre de O à 2200 degrés en quelques secondes.
Comme une forêt presque millénaire.
La politique de la terre brûlée est toujours de mode chez nous. Aujourd’hui en plein cœur de la capitale.
Relisons César Birotteau.
…
Dans la Finance, ce qui différencie le voyou Bernard Tapie de Emmanuel Macron, c’est que l’un a toujours navigué en contorsion en dehors des Banques et n’a jamais été que le joueur de pipeau de son propre destin, de l’autre, celui qui a connu ces mêmes Banques, mais les a connu de l’intérieur. Et qui, par elles, est devenu le chef suprême de ce qu’on nomme le pouvoir qui n’a plus même de visage.
…………………………………………………………………………………………….
3 mai 2019
Nous avons fêté hier midi, les soixante dix neuf ans de Dany la Piaf. Elle avait organisé une tablée d’une dizaine de personnes au Saint Ef, Place Saint François et nous a réservé un petit récital accompagné d’un guitariste et d’un accordéon.
La mémoire évidemment n’est plus là… Mais ce fut un moment agréable avec ceux du quotidien de chez Sauveur.
…………………………………………………………………………………………….
nuit
La définition de l’ontologie est depuis longtemps déclinée en je suis, tu hais, il hait…
…………………………………………………………………………………………….
5 mai
Déjà né en Juin, quand je mourrai, que ce ne soit au printemps, mais au fin fond de l’hiver sur lequel je n’aurai de mal à prendre les couleurs fugitives de ce qui ne revient pas.
Rien n’est plus triste que de partir au temps de l’éclosion de toute chose dans les florilèges des échancrures du ciel, du bleu et des verts des espérances, des litanies de la terre qui tremble.
« Comme on voit certaines roses et les lèvres du vent sur ce demain des roses ».
………………………………………………………………………………………….
6 Mai
Alain Jacquot m’apprend que Chantal, sa première épouse, est morte hier. Elle était malade depuis un certain temps. Sa vie était une vague mise en scène, une garance d’énergie et un théâtre d’affect.
Je garderais le souvenir d’une taverne alsacienne dans les années quatre vingt cinq, où l’harmonie du munster millésimé et le non moins rare Riesling de quelques années d’âge portaient d’espoir dans ce que nous avions de plus vivant en notre jeunesse et nos premières années de galères professionnelles.
Nous sommes amenés à nous délester, de plus en plus, de ceux que nous avions côtoyés et aimés.
C’est la loi.
…………………………………………………………………………………………….
7 Mai
C’est la nuit. J’écoute ces fados de chez Jaime d’En Graça. Comme une envolée au-dessus de la ville, ces carreaux bleus de la tristesse occulte.
…………………………………………………………………………………………….
Porto sera-t-elle demain dans ses faïences bleues de cette beauté qui sied à un phare devant les vagues qui frappent à la porte ?
8 Mai – mercredi-
PORTO
Cinq heures cinquante, arrivée à Porto. C’est le complément d’un premier volet portugais commencé il y a à peine plus de trois semaines à Lisbonne. Comme si l’intervalle de temps du retour vers Nice n’avait été qu’une vague parenthèse dont on ne retiendrait que l’élan ou le rebond qui allaient nous mener encore vers un séjour inévitablement attaché au précédent.…Rua Cedofeita n° 193, Hôtel Estoril, assez loin de la station de métro, rue piétonne avec ses petits pavés jaunes et noirs disjoints et souvent cassés, déjà rencontrés en Avril. Le dernier soleil nous accueille avant les pluies prévues pour très bientôt. La curiosité nous mène sans plus tarder sur le toboggan permanent qu’est Porto, les montagnes russes de ses avenues partant d’un point sommital pour plonger abruptement et remonter à la même altitude quelques centaines de mètres plus loin, voire plus encore. Et comme le regard n’est pas attiré par la partie plongeante mais par l’église San Ildefonse tout là-haut, face à nous, nous avons la trompeuse illusion qu’elle se situe à deux pas plus loin. L’exposition de cette merveilleuse façade toute de bleues et de blanches faïences sur une large et assez vaste place est au couchant, et les derniers rayons, mêlés aux faibles éclairages du centre de l’édifice, semblent faire vivre celle-ci d’une lumière spirituelle entre deux passages de nuages gris et cotonneux. San Ildefonse est comme un résumé de l’art portugais du XVIII°, ou même de tout ce qu’on peut imaginer, sans avoir à nous y rendre, du Brésil baroque de Salvador de Bahia.
Cette confusion est facilement entretenue par l’imagination. Mais peut-être les azulejos d’ici donnent-ils un plus beau relief aux édifices.
Il n’est évidemment pas question de se contenter de cette première approche sous un ciel incertain et de cette lumière de crépuscule timide qu’on a l’impression d’avoir pris en cours de route sans l’avoir pleinement savouré dans son évolution. Ce n’est qu’une tentation, comme souvent en début de voyage, de tout voir le plus rapidement possible.
La Place de la Liberdade est toute en longueur, avec la statue équestre de Pedro IV et, de part et d’autre, de somptueuses architectures du siècle précédent. Comme un résumé, en un seul lieu, de la richesse et de la splendeur de l’urbanisme de Porto. En point d’orgue, tout au Nord de la Place, légèrement plus en hauteur, faisant face à la large et tranchante Rua dos Clerigos, le très imposant Palais du Conseil.
Dans le milieu de la Rua dos Clerigos, l’autre façade de l’église dos Congregados également décorées d’azulejos faisant face en contrebas à la gare de Sao Bento que nous négligeons pour prendre vers la large Rua dos Flores que jalonnent de multiples terrasses de café, de la façade sombre de la Misericorde, de placettes animées jusqu’à la grande artère suivante, Mouzinho da Silveira, le marché couvert de Borgès en ferraille rouge, puis c’est la trouée sur le Douro, après l’église San Nicolau et le Palais de la Bourse avec l’imposante statue de l’Infante Henrique.
Depuis les quais que nous venons d’atteindre, le Douro large et calme, est maintenant éclairé par les reflets mouvants des multiples lumières de l’autre rive, celle du Sud, ses péniches , ses barques de tonneaux arrimées et au-dessus de ce paysage urbain, le pont de métal San Luiz et à sa hauteur, sur la colline au Sud, la rotonde du Monastère Serra do Pilar, grandiose dans son habit de lumière nocturne.
Porto est pauvre. L’approche d’une grande ville est toujours dépendante des premières impressions que feront les édifices, la couleur dominante de ses rues et des ses lumières nocturnes, ce qui est le cas ce soir de notre arrivée, avec la vie qui s’y exprime à travers la densité des ses bars, de ses cafés et des ses terrasses qui ici, sur les quais, sont larges et démesurément longues, comme si tout ce qui flânait dans le vieux Ribeira battant le pavé s’était donné pour seul but de regarder couler paisiblement le Douro.
Les maisons colorés à l’extrême descendent aussi jusqu’à rejoindre les quais et sont maintenant noyées dans le ciel noir. Il ne reste plus qu’à se fondre dans les ruelles tortueuses, montantes et descendantes et se laisser tenter par quelque restaurant où la morue sera à l’honneur, comme l’excellent vin rouge du Douro.
La nuit venue, les pentes du retour vers l’Estoril sont dures à présent.
9 Mai -jeudi-
Il bruine sur la ville. Le ciel ne laisse aucun espoir d’un répit dans la grisaille qui envahit le paysage alentour. Comme la lumière semble favorable aux végétaux à dominantes vertes et à certaines tonalités humides , c’est l’adorable petit jardin, sous les fenêtres de notre hôtel qui fait l’objet d’une belle visite. Les roses de Porto sont reines, les rouges et les jaunes. Mais aussi des enfilades d’arums que je ne voyais plus depuis longtemps, de gigantesques hortensias qui verront bientôt épanouir leurs fleurs, et quantités d’autres variétés de couleurs que plutôt que l’opulence d’un jardin d’exception, c’est la douce harmonie d’un ensemble fleuri dans la maestria d’un jardinier amateur et amoureux qui se dégage dans sa plus belle simplicité en ce lieu odorant et enivrant de nuances végétales.
De petites îlots avec des fauteuils de jardin, enserrés par les végétaux font d’idéaux refuges pour la méditation. Seul manque évidemment un peu d’ensoleillement.
La pluie ne contrariant pas encore de possibles promenades, c’est vers la grande Place des Carmes et son église au flanc droit tapissé de faïences que nous faisons une première halte, avant de descendre sur les pavés mouillés et durs à l’austère Notre Dame de Vitoria qui se voit depuis les perspectives les plus lointaines de la ville. Un très bel orgue baroque et des niches dorées peuplées de martyrs et de saints que ne trouble le silence à cette heure frileuse du matin.
Les ruelles labyrinthiques descendent abruptement et, sur la colline adjacente, remontent tout aussi sévèrement vers San Lourenço, austère, d’où émerge le son d’un orgue splendide, aux trompettes en chamade comme il semble que se soit une habitude de facteur d’orgue au Portugal. L’organiste ne paraît pas plus troublé que ça de notre présence où nous pouvons bien voir l’instrument depuis la tribune sous celui-ci.
Pour la première fois nous voyons un maître autel typique de l’art portugais dans ses forêts de dorures et ses contorsions baroques poussées à l’extrême.
Qui contrastent avec quelques belles statues de bois romanes dans les couloirs du Musée d’Art Sacré et d’Archéologie.
Redescendant de San Lourenço, je m’aperçois qu’ici, un même édifice ou un même lieu peuvent avoir deux noms différents. Ainsi San Lourenço se nomme également église de los Grilos. La Cathédrale, la Sé…
Il est étonnant de constater que les jalons d’une promenade, que ce soit dans de petites villes ou de grandes capitales, ressemblent souvent à un parcours ordonné d’art sacré.
Certains prennent même le bateau pour affronter de forts vents, et parcourent des landes à perte de vue pour voir les ruines de Seven Churches en Irlande…
Des escaliers noirs, humides et moussus par le temps, nous mènent à la Sé, la Cathédrale, sombre et brunie sur une place très dégagée où commencent à s’agglutiner les touristes les moins réfractaires à la grisaille. Le cloître, qui est la partie la plus séduisante, présente une alternance, sur ses murs, d’ ensembles d’azulejos, de piliers et d’ogives gothiques. Depuis la galerie supérieure, il eut été admirable d’embrasser, par beau temps, une perspective profonde sur l’ensemble de la Ribeira et plus loin encore, au-delà du Douro. Jouxtant le cloître, la chapelle San Vicent avec son orgue doré enchâssé dans des reliefs en bois.
Au Largo do Pena Ventosa, ce ne sont plus les dorures et les ébouriffants symboles du baroque religieux qui étalent leurs richesses patrimoniales mais les goulets pavés qui affichent avec certitude une pauvreté et un lent abandon de son tissu urbain.
Deux maisons, comme jumelles, jaunes et bleus, rehaussent d’une tonalité poétique les serpentins gris du vieux quartier.
Porto chante une grisaille, due tout autant au sentiment qu’on a de traverser des rues et des ruelles en accord à ce que notre âme ressent de gris et d’abandonné qu’elles ne doivent être perçues sous d’autres ciels.
Une ancienne publicité disait du Portugal, le pays où le noir est couleur. Cela participe bien à ce ressenti d’une âme doloriste à l’extrême dans ses manifestations baroques poussées bien plus loin qu’ailleurs dans cette ville.
Depuis l’autre rive, celle du Nord, franchie à pied par le pont San Luiz, c’est enfin la vue panoramique qui embrasse le cœur de Ribeira.
Si Lisbonne est associée à Pessoa, Porto est associée à ses portos.
De ce côté, ce sont des maisons sombres et décaties qui procèdent d’un laisser aller (je dirais cultivant un certain abandon) où de vastes demeures, certainement florissante naguère, sont laissées en ruines côtoyant de crasseux ensembles modernes.
C’est sur cette rive que sont concentrées les quinze maisons du plus célèbres vin du pays. Sandeman, Barros, Calem, Casal Jordoes, Cockburn’s, Croft, Cruz, Dow’s, Graham’s, Offley, Osborne, Quinta do Passadouro, Ramos Pinto, Rozes, Taylor’s, dont on peut lire, du moins pour celles-ci, depuis la rive de Ribeira les enseignes comme distillant sur toute la longueur du quai la concentration de ses vins, avec sur les bords du fleuve, les barques qui naviguent depuis les vignes jusqu’ici, sur ces sortes de jonques à porto. La lumière en cette fin de matinée est bien sûr voilée et pesante. On aurait préféré découvrir Ribeira sous d’autres ciels, mais l’heure du premier porto est là, dégusté sous le crachin qui redouble de menace et le vent qui maintenant fait rage.
Ce ne sera pas le jour des paysages épanouis, mais plutôt des refuges que peuvent proposer les églises et la gare Sao Bento et ses azulejos bleues et blanches, mais aussi ses frises de couleurs multiples aux parties supérieures des murs de l’entrée. Des batailles, des scènes amoureuses, un peu de l’Histoire du pays s’inscrivent surs ces magnifiques faïences.
On serait presque tenté de prendre le train pour la cité historique pleine de poésie de Guimarès.
Un essayiste disait, il y a bien longtemps, qu’une ville était le visage porté par les sons qui émanaient d’elle-même.
Porto serait alors une ville concerto où fréquemment on surprend un éclat de voix qui s’élève au-dessus d’une mêlée informelle de conversations, pour disparaître et se fondre peu après dans l’ensemble.
Cela fait penser aux bribes de voix qui éclairent le silence de certains quartiers isolés, ou tout simplement les petites clameurs indistinctes des enfants qui jouent dans la rue avant la nuit de nos villages.
La pluie devenant maintenant envahissante, après avoir quitté la rive et la terrasse au petit porto réconfortant, après avoir pénétré à la gare et fait un salut à l’église dos Congregados, c’est en métro qu’on rejoint l’autre rive et Sao Francisco qui nous offre refuge sous les rafales de vent et de pluie froide.
Dès l’entrée, ce sont les profusions de gloire des ors et des contorsions à l’apogée de l’art portugais. Les piliers, les retables de Notre Dame de Bon Secours, celui de Notre Dame des Roses, celui, émouvant, des saints martyrs du Maroc, de l’Annonciation, qui se noient dans l’informelle apparence de la matière dorée. Une avalanche terriblement expressionniste d’ors et de bois ciselés qui ne trouble la rigide structure gothique de l’édifice, fondant ainsi dans celle-ci un délire doloriste à la manière des extases de Sainte Thérèse d’Avila en volutes ascendantes, en courbes et déhanchements et en des ciselures de cette même douleur, qui marquera bientôt un point de rupture engendrant un processus de décadence de l’art religieux au XIX° siècle.
Et le joyau qui à lui seul vaudrait l’appellation de sommet de l’art baroque au Portugal est l’Arbre de Jessé.
L’arbre sculpté en bois polychrome représente les douze rois de Juda ; debout, ils s’appuient sur les branches d’un arbre qui monte du corps allongé de Jessé et se termine avec la figure de Saint joseph.
L’œuvre est surmontée d’une niche avec la Vierge à l’Enfant que semble bénir, si ma vue ne m’a pas trahi, une bénédiction de Jean-Baptiste.
C’est l’œuvre de Felipe De Sousa et de Antonio Gomes vers 1718.
Ce travail perçu dans son ensemble laisse une impression similaire à cette Pentecôte du Greco exposée au centre d’Amsterdam il y a deux ans.
Les catacombes présentent ensuite des tombes sans intérêts de personnages nobles ou d’ecclésiastiques des 17 et 18 ° siècles et le musée justifie par la profusion des grandiloquences des statues et des symboles poussés à l’extrême, l’inintérêt porté à cet art religieux qui rendra bientôt l’âme par tant de boursoufflures.
La bruine et la pluie ont maintenant laissé place au brouillard. Porto donne des accents de Liverpool en novembre. Ce que nous ne savions pas c’est que l’influence de l’Atlantique laissait la ville dans une grande incertitude climatique jusque vers la fin Mai. C’est donc là les dernières turbulences de saison.
C’est dans un minuscule bistrot près de Mouzinho da Silveira, chez Barrete incarnado, en pente raide, que nous prenons un verre, attendant la fin des rafales de vent glacé.
Avec le Calem acheté dans une cave ressemblant à une grotte, aux milliers de bouteilles exposées comme des œuvres d’art dans la demie obscurité. En guise de plaisanterie, le patron probablement, indiquant à la caisse le prix de cinq cent euros, lequel Calem ne valant que cinq euros cinquante, mais du meilleur porto…
Sous les fenêtres de Dona Porto où nous dinons, le paysage est fantomatique, comme cristallisé dans un halo de poudre blanche autour des éclairages de la nuit tombée. Au loin on distingue les passants hallucinant les rues dans un ralenti fugitif. La Torre dos Clerigos se dresse comme un long cierge jaune, solitaire et glacé dans le flou de son ciel. Etait-ce Londres ou Porto ?
10 Mai -vendredi-
La grisaille du matin, dès le rideau tiré sur la journée qui s’annonce, laisse entrevoir de possibles trouées dans le ciel. L’épais brouillard a disparu. La première curiosité sera la Librairie Lello qui nous permettra de patienter sous un ciel indécis. Une longue file patiente, la plus dense qu’on aura à subir, souvent composée de jeunes filles asiatiques, le regard fébrile d’avoir à aller à la rencontre d’un lieu où Harry Potter a été imaginé par son auteur. Il n’en faut donc pas plus pour transformer l’univers du rêve d’une sorte de Disneyland pour adulte, dans le cadre d’une librairie. C’est probablement l’escalier qui est cause de toute cette agitation. D’un style néo-gothique, avec une double échappée en colimaçon, on pourrait se croire un instant descendant les marches d’un Chambord miniature, avec une répartition des visiteurs montant qui ne croisent jamais ceux qui redescendent. La librairie en elle-même est de petite dimension, ses plafonds et ses boiseries montent très haut et les rayons de livres ne comportent aucune rareté, sinon de disposer de multiples traductions du Petit Prince, de quelques œuvres de Jules Verne, des grands classiques de la littérature universelle, de Pessoa dont les poésies en français de chez Christian Bourgois, et surtout ces Lusiades de Luiz de Camoës qui forment une petite montagne sur les présentoires.
Comme la première de couverture de cette épopée présentait des illustrations de faïences, j’ai cru que l’auteur de ce qui constitue dans le cœur des portugais la saga nationale des aventures maritimes de l’auteur, qu’il était le principal pourvoyeur des illustrations d’azulejos contant les épisodes de la Conquistà dans le pays.
Par la rua Conceçao nous traversons vers la Trinidade et débouchons sur la Capela das Almas, à la façade à un seul clocher et recouverte entièrement de faïences. D’une harmonie sublime. C’est à l’angle de Santa Caterina qui est une des plus importante rue protégée de ce quartier de commerces essentiellement, faisant étrangement penser au Corso del Popolo à Rome.
Le ciel s’est partiellement et timidement découvert.
La dégustation de porto est initiée par une dame parlant un français sans aucun accent.
Il est étonnant de constater, qu’avec le temps, et sous toutes les latitudes, la langue française a perdu de son prestige, du moins perdu de son efficacité. Mon coiffeur portugais me disait pourtant que les portugais n’attendait qu’une occasion pour avoir à parler notre langue. Nous n’avons rencontré qu’une aimable personne, le premier jour, au sortir du métro, qui, nous entendant parler français se fit visiblement un plaisir de nous indiquer notre chemin dans un français venant plus du cœur d’ailleurs, et probablement d’une bonne volonté d’ancien émigré, que d’une réelle maîtrise de celui-ci.
Trois portos donc. Un blanc de la Quinta do Estanho de dix ans d’âge, puis, dans un ordre de qualité croissante, un rouge de la même provenance, en vingt ans d’âge, et pour finir, un vintage millésime 2000. En de tels moment, dans le calme du bistrot, ce sont toutes les effluves de la terre et la patience de la longue pratique de celle-ci qui définissent l’âme qui chante dans les verres.
C’est de nouveau un ciel bas lorsque le 200 nous laisse à Foz do Douro, traversant toute l’étendue du bord de mer par une avenue parallèle sur plusieurs kilomètres avec différents types de quartiers, surtout de maisons basses et de villas qui sentent déjà le balnéaire, de beaux immeubles, souvent entamés par la rouille et rongés par les corrosions de sel aux balcons.
L’Atlantique nous saisit dans le vent et les embruns odorants. Le sable des plages est d’un grain épais, humide où le pas s’enfonce et la marche est difficile. Tout au loin, au bout d’une longue jetée rectiligne apparaissent deux phares, dont le premier semble le plus ancien, battu par l’assaut des vagues. Au bout de la jetée où nous sommes au bord du vertige, ça sent l’algue et l’iode, le vent aigre.
Nous faisons halte dans un bistrot improbable, proche du rivage attendant que ne se découvre le ciel pour poursuivre le long du bord de mer, sa promenade bordée d’immeubles face à l’océan où la vue uniforme pourrait inciter aux méditations sur l’infini ou quelque chose d’avoisinant. La lumière sculpte maintenant jusque très loin au travers des pins échevelés, de sa célèbre pergola, des rochers léchés par les vagues. Le paysage est évidemment méconnaissable, comme une fille parée sous le soleil, avec le sourire que les tumultes de l’Atlantique refusaient encore hier.
Une belle sculpture représentant la symbolique du naufrage vient jeter une ombre sur la violence exubérante de ce front de mer.
Par le bus du retour c’est tout le bord de mer que nous longeons. A l’entrée de la ville apparaissent les maisons de couleurs, les balcons de guingois, serrées les unes contre les autres à Miragaïa.
Porto a l’allure d’une sanguine mûre sous les jets de soleil.
La nuit est maintenant tombée sur les quartiers qui s’animent, et nous dînons au pied de San Lourenço, au Barrete incarnado de cette morue rôtie simplement et d’un vin de Douro de la propriété du patron.
Puis à pied, le long des quais, hors de la frénésie des abords du pont San Luiz et des terrasses encombrées, dans le quasi silence des quartiers populaires où sont les solitaires, déjà presque endormis, et les éclairages jaunes qui donnent un teint blafard à cet endroit des quais, la pauvreté des lieux aboutit à l’église San Pedro des Miracles sur une petite place, sans beaucoup de dégagement et de recul, qui paraît un compromis architectural entre San Ildefonse et la Capela das Almas, toute couverte d’azulejos. C’est sous le soleil de fin d’après-midi que sa beauté serait à son comble. Des enfants jouent dans les ruelles prolongeant leurs ombres, de faibles éclats se font entendre alentour, quelques femmes apparaissent au seuil des maisons. Dans l’église, et malgré l’heure avancée, mais peut-être est-ce parce que c’est vendredi, les femmes portugaises ont cette couleur des vendredis de douleurs, sortes de modèles qui ont donné ces statues de stuc si affectées, d’un mélange d’éternelles repentances et de contorsion de l’âme à genoux.
Nous rentrons par la même rive où le fleuve se pare du bleu, des verts et du jaune se reflétant dans l’eau. Passant par les quais maintenant endiablés aux terrasses de Ribeira, Porto s’étire dans le bruit et les lumières jusqu’à bien loin dans la nuit.
11 Mai -samedi-
Derrière les rideaux qui donnent sur le jardin de l’hôtel on sent que l’air vif est là. Qu’il n’y aura plus de nuages sur la ville. Porto est enfin sous un grand soleil.
Dès l’arrivée, le Palacio de Cristal présente une coupole géante semblable à celle du Parc Phoenix à Nice. En complète restauration. A tel point qu’on croit un moment que le parc est fermé en cette saison. Il suffit simplement de prendre une allée contournant les travaux pour être saisi par la luxuriance d’une vue sur le Douro depuis les jardins et les balcons successifs en escalier, et embrasser pleinement du regard toute la rive nord de la ville au travers des arbres et des pergolas qui habillent des perspectives inouïes. Porto paraît toute rose de là-haut. Plusieurs jardins sont consacrés aux roses, les paons font la roue et semblent accompagner de leur ballet des myriades de fleurs et de couleurs. Des plan d’eau tracent des allées rejoignant d’autres escarpements où d’autres jardins de caractères différents nous attendent. Ce sont des parterres cultivés à la français, des petites gloriettes et des arcs de temples grecs qui se succèdent. Les paons envahissent tout autant que les coqs en pleine liberté qui chantent à une heure bien avancée de la matinée. Du plus haut point de vue, sur le plateau de la colline, à l’ombre d’une chapelle, on peut apercevoir en contrebas un jardin trilobé au centre duquel jaillit l’eau d’une fontaine, et tout au fond le pont Arrabida, du même lignage que celui de San Luiz, le dernier pont de Porto avant l’Atlantique. Ce Palacio de Cristal est tout autant le poumon de la ville qu’un havre de paix. Le plus émouvant jardin, après ceux consacrés aux thèmes des plantes aromatiques, des plantes médicinales, le jardin des sentiments, à la fois le plus sobre et le plus dépouillé à flanc de colline sur la rive rose orangée qui s’étire le long du fleuve. Son pavement compose un labyrinthe enserré d’oliviers et de citronniers menant à une statue de poète en posture d’extase.
En pente douce, la ligne du tram, au sortir du parc, nous mène, bien à l’ombre, vers Miragaïa, d’où surgit une nouvelle église de même type que San Pedro ou la Chapelle des Ames, aux faïences blanches et bleues. C’est le Corpo Santo do Massarelos. Une vague indication à l’entrée parle de Henri le Navigateur qu’on aimerait penser qu’il fut né par ici.
Midi. A l’angle de San Pedro que nous avons rejoint, c’est l’heure du vino verde. Puis suivant les rails du tram, apparaissent très proches de Ribeira, les maisons entrevues lorsque nous revenions de Foz, dans leur décati, leurs lèpres colorées et toute la pauvreté qui fait le paradoxe des maisons qui attirent le plus l’intérêt du visiteur. Derrière ces demeures à niveau du Douro, de là-haut s’élève vertigineusement toute la colline aux teintes sublimée du Miragaïa.
Ribeira est traversée par les ruelles les plus à l’ombre possible, révélant une physionomie opulente à l’heure du soleil au plus haut.
Cette fois nous prenons le pont San Luiz vers treize heures. L’affluence de ce samedi est rendue plus compacte encore par l’animation dans Ribeira d’une compétition de motos. On se croirait, au bord du Douro, pour un événement aussi tumultueux que le Grand Prix de Monaco. On ne sait si c’est nous ou le pont qui manquent de chavirer de bruit et de fureur solaire.
Et enfin rendus sur l’autre rive, c’est l’enchantement. Porto de face, rive sud, sur toute la panoramique déployée, de ses ocres orangées, ses jaunes, de ses trouées tranchantes partant du fleuve jusque là-haut vers les lieux de prières innombrables, San Lourenço, la Sé , les chapelles multiples, toutes devinées du regard pour les avoir conquises dans des escalades abruptes au hasard des ruelles sur les collines.
…
… « Il présente une couleur brune dorée ainsi que des arômes de fruits secs et d’épices. Il est velouté, balancé, avec des nuances de fruits secs. Idéal pour servir avec des gâteaux et des fruits secs. »… C’est évidemment Un Calem Special Reserve. Plus loin, mieux encore. Devant la profusion des petits verres et la joie indéniable d’une assemblée d’américains exubérants, nous décidons à quelques tables de là, d’essayer cette fameuse dégustation de cinq portos, allant des plus frais blancs, aux plus veloutés rouges, ruby et tawny, passant par le rosé nouvellement développé dans la gamme des portos.
Derrière les caves que nous croisons, les noms de Graham’s, Cruz, Sandeman et d’autres défilent, et tout contre les rives, les jonques chargées de tonneaux des mêmes noms. La ville se déploie dans une lumière qui ferait penser à une approche de Tanger au sortir du détroit de Gibraltar. Peut-être est-ce une vieille image imprimée depuis mon enfance…
Une petite église, d’un baroque sobre, apparaît comme un hiatus aux confins de cette rive nord au delà de laquelle les habitations deviennent plus rares.
Le retour par le centre de Ribeira étant ceinturé pour les raisons de la compétition de motos, nous grimpons, comme pour notre calvaire, des centaines de marches d’un dénivelé qui laisse derrière nous en contrebas le pont San Luiz lui-même, pour atteindre tout en haut, et comme par enchantement le quartier de Batalha d’où émerge San Ildefonse. Rendue à ses parures blanches et bleues, éclatante, gorgée de clarté au centre de la Place qui la laisse entrevoir sous n’importe quel angle.
Par la Rua Santa Caterina, rectiligne et piétonne, la ville entière semble s’être donné rendez-vous sur ce passage à l’affluence extrême. La Chapelle des Ames, pareille à San Ildefonse, rayonne comme une fulgurance dans ce quartier de commerces et son flot de fureur animée.
Le crépuscule tombe sur Porto à près de vingt heures. La ville offre une lumière de grenade, une sanguine saturée depuis le promontoire au pied de N.D. de Vitoria. Avec les docks au loin, sur la rive que nous avions quitté quelques heures avant, les enseignes des marques de vin, les façade des édifices majeures sur chacune des collines, et au premier plan, un goéland peu farouche qui se prête aux caprices de l’objectif.
Chez Berette Incarnado nous sommes les derniers clients. Les sardines grillées étaient énormes. Le Topazio, le meilleur vin du Douro.
Depuis notre balcon la lune est calme.
12 Mai -dimanche-
Porto a déjà tout donné de son ciel, de ses jardins et de ses pierres, de ses camélias japonais qu’on confondrait avec les roses. C’est dimanche, les rues sont calmes et désertes dans le quartier du cimetière d’Agramonte, un peu au nord de notre rua Cedofeita.
Les allées sont bordées d’arbres et donnent l’ombre en ce début de matinée. Des mausolées semblables les uns aux autres, dominés souvent par des anges ou des représentations de l’au-delà dans un goût ostensiblement grandiloquent. Comme à Caucade, comme souvent dans les vieux cimetières. D’autres tombes sont fleuries à même la terre, sans apprêts et sans décorum.
La Casa de Musica, sur la Place en forme d’étoile aux grandes avenues qui filent en toutes directions, est une architecture comme on en voit partout dans le monde. Un cube plus ou moins irrégulier, taillé à la manière des formes qu’on donne aux diamants, de larges baies vitrées et un environnement composée de vallonnements lisses à usage des skateboarders, donc volontairement identique à ce qu’on peut s’attendre à voir dans toutes les villes modernistes. Les programmes pourraient être prometteurs, avec des concerts Ligeti, des solistes de hautes réputations etc, si ce n’était que le dimanche on ne visite pas et que les visites sont essentiellement commentées, payantes et proposent simplement la découverte des différents auditoriums.
C’est sans regret qu’on affronte la très longue et large Avenida Boavista, qui part de cette Place et débouche sur la mer après plusieurs kilomètres. Tranchant plus au sud, la très poétique Rua Guerra Junqueiro, aux jasmins et aux rosiers sous le soleil, les oiseaux endimanchés, les maisons résidentielles et la très ténébreuse synagogue cadenassée et close comme une fortification.
Dès l’entrée du Jardin Botanique, dans la non moins belle Rua de Campo Alegre, un immense cercle sur lequel sont inscrit en latin des milliers, peut-être des millions de noms de plantes et de végétaux.
La très belle maison à deux niveaux, dans son carmin violent, Casa Andresen, invite à se fondre sous les voûtes d’arbres et les parterres de végétaux rares. Le premier jardin est dominé par un arbre nain aux tintes automnales qu’on se croirait à Kyoto. Suivent des carrés aux roseraies, aux haies de camélias, et aux pièces d’eau aux nénuphars. Un mur d’ombre et de lianes en désordre sous lequel est installé un banc aux azulejos à multiples motifs colorés, permettent de se protéger du soleil et de contempler les larges îlots de massifs fleuris alentour.
Le second niveau, par des escaliers qu’on croirait issus d’une cité perdue précolombienne ou d’une quelconque Arcadie, plonge vers des dalles rongées d’humidité et d’algues, une pièce d’eau entièrement recouverte de lentilles comme un tapis de billard, dans le plus bel émeraude. Il y fait presque frais sous les arbres gras, les lianes et les mousses environnantes. C’est un petit îlot d’atemporalité.
Après le lac aux nénuphars et aux fleurs de lotus, le jardin des plantes xérophytes avec les différents cactus dont certains grimpent bien haut qu’on dirait un petit coin d’Arizona ou de Mexique. Des plantes succulentes comme les figues de barbarie s’insèrent au cœur de ces cactus géants.
Au dernier niveau, se trouve l’arboreum où s’épanouissent les collections de conifères et le plus grand lac du jardin.
Ce que le Palacio de Cristal avait d’ordonné et de clarté, contemplant de son élévation la ville entière, est complété ici par un sentiment d’enfouissement au cœur d’une végétation échevelée, hors du monde.
…
Je me donne l’impression, en relisant ces quelques pages, que je ne fait qu’une description des villes que je traverse, un peu comme Pessoa laisse vainement, avec son petit Lisbonne, une sorte de guide où vaquer et traverser lorsqu’on s’y rend. Un catalogue des curiosités. Mais il est absolument inévitable qu’un séjour, qui plus est, un bref séjour, ne peut s’appréhender qu’au travers des rues, des espaces et de toutes sortes de jalons comme autant de labyrinthes, et de monuments qu’on y découvrent fugitivement. Le monde intérieur avec lequel les lieux sont intégrés en nous se confondant dans les lumières et les parfums, les événement se confondant aux choses, dont il est tentant et peut-être impossible de faire ressortir la quintessence.
…
Nous rejoignons la mer par la Campo Alegre à une heure où on ne rencontre personne, sinon cette église de Sao Martin de Lordelo, église à faïences sous la lumière de treize heures, et débouchons sur le bord du Douro, non loin du pont Arrabida. Depuis la terrasse d’un petit café perdu sur cette rive, on aperçoit de l’autre côté, la Marina do Douro et ses maisons de couleurs. C’est un port de pêche, le dernier avant d’atteindre la mer. Pour y accéder, il faudra revenir à la gare Sao Bento où même les chauffeurs de taxi ne connaissent pas le nom de cette Marina. Celui qui nous y mènera ne semble d’ailleurs pas savoir lire un plan. L’endroit est plus connu sous l’appellation d’Arufara. Pour y accéder il faudra passer sur la partie supérieure du Pont et descendre ensuite vers le petit port. C’est San Pedro do Arufara, les lieux ayant souvent deux noms différents suivant les caprices ou l’histoires de ces lieux.
De charmantes petites rues saturées d’odeur de sardines nous attendent. Elles sont grillées sur des grills géants, à même le trottoir, et les fumées, au gré du vent, traversent tout le quartier des pêcheurs. Arufara est au cœur de la sardine, et celle-ci semble au cœur de l’âme portugaise. Ici l’odeur est si forte que le dimanche, il n’est pas rare que les gens de Porto vomissent leur nuit de samedi. Les maisons sont d’adorables petites constructions ayant toutes un seul étage et deux entrées, leur donnant ainsi de belles proportions, rehaussées par la stridence des couleurs, les harmonies se faisant des mauves à côtés des vertes et les jaunes à côté des rouges. Mieux encore, pour un œil avisé, face à une coquette maison rose qui jouxte une autre vert bouteille, toutes les deux à gros carreaux, stationne une bicyclette vert amande aux jantes rose. Un petit Burano inattendu.
Les rues étroites au cœur du village étant offertes aux seuls piétons.
Une rue montante, un peu à l’écart, m’attire par la parfaite enfilade de couleurs qui semble aller jusqu’au point d’horizon. L’harmonie de cet îlot de pêcheurs n’a pas changé depuis très longtemps. Quelques vestiges de maisons trahissent le fantomatique passé qui n’attend que sa destruction comme si leur âme s’accordait encore un peu au temps de leur splendeur. Sur une placette des travailleurs torse nu, allongés sur des transats, profitent de la force du soleil en ce milieu de dimanche. Le café des supporters du F C Porto est saturé de ses emblématiques bleus et blancs. Je rejoins Cécilia non loin des dernières fumées des grills mais protégée des senteurs à l’angle d’une ruelle pour le vino verde avant le long retour à pied sur la rive qui mène aux quais des dégustations.
…
Et nous voyons défiler les quartiers de Miragaïa, la maison de l’Architecture toute blanche dans son écrin de verdure, ses cubes et ses géométries, le Palais de Cristal tout là-haut, vu maintenant de l’autre côté, le sommet des églises de Ribeira, la Cathédrale pain d’épice dans le feu du soleil d’après-midi, les jonques qui portent les touristes du dimanche, les travaux sur les plaies de l’église du Corps Saint de Massarelos dont seuls les clochers montent vers le ciel, les bannières qui disent que le Portugal et Porto ont un cœur plein de sève comme ivres d’eux même et de la richesse de ses barriques navigantes.
Plus loin, San Pedro des Miracles et l’entrée dans Ribeira.
Le taxi nous évite la dureté de la colline vers Cedofeita.
La nuit est tombée. Une dernière promenade sur la rive de notre colline, ses quais et ses lumières, le pont San Luiz éclairé, les reflets pâles sur le Douro, et un dernier dîner dans Rua da Fonta Taurina, la ruelle étroite du premier soir.
La remontée vers l’hôtel ressemble à un petit calvaire…
13 Mai -lundi-
Beaucoup de vent ce matin. Comme une anticipation de notre prochain départ.
Au-delà de Foz, le 200 longe une belle avenue bordée de maisons enviables, d’autant que le soleil rend le bord de mer plus riant que lors de notre premier passage. Tout au bout de ce long boulevard de plages, le bus nous laisse sur la place en étoiles qui fait pendant à celle qui se situe au pied de la Casa de Musica. Entre les deux, c’est la longue Avenida Boavista qui vient s’échouer au pied des plages.
C’est avec une sorte de tristesse muette que nous longeons ce bord de mer où la lumière sature le paysage de couleurs qui se délavent et blanchissent l’horizon. Les immeubles sont luxueux et n’ont plus la simplicité fragile et un peu vieillie de ceux situés près du phare. Les plages sont d’un sable étonnamment fins et pourraient figurer au tableau des plages idéales si ce n’était une certaine monotonie due à une platitude de l’étendue que ne viennent briser des arythmies de rochers ou de criques naturelles, mais plus encore, la désolante présence des raffineries aux monstrueux cylindres et aux architectures industrielles qui s’offrent en paysage tout au nord du côté de Matosinhos.
Une monumentale sculpture dressée face au rivage, à même le sable, dans son étendue plate et monotone, représente la Tragédie de la mer. On l’aurait mille fois imaginée plus à proximité des rochers et des phares à l’autre bout de Foz.
L’ensemble sculpté est composée de cinq femmes portant un foulard sur la tête, à la manière des secouristes et des infirmières ou simplement comme portent la coiffe traditionnelle les femmes portugaises, les bras tordus d’angoisse et de désolation vers le ciel devant un danger qu’on imagine être un naufrage au large. L’une d’elle, au premier plan, porte un enfant dans ses bras, ajoutant un supplément dramatique à la scène.
Puis c’est la longue traversée de la ville, le début du retour vers Ribeira. Nous traversons des quartiers très contrastés, populaires et luxueux, et des milliers d’images et de sensations défilent, difficiles à fixer tant le métro ne laisse de répit pour la méditation entre les multiples stations.
…
Lisbonne l’aristocrate, au Tage hautain, et distant de la ville, aux collines et aux placettes dissemblables les unes en regard des autres, Lisbonne de Pessoa et de Chiado, fiévreuse et nostalgique, puis Porto tumultueuse et son tangage de tonneaux sur la ville, son Orient proche à force de voyager sur son Douro, ses deux rives se faisant face et se défiant quelque part dans leurs expositions solaires opposées, ces deux villes n’existant que comme complément l’une de l’autre.
…
La dernière station du métro aérien franchissant le Pont San Luiz, dominant la ville du plus haut, finit sa course au pied du Monastère Serra do Pilar au Jardim do Morro.
C’est le point culminant, aujourd’hui sous l’insolente lumière qui découpe la rive de Ribeira jusque loin, au-delà des clochers, des autres collines, comme vue déjà depuis les airs.
Le vertige me saisit. Le pont est à quelques mètres et je ne peux embrasser du regard le panorama grandiose en sa plus belle exposition qu’en gardant une distance avec le gouffre sous nos pieds.
Derrière nous, le tram continuera sa course vers la vallée et les vignes du Douro plus au sud.
C’est maintenant proche de midi. Il est temps de voir une dernière fois la façade de San Nicolau qui n’a pas de chance avec moi, et qui présente toujours son côté d’ombre à l’heure de nos rencontres.
Les parasols sont nécessaires le long de l’étroit petit promontoire qui surplombe suffisamment le quai au-dessus du fleuve et qui propose toutes ses caves de dégustation.
L’heure de s’asseoir dans cet étroit goulet, de demander un porto. Un Mongès, tawny, de dix ans d’âge, puis un second, suivi d’un Graham’s…
…………………………………………………………………………………………….
Bien plus tard, dans le bus qui mène à l’aéroport, à un feu rouge, comme une ultime surprise, se dresse la splendide façade d’une église à faïences qui, à elle seule, tenait à la fois de la Chapelle des Ames, de Sao Martin et de presque toutes celles de Miragaïa. J’ai juste le temps de déclencher au travers des vitres sales avant que le bus ne reprenne sa route. Je ne saurais jamais son nom. Elle avait l’air de sourire sous le soleil.
…………………………………………………………………………………………….
15 Mai
De plus en plus nous parlons, Cécilia et moi, de notre mort, et de celui qui resterait : « Quand je partirais, tu n’auras qu’à… Si je disparais, tu trouveras dans tel tiroir… »
…………………………………………………………………………………………….
20 Mai
Maintenant il devient banal de compter le passé en terme de demi siècle… 1969, il y a aujourd’hui cinquante ans.
J’entrais dans l’ordre professionnel il y a quarante ans.
A chaque anniversaire, chaque pierre, chaque cicatrice ayant compté, le temps fait figure d’un ruisseau quotidien qui demeure dans sa force de torrent.
…………………………………………………………………………………………
La musique baroque a entamé sa révolution dans les années soixante dix. N’était-ce pas d’une manière certaine, une façon de réinstaller dans le paysage du sensible, l’Ancien Régime ?
…………………………………………………………………………………………..
22 Mai
Voilà deux ans, je faisais ma dernière classe. Gilbert Bessone m’apprend ce matin que Caty Bes est plongée dans un coma artificiel.
…………………………………………………………………………………………..
24 Mai
Gilbert appelle ce matin. C’était prévisible. Caty Bes nous a donc quitté aujourd’hui vers sept heures. Une cérémonie est prévue à l’église Saint François de Paule dans les jours qui viennent. Probablement à la demande de sa maman. Pour la musique, je pense que ce sera Puccini. Un bel di vedrem ou quelque chose du troisième acte de La Bohême. Un ballet aussi, évidemment. Ce qu’elle aimait le plus. Tout cela paraît si dérisoire…
……………………………………………………………………………………………
27 Mai
DONC LE NEANT
Dans le néant, qu’il soit celui d’une nuit de sommeil ou celui qui pèsera de ces milliards d’années après l’endormissement pour toujours, l’épaisseur de ce rien qui nous est promis se confond comme deux gouttes d’eau dans un même océan. Il faudrait qu’il y ait un réveil pour mesurer la misère de ce rien dans toute son étendue.
Comme les trompettes du Jugement risquent de se faire attendre, c’est à une sorte de retour à ce rien qui a précédé notre naissance auquel nous sommes conviés.
…………………………………………………………………………………………….
29 mai
J’aurais même manqué le dernier rendez-vous avec Caty, celui de la cérémonie d’au revoir à l’église du Vieux Nice. J’avais affaire vers huit heures avec un technicien venu brancher la conduction de la fibre optique pour l’appareillage informatique…
Gilbert m’assure que la gerbe était superbe. Participaient à cette couronne, Jean, Gilbert, Alain et moi, mais aussi Dani Larché et Helvia.
…………………………………………………………………………………………….
Dans le néant qu’on imagine noir, parce que l’imagination pense naturellement que la notion d’absence, de vide, comme les espaces sidéraux ne peuvent être que noirs, il n’ y a plus même ce noir qui est la gravitation de notre idée de néant. Pas de blanc absolu, cette lumière vive et intense que disent vivre les rescapés des nde.
Plus de couleur, et d’autant moins d’ailleurs que cette idée d’attacher du noir ou du blanc à ce phénomène de la dissolution totale n’est que la conséquence d’une pauvre imagination qui pallie à notre ignorance, et qu’on ne saurait définir en termes réels (et donc de couleurs) ce lieu qui a même perdu, dans ce rien des milliards d’années à venir, la notion d’où il se situe.
…………………………………………………………………………………………….
Le néant est d’autant plus difficile à imaginer que toutes les dimensions de nos approches du réel, même les plus surréalistes s’il était possible de pousser l’imagination à ses confins, ne peuvent se concevoir que dans l’espace et le temps, les couleurs qui rythment la température de ce binôme, et la profondeur des choses qui traverse la chair de ce qui existe. Le noir est devenu synonyme de vide, de rien, et se trouve donc la conséquence de ce qui s’éloigne de la plus intense vie, du soleil, des vibrations des choses qui se conjuguent en bleu froid ou en rouge brûlant, en orangé automnale ou en ces milles nuances qui sont autant de variations de l’existence des choses vivantes sous le soleil.
Comme sur un vecteur allant d’une intensité colorée, de la plus vive à la plus faiblement éclairée, les nuances prouvent par l’infini, la réalité de ce qui se définit du vivant. Parce que la vie est couleur. Et qu’imaginer le néant consiste à lui attribuer celle qui est au cœur de notre peur de la nuit primale.
Comme l’image atroce d’un cosmonaute détaché de son vaisseau, dérivant sans plus d’espoir, vers les vides sidéraux.
Ce que l’imagination la plus fertile ne pourra jamais entrevoir, c’est qu’il ne s’agit plus d’une intensité de lumière ou de privation de lumière, mais de la qualité même, inconcevable, de ce qui lui est substituée.
…………………………………………………………………………………………..
Dans le néant serons nous mené vers une sérénité minérale ?
……………………………………………………………………………………………
Non ? Pas même de sable .
…………………………………………………………………………………………….
L’effrayant est de savoir qu’entre 1969 et 2019 il ne s’est rien passé. Sinon une série d’espace jalonnée de dates et d’évènements. Puisque la vie s’est déroulée dans ces cinquante dernières années sans qu’on ait jamais retenu que ce rien ou ce tout qui s’est déroulé « entre temps ».
La cruauté vient de cette temporalité qui est comme une peau qui nous déchire et qui finit par faire mal de ne savoir ce qu’elle nous inflige.
Parce que nous ne savons pas plus de choses sur l’être et tous les évènements (sinon des signes) devenus fantômes de notre vie que sur ce rien où nous allons.
L’être, le temps…
ET L’ETERNITE
…
La nostalgie est la douleur de la mémoire. Et pourquoi la refuser ?
Dans cet amas de mémoire, ce revivre permanent, il n’y a bizarrement pas de place pour les ombres au tableau du passé. Comme une sorte de nouvelle virginité dans l’ordre du temps, douce et dépouillée du souci d’aucun futur antérieur.
La nostalgie ne consigne que le bon ressouvenir.
Mon père qui n’avait jamais été gâté par la vie disait souvent, définitivement, comme d’un trop bien vécu, « ma vie a été belle » …
…
Entre 1969 et 1971 j’ai le sentiment d’avoir vécu une éclosion
…
En 2021, j’aurai soixante neuf ans, pour un cinquantenaire inauguré en soixante neuf, début de cette trilogie de l’érotisme et courant jusqu’en soixante et onze.
…
Depuis vingt ans, je constate que le prunius ne baisse pas trop la tête. Et même s’il ne me survivait, son déclin sera plus long que le mien.
…
Je grignote les premières tiges de ciboulettes, des basilics fragiles et des menthes qui sont faciles à venir comme les mauvaises filles.
…
C’est aujourd’hui que je sens le souffle chaud de Juin. J’ai ouvert les portes au Nord comme au Sud, côté jardin. On y entend, depuis le salon, des bégaiements d’oiseaux, des coassements et des pies qui se baignent bruyamment dans la fontaine. L’air circule comme le temps qui se répand. Cécilia est avec Y au bord de l’eau. C’est la mesure du bonheur.
…
C’est un jeudi de l’Ascension.
Dieu n’existe pas, mais que veut dire dormir d’un sommeil éternel ? Dunlopillo ?
…
Les truands qui ne croient à rien se vautreront dans leur croyance à rien et moi dans mon angoisse de chaque nuit
…
L’aurore s’éloigne
…
La mort de Caty laisse inexorablement penser à la quiétude du temps.
L’indifférence qui le qualifie.
Aux harpes qui sont jouées au temps des funérailles.
Mais demain, pour chacun, comme les têtes du « Dialogues des Carmélites »…
…
Et si nous restions dans le ravissement de l’enfance, ce que nous savons être le jardin d’Eden ?
…
Quand je vois l’horreur de mes collections, l’amassement du temps qui s’est proposé d’être à moi sous forme d’une logique de l’avoir, je me dis que je suis chanceux de faire des courants d’air à la maison, ne serait-ce que pour dissiper la poussière qui me prélude.
…
La honte de la vie serait-elle qu’elle n’en a pas donné les clés ?
…
Suis-je né pour cette raison qui me doit d’aller à la mort ?
…
Ma vie est infecté d’éternité
…
J’arrive à lire le Lisbonne de Pessoa les yeux fermés.
Sommes nous redevables à l’éternité des baisers manqués de nos ruisseaux qui s’en vont ?
…
Je continue dans le temps imparti aux pauvres, aux récalcitrants, aux muets et aux démunis des cryptes de la démesure, de vouloir vivre avec les solstices de ceux qui s’arriment à nos désirs.
…
Arrêter le temps reste une futilité d’insomniaque.
…………………………………………………………………………………………….
4 Juin
Quelques mesures de l’opéra de Georg Friedrich Haas. « Coma », dont le contenu s’étire en longues nappes sonores, évoque bien la douleur, l’inconscience et finalement la mort. Avec celles de Francesconi , Dusapin et Benjamin, peut-être une œuvre lyrique capitale aujourd’hui.
……………………………………………………………………………………………
Depuis longtemps, le moment le plus inévitable et le plus appréhendé est le moment où il va falloir aller dormir.
…
Les nuits sans rêves sont simplement des morts trompeuses
……………………………………………………………………………………………
Le corps des hommes est comme ces assemblages de nuages qui se sont formés, transformés au gré des vents, et disparaissent dans l’espace infini. Sauf que ces corps sont plus compacts et leur transformation moins visible.
Mais il n’y a qu’à voir les photos d’un même visage à quelques années de distance…
……………………………………………………………………………………………
Michel Serres est mort il y a quelques jours. Il a fini comme un penseur qui n’aurait plus qu’à écrire son art d’être grand-père. Il avait déjà, avec son petit opuscule sur le Bonheur, des côtés Krishnamurti.
Je n’avais que modérément goûté son ouvrage sur Rome, d’un style ostensiblement voyant, du temps de sa pénitence aux Etats-Unis lorsqu’il fut plus ou moins mis au banc des penseurs d’ici.
Dans ses conférences données à l’Université de Nice environ 1972, il a toujours été brillant et d’une impeccable clarté. J’y entendis pour la première fois parler du clinamen.
Parti des grands champs de la connaissance philosophique, des sciences et des prospectives sur le futur, il en fut donc revenu avec les bonnes vieilles recettes de la sagesse ordinaire.
…………………………………………………………………………………………….
6 Juin
« L’Escadron noir » de Raoul Walsh de 1940, juste après « la Piste des Géants », un non moins grand chef d’œuvre dans l’histoire du genre.
…………………………………………………………………………………………….
7 Juin
C’était presque hier, il y a cinquante années, ce jour même, que je rencontrais Josiane Roche, apparue aux environs flous de la rentrée d’Octobre 68 au Parc Impérial, tremblant et risible. Comme on voit certaines roses…
Sur la plage des Voiliers il y avait Stef qui m’avait encouragé à l’aborder, puis ensuite, ce fut simplement une apesanteur qui nous saisit, et un cheminement sur le boulevard Gambetta.
Je me souviens que le soleil était déjà lourd et que nous marchions sous les arbres qui offraient, entre les trouées de lumière verticale, une ombre silencieuse.
…………………………………………………………………………………………….
8 Juin
J’éprouve de plus en plus le besoin de me lever tôt. Peut-être est-ce la chaleur qui est montée rapidement ces jours-ci, nous dépouillant des quelques vêtements d’hiver portés il y a peu de temps encore. Je ne suis pas allé dire au revoir aux fidèles de chez Sauveur. Ils savent que je serais ce samedi à Séville. J’en ai profité par contre pour monter chez Luc, mon coiffeur portugais, pour lui relater mon passage à Lisbonne et à Porto. Il confirme qu’on prononce le nom (Camoès) du héros de la grande épopée littéraire de l’aventure portugaise autour des mers, Camouèche. Ce qui donne en entier, Luiche dé Camouèche.
Ce qui serait presque Camouèïche…
…
Les rues de la vieille ville sont assez désertes en milieu de matinée, et je trouve surprenant, venant du Portugal, de voir à Nice tant de mendiants, de visages brunis et rougis par l’abrutissement, de ces colonies de gens venus de si loin. De l’Est, des Balkans, de Roumanie.
La France se dit généreuse parce qu’elle est la dernière étape où vient aboutir tant de misère du bout du monde.
Seuls, ceux bénéficiant des mannes de la république, issus des pays d’Afrique et surtout d’Afrique du Nord, du regroupement familial et de tout un arsenal d’avantages sociaux, peuvent vivre d’un niveau bien supérieur à ce que serait le leur dans le pays d’origine. La France s’enorgueillit de ne pas choisir son immigration, de naturaliser, de reconnaître le droit du sol, et de prendre dans ses bras l’ensemble des misères qui franchit le seuil du territoire. Cette immigration venue ici, notamment depuis la faillite de l’Indépendance algérienne, entraînant aussi dans une spirale aspirante ceux des pays voisins de l’Algérie, a échoué dans l’idée d’une possible intégration.
Parce que dans son cœur elle ne l’a jamais voulue.
Pour paraphraser tristement Lacan dans sa définition de l’amour, je dirais que nous sentons que notre pays « veut donner quelque chose qu’il n’a pas à quelqu’un qui l’exige et qui ne rendra que mépris en retour ». C’est la situation paradoxale d’une France généreuse par devoir d’humanisme qu’elle s’impose dans son souci d’universalité, qui n’a jamais mesurée la fracture issue de l’échec d’une intégration que ne désirent pas les banlieues et les communautés concernées.
Je me souviens que vers 1992, le roi Hassan du Maroc, interpellé par Madame Anne Sinclair, du temps où le vent de l’idéologie de l’époque était certain que dans les décennies suivantes l’intégration serait un bienfait, avait alerté celle-ci : « Je connais très bien mon peuple, jamais vous ne ferez de petits Marocains de véritables Français. Nos mœurs, nos coutumes et notre religion passeront toujours dans notre être fondamental et notre sensibilité, avant le fait de se considérer comme citoyen Français ». Prophétique Hassan II.
Dans les rues de Lisbonne je n’ai vu aucun mendiant. Pas plus que je n’ai vu d’étrangers profitant des avantages offerts par le pays. Les ressortissant de Goa et des divers anciens comptoirs indiens sont aujourd’hui intégrés dans le circuit de la vente de produits touristiques, de bimbeloterie, de cartes postales et d’objet de souvenir . On leur a octroyé, et c’est honnête vis-à-vis d’eux, cette exclusivité leur permettant de trouver leur place dans la société portugaise. Cela demeure dans des proportions acceptables pour tous.
D’assistés sociaux et de bénéficiaires de droits exorbitant au titre de réfugiés ou d’anciens ressortissants de colonie, le Portugal n’en a pas.
De fanatiques islamistes non plus. Ceux-ci, ne pouvant bénéficier d’entrée de complaisance dans le pays, ni d’avantages sociaux, restent à l’écart.
Le Portugal invoque que la modestie du pays ne peut permettre de telles largesses.
C’est par contre la France d’un ancien monde qui n’est plus, qui garde ce vieux réflexe d’opulence et de générosité qui a vu se développer, et avec toujours plus d’arrogance, une faillite communautariste de plus en plus affichée.
Et à l’autre bout de la chaîne, les épaves échouées, depuis la refonte des pays de l’Est, par cette même illusion que nous offririons une terre de cocagne.
……………………………………………………………………………………………
Bernard me disait que s’il avait été de la génération de nos enfants il eut été un enthousiaste amateur de virtualité. Sa formation d’informaticien, son goût pour la science fiction le porteraient naturellement vers cet univers dont je me suis toujours méfié. Je lui ai répondu que pourtant« la virtualité peut faire rêver, et ce n’est pas moi qui penserait le contraire, puisque dans le champ de la poésie, si ce n’est du virtuel qui s’exprime, c’est du moins du réel sans réalité. Mes mensonges sont mes réalités et celles-ci prendraient bien la place de mes mensonges si la réalité ne se restreignait pas tant ».
…………………………………………………………………………………………….
Irais-je voir des courses de taureaux ? Je ne sais. A Arles, la semaine de Pentecôte voit la ville enflammée par la saison tauromachique.
J’ai toujours pensé que Manolete était, en plus d’un exceptionnel et unique matador, un artiste du geste tauromachique qui tenait de la haute calligraphie.
Il enroulait dans le cercle de la mort comme on endort un enfant. Il ne faisait aucun geste inutile, et faisait beaucoup moins de pas que les autres. Avec la fluidité naturelle.
Sa mère qui ne vivait pas lorsqu’il était dans l’arène se prénommait réellement Angustias (Angoisses).
Voilà, je suis déjà un peu sur le chemin…
……………………………………………………………………………………………
SEVILLE
Samedi 8 Juin
L’Andalousie sera brûlante. Nous devrions être à Séville en fin de journée. Hôtel Simon, Garcia de Vinuesa, 19… Ca sonne comme un nom de notaire, tout prêt des arènes, si ce n’était près des remparts …
Depuis l’avion qui descend maintenant résolument vers Séville, ce ne sont que des marqueteries de bocages, des jaunes et des verts, enserrant des villages ou de petites villes que l’on prendrait pour des forteresses tant la densité de leurs tortueuses rues vues du ciel dans leur compacité, les fait paraître comme des îlots solitaires dans cette mer agricole.
Au cœur de la ville, au bord du Guadalquivir. Immédiatement, une statue dédiée à Mozart, peu réussie, mais comme un signe.
Après un dédale de ruelles aux badigeons jaunes et ocres sur fonds blancs, les balcons avancés aux fenêtres closes par des verrières qu’on appelle cierros (un peu ce que sont les échauguettes de nos châteaux) donnent l’impression qu’on ne veut jamais tout à fait se départir d’une jalousie latente en ayant en même temps un regard sur le rue.
Les rues sont donc terriblement animées, et le seront peut-être même au-delà de la nuit. C’est ici comme le plein jour avec le soleil en moins. Mais à l’heure de notre arrivée la nuit est loin d’être tombée. La Giralda surplombe de son aura tout le quartier avec l’Alcazar qui donne ses derniers feux. Vers vingt heures on peut encore se promener à l’extérieur des jardins et sur la Place de l’Alianza.
Pour les premiers tapas, c’est en traversant simplement la rue pavée de l’hôtel que nous entrons chez Diaz Salazar, bistro plus que centenaire, où nous attendent le vin de Jerez, les brochettes de bœuf marinées au safran, le boudin noir et les supions au beurre aillé.
Nous déambulons sous les mille feux de la ville entre la Place San Francisco, le Palais de l’Inquisition en remontant les ruelles de Santa Cruz par la Calle Guzman el Bueno, et la Calle Matteos Gago qui semble le poumon touristique des alentours de la Giralda. Devant l’un des multiples bar restaurant deux portraits en médaillon du matador Juan Belmonte. L’ancien minaret brille comme un énorme cierge dans la nuit sévillane avec à ses pieds les premières calèches aux traditionnelles roues jaunes.
Nous rentrons épuisés à près de minuit. Le patio de l’hôtel est une vraie oasis, avec son bassin au jet d’eau qui coule délicatement sur fond de céramiques aux motifs abstraits, aux plantes grimpantes et aux miroirs géants dans un véritable décor mauresque que surmonte tout en haut une verrière.
Dimanche 9 Juin
Dans la salle du petit déjeuner c’est tout un décorum oriental qui nous attend, des faïences ocres et jaunes, des arcades et depuis le patio, le tintement léger du jet d’eau.
REAL ALCAZAR
Il faut avoir entendu les volées de cloches de la Cathédrale, drues et graves sur plusieurs tonalité durant la longue file d’attente à l’entrée du Real Alcazar, avec les calèches qui se rassemblent et viennent se positionner pour la journée qui commence petit à petit dans ce décor de carte postale.
L’entrée du Palais se fait depuis une immense place ouvrant sur une façade austère. Mais décrire par le menu cet Alcazar relève d’un bien difficile défi, tant la luxuriance et l’abondance de l’architecture et de l’environnement sont complexes.
Dans le maelström de tant de luxe on ne peut qu’être interdit et silencieux.
L’Alcazar de Séville, avec ses plus de mille années d’histoire, est l’un des édifices les plus riches au monde, de par la diversité et la singularité de ses pièces qui sont presque parfois des labyrinthes conduisant à chaque pas à travers les moments clé de son histoire. Depuis l’arrivée des rois des taïfas, le califat almohade, la transformation castillane etc. Dans ces espaces résonnent encore les pas des personnages aussi fantastiques qu’Al-Mutamid, Ferdinand III « le Saint », Pierre Premier « le Justicier », Isabelle de Castille ou l’Empereur Charles.
L’histoire de l’Alcazar islamique est l’histoire même de la ville. Une histoire dynamique et grandissante, tant en politique qu’en terme d’architecture. Actuellement encore, une grande partie de ses murailles et l’ensemble du corps du palais sont conservés, bien que masqués ou retouchés par les différents pouvoirs installés depuis la reconquête espagnole.
Les murailles entourant le Patio de Banderas, sa façade originale, ainsi que le Palacio del Yeso et une grande partie du Patio del Crucero appartiennent à la période islamique.
A partir du XIII° siècle, les castillans se sont adaptés à la vie de palais, en transformant le sens et l’usage de ses différents espaces.
Les différents maîtres des lieux ont choisi de superposer un édifice emblématique nouveau par sa qualité et sa symbolique sur ce qui avait été le principal palais almohade.
Le Palacio Gotico a mis en scène la transition drastique du nouvel ordre chrétien mais dans le reste des édifices de la casbah islamique chaque édifice a continué d’être habité en ne modifiant pas sa physionomie au cours des siècles postérieurs à la conquête.
Les fouilles archéologiques ont mis en évidence les deux processus en soulignant le spectaculaire changement provoqué par le roi Pierre Ier à partir de 1356 qui a entraîné la disparition définitive de l’organisation interne almohade.
Le cœur de l’actuel Alcazar est son Palacio Mudejar, son joyau le plus précieux, fidèle témoignage d’une époque de splendeur, de panache et d’une personnalité rare de l’histoire de l’Andalousie.
L’Alcazar ne s’envisage pas non plus sans ses jardins, dont la diversité et l’harmonie témoignent de la splendeur de Séville à partir de la Renaissance. Confrontés au grand Palacio Gotico et au Palacio Mudejar, les jardins à l’italienne de Las Damas, La Donza, Troya, Galera et Flores, s’étendent vers le sud de manière ordonnée, à l’ombre de la muraille almohade.
Et sur leurs flancs est et ouest, se développent les jardins del Marquès de la Vega Inclàn, de style français, et le Jardin Inglès, démonstration des styles dominants au début du XX° siècle.
Au cœur des jardins, solitaire, le palais mauresque de Charles Quint.
C’est là que viennent et montent en plein midi, les évocations et les exhalaisons de ces Nuits dans les jardins d’Espagne de Manuel de Falla que je n’aurai jamais respiré d’aussi près.
….
Après ce bain d’esprit et d’histoire, il se trouve qu’il est déjà treize heure trente. Il aura fallu trois heures pleines pour prendre la mesure de la merveille de Séville. Pour n’en considérer que ce que je crois être une première approche, furtive et comme issue maintenant d’ une réalité diaphane.
Le vin de Jerez se prend à l’ombre de la Giralda, au bar Manolete, où l’on peut voir quantité d’affiches tauromachiques dont celle, l’originale du 28 Août 1947 à Linares où figure, de pied en cap, Manolete avant son dernier combat. En bas de l’affiche, le nom de celui qui l’accompagnait déjà, Luis Miguel Dominguin.
Comme la Catedral ne se visite pas dans son ensemble à cette heure de l’après midi, on se contentera d’un bref passage dans les allées latérales où l’orgue se fait entendre sur les grands jeux. Quel meilleur complément à la délicate vision des merveilles architecturales de l’Alcazar ?
A la Bodega Diaz Salazar, qui existe depuis cent onze ans, c’est la deuxième pose, bien à l’ombre, pour un autre type de Jerez, désaltérant à un euro soixante, le prix d’un affreux rouge chez Sauveur…
La lumière est encore forte, elle découpe parfaitement les reliefs . Les lunettes noires s’imposent pour une polarisation parfaite.
Par l’Avenida de la Constitution , perpendiculaire à celle de notre hôtel et parallèle à la Cathédrale, on accède à la jolie Puerta de Jerez et son grandiose hôtel Alphonse XIII (où séjourne à l’occasion la famille royale qui ne va plus à l’Alcazar), dans le grand style andalou, de ferronneries, de balcons en cierros sur ses quelques cinq ou sept étages.
Sur l’Avenida San Fernando qui fait suite, d’une belle largeur, c’est la trouée du tram qui trace en diagonale le centre de la ville, aux maisons franchement ocres, alternant avec celles de la plus grande blancheur. C’est sur la partie la plus rectiligne que l’on s’aperçoit, que l’on y pense parfois ou non, que nous sommes au pays de Carmen. Tout le long de l’avenue et légèrement en retrait, s’étire la grande Manufacture des Tabacs que de petites faïences le long des murs rappellent en de jolies lettrines torsadées.
PLAZA DE ESPANA ET PARC MARIA LUIZA
Puis c’est enfin la Place d’Espagne dans la pleine lumière, sans aucune ombre sur tout le gigantesque demi cercle qui la compose. Deux cent mètres de diagonale, peut-être plus. On ne mesure pas les impressions d’infini.
C’est l’orgie de la faïence.
La Plaza de Espana a été conçu pour l’expo Ibérico-américaine de 1929. Symbolisant par sa forme, l’Espagne accueillant à bras ouverts ses anciennes colonies. Elle regarde vers le Guadalquivir, ce dernier représentant le chemin vers l’océan Atlantique et vers l’Amérique. Un canal parcourt l’arrondi de la place ainsi qu’une grande partie de son côté rectiligne, ne s’interrompant que pour laisser accès au centre de la place et à la fontaine, ce qui donne parfois à ce lieu un petit côté vénitien..
Quatre ponts consacrés aux royaumes de Castille, d’Aragon, de Navarre et de Léon relie la place centrale et le palais, symbolisant l’unité politique de l’Espagne.
Ce qui éblouit dès l’approche de la place c’est la succession des cinquante deux bancs de pierre revêtus d’azulejos, non pas bicolores comme souvent au Portugal, mais de toutes les couleurs, représentant les cinquante deux provinces d’Espagne, avec à leur pied la carte colorée de chacune des provinces. Les espagnols se faisant souvent photographier devant leur province d’origine ou de leur province de cœur.
Ici, en effet, chaque banc relate un événement, une bataille ou un haut fait glorieux concernant chaque région.
La chaleur y est difficilement supportable, à moins de trouver refuge sous les arcades au-dessous du palais.
Plus au sud, à la recherche de quelque banc et surtout d’un peu de fraîcheur, il n’est qu’à poursuivre vers l’immense Parc de Maria Luiza qui borde le Guadalquivir et qui par sa superficie est un des poumons de la ville.
Le Parc abrite de nombreux étangs et de fontaines. Parmi les plus célèbres, la Fontaine aux Lions, la Fontaine aux Grenouilles et l’Etang des lotus d’or. C’est un lieu réellement romantique qui doit donner toutes les puissances de son charme au printemps et à l’automne. Il y a même un parc destinée à la lecture et à la mélancolie. Je prends ces notes sous un merveilleux parasol de Chine aux branches de boa comme surgies de terre dans l’urgence.
Des monuments ponctuent ces havres de fraîcheurs, parmi lesquels le Monument à Cervantès et celui à Gustavo Adolfo Becquer. A la droite de celui-ci, Cupidon lançant des flèches à trois jeunes femmes. Puis, Cupidon mourant. Une scène inspirée des vers d’un recueil de poésie de l’auteur, Rimas.
La Fontaine aux Lions montrent quatre d’entre eux portant chacun un bouclier placé sur quatre des huit faces d’une fontaine octogonale dans laquelle ils crachent de l’eau.
Nous éloignant des sortilèges tranquilles de ce Parc, nous longeons le Guadalquivir , puis remontons vers le centre ville par la Calle Roma et la Calle Adriano qui donne le dos aux arènes., pour un Tio Pepe chez Baratillo.
Maintenant, ce sont les Arènes. D’abord, nous tournons autour. Les souvenirs des héros de l’arènes ne manquent pas. Les sculptures dominant de leur piédestal le très large boulevard au bord du fleuve, le paseo Cristobal Colon, celle de Curro Romero, Manolo Vazquez et celle de Pepe Luis Vazquez. Et à l’ombre des arbres, presque à l’abri des regards, face aux arènes, en forme de défi, Carmen, que les sévillans n’ont pas manqué de faire figurer dans leur mythologie tauromachique.
19 h 30
S’il me fut donné un privilège, c’est bien ce soir de dimanche où j’ai pu me trouver seul avec Cécilia au cœur même de ce temple de la tauromachie.
Le soleil était déjà bas, la lumière semblait rejaillir avec plus d’intensité, les statue des matadors de légende prendre une ampleur tragique avant la tombée du jour.
Je désirais simplement pénétrer dans les arènes et photographier le gigantesque cirque d’ocre et de rouge dressé aux murs blancs ceinturant du même rouge plombant l’ovale de la cendrée immaculée.
Pour cela il eut fallu perdre une bonne heure de visite guidée obligatoire et manquer cette qualité de soleil qui ajoutait au drame de cette enceinte pure d’architecture et de légende tauromachique.
C’était risqué, mais devant la contrainte de supporter les généralités d’usage sur le sujet, les faits saillants de l’histoire des arènes et tant d’autres considérations sur la qualité des taureaux, ce qui en soi, dans d’autres circonstances eussent été intéressantes, nous prîmes le risque de refuser la conférence, prétextant que je maîtrisais mal l ‘anglais et que mon espagnol serait défaillant sous l’avalanche des détails et la rapidité du discours de la conférencière.
Nous dûmes être convaincants, puisque totalement désarmée, la responsable de la visite nous invita à nous diriger directement vers le mur d’enceinte et l’entrée dans l’arène… Seuls.
J’ai mesuré immédiatement l’ampleur de la situation. Seuls dans l’ovale magique de l’arène la plus prestigieuse qui fut ! A une heure où le feu de la lumière ajoutait un dramatique silence à l’épure de cette architecture conçue pour la plus grande des solitudes des matadors, de l’homme et de la bête, délivrant la mort et la gloire, l’ombre et la lumière, la géométrie initiatique du prélude au sang..
Je devais être minuscule au centre de cette arène faite pour des jeux de mort et de gloire, de combats d’homme et d’animaux, de bruits et de fureur, là où ce soir, exceptionnellement, je pouvais mesurer dans le silence coupé parfois par quelque oiseau dans le ciel, la dimension gigantesque de ce terrain de jeu, d’angoisse et de défi, jusqu’à la ligne d’horizon, entouré au loin par les limites du terrain où rien ne peut plus venir du monde extérieur.
Les photos furent parfaites mais comme venues d’une irréalité tant ma présence ou celle de Cécilia sur ces lieux devenues désertiques par enchantement pouvaient sentir un artifice de studio de cinéma.
Mais c’est bel et bien un moment unique, véridique et presque inespéré dans ma vie, qui venait de se produire.
…
Ma grand-mère maternelle, celle du Tarn, née Taurines, m’aurait-elle donné ce goût pour l’arène ?
…
CANTAOR
S’il est un paradoxe, ou simplement une surprise, c’est qu’il est devenu difficile, voire impossible, d’assister à Séville à une soirée de Cante Jondo. Dès le premier soir, l’accueil de l’hôtel nous promit de réserver pour nous une soirée flamenco. Je me méfie souvent des gens parlant de flamenco. Dans leur esprit, et plus peut-être pour des sévillans ayant affaire à des touristes, flamenco signifie danses gitanes frénétiques et sensuelles dans des costumes de traditions, de jupes compliquées, de chants mixtes à plusieurs, d’éventails et de claquements de talons endiablés, accompagnées de quantité de guitaristes sombres et résolus. Ce type d’exercice évidemment peut se trouver fréquemment et même à n’importe quelle heure dans la ville. Mais trouver une soirée de ces chants venant du plus profond de l’âme depuis la nuit des temps est chose devenue rarissime.
A l’origine, c’était les maréchal ferrants qui chantaient les douleurs de toujours accompagnés du marteau sur leur seule enclume. La guitare n’est venue que bien plus tard.
Il est d’autant plus rare d’entendre ces chanteurs aux voix venues des entrailles de l’âme qu’un même chanteur de légende peut être mauvais le lendemain même d’une soirée d’anthologie où le duende s’est manifesté.
Donc, ce soir de dimanche je restais méfiant quant à la soirée qu’on nous a finalement conseillé de passer à la « Carneria », tout en haut de Santa Cruz. Pour y accéder, les ruelles et les tortuosités du quartier semblaient bien s’accorder à cette perspective de chants des grands tourments.
Et c’est dans une première enceinte de terre battue, d’arbres sous lesquels quelques tables aux bouteilles vides laissaient penser que devaient se faire les entractes ou les pauses des spectateurs.
A l’intérieur de la seconde enceinte, qui n’était autre qu’un méchant hangar surchauffé, une foule compacte dont une grande majorité de femmes se serrant autour de quelques tables et de consommations répandues, que jaillit de la plus lointaine douleur la voix du cantaor.
Pleine, velouté, âpre. Assis sur une chaise, un verre d’alcool fort à ses pieds, accompagné à sa droite par un guitariste à l’écoute des moindres frémissements, entrecoupés des olé d’encouragement comme des incises incitant à trouver encore plus dans les profondeurs, du danseur qui interviendra comme en forme d’interlude, l’artiste égraina les chapelets de coples de son répertoire.
Manifestement les femmes étaient venues pour le jeune danseur et le brillant de leurs yeux trahissait le plaisir de la contorsion.
Je fus même gêné par ce que j’ai cru être une américaine blonde qui se comportait à l’écoute du grand chant dans l’attitude de la connaisseuse dodelinant de la tête à la manière qu’elle aurait eu pour un concert d’Eric Clapton.
J’ai pu échanger quelque mots à la fin, avec le chanteur qui me vendit son disque, tout en m’excusant pour le public et sa médiocre qualité d’écoute.
-Necesito algo para comer…
Ce n’était peut-être pas Camaron ou Mairena, mais ce Javier Allende avait tout de même du Jondo dans son art.
Au sortir de ce fond du Santa Cruz, le grand cierge éclairé du clocher ocre et rouge de San Bartolomeo laissait voir les plaies de ses plâtres et de ses badigeons sous les éclairages de la nuit.
Pour revenir à l’hôtel, nous prenons plaisir à faire semblant de nous perdre dans les dédales du Santa Cruz encore effervescent.
Lundi 10 Juin
TRIANA
Isaac Albeniz a écrit une Iberia pour piano, chef d’œuvre de la musique pianistique espagnole du début du XX° siècle et de tous les temps, ciselée à tel point que chaque note est accompagnée d’une intention d’attaque, de respiration ou de rythme d’exception, d’un geste musical extrêmement contraignant, notés par le compositeur. Les titres sont largement inspirés par des quartiers de villes andalouses.
J’aimerais un jour futur connaître l’ El Albaicen de Grenade et le Lavapiès, autres lieux de la plus pure inspiration de veine andalouse. Aujourd’hui, ce sera ce fameux Triana qui nous fait signe depuis deux jours depuis l’autre rive du Guadalquivir, avec ses maisons alignées bleues, blanches, jaunes et rouges vues du nord.
Ce matin le réveil a été évidemment plus tardif. Il devient inutile d’avoir des doutes sur les intentions du ciel. Dans un pays où la passion fibre la pierre, la chair et la moindre inflexion de l’esprit, le temps ne peut que se fixer au beau qu’on croirait qu’il peut le rester éternellement.
Aux abords du Puente de Isabel II , avant de le franchir, comme un signe de gitan qui a été éternisé dans le bronze, le grand cantaor Antonio Mairena, toutes veines saillantes au front, premier d’une dynastie flamenquiste du plus pur jondo, semble jeter un cri nocturne dans ce matin éblouissant.
L’arrivée sur la Place Altozano où se trouve le Castillo San Jorge et le minuscule square au buste fier de Juan Belmonte donne une note populaire vive et saillante, où pleurent aux façades des maisons, des Vierges couronnées dont les couronnes sont deux fois plus larges que les têtes des Vierges, comme pesant d’une charge de royauté qu’on ne saurait estimer, des cierros plus accusés, et cette merveilleuse pharmacie Murillo de Santa Ana dont les murs sont entièrement revêtus entre les étalages des familles de médicaments, de faïences à dominantes jaunes et vertes.
Plus surprenant, dans cette sculpture du flamenco, l’enclume du chant profond sur laquelle se dresse la représentation féminine qui le symbolise.
Triana semble soudain d’un monde différent. A la fois plus pauvre, plus humaine et plus fière.
Le temps y semble ralenti aussi. Les touristes plus rares à cette heure. Nous longeons la Calle San Jacinto jusqu’au Collegio Salesianos, imposant comme un château autrichien. A l’intérieur de l’église du collège, une grande, douloureuse et splendide Vierge en robe de velours sombre attire les sévillans muets qui se signent en ce lundi de Pentecôte. De l’autre côté de la rue, la reproduction de cette même Vierge est plaquée de faïences entre deux étages d’un immeuble de dentistes pour pauvres. Et ainsi, dans chaque rues de Triana, une Vierge protectrice et couronnée défend la rue ou la maison dont elle dépend et où elle est probablement reine des lieux.
Le plus pur du quartier se situe aux abords de ces ruelles souvent très étroites qui longent le Guadalquivir qu’on aperçoit aux angles de chaque pâtés de maison et par la calle de Triana, qui mènent, pour le plus beau des décors de poésie à la Chapelle Santa Ana et la petite place du même nom, aux magnolias gras et aux troncs géants comme ils le sont tous à Séville, et où le silence est tel, que l’on n’entend que les exclamation du garçon de café , visiblement maître des lieux.
Par contre le verre de Tio Pepe est toujours servi dans des verres de tradition aux cols tellement étroits que je sens en moi passer la fable du Renard et de la Cigogne…
La chapelle domine, par sa seule autorité et comme son centre de gravité, le quartier, qu’on en a installé alentour les principaux cafés encore endormis à cette heure.
A l’intérieur, le retable du chevet est la partie la plus majestueuse avec ses images de Sainte Anne, de la Vierge (XIII° siècle), entourés d’une quinzaine de tableaux du XVI° aux XVIII° narrant la vie de la Vierge, de Saint Pierre, Saint Paul et tout au centre du retable, Saint Jean Baptiste et saint Jean.
A l’entrée, un retable tout en largeur, d’un bois apparemment fragile, une œuvre importante de Alejo Fernandez des environs de 1525, la Vierge à la rose et les niches latérales contant les aventures de Saint Philippe Neri et de Saint Jean Népomucène.
La lumière de presque midi renforce encore les reliefs, fait flamber la multiplicité des tonalités des façades, des ocres aux mauves et des roses aux moutardées, dans le désordre le plus artistique, rehaussé de bougainvilliers et de cierros tout le long des rues du quartier.
J’ai noté un café aux céramiques bleues qui doit bien rendre l’âme ancestrale de Triana, le Bistek, encore solitaire, mais sûrement éveillé la nuit aux premiers accords de guitare, à l’heure où les parfums commencent à respirer.
Triana a une âme qu’on ne confondrait avec aucune autre. Nous nous fondons dans ses multiples replis qui ont le charme de sa langueur, de ses vierges qui pleurent et de ses femmes aux balcons qui exposent à la curiosité tout le tragique goyesque d’une antique errance gitane.
C’est ainsi qu’après la chapelle de los Marineros, emplies de merveilles avec sa Vierge protectrice en robe rouge, on rejoint, pour finir notre boucle, la Pharmacie Murillo Santa Ana sur la place Altozano et le marché couvert à l’heure du Tio Pepe servi dans un large verre et la barquette de fruits frais.
Plus à l’ouest dans Triana, c’est le quartier des céramiques, des ateliers aux merveilles artisanales, des entrées de maisons préludant aux patios fleuris, à l’ombre et au silence.
…
Puis le Pont Saint Isabelle en sens inverse, où la Giralda et la Cathédrale, vues de loin dominent la rive nord de la ville et le Guadalquivir qui souffle un léger vent et un air de fraîcheur fugitif, la remontée par la large Calle San Pablo jusqu’à la Magdalena, toute rose et bleue enserrée par les maisons qui lui ont pris son espace qu’on ne peut qu’en deviner la coupole, et parfois le clocher, suivant les points de vues alentour.
On achète un petit picador avec son taureau pour Y, dans une boutique au parfum de naphtaline semblant sortir du temps de l’enfance.
Sur la Place Dona Carmen, arborée, le buste fier du Nino Ricardo, guitare à la main, et quelque maisons bleues et jaunes s’harmonisant aux troncs géants de magnolias comme issus de forêts tropicales.
Le Metropol Parasol est une parenthèse dans cette belle unité qui mène du fleuve aux boulevard grouillants débouchant au nord. Son allure de champignon géant percé d’alvéoles et de replis ne masque pas la matière déjà vieillie qui est le propre des grandes architectures urbaines métalliques contemporaines.
Depuis une étroite ruelle, on aperçoit comme vue d’une tranchée ouverte sur le ciel, le bulbe rouge et bleu d’une église comme il y en a tant dans ce quartier où les larges boulevards ont fait place à de minuscules trottoirs, à des chaussées pavées et des véhicules qui ont à peine de quoi éviter les passants.
Saint Ildefonse apparaît, carrément ocre et jaune, aux couleurs exagérément soutenues, telles les couleurs du drapeau de l’Espagne, et au débouché du chemin improbable, le petit enfer de la file d’attente devant la Casa de Pilatos, où une statue sur la placette du même nom, d’un sévère Zurbaran, anguleux et ténébreux, nous observe une heure durant.
La « maison de Pilate » est un palais aristocratique, qui avec l’Alcazar est le prototype même du palais sévillan. Bâtie essentiellement aux XV° et XVI° siècle, elle marie, autour de plusieurs patios et jardins, les styles mudejar, gothique et renaissance. On croirait parfois se sentir traverser une peinture de Delacroix ou émerger d’une vision d’un clair obscur de Rembrandt et peut-être mieux encore d’un scénario idéal d’un orientaliste fin du XIX°.
Des bancs de pierre recouvert d’azulejos incitant au repos et à la contemplation se trouvent aux pieds de chaque large et haute fenêtre à deux arcades séparées par de fines colonnettes. C’est un décor de mille et une nuit sculptant les ombres et les trouées de lumière s’insérant et participant à l’architecture même des allées du palais.
De très bienfaisants courants d’air soulagent des fatigues et nous trouvons quelques instants de repos sur ces bancs qui encadrent chaque fenêtre donnant sur la grande cour.
L’escalier constitue sûrement l’un des plus beaux trésors du lieu. La cage étant pourvue d’un riche décor de faïences surmontée d’un plafond de marqueterie et d’une impressionnante coupole sur trompe en bois doré.
Les jardins révèlent la conception plutôt intimiste servant d’écrin à des espèces végétales qu’on pourrait trouver dans tous les jardins tenus dans la simplicité par les amoureux des jardins : arbres fruitiers, palmiers nains, orangers, magnolias, jasmins de Madagascar.
Le plus grand est organisé autour d’une fontaine, au milieu d’un beau beau décor architectural, dominé par une galerie et une loggia.
Le plus petit marque une influence mauresque intimiste inclinant aux rêves qu’on fait à l’écart du monde.
La maison de Pilate est l’oasis du luxe du calme et de la volupté au cœur d’une ville baignée de ce soleil andalou qui ne nous aura pas quitté de tout le jour.
Cécilia est attirée par un magasin de céramiques, sur la jolie place de Jesùs de la Pasion, représentant des petites maisons en faïences vernies à toits pointus faisant penser à l’enchantement de celle d’Hansel et Gretel.
Nous rentrons par les ruelles qui portent des noms différents tous les cinquante mètres, dès que celles-ci inclinent à droite ou à gauche sans prévenir, en essayant de nouvelles Manzanilla dans divers bistrots, tous excellents, jusqu’au buste de Cervantès, mi sérieux mi moqueur, aux portes de la Place San Francisco où s’achève le périple du jour et son lent crépuscule.
C’est la dernière soirée dans Séville, Calle Gago, chez Belmonte, à défaut de trouver un équivalent à notre Diaz Salazar fermé depuis le début des festivités du dimanche.
Il y fait frais, le poisson est bon. La nuit tombante sur Santa Cruz traverse en silence ses rues et ses secrets.
Par le hasard d’une cour ouverte éclairant un espace aménagé en cinéma improvisé en plein air, on nous propose, en forme de promotion pour un film documentaire de voyage, un portrait de nous, avec pour fond, une destination de notre choix. Nous avons opté pour le Japon.
Mardi 11 Juin
Revenus tôt ce matin vers les larges avenues menant au Musée des Beaux-Arts, seul, dans un square qui mène au musée, enserré entre une banque, et quelques immeubles modernes, le buste de Velazquez, sur piédestal, moustache au vent et pinceau inspiré, semble bien réussi en regard des sculptures généralement insipides et simplement considérées comme du mobilier urbain se remémorant les gloires de l’Espagne.
Devant le Musée, cette fois c’est Murillo, si haut dans le ciel qu’on doit lire le cartouche à mi piédestal pour connaître le nom du personnage triste et solitaire qui flotte tout là-haut, comme un veilleur inquiet.
La Pinacothèque de Séville a été érigée sur l’emplacement d’un ancien couvent et ouvre ses portes vers le milieu du XIX° siècle comme « musée de peintures ».
Réparti sur une quinzaine de salles sur deux niveaux, l’intérieur conserve cette allure de vieil hôpital aux galeries hautes et aux escaliers incertains. Elles se repartissent dans un sens chronologique, allant du Médiéval espagnol dont on remarque surtout un Bartolomé Bermejo, aux peintres espagnols du XX° siècle.
C’est surtout les salles intermédiaires qui attirent l’attention avec le maniérisme et le baroque européen où un seul Velazquez se fait difficilement remarquer par les tons sombres et la composition inattendue.
Deux Bruegel le Jeune présentent un Paradis terrestre et un Paradis aux animaux, Cornelis de Vos, collaborateur de Rubens, un Portrait de Dame, puis toute une litanie de peintres espagnols dont trois se démarquent à mon sens, Juan de Uceda et une grandiose Dormition de saint Hermanégilde, une Vision de saint Basile de Herrera le Vieux et un Martyre de Saint André de Juan de Roelas, tous trois de l’école de Murillo. Quelques tableaux ténébreux de Ribera dont un Christ aux outrages d’un grand réalisme.
Nous étions venus surtout pour Zurbaran le sévillan. Pour le saint Hughes au réfectoire, les Christ aux ténèbres, Saint Grégoire le Grand mais la surprise est venue de ses portraits de femmes, de pied en cap, tout à la fois dépouillés de décor, rendant austère l’ensemble, contrastant avec l’extrême réalisme des expressions des visages et des attitudes presque sensuelles.
Dans l’empressement de découvrir ces Zurbaran nous avons omis, ce qui est peut-être le chef d’œuvre du peintre, l’Apothéose de saint Thomas d’Aquin, exposé dans la salle de Murillo et l’école sévillane du baroque.
Un Goya et un Greco inattendus complètent cette visite où nous fûmes, à part un groupe d’étudiants assez ébahis et comme perdus, parmi les rares visiteurs à cette heure matinale.
Poursuivant « par les rues et par les chemins », les maigres colonnes solitaires et abandonnées d’Hercule et de César à leur sommet, ne semblent pas nous voir au bout d’une longue esplanade.
Je ne saurais dire le charme de ces rues et de ces chemins, qui s’écartant soudain des avenues plus larges, deviennent, sans prévenir, de maigres boyaux pavés, cherchant le nord de Macarena, comme hier ils cherchaient le cœur et les entrailles de la ville jusqu’à la placette de la Casa de Pilatos. C’est toute l’âme andalouse sans apprêt ni beauté particulière qui murmure aux pied de maisons modestes et de trottoirs qui souvent n’excèdent pas quelques centimètres pour s’élargir timidement un peu plus loin. D’une fenêtre entre ouverte jaillit parfois la voix d’une fillette ou le grondement de la maman très vite disparus de la scène sonore lorsque la rue incline en une courbe imprévisible, à l’aveugle, poursuivant plus loin le charme inattendu d’une nouvelle échappée tortueuse dans des goulets successifs.
Et ceci jusqu’à l’Eglise San Marco, au cœur de cette Macarena, comme s’il s’agissait d’un havre ou d’une étape obligée dans la connaissance de ce quartier, s’ouvrant sur une minuscule place où les premiers jerez commencent à se boire à l’ombre d’une terrasse.
A San Paula, couvent ou ermitage, le temps n’a pas de prise. Nous sommes reçus par de vieilles bonnes sœurs qui ne nous laissent pas visiter sans avoir préalablement refermé les portes précédentes derrière nous avant d’ouvrir les suivantes. La chapelle resplendit de ses voûtes en céramiques de mille couleurs, là où habituellement la pierre fine couronne celles-ci.
Séville, comme Rome, dispose d’une église dédiée à Saint Louis des Français. C’est le cœur de Macarena. Située dans la Calle San Luis, mitoyenne des construction voisines, elle ne dispose d’aucun recul pour qu’on en apprécie la belle façade, et surtout ses tours et sa coupoles vernissées. Elle est nettement inspirée de l’église Saint Agnès en Agone de Rome.
L’intérieur est organisé selon un plan en croix grecque, dotée d’absides semi circulaires, richement décorées, constituant un des sommets de l’art baroque sévillan. Des représentations des grandes vertus figurent à l’autel de chacune des absides, avec au sommet de la chapelle sous terre, la magnifique génuflexion en bois polychrome de ce que je crois être saint Louis.
Nous parvenons tout près de là, à la Casa de las Duenas. Du nom du monastère cistercien de Santa Maria de las Duenas. Le poète Machado y naquit et y vécut ses premières années comme le rappelle une plaque dès l’entrée de la maison.
Comme la plupart des palais sévillans, ce sont les luxes des divers patios et de ses jardins qui accueillent le visiteur, avec ses senteurs, ses palmiers et ses orangers, ses multiples murs de bougainvilliers et ses fontaines discrètes aux faïence de couleurs, dans la structure de ses styles renaissance, sans renoncer ici à l’esthétique gothico-mudejar et plateresque typique de la région. La merveille du palais est sans doute le portique qui entoure les quatre côtés du patio formé de deux étages d’arche et du bassin au centre de celui-ci. Nous longeons les allées aux senteurs multiples au gré des bougainvilliers, des petits bassins essoufflés qui n’ont plus la force de faire tinter leur jet d’eau et les patios donnant sur des salons saturés de bibelots, de mobiliers, de toiles et d’objet d’art amassés depuis le XVII° siècle à aujourd’hui. J’ai retenu un très bel Antonio Carracci et suis resté en extase devant le Ribera du Christ aux outrages, lugubre peinture ténébriste.
Revenus plus au sud, dans le quartier de la Magdalena, sur le bruyant boulevard de la Calle San Martin, à plus de midi maintenant, nous prenons la Manzanilla fraîche à la terrasse du magnifique immeuble qui abrite à l’angle de la Calle Cuna, le café Victoria Eugenia, ses faïences bleues et blanches et les caractères du nom de l’établissement dans un relief de lettres dorées. L’endroit se nomme aussi Baco, Bacchus. L’intérieur qui mène vers des salons de luxe est un patio à l’imitation des plus vrais palais de la ville.
Dans la même Calle Cuna, c’est le Palacio de la Contesa Libreja, la troisième maison mauresque, après l’Alcazar, que nous rencontrons depuis hier.
La maison présente, dès l’entrée dans le patio, un caractère plus intime de par ses proportions plus petites que celle de la Duenas. C’est en 1901 que la comtesse de Lebrija restaura cette riche maison pour y abriter ses œuvres d’art dont des tableaux de van Dyck, de Bruegel l’Ancien, d’autres de l’école de Murillo et des antiquités gréco-romaines innombrables.
Dans le centre du patio, la partie la plus enchanteresse par son élégance, on peut y admirer les colonnes de marbre des piliers du portique et les mosaïques romaines des II° et III° siècles.
Dans l’une des pièces jouxtant le patio, une exposition temporaire de deux tableau de Rubens, d’un Hercule et d’une scène sensuelle de femme à moitié nue comme le sont les opulentes femmes de Rubens qu’on n’attendait pas ici, vient clore la visite d’un lieu isolé des agitations de ce quartier qui transite vers le centre de la ville.
La Catedral est enfin ouverte en ce début d’après-midi, mais j’avoue ne pas avoir compris les heures et les jours d’ouverture et de fermeture de celle-ci, d’autant que cette fin de Pentecôte devait restreindre encore le rythme des moments accessibles. Nous n’y avions fait qu’une brève déambulation à notre arrivée, mais pas eu le plaisir d’en embrasser toutes les parties maintenant ouvertes au public.
L’intérieur, avec la nef la plus longue d’Espagne, est impressionnant de hauteur même si elle est moins élevée que celle de Beauvais ou d’autres en Europe. Dans le corps principal de l’édifice se distingue le chœur qui occupe le centre de la nef, avec ses deux grands orgues que nous avions entendu un bref moment la fois précédente. Ce chœur s’ouvre maintenant sur la Capilla Mayor, dominé par le colossal retable gothique de bois doré, si monumental qu’on ne distingue pas les différents épisodes proposés à l’admiration, ses quarante cinq panneaux sculptés représentant des scènes de la vie du Christ. Ce chef d’œuvre unique est l’ouvrage de toute une vie du sculpteur Pierre Dancart. C’est le tableau d’autel le plus grand et le plus riche du monde et l’une des plus somptueuses pièces sculptées de l’art gothique.
Dans la chapelle royale sont enterrés les rois Ferdinand III le Saint et Alphonse X le Sage. Et non loin de l’immense retable, le tombeau de Christophe Colomb.
La Cathédrale n’en est pas moins aujourd’hui un lieu de frénésie bruyante, où l’aspect muséal donne une idée de ce que seront Notre-Dame de Paris ou celle de Chartres dans quelques années. Les chinois, très nombreux, y ont déjà leurs guides et leurs audiophones.
A quand les starlettes chinoises minaudant en selffies devant un christ en croix ?
La sortie se fait par la grande esplanade arborée donnant tout à la fois sur la belle façade de dentelles gothiques et sur la Giralda qui domine l’ensemble.
C’est maintenant quinze heures passées. La Casa Morales, dans la rue de notre hôtel, qu’on nous avait indiquée comme offrant « le meilleur de l’Espagne du sud » étant fermée, nous passons ce moment de la dernière halte sur la terrasse brumisée de chez Belmonte du côté de la petite rue montante et pavée, Calle Meson del Moro où nous sommes servis par une jeune sévillane aux yeux d’ici, qui ne sait pas que nous quittons Santa Cruz pour longtemps.
…
Séville, ville des madones couronnées de couronnes lourdes à porter
De madones aux robes de vierges mariées
Séville qui sent aussi la queue de taureau confite la manzanilla et le vieux jerez
Séville aux calèches aux roues d’or
Séville la mauresque, de la solitude des arènes, des vieilles rues pavées, des parcs innombrables, et des cierros
Il est encore temps de garder en tête ce Triana d’Albeniz qui respire le parfum des nuits anciennes, le rythme âpre de ses sorcelleries et de ses incessants sortilèges.
…………………………………………………………………………………………….
13 Juin
On connaît peu de choses de Pérotin, sinon par un témoignage de celui qu’on appelle l’Anonyme 4.
…………………………………………………………………………………………….
On déposait à cette date, au cimetière de l’est, mon grand-père, le nono, il y a juste cinquante années. Le même après-midi, nous filions Jo, moi et quelques autres, sur nos petits deux roues, vers la plage de Passable, d’où il reste quelques photos délavées du début de cet été magique.
…………………………………………………………………………………………….
15 Juin
L’Europe à court terme :
La Première Ministre allemande
La Première Ministre britannique
Le Premier Ministre italien
Le Premier Ministre néerlandais
Le Premier Ministre suédois
Le Premier Ministre luxembourgeois
Le Président de la Commission européenne
Le Président de la République française, n’ont pas d’enfants…
…………………………………………………………………………………………….
20 Juin
« Dakota » de Joseph Kane, de 1940. Avec John Wayne. Heureusement Paramount propose ces pépites de western tous les jeudi soir. Un western serré, dense et tranchant, comme on les faisait dans ces années-là, avant d’oublier que le genre concerne, avant tout, les évènements concernant la conquête de l’Ouest.
…………………………………………………………………………………………….
22 Juin
Le portrait de José van Dam s’achevait cette semaine. Un grand chanteur, sûrement un des plus beaux barytons du siècle passé. Insistant particulièrement sur l’intériorité des interprètes de lieder et de mélodies, il en concluait que les allemands, nourris de fortes consonnes avaient les pieds sur terre, et que la mélodie des français les projetait la tête vers le ciel. Il n’était que de comparer le « Ich grolle nicht, ich grolle nicht… » des Amours du Poète de Schumann, à l’Horizon Chimérique de Fauré « Le long du quai les grands vaisseaux… »
Il en conclut malgré tout, que même dans la mélodie française, l’impulsion qui donnera le caractère à une courbe mélodique se fera sur les temps forts proposés par les consonnes.
…………………………………………………………………………………………….
24 Juin
Qui pourrait être plus photogénique que Paul Léautaud ? Il y a chez lui, dans l’accoutrement, les stigmates du Volpone de la pauvreté en chiffons et l’avarice qu’il semble réserver au mouvement même de la vie, un décor de chats paresseux, avec les costumes d’un théâtre où se trouveraient successivement et tout à la fois, Céline, Charles Dullin, Michel Simon dans le rôle de la laideur, les concierges effrayantes au sortir de leurs loges, et quelques fantômes à visages ravinés de vieilles figures de cinéma en noir et blanc.
…………………………………………………………………………………………….
25 Juin
…
Mon ami et grand Scroc’
Je passe dans ma mémoire le temps ou les temps qui ont compté dans ma vie, et j’ai souvenir d’un temps pas si lointain dans l’absolu, il y a seulement cinquante années, où je rencontrais un adolescent au square Alsace-Lorraine (nous devions être un 14 ou 15 juillet de 69). Il avait rendez-vous avec une fille qui était la soeur de celle que j’attendais moi-même…
Ca, je l’ai appris une heure après et nous en avions ri…
On était resté longtemps sans parler et sans savoir pourquoi nous étions là, l’un et l’autre, dans cette attente bizarre, comme Bouvard et Pécuchet quand il se sont rencontrés…
C’est le jour où nous nous sommes vus pour la première fois. J’y pense souvent, cela fait parti de mes repères, de ceux qui nous ont mis sur la voie de la première maturité.
Les choses étaient belles parce qu’elles étaient neuves, les évènements étaient des sillons qui marqueraient gentiment le futur.
Avions nous conscience que nous faisions partie d’une génération exceptionnelle : on se photographiait sur la Promenade des Anglais quelques jours plus tard alors qu’on se connaissait à peine…?
On savait qu’on était dans l’Histoire. La notre, celle de ceux qu’on a connu à cette époque.
Certains marcheront même sur la lune dans quelques jours, le 21 juillet.
On écoutait "white room" et l’avenir était sans importance. On allait devenir grand et on n’avait pas peur de grandir. On a fait partie d’une génération bénie qui n’a pas connu le chômage, la guerre (celle d’Algérie nous a épargné, nous n’avons connu de ces années-là que les yéyé…), et puis nous sommes tous partis pour faire nos vies, nos amours et nos chemins respectifs dans le monde social.
Voilà, je tenais à te faire ces quelques mots qui te feront peut-être partager un peu de cette mémoire que j’ai de ce fameux "bon temps"…
Merci de tes envois de tous les jours. je n’y manque pas, je les lis, les fais souvent passer…
A bientôt, biz
Paul.
…………………………………………………………………………………………..
27 Juin
La canicule a refait son apparition depuis deux trois jours, mais aujourd’hui elle atteint une intensité suffocante qui permet à peine de rester quelques secondes au soleil. Quant à la température, il semble que les quarante degrés ne sont pas loin, voire bien dépassés. Je n’ai pas souvenir de cette fameuse année deux mille trois que les météorologues s’accordent à considérer comme une année exceptionnellement violente, bien qu’elle se manifesta en Juillet ou en Août, ce qui paraît plus normal et plus attendu puisque arrivée progressivement. Peut-être que je n’y étais alors pas du tout sensible. Plus de quinze ans ont passé et je ne peux aujourd’hui que souffrir et fermer derrière moi portes et fenêtres sachant que j’ai la chance de pouvoir ouvrir au nord et au sud quand l’accablement fait place à un peu de répit aux abords de la nuit.
La dernière canicule dont j’ai eu à souffrir, je m’en souviens encore bien, c’est lors des dix jours de cérémonies du Centenaire du Conservatoire, en deux mille quinze. En ce temps pas si lointain que ça, j’étais présent depuis les neuf heures du matin à parfois vingt trois heures. Et j’avais les vêtements de circonstance. Et je travaillais souvent au fin fond de l’auditorium qui sentait sa fournaise comme un four de boulanger, dans le noir et les éclairages qui ajoutaient encore à la chaleur.
Peut-être que ces quatre années de plus m’ont réduit à une vulnérabilité qui ne peut que s’accroître avec l’âge.
Déjà cette nuit, cherchant le sommeil, j’avais le souffle coupé par une respiration qui, de par son simple mouvement naturel, demandait un effort insurmontable. Je dus m’endormir longtemps après que la respiration eut pris un rythme que je ne savais contrôler avant que ne vint le sommeil. Cela me parut long et angoissant. Comme si la qualité de l’air préludait à une sorte d’asphyxie lente que j’en imaginais dans le noir de la chambre le désespoir des naufragés.
Je passe donc une partie de l’après-midi à boire abondamment tout en ayant l’impression que l’illusion de fraîcheur précède un sentiment de plus d’intensité, on dit aujourd’hui un « ressenti », de chaleur.
La lecture elle-même est entrecoupée toutes les cinq minutes pour me mouvoir. Le moindre effort de pensée ou de réflexion participe de la torpeur de cet après-midi et fait l’effet d’une réelle difficulté physique.
Les oiseaux même ne se font plus entendre, les colombes ont déserté le bassin de la fontaine asséchée. Le bruit d’un vent timide et léger semble assourdi par le plomb qui accable.
Nous n’aurions d’accalmie dit-on que dans le courant de la semaine qui vient.
La seule note de réconfort est d’avoir eu le bonheur d’entendre l’interview de Gabriel Bacquier, une semaine après van Dam, deux des très grands Golaud de l’histoire. Je ne sais trop son âge, probablement plus de quatre vingt dix ans, avec cette voix du sud, de Béziers en l’occurrence, qui s’est encore accentuée comme il avait pris artificiellement cette habitude de forcer le trait lorsqu’il fut amené, en fin de carrière, à entamer les rôles de barytons bouffes.
…………………………………………………………………………………………….
On nous parle déjà de l’eau à économiser, des réfugiés à accueillir à l’abri du soleil, des communes, dont on prévoit de mettre à disposition jusqu’à la fin de l’été, les salles chèrement entretenues par ces mêmes communes.
En France aujourd’hui, qu’y a-t-il de plus obéissant qu’un préfet ?
…
…………………………………………………………………………………………….
28/29 Juin
La canicule est d’autant plus insupportable qu’elle oblige à dormir avec les volets fermés. Les seules fenêtres largement ouvertes ne laissent que très peu passer d’air. Et encore de quel air s’agit-il !? Comme dans un tombeau, la sensation de mon propre corps dans le plus grand noir m’est intolérable.
Cette vague intense et inattendue vient au moment où je suis examiné par un infectiologue, après être passé chez une allergologue pneumologue pour mes misères d’irruptions cutanées qui ont commencé à devenir embarrassantes dès cet hiver. On a envisagé une parasitose due à une quelconque ingérence alimentaire. Et cela reste hypothétique.
Vermifugé depuis avant le départ pour l’Espagne où j’avais connu quelque répit, les irruptions sont revenues plus intenses encore la nuit où le contact avec les draps me laissent l’impression d’être passé dans un champs d’orties. Je vois défiler chaque heure sur le cadran horaire et la moindre immobilité dans la position du sommeil réveille des démangeaisons et des brûlures sur n’importe quelle partie de ma peau jusqu’aux bouts des tétons. Un petit enfer nocturne supplémentaire, pour moi qui a toujours détesté d’avoir à subir ces petites morts toutes les nuits.
…………………………………………………………………………………………….
Ce midi je déjeune avec Bernard à la pizza à côté du Sauveur. Les quelques verres de vin bus et l’ampleur de la pizza m’ont laissé au bord du malaise. Je m’en vais dormir d’un mauvais sommeil tout le long de l’après-midi.
…………………………………………………………………………………………….
30 Juin
Dans le Moulin de la Galette (La « Butte Faim » la bien mieux nommée), dans les Canotiers (à « La Fournaise ») de Renoir, le plus important a été la mise en scène mise en lumière. Ce qu’aura bien compris plus tard son fils Jean.
Auguste, à petites touches, aura finalement été l’héritier du Veronèse des Noces de Cana, autre metteur en scène de génie.
……………………………………………………………………………………………
1 Juillet
PARFOIS IL FAUT UN ECLAIR DE GENIE
Chaliapine devait interpréter le rôle de Don Quichotte vers 1920 à l’Opéra de Monte Carlo, à l’époque dirigé par l’extraordinaire Directeur que fut Raoul Gunzbourg, maître des lieux de 1892 à 1951.
Lors d’une répétition, un différent eut lieu entre le chef d’orchestre et la capricieuse star internationale.
Les musiciens d’orchestre, soit par solidarité avec leur chef habituel, soit parce qu’il leur a paru que la star avait quelque tort, prirent parti contre Chaliapine.
Gunzbourg fut immédiatement convoqué dans la loge de la célèbre basse.
Gunzbourg est en nage. Il n’est pas facile de traiter avec le chanteur.
-« Si les musiciens ne s’excusent pas, je ne chante pas demain soir ».
Gunzbourg a du mal à convaincre.
Le lendemain, deux heures avant la représentation, Chaliapine se trouve dans sa loge, se maquille, revêt le costume de Don quichotte et se trouve fin prêt bien avant le début de la représentation.
Lorsque Gunzbourg vient aux nouvelles, Chaliapine, comme la veille :
-« Voilà, je suis prêt, mais si les musiciens ne s’excusent pas, je ne chante pas ce soir ; »
Gunzbourg est en nage.
Et alors, un petit miracle se produisit : un violoniste et un clarinettiste se présentent dans la loge où les deux autres s’affrontent, dont Gunzbourg qui semble s’attendre au pire, et disent :
-« Nous venons présenter nos excuses au nom de tous les musiciens de l’orchestre ».
Sans un mot, Chaliapine se dirigea vers la scène.
Aussitôt, Gunzbourg, fermant la porte de la loge, prit sèchement des mains la clarinette et le violon des deux représentants de l’orchestre et leur dit :
-« C’est très bien, maintenant vous pouvez retourner au Casino ! »…
Gunzbourg avait, devant l’intransigeance de la star internationale, substitué momentanément deux obscurs croupiers du Casino d’à côté pour leur faire jouer le rôle des musiciens s’excusant à temps avant le spectacle.
Personne n’en a jamais rien su.
………………………………………………………………………………………………
3 Juillet
Coup de fil vers vingt heures. Une voix connue il y a bien longtemps ravivant tant de souvenirs, celle de Gilles Marchand, un des fils de Louis Marchand que nous avions suivi quelques années, entre la Galerie Paul Hervieu, la Fondation Ephrussi de Rothschild où il vivait du temps de sa femme dans une petite cabane de jardinier, et son petit appartement au dernier étage du 3 rue de l’Eglise à Villefranche sur Mer, dans les années quatre vingt cinq. Repaire des amis et des amoureux de la peinture de Louis Marchand des Raux.
Avec Cécilia nous lui rendions visite tous les samedis jusqu’à son départ pour Cuxac d’Aude chez une de ses filles, quand il eut dépassé les quatre vingt dix ans. Une petite rue porte maintenant son nom à Fondettes où il est né dans la banlieue de Tours.
L’amitié réciproque entre le peintre et notre petite famille était telle en ce temps où il vivait bien seul, où beaucoup l’avait oublié, qu’il me prit comme confident et me légua une valise bourrée de documents inestimables. Des lettres de Lucie Valore qui n’avait jamais peur de se répandre, de Cocteau, une lettre d’un jeune Dubuffet empreinte de l’humilité d’un artiste qui n’a pas encore trouvé la grande voie et qui remerciait Marchand de lui avoir fait parvenir une plante pour son jardin, de quantité d’artistes plus obscurs, puis un courrier de Henri Matisse (où manque hélas la signature manuscrite !) s’excusant de ne pas participer à une exposition en son honneur à Villefranche sur Mer. De plusieurs livres d’or aux signatures restées anonymes, mais aussi celles de la Princesse de Barcelone, du même Cocteau bondissant d’une soirée à l’autre, de Romy Schneider que Louis Marchand maria au réalisateur Reichenbach à la Mairie du Cap Ferrat, de Sylvia Monfort aussi, qui était réellement une amie de toujours.
Il est aujourd’hui enterré au cimetière marin de Cap Ferrat. Lors de l’enterrement il y avait son élève, James Coignard, autre tourangeau, qui avait fait le déplacement depuis son atelier de New-York.
On lui rend un nouvel et lointain hommage le 16 de ce mois à la Galerie de la Maison de la Culture sur le port de Saint Jean.
Nous y serons.
Je suppose qu’on y verra quelques vieux fantômes de cette époque, vieux maintenant comme nous le sommes tous. Le second fils, Maurice, l’aîné, qui vivait aussi au 3 rue de l’Eglise et avait sa boutique d’horloger au rez-de-chaussée, aurait disparu il y a longtemps.
On peut aujourd’hui visiter la chapelle Saint Hospice tout au bout du Cap, où un merveilleux vitrail du à Lucien Allari, d’après une série complète inspirée du même thème, nous accueille sous le auvent de l’entrée, avec des pastels relatant la vie du Saint luttant contre les Lombards, et vient éclairer d’une lumière d’or la nef de ce petit écrin d’esprit au pied des rochers.
……………………………………………………………………………………………
8 Juillet
La musique n’a jamais adouci quoique ce soit. Surtout pas les mœurs. Tout au plus elle affine le jugement, elle arrondit celui-ci en de multiples nuances. Il n’est qu’à écouter, pour ceux qui auraient le privilège d’entendre plusieurs versions, disons, d’une quelconque symphonie de Beethoven, de mesurer les imperceptibles différences dans le tempo, les articulations choisies par le chef, tout un micro univers qu’il n’est incontestablement possible de percevoir que lorsque l’oreille a reçu une éducation dans le domaine de l’écoute. Pour ceux qui peuvent, de surcroît, vérifier sur la partition où se situe l’interprétation la plus proche des intentions du compositeur, l’art de la nuance auriculaire n’en sera qu’affinée.
Mais aucune musique, surtout celles qui puisent leur énergie dans une dynamique, voire un support de paroles orientables (donc dans un contexte à portée plus limitée que ne le serait une musique pure et sans arrière pensée) comme le sont les chansons, où s’expriment plus l’aventure personnelle ou les épisodes de la vie d’un artiste, une tranche de vie ou encore un thème de société, sans qu’obligatoirement une adhésion de l’auditeur, ne rende plus humain ou mieux intentionné celui-ci à l’écoute de celle-ci.
Souvent, c’est même le contraire qui se produit, à savoir une réaction à l’écoute de paroles engagées ou simplement édifiantes.
Platon parlait déjà, dans La République, des musiques à privilégier, dans le cadre de l’Athènes démocrate, qu’étaient les modes doriques (plus guerriers que les modes lydiens, plus féminins, qui affadissaient la sensibilité).
La musique adoucit les mœurs veut peut-être dire qu’il y a dans la possible compréhension universelle d’une même œuvre un désir d’aller dans le sens envisagé par le compositeur ou les interprètes que nous écoutons, les universaux que seraient la mer, le ciel etc. et les correspondances possibles entre l’organisation des sons et l’expérience de chacun à saisir l’ineffable.
Mais ce qui reste à prouver c’est justement cette fameuse compréhension universelle.
………………………………………………………………………………………………
Dans son Journal de Voyage, Montaigne parle avec une drôlerie presque naïve de cette étrange histoire de jeunes filles de Chaumont en Bassigny qui décidèrent de se vêtir en mâles et continuer ainsi leur vie par le monde.
L’une d’elle se fit tisserand et se fiança à une femme jusqu’à ce qu’un désaccord survint entre eux. Le tisserand devint plus tard amoureux d’une femme et vécut quelques mois avec elle, mais ayant été reconnu par quelqu’un de Chaumont, la chose fut mise entre les mains de la Justice et elle fut condamnée à être pendue pour des inventions illicites à supplir (suppléer) au défaut de son sexe.
Dans une autre histoire, il s’agit d’un jeune homme nommé Germain, qui a été fille jusqu’à l’âge de vingt deux ans, vue et connue par tous les habitants de la ville qu’on finit par l’appeler Marie la Barbue. Un jour, faisant un effort à un saut, ses outils virils se produisirent et le Cardinal de Lenoncourt, évêque de Châlons, lui donna nom Germain. Il y a donc encore en cette ville une chanson ordinaire en la bouche des filles où elles s’entr’avertissent de ne plus faire de grandes enjambées de peur de devenir mâles, comme Marie Germain. Ils disent qu’Ambroise Paré a mis ce conte dans son livre de chirurgie.
………………………………………………………………………………………………
Une joueuse de l’équipe de football des Etats-Unis, vainqueur ce dimanche de la Coupe du Monde féminine, connue autant pour ses positions en faveur des minorités que pour son talent sur le terrain, pose régulièrement avec sa compagne de cœur pour des publicités relatives aux causes qu’elle défend, a déclaré ne jamais chanter l’hymne américain tant que le président Trump sera au pouvoir.
Cela paraît d’un engagement bien relatif lorsqu’on songe que si elle avait défendu les couleurs de l’Arabie Saoudite (ou quelques autres existant dans le monde), elle aurait non seulement chanté l’hymne saoudien, mais aurait eu à rendre compte de ses engagements en faveur des minorités sexuelles si tant est qu’elle eut préalablement pu déclarer quoique ce fut… Le courage étant également chose relative.
Le plus triste est de constater l’ampleur donnée par nos médias à des faits qui ne présentent pas plus d’intérêt que la cause majoritairement soutenue en faveur de minorités qui ne risquent rien depuis bien longtemps.
Reste la caisse de résonance que certains monopolisent et font si bien battre en leur faveur.
………………………………………………………………………………………………
L’après-midi est accablant. Les cigales donnent l’impression de venir jusque sous les fenêtres et le ciel est blanc. Je me serais volontiers glissé dans l’eau si ce n’était ce rendez-vous avec le Docteur Lévy pour un test d’effort (!) prévu depuis quatre mois…
Hélène et sa petite famille sont en vadrouille dans le sud de la Corse. L’accablement doit être le même. Et les nuits n’apportent aucun semblant de fraîcheur.
J’ai reçu quelques nouvelles de Heinz, quelques photos de Toscane. C’est un peu le seul lien que j’ai avec le Conservatoire depuis la mort de Caty Bes.
………………………………………………………………………………………………
17 heures
Le Docteur Lévy a trouvé mon cœur intéressant comme tous les cœurs qui ne présentent pas plus d’intérêt lorsque tout va bien.
C’est à notre âge, voyez-vous qu’il faut s’entretenir, un peu chaque jour, pour éviter de tomber. Et dans le geste qui accompagnait sa phrase, il était bien évident qu’il ne s’agissait pas de chute de vélo.
C’est ce « tomber » qui résonne dans ma tête depuis que je suis sorti de chez lui.
Je sais aussi que le docteur n’a pas plus fait de rapprochement entre ce tomber et la tombe qui l’attend lui aussi.
Eviter de tomber, éviter la chute qui ne manquera pas d’arriver, mais enfin éviter de tomber aujourd’hui, demain et quelques temps de plus encore…
……………………………………………………………………………………………
9 Juillet
Michel Onfray, La Théorie de la Dictature, précédé de Orwell et l’Empire maastrichien.
N’y sommes nous pas déjà ?
…
Onfray, j’ai toujours eu des doutes sur le fait qu’il ait écrit lui-même tous ses livres. Ca paraîtra scandaleux auprès de ses fans, mais je pense qu’il est devenu une marque, qu’il vend une signature, entouré qu’il est d’une petite armada de spécialistes, documentalistes spécialisés, (l’université de Caen) et quand un projet est avalisé tout ce petit monde se met à l’ouvrage. Il est ensuite le dernier module de la fusée et défend personnellement le projet auprès du public (passage tv, rapport à la presse etc.)
Il est devenu tellement boulimique (raison économique ?) qu’on ne sait jamais vraiment quel est son dernier livre. Cela pourrait donner lieu à une sorte de jeu.
Sa dernière production est intéressante, il démonte les mécanismes de la tyrannie.
Se servant d’Orwell et de toutes les connaissances que nous avons du conditionnement de nos propres sociétés. Ses conclusions sont fatalement justes. Mais on s’en doutait un peu.
……………………………………………………………………………………………..
Courrier pour Bernard de ce 9 Juillet
Je ne sais pas quel avenir donner au Livre des Répons. Je ne me suis jamais préoccupé de son sort. Se sent-il orphelin d’un géniteur ingrat ?
Je ne sais quel avenir lui donner. J’aurais pu m’investir plus. Passés les quelques refus ou politesses des libraires abordés, je me suis drapé dans un silence laissant dériver le livre de sa vie muette et sans éclat.
Malgré tout, quand viendra le jour du pilon, je rachèterais le solde des volumes restant.
…
Et pourquoi ne pas proposer une même aventure aux Carnets (sous une appellation moins générique) ? Mais sous quelle bannière ? C’est une sorte de mosaïque, avec des réflexions, des écrits de type journaux, et des mémoires.
Quel publics pourraient en saisir l’unité ? dans quel type de littérature pourraient-ils se situer ? J’avais jusqu’à présent considéré cet "exercice" comme complément à une meilleur connaissance de l’auteur de poésie. Mais je me rend compte qu’il fait un bloc, bientôt un massif en lui-même, et pour lui-même. Mais comme le public aime les genres, polar, histoire, roman etc.
Lui, n’est nulle part.
D’un autre côté, je n’ai pas la force de recommencer une aventure qui risquerait de coûter plus chère encore, pour une destinée aussi improbable.
Je serais encore longtemps l’auteur de livres sans lecteurs.
………………………………………………………………………………………….
12 Juillet
Comment et quand coïncide le moment où l’on va ouvrir un livre parce qu’il a été décidé de le lire ? J’ai souvenir que vers la fin des années de lycée, il devenait impératif de lire, en vue de passer l’épreuve de Français au bac, si ma mémoire ne me trahit pas, tout à la fois Madame Bovary, La Nouvelle Héloïse, Les Souffrances du Jeune Werther, Le Rouge et le Noir et quelques autres.
Jamais je ne les aurais lu à temps. Je dirais même que je ne sais pourquoi, le seul fait d’avoir à les lire comme on passe un contrat dans le temps et dans les règles d’un jeu que je n’appréciais pas du tout, j’émettais un refus comme le cheval devant l’obstacle, et que je m’en fus passer l’épreuve sacrée sans avoir lu une seule ligne de ces ouvrages.
Ce n’est pas tant que Madame Bovary m’eut déplu, bien au contraire. Quand je l’eus enfin abordée vers la trentaine, je fus stupéfait par le ton, le style et l’humour de Flaubert entre autres qualités. Monsieur Homais le pharmacien, dans son inutilité, ses saillies à contre temps et ce relief à contre-pied d’une histoire tout à la fois bourgeoise et intimement tragique, me laissèrent l’impression durable d’un profond comique de situation et m’apprirent ce que devait être à présent une mise en scène romanesque, au-delà de la simple et banale histoire de roman, pour pénétrer dans les arcanes et la complexité des formes de l’univers littéraire.
Pareillement, devant les trop forts conseils qui m’étaient prodigués de lire Céline, vers la même période de ma vie, je restais pleinement dubitatif comme lorsque l’on sait que ce n’est pas encore l’heure d’un rendez-vous qui ne saura que venir en son temps.
Pareillement, l’émerveillement de la Mort à Crédit, plus que du Voyage, pénétra durablement dans ma vie psychique à la même époque que pour Flaubert, comme le modèle du livre libre, rare, unique et indéfectible, que ne sauront rarement atteindre d’autres ouvrages ultérieurement.
La question se pose donc de savoir comment et quand coïncide le moment idéal de la rencontre avec un ouvrage. Probablement par une alchimie auto produite par le futur lecteur mêlé à une volonté pré-destinée qui engendreront la parfaite harmonie de la rencontre avec l’ouvrage.
Ce n’est d’ailleurs pas par hasard que j’eus entre les mains les Essais de Théodicée de Leibniz vers l’âge de quinze ans, que ma mère dans sa bonne volonté et dans ses approximations, ne me découragea pas d’en tenter la lecture, mais qu’il devenait évident pour moi devant tant de clés et de codes opaques à mes connaissances d’alors, que ce n’était guère le moment. La couverture avec un tableau de Poussin peut-être, la mystérieuse phonétique d’un nom d’auteur qu’on aborde en sachant qu’il est auréolé d’un prestige qu’on devine, laisse entrer en tentation un jeune garçon qui ne saura pénétrer la vérité et la compréhension de ces Essais que bien plus tard. Pareillement avec l’autre sagesse des Essais de Montaigne qui était l’évidence même puisque je n’avais pas eu même l’occasion d’en lire une ligne qu’on avait déjà pour moi déterminé toute la bénéfique profondeur qu’ils requéraient.
L’Apologie de Raimond Sebond ne devint la clé de voûte de ma lecture des Essais que dans les mêmes temps que je découvrais Bovary, la Théodicée, et, dans un genre plus surréaliste, les Cent ans de solitude de Garcia Marquez.
J’étais enfin parvenu à éclosion pour aborder tant de fruits mûris.
…………………………………………………………………………………………….
On aurait exhumé le Grand Echiquier. Celui qui mettait d’accord dans les années soixante dix, tout à la fois Brassens, Menuhin, des réalisateurs de cinéma et des candides en tous genres. L’émission avait lieu une fois tous les deux trois mois.
Soirées bon enfant.
C’était l’élégant et subtil Jacques Chancel, dont la voix, à elle seule, garantissait le ton et la bonne tenue des contenus qui étaient proposés dans ces soirées-là. Une occasion d’aller à la rencontre de genres généralement parallèles les uns aux autres.
Cette exhumation s’est vue aujourd’hui, sans aucune vergogne, reprise, comme si elle émanait tout ensemble de l’amnésie d’un public aujourd’hui assez âgé et d’un public d’aujourd’hui ignorant ce précédent, par une quelconque présentatrice du journal télévisé mise à ce poste par les pouvoirs en place.
On y a donc fait venir évidemment des gens de la variété, et la pianiste Buniatishvili, qu’on peut voir dans toutes les émissions de type commémoration du 14 juillet, esquissant ce soir là quelques mesures du second concerto de Rachmaninov, qui s’est tout de suite vue poser la question par la présentatrice, question qui paraissait être de la plus urgente importance « aimez-vous le rap ? ».
– Oui, j’aime le rap, j’aime toutes formes d’expressions si elle peuvent servir la cause de l’art.
– Soulagé, le Grand Echiquier pouvait enfin renaître.
……………………………………………………………………………………………..
13 Juillet
Courrier pour Bernard après que fut achevé le récit sur Séville
J’ai mis le récit de voyage que tu as lu dans le carnet, c.a.d dans les archives de ma mémoire. C’est quand j’ai fini ces récits que le voyage peut s’en aller doucement rejoindre les précédents.
…
C’est vrai, la mort est souvent présente. Mais n’est-ce pas une réalité qui tenaille ? J’ai parfois même l’impression que si ça finissait maintenant il n’y aurait pas de scandale majeur. Que tout aurait été comme il se devait.
…
Je ne suis pas d’accord concernant la natalité en berne. Elle concerne seulement notre petit périmètre. Il ne t’aura pas échappé cette bêtise de Yves Cochet (j’en parle au printemps, Février ?) disant qu’il faut en effet réguler les naissances (source de pollution) à des fins plus troubles (celles de ce Cochet), à savoir d’accueillir plus de migrants (donc afin d’accélérer par ailleurs et paradoxalement la natalité extra européenne)…
Très troublant raisonnement pour ne pas dire totalitaire comme seuls les chinois ont pu le faire avec leur natalité (mais eux sont plusieurs milliards).
Certaines bêtises d’hommes politiques paraissent mues par l’énergie du désespoir de se voir disparaître de l’arène quand les scrutins les ont cruellement rejetés.
C’est étonnant, on se préoccupe de l’équilibre écologique , de la disparition des abeilles, des loups et autres espèces, mais on constate que la place de l’homme serait de s’effacer.
…
Et puis quel sujet aujourd’hui échappe au totalitarisme de la pollution ? Pareil que pour la natalité. L’hypocrisie est à son comble. On taxe pour "sauver la planète". mais on ne fait aucun geste (je dirais plutôt qu’on s’incline) devant les plus grands pollueurs du monde.
Et ces pollueurs chinois "achètent" la France, pour en faire quoi ?
…
Je ne peux reprendre tous les sujets qui me préoccupent mais je ne changerais pas un mot dont je crois avoir bien mesuré la portée.
…
C’est bien que le Livre des Répons vive de sa vie, je dirais de sa vie indépendante. Et le choix de l’année 2013, après mes méditations sur l’Urgell pyrénéen, n’a pas été fortuit.
…
Belmonte le matador ne m’a pas fait penser un seul instant à l’autre. Mais peut-être est-ce bien dissociable.
C’est vrai que de se trouver seul dans les arènes de Séville est quasiment une anomalie et un (heureux et unique) concours de circonstances (comme dit dans le récit).
C’est enfin une ville que j’ai aimé. Triana peut-être plus, mais aussi les pourtours de Macarena.
J’ aurais presque retrouvé dans cette ville, dans les profondeurs du passé, un parfum ineffable revenu de la mémoire de l’enfance.
…………………………………………………………………………………………….
Du 14 Juillet
A Bernard
Tu as raison, et définitivement. L’idée de publier les carnets n’est pas une bonne idée. Comment décider de l’arrêter à une date quelconque. Le meilleur serait peut-être à venir. La mort en direct serait une belle fin, une sorte de fin de partie sublime. Qui pourrait plaire à un éditeur.
…
Chateaubriand est génial. Le style. Mais ses mémoires sont autant de mémoires mêlées à l’Histoire, donc publiables comme celles de de Gaulle avec ses volumes sur la Seconde Guerre Mondiale. Une période délimitée d’avance.
Je te conseille, dans le genre journal, mémoires, les « Mémoires d’un touriste » de Stendhal. Je sais que tu ne l’aimes pas trop. Moi non plus. Ses a priori sur l’art médiéval, sur l’art en France en général sont trop peu objectifs.
Mais ses mémoires-là sont justement peut-être plus intéressants que ses voyages en Italie. Parce qu’il y est méchant, qu’il trahit une certaine mauvaise foi, mais aussi parce qu’il nous étonne en décrivant des lieux et des situations inattendues.
Je suis plongé ces temps-ci dans toutes sortes de récits autobiographiques ou de mémoires justement parce que moi-même…
…
En diagonale : Gide, Journal des années 20/30, Itinéraire de Paris à Jérusalem, un peu du Nerval des voyages en Orient, Flaubert idem, l’inépuisable Léautaud, mais celui qui m’a tenu éveillé dans mes nuits difficiles aujourd’hui, c’est le Journal de Voyage de Montaigne.
En fait, seuls les deux derniers tiers sont écrits par lui, et une grande partie de la fin rédigée pour y mieux faire sentir les parfums, en italien ! La première partie, toute autant savoureuse, est écrite par une sorte de valet qui l’accompagne et qui décrit les moindres situations du voyage au travers de ce qu’en pense Montaigne.
Et bien sûr dans cette langue inimitable du XVI°.
…
…………………………………………………………………………………………….
15 Juillet
La pluie enfin. Peut-être que les nuits deviendront respirables. L’accablement se fait sentir depuis plusieurs semaines en début de soirée comme si l’oxygène venait progressivement à manquer et qu’une humidité de plomb sourde et suffocante fondait sur les corps fatigués.
Cette nuit j’ai rêvé les yeux ouverts que les volets à peine joints par un simple battant formant deux grands rectangles sur fond de ciel de nuit signifiaient, en plissant légèrement les yeux, les deux tours de World Trade Center, que j’étais dans l’avion kamikaze s’approchant de ces tours dans une sorte de ralenti, dans le décomposé de l’action, le temps s’était figé et comme la flèche de Zénon, l’avion avait toute une éternité pour parvenir à cet improbable et scandaleux cataclysme que tous ceux du 11 septembre 2001 à bord de l’avion durent ressentir quand ils virent avec terreur ce mur qui n’en finissait plus de se présenter à eux.
…
J’ai pensé également au film extraordinaire de Sidney Lumet « Point Limit Zero ».
………………………………………………………………………………………….
Comme une foudre ce matin, surpris par ces Papillons de Schumann, apolliniens, simples, d’une nudité et d’une fermeté de toucher, tranchants et perlés que je n’en avais jamais entendu de plus subtils et aériens. C’était et ce ne pouvait être que Catherine Collard.
……………………………………………………………………………………………
16 Juillet
Ce jour porte le poids d’une vie. On m’avait dit il y a longtemps, lorsqu’on s’amusait à se lire et à interpréter les lignes de la main, que ma ligne de vie était étrange, et présentait une sorte de brisure en deux, qui lui donnait une trajectoire irrégulière par cette fragmentation. Je comprends aujourd’hui qu’il s’agit simplement de ces cinquante cinq années passées à Nice (ou ses proches banlieues), qui succèdent à ses douze premières années de mon existence à Rabat, avant le départ sans retour, d’un certain 16 juillet 64.
…
Ce soir le vernissage de l’exposition Marchand des Raux, sur les quais surchauffés de Saint Jean, a été particulièrement réussi. Rendez vous des amoureux de la peinture d’un peintre jardinier hors norme, rendez vous des toujours même collectionneurs, avec beaucoup de pantalons blancs, amateurs ou familiers habituels plutôt que rendez vous mondain, bien que l’exposition devrait être l’événement majeur de cette saison à Saint Jean.
Toutes les périodes de sa vie créatrices étaient étagées, depuis les périodes de tâtonnements, celle des portraits avec Picasso immense, et lui du côté du chevalet, minuscule, celui de l’Utrillo au visage rougi et congestionné, celle aux jardins de Touraine fleuris et aux contes de son pays natal, jusqu’au fabuleux thème, sommital dans sa production, de l’histoire de Saint Hospice dans sa lutte contre les Lombards, et enfin la série des maternités, des monumentaux intimes, presque primitifs, et des dernières confidences.
Il y avait eu une photo prise au même endroit il y a vingt ans. On aurait, à quelques retouches près, pu prendre la même pose hier soir, comme aurait pu imaginer un Lelouch espiègle rejouant le coup d’Un homme et une Femme, si ce n’était que Madame Hervieu, quatre vingt douze ans, plie un peu plus sous le poids de son arthrose de la hanche, que les Ganaye, collectionneurs attentifs, ont quelque peu blanchis comme tant d’autres, et que les enfants du peintre sont aujourd’hui souvent flanqués de la génération qui a suivi.
L’exposition a toutes les chances de vivre un peu au-delà du 26 de ce mois, puisqu’il est prévu une sorte de jumelage avec Fondettes où une rue porte désormais le nom de Louis marchand, peintre jardinier, les mêmes œuvres seront de nouveau proposées, à deux pas de la maison natale.
J’ai pu échanger quelque mots avec Marie-Paule, la benjamine des filles, celle chez qui, pour la dernière fois, nous avions vu le peintre à Roquefort les Pins, avant son départ qui l’arracherait, pour ses ultimes années encore, dans le Roussillon.
Elle m’a immédiatement reconnu, et ses premiers mots me sont allés droit au cœur et ont ravivé toutes les couleurs de l’atelier des rêves : « Je vous ai reconnu immédiatement savez-vous… Il vous aimait beaucoup. »
…
J’écrivais vers Juillet 85, ces lignes sur Marchand de Raux : « Il en est de la peinture d’aujourd’hui comme de certaines musiques contemporaines : elle séduit ou fait grincer des dents.
L’œuvre de Louis Marchand des Raux dont Saint Jean Cap Ferrat exposera cet été une partie de la production actuelle, appartient par nature, à l’infime catégorie de celles qui séduisent. Qui séduisent parce que le cœur et la spiritualité, plus que la spéculation et le savoir-faire de laboratoire, illuminent ceux qui ont le bonheur de l’aborder.
Qualités rares par les temps qui courent où le jugement fait bien plus souvent appel à la cérébralité desséchante et stérile qu’à la spontanéité du sentiment vécu.
Loin de nous d’isoler ou de retrancher Marchand des Raux du nombre des peintres modernes. Il est tout simplement inclassable et d’une modernité difficile à situer dans les courants contemporains : par sa seule originalité, il semble transcender les anciens fantômes des figuratifs et des abstraits, pour engendrer un sillon qui n’appartient qu’à lui.
Né en Touraine en 1902, au hameau des Raux, il découvre la Côte d’Azur, et se fixe définitivement à saint Jean Cap Ferrat qui deviendra sa terre d’élection (à tout point de vue, puisqu’il y exercera la fonction très officielle de Maire-adjoint durant plus de trente années), là où la lumière rayonnante de ce midi perpétuel saura, sous l’inspiration de ce magicien, se convertir en féeries colorées.
La rigueur et l’intelligence aiguë qu’il a toujours eu de son art l’ont conduit bien évidemment à l’expérience de l’isolement et de la solitude. Chemin ardu dans la jungle des artistes d’hier et d’aujourd’hui, où bientôt Louis Marchand reconnaîtra les siens !
Ce chemin solitaire dans le processus de la création n’en a pas fait pour autant un oublié dans le monde de la peinture.
Bien plus que les vocations qu’il saura susciter, les amitiés réelles qu’il aura entretenues avec des célébrités connues de tous, tels Matisse, Utrillo, Dubuffet, Giacometti et d’autres, ce qui paraît plus révélateur enfin, c’est surtout ses propres œuvres, jalousement collectionnées par des cohortes d’amateurs fidèles et véritables, presque anonymes, silencieux.
Le prix de la beauté ne fait pas de bruit.
Marchand des Raux inconnu ? Ses tableaux ont été accroché un peu partout aux Etats-Unis, en Scandinavie, lors d’expositions temporaires, parfois définitivement, dans des musées ou universités, et ses plus grands clients sont longtemps restés hors de nos frontières.
Mais si Louis Marchand reste encore une énigme pour le grand public de notre pays, c’est sa modestie qui en est la cause, un peu comme les glorieux imagiers de chez nous qui ont crée les inégalables vitraux de Chartres, les voûtes décorées de Saint Savin, mais qui n’ont jamais dit leurs noms depuis le Moyen-Age…
Marchand des Raux est de la race des imagiers modernes, bonhomme et orgueilleux, lui qui sait si bien taire qu’il est également l’artisan des fameux jardins exotiques et des jardins à la Française de la Fondation Ephrussi de Rothschild, Musée Ile de France, le plus beau fleuron décoratif de Saint Jean cap ferrat.
Ce qui m’a le plus étonné, voyez-vous, c’est que personne n’ait encore songé à prononcer à son endroit le mot de génie, et il est pourtant près de nous, ce vénérable homme de génie, à Villefranche, rue de l’Eglise. »
…………………………………………………………………………………………….
18 Juillet
Il est heureux qu’un économiste de renom, Carlo Cipola, ait osé concevoir les « Lois fondamentales de la stupidité humaine ».
Dès les premiers mots : « L’humanité est dans le pétrin… »
…………………………………………………………………………………………….
Pour la France, et pour longtemps encore, l’Algérie c’est la plaie d’Amfortas.
…………………………………………………………………………………………….
20 Juillet
Dans la civilisation japonaise on dit qu’un homme, quelque soit l’attitude d’une femme à son égard, ne saura jamais si elle l’a aimé ou si elle l’a haï.
Une femme avec laquelle il aura vécu des années durant ne montrera jamais le fond de son cœur.
La force du secret des femmes japonaises est plus forte que la manifestation du sentiment éprouvé par celles-ci.
J’ai souvent songé qu’en sens inverse, si on admet qu’un sentiment profond est plus reflété par des actes qui ont accompagné l’existence de deux êtres, l’amour attesté qu’aura porté Enrique Granados à son épouse en est devenu pathétique.
Les derniers moments de leur existence tiennent en effet du tragique ordinaire de la Première Guerre Mondiale et du romantisme le plus incarnée.
En 1916, le rafiot qui les transportait vers les côtes de la Manche fut sabordé par un sous-marin allemand et coula immédiatement. Réfugié momentanément sur une coque de noix, Granados aurait pu être sauvé. Voyant son épouse se débattre à quelque mètres de là, il plongea à sa rencontre pour se noyer avec elle.
…………………………………………………………………………………………….
On dit que tous les pays ont un charme, une beauté qu’on peut saisir même dans la poésie qui ressort de lieux ou de contextes misérables, mais ce n’est qu’une disposition de l’esprit plus qu’une réalité tangible.
J’ai souvenir de villes affreuses comme Bombay (aujourd’hui c’est Mumbay), où je ne pourrais plus mettre les pieds, ou même Delhi et toutes ces villes qui manquent de cette beauté qui vous prend au premier élan du coeur dans des pays et des régions qui auront notre adhésion. Un certain air qui vous enveloppe, un équilibre et une harmonie où on se sent chez soi. Même au bout du monde.
La beauté que je ressens aujourd’hui pour des lieux et des choses tient souvent au fait que le temps et la culture qui les ont modelés trouvent leur correspondance quelque part dans mon univers mental.
Je me sens de plus en plus chez moi dans les pays latins, peut-être parce que je me sens de plus en plus appartenir à cet ancrage géographique bien que né au bord de l’Atlantique. Mais ma naissance vient plus du hasard et du contexte des ressortissants français nés quelque part outre-mer que d’une filiation qui n’aurait jamais quitté les rivages de ses origines.
Mon arrivée en France a été comme une découverte progressive de ses multiples visages, de sa mosaïque à nulle autre pareille, de ses contrastes qui, sur si peu d’espace, embrassent sur à peine plus d’un demi million de kilomètres carrés, autant de sensibilités, de cultures et de caractères aussi opposées que l’influence du nord peut se démarquer de celle du sud, et plus encore, aux quatre points cardinaux.
Mondes de rivières et de lacs, de littoraux et de montagnes, de neiges et de mers, d’océans de blés et de plaines, de châteaux et de jardins, de ruines et de basques, de bretons, d’occitans et de cousins germains.
La beauté est certainement présente un peu partout dans le monde, mais toutes les beautés du monde se retrouvent dans la beauté d’ici.
…………………………………………………………………………………………….
23 Juillet
Maman aurait eu quatre vingt quinze ans.
…
Même Baudelaire a commencé par publier à compte d’auteur. Mais j’ai commencé bien tard, en un temps où tout le monde publie un peu n’importe quoi. On peut d’ailleurs devenir son propre éditeur Internet.
…
Je me suis laissé tenté par la biographie de Céline de Henri Godard. Irais-je au bout d’une aventure qui se confond avec la face trouble de ce XX° siècle ?
Je voudrais pouvoir lire Guignol’s Band ou la Mort à Crédit en ignorant tout de Céline. Mais lorsqu’il s’agit de lui, on en sait trop ou pas assez. Il est étonnant, quand on entend la voix de l’écrivain, de sentir la peur qui émane de ses propos. Un ton aigu, étranglé, avec un souffle mouillé de la voix qui respire la peur. Je n’ai pas trouvé d’autre sentiment. Je n’ai pas trouvé d’autre mot. On s’attendrait de sa part à de la morgue ou à un ton superbe, une énorme exclamation peut-être du plus profond de son être. Mais il n’émane qu’une peur sourde, rétrospective, d’un homme cassé, rattrapé par l’acharnement, et là, on comprend mieux Nord qui relate son odyssée danoise.
…
Norma ! La petite harpiste, que je continue d’appeler petite bien qu’elle me dépasse de plusieurs centimètres, est apparue comme une fleur parmi toutes les vieilles plantes de chez Sauveur. Elle est de passage à Nice, le temps de voir ses parents. Elle est toujours à l’orchestre de Versailles, aime toujours Rameau et Debussy, et peut-être aussi ma poésie…
…………………………………………………………………………………………….
24 Juillet
Je reçois mon passeport. Il était périmé. J’ai donc un nouvel espace de dix années, plus, éventuellement, la tolérance de quelques années supplémentaires pour traverser les lieux où me mouvoir dans ce monde. Ce document me semble un passe droit ultime, un pourfendeur de temps. Vivrais-je aussi longtemps que le temps de sa validité ?
…………………………………………………………………………………………….
Y est passé avec sa maman hier soir. Avec sa petite casquette à fleurs, ses joues rouges, cueillant les petites tomates dans le jardin. Il continue de grandir comme un petit astre. Il aura une petite sœur avant la fin de l’année.
…………………………………………………………………………………………….
Ventoux ne signifie pas le vent, mais ce qui se voit de loin. Et le voir tout depuis le sommet. Depuis quatre vingt millions d’années le massif continue de s’élever.
…………………………………………………………………………………………….
La montagne de Ceüse, dans son fer à cheval à plus de deux mille mètres, n’est-elle pas la plus belle falaise de France ?
Et le Pic de Bure dont on dit qu’il permet de voir mieux dans la profondeur du ciel. Tout ça dans les Hautes Alpes.
…………………………………………………………………………………………….
Dans « l’Intranquilité », au chapitre 66 , « haussement d’épaules », Pessoa, en quelques lignes, résume la philosophie de Clément Rosset concernant le réel et sa sublimation, ses substitutions possibles, ses doubles :
« Nous attribuons généralement à nos idées sur l’inconnu la couleur de nos conceptions sur le connu : si nous appelons la mort un sommeil, c’est qu’elle ressemble, du dehors, à un sommeil ; si nous appelons la mort une vie nouvelle, c’est qu’elle paraît être une chose différente de la vie. C’est grâce à ces petits malentendus avec le réel que nous construisons nos croyances, nos espoirs – et nous vivons de croûtes de pain baptisés gâteaux, comme font les enfants pauvres qui jouent à être heureux. »
…………………………………………………………………………………………….
28 Juillet
C’était à la terrasse de la Dégustation, il y a donc six ou sept ans en arrière. J’ai toujours été surpris par la qualité inattendue de certaines réparties, certains propos qu’on ne s’attendait pas à entendre sur ces terrasses nonchalantes, soit parce que les personnes attablées ne me semblaient pas en mesure de se répandre en idées et arguments comme je n’imaginais pas qu’elles pussent en avoir au fond du crâne, soit parce que la nonchalance même du lieu n’était pas propice à des envolées lyriques ou à une certaine hauteur d’esprit.
Il y avait une femme jeune à la trentaine épanouie, qui s’assaillait à une table proche de la notre, assez hautaine, tirée à quatre épingles et moulée dans une sorte de robe fuseau largement échancrée dont les relief vus de dos laissaient apparaître qu’elle ne portait rien dessous.
Lorsqu’elle montait les escaliers menant aux toilettes, c’étaient souvent des murmures qui accompagnaient la lente ascension vers l’étage du dessus. Comme l’escalier formait un colimaçon, il était possible de voir le recto et le verso de la progression de la marche, droite et ondulante de l’énigmatique qui redescendait quelques moments plus tard, droite, et peut-être un peu plus fardée encore, toujours imperméable et détachée, semble-t-il, des contingences alentour.
Beaucoup d’entre nous pensions qu’il y avait du vénéneux qui émanait de la personne et il était rare que passées certaines tentatives d’approche de la plus élémentaire drague parmi les plus écervelés d’entre ceux qui s’imaginaient irrésistibles, la jeune femme ne donne en retour autre chose qu’un regard glacial, tournant légèrement la tête vers l’importun, dans une expression proche du mépris.
Certains pensaient même qu’il eut été dangereux de se voir compromis avec cette inaccessible d’un milieu qui ressortissait plus du monde de la nuit et de ses mirages que du plein soleil et de l’insouciance qui était la notre.
On finit par s’habituer à la présence silencieuse et hiératique de la jeune femme paraissant toujours attendre un mystérieux inconnu.
Cet après-midi là, une conversation un peu houleuse avait roulé sur le social, comme souvent ici, et quelqu’un butait sur ce que Marx avait dit à propos de la cruauté même de la condition humaine, lorsque, dans un souffle presque inexpressif, comme venu d’un monde impossible, la femme à la table d’à côté dit avec la plus ferme assurance : « L’homme est un loup pour l’homme, mais c’est dans le Léviathan de Hobbes… »
…………………………………………………………………………………………….
Relisant un texte parmi les nombreux articles de Pessoa, j’ai retenu cette classification qu’il a su faire des plus importantes épopées universelles.
D’un premier cercle : L’Illiade, la Divine Comédie, le Paradis Perdu de Milton.
D’un second cercle : l’Odyssée, l’Enéïde, la Jérusalem Délivrée du Tasse et the Fairy Queen (!) . Les Lusiades de Camoës se distinguant des unes et des autres, en ce sens qu’ils sont directement une épopée historique, un reportage transcendant.
Pas un mot, (mais peut-être juge-t-il que nous tombons dans un troisième cercle très inférieur), sur la Chanson de Roland et nos épopées médiévales.
« …Les français ne sauraient en avoir. Il ne cultivèrent que le roman qui n’est que la forme inférieure et accessoire de l’épique… »
Rien sur Gilgamesh non plus, l’épopée japonaise des Heike et sur l’orient des Mabaharata ni sur les légendes islandaises.
Pessoa est souvent strict, partial souvent, et vindicatif.
Dans sa poésie française si malhabile, les ombres de Racine et de Mallarmé n’ont certes pas habité le Pessoa poète à ses heures.
…………………………………………………………………………………………….
29 Juillet
Leif Ove Andsnes, le pianiste norvégien ne cesse d’étonner. Il avait été un impeccable interprète des concertos de Rachmaninov. Il se met à Chopin, qu’il avait longtemps hésité à enregistrer. C’est chose faite avec une alternance intelligente des quatre Ballades et de trois Nocturnes dans le même esprit. La quatrième Ballade en devient un monolithe de première grandeur.
…
De plus en plus de velléités de philosophie chez Sauveur. Mais beaucoup de platitudes comme l’inévitable dictature écologique, le catastrophisme climatique. On ne peut avancer un argument sans que, chez certains, la dictature qui s’exerce sur la culpabilité des humains ne deviennent le repoussoir absolu sur cette planète.
C’est devenu aussi écoeurant et d’une stérilité aussi accablante que les conversations qui mettent en scène les pauvres chômeurs, les bénéficiaires des aides publics, les assistés célestes conchiant les riches qui s’en mettent plein les poches.
Le ciel navigue entre de faibles ondées et une tristesse de nuages gris. L’été est pesant.
…………………………………………………………………………………………….
30 Juillet
On a abattu la haie de cyprès qui séparait de notre voisine du 28. De vieux cyprès coriaces et encore plus odorants maintenant que les branches en sont répandues, éparses sur le sol du jardin, attendant d’être remplacés par une nouvelle clôture.
…………………………………………………………………………………………….
3 Août
à Bernard
…
C’est vrai que ça fait longtemps que les français ne veulent plus exercer comme cantonnier ou comme travailleur du bâtiment. Aujourd’hui ils refusent aussi les travaux des champs (je ne parle pas des agriculteurs, mais des saisonniers ou des sans emplois qui préfèrent le rester), et laissent ça aux polonais ou aux bulgares. (Il est loin le temps où nos étudiants venaient se dégourdir en chantant dans les champs de vignes au moment des vendanges).
Les raisons ? Probablement qu’ils n’acceptent pas de travailler au dessous d’un certain salaire. (C’est du moins la raison invoquée). Les polonais payés 10 euros de l’heure gagnent toujours plus que le taux horaires pratiqué dans leur pays. On connaît ça aussi dans l’automobile, où Renault fait transférer ses usines à l’étranger pour profiter d’une main d’oeuvre moins chère.
Le Français vit donc au dessus du seuil de compétitivité. Les syndicats lui cachent cette simple réalité en lui parlant de conserver son pouvoir d’achat et donc d’un smic bien supérieur à celui des pays d’ Europe de l’Est. A l’opposé de cette Europe, l’Allemagne bien sûr a une économie forte, mais son smic est dépendant du secteur en compétition, et l’Allemagne est largement exportatrice, ce qui n’est pas le cas de la France.
Voir dans le goût des fraises un bienfait du à l’importation des travailleurs sous payés est en effet une des conséquences de cette Europe de l’euro et un amer petit naufrage pour notre économie.
Avec ainsi plusieurs pans de celle-ci en voie de disparition.
Nous exerçons par contre sur le terrain du service public une attractivité que souhaiteraient atteindre tous nos bacheliers. Mais comme le service publique c’est l’argent public… le moteur économique du pays se trouve ailleurs.
…
……………………………………………………………………………………………
4 Août
Le phonème Guadalquivir résume toute la perspective qui hante les grands Sud, l’alliage des sables.
…
C’est vrai qu’on s’est aimé… trop peut-être, ou mal. Je t’ai vue effectivement la semaine dernière. Tu allais avec le même monsieur à la boucherie Francis.
Tu as passé sans trop oser me calculer comme tu dis dans ton message.
Quel sont les mots que tu as utilisés pour les amants qui sont passés avant moi ?
Est-ce eux qui on pris l’initiative de te quitter ou toi ?
Je sais qu’on aurait pu continuer à se voir en amis, mais les amours compulsifs ou fusionnels font mal, et mieux vaut faire le silence pour toujours.
Pour te consoler, je dirais que je vieillis, que je m’occupe de mon petit fils, que je vais devenir papy d’une petite fille en novembre, donc que je n’ai plus d’avenir pour quiconque, si ça peut te consoler.
Tu auras été mon dernier amour, celle qui m’ aura donné de l’amour dans l’automne de ma vie.
Je t’embrasse Katy.
…………………………………………………………………………………………….
DU PASSAGE SUBVERSIF DE LA STATUE D’ APOLLON EN FORCES DYONISIAQUES
Ce dimanche j’étais sur la Place Masséna de bonne heure. La lumière était encore bien lourde de la nuit, les promeneurs se rendaient vers la mer.
Dans la nuit, un illuminé avait habillé la statue du dieu marin de la grande fontaine d’un bandeau signifiant « je suis Steve », malheureux jeune homme jeté à la mer et disparu sans que l’on sache qui rendre responsable.
Mais le plus extraordinaire de cet acte revendicatif est qu’il avait été accompagné d’une intention de protestation consistant à verser un produit colorant rendant l’eau rouge comme le sang.
La vieille recette des Noces de Cana…
Ce qui changeait extraordinairement la significations des rictus des taureaux, le hennissement des chevaux de Phaëton, les naïades contorsionnées rendues enfin à quelque tragédie sanglante etc. Toutes les bouches de la fontaine faisaient jaillir des jets pourpres sur l’eau du bassin en une harmonie jamais soupçonnée avec les façades ocres et rouges traditionnellement couleurs de la Place Masséna.
Probablement que le jugement tout administratif des autorités municipales ne verra pas dans l’harmonie inattendue de ces couleurs dans ce nouvel environnement urbain une occasion de pérenniser le plus heureux des hasards.
…………………………………………………………………………………………
Je passe mon temps entre la théologie de la mort que parle le cardinal Ratzinger et cette « intranquillité » qui n’en finit plus et qui nous fait aussi un peu mourir.
…………………………………………………………………………………………….
6 Août
Tous les cinq et six Août, je pense à ces bizarres évènements, parce que c’est le souvenir de cette nuit sur les collines de Biot, la nuit du seul des trois festivals post Woodstock en France, un an après, en 1970, où les européens, faute d’être allé dans ces contrées lointaines des Etats-Unis , participaient d’un effet de post-combustion spirituelle, à l’illusion de ces trois jours de Peace and Love, mais comme à une réplique du pauvre. Et pour une seule nuit.
C’est aussi au petit matin que, les ciseaux sur les reins, ma chère Dani Belmonte me signifiait que j’étais désormais libre et que c’était fini entre nous.
L’amour et la paix n’avaient donc pas triomphé.
J’en ai gardé, dès le retour chez moi, sur ma petite pétrolette au vent qui accentuait les quelques larmes qui roulaient sur le chemin, ce sentiment d’avoir vécu, ce qui n’était évidemment qu’un ressenti, un syndrome de Hiroshima, tant l’ampleur de la défaite et l’inattendu de la rupture m’avaient laissé démuni. C’était donc en Août de 70, la nuit du 5 au 6.
…
Mais qui pense aujourd’hui, aux mêmes heures qui furent les miennes, dans nos pays de mémoire, à ce Nagasaki et à cet Hiroshima du pauvre ?
…………………………………………………………………………………………….
Il est dix huit heures. Catherine Collard peut me mener dans ses Kinderszenen, ses Papillons ou ses Romances. C’est comme une main juste dans l’absolu déséquilibre de Robert Schumann, dans la nuit qui vient.
…………………………………………………………………………………………….
11 Août
à Bernard (… les montagnes meurent aussi, mais c’est plus long …)
Oui, le soleil aussi s’en va un peu chaque jour. Est-ce les humains qui en sont la cause ? Le réchauffement climatique qui le perdra lui aussi ? La pollution qui remonte jusque là ?
Les fiérots de la préservation durable n’en soufflent rien.
Mais tout de même ce matin le soleil s’est éclipsé derrière des nuages qui ne sentent pas encore la pluie.
J’ai parlé des montagnes qui demeurent comme je parlais des arbustes, ces frêles cigarettes qu’on a connu au Parc Impérial devenus de gros cigares ventrus qui nous survivront longtemps encore, sauf…
Nous reconnaîtraient-ils d’ailleurs, nous qui avons aussi tant changé ?
Figure toi que j’ai tenté l’impossible il y a trois ans en essayant de retrouver un certain arbre près d’une ruine de la Via Appia. Je me suis laissé guidé par une photo que j’avais en mémoire où je figure avec ma mère.
J’avais alors quinze ans.
J’ai bien cherché, je ne l’ai pas revu. Lui m’aura peut-être reconnu au passage. Mais était-ce encore moi ? Ma mère en tous cas ne pouvait plus être des retrouvailles.
…………………………………………………………………………………………….
12 Août
à Bernard (- en Bretagne –)
La durée de la vie c’est vrai n’a qu’une importance relative. C’est une sorte de film. Pourquoi les jeunes de maintenant, outre cette insolence à vouloir (et penser surtout) qu’il y ait à vivre cent vingt ans avec certitude ?
Comme s’ils n’aimaient que les films longs.
Il est vrai que lorsque quelqu’un meure jeune on a toujours l’impression qu’il est parti avant la fin de la séance.
Nous raisonnons en terme de développement des cycles de la vie, qui sont à peu près ceux que nous attribuons aux saisons. On dit d’ailleurs qu’un tel est parti à la fleur de l’âge.
Cela peut donner à ceux qui restent l’impression que le disparu a manqué un épisode.
C’est sûr, et je le crois. Mais à nos âges, on pourrait partir comme si tout avait vraiment été accompli.
Notre capital cellulaire a rendu les diverses phases des cycles en question. Comme la nature a réalisé ses divers moments de naissance et de transformations nécessaires.
Sauf que nous n’avons droit qu’à un seul tour de manège.
On n’a plus qu’à se traîner encore un peu…
Ce qu’il faudrait comprendre, ce n’est pas de faire un concours de longévité, mais d’accomplir cette trajectoire qui est celle d’une flèche qui est lancée, qui va à son zénith et qui va se planter quelque part on ne sait où.
Pas de vivre deux cents ans, ou plus peut-être au XXII° siècle. Les scientifiques nous y préparent. Mais à quel prix ?
……………………………………………………………………………………………
La pluie bienfaisante est tombée timidement dans les matinées. C’est un peu de fraîcheur, du vert et du gris sur les jardins.
……………………………………………………………………………………………
Rolf Liberman prétendait qu’il n’y a pas d’« école française » de chant, tout en ajoutant qu’il n’y a pas plus d’école italienne ou allemande.
Je me souviens néanmoins d’une master class de Michel Sénéchal, félicitant ses élèves pour la qualité de leur voix, précisant que si elles espéraient faire un jour carrière, il leur restait à franchir ce qui faisait l’âme du chant, la juste prononciation qui donne l’illusion, non que l’on chante, mais que l’on parle. Ce qui revient à dire que si il n’y a pas d’école de chant, il n’y en a pas moins un génie propre à chaque langue et qu’exprimer celui-ci est le secret du chant intelligible.
Comment expliquer autrement le miracle de ce Samson et Dalila des années quarante, ce Pélléas des mêmes années quarante où les chanteurs donnent le sentiment que l’on pourrait se trouver sur une scène de théâtre classique.
Vanni-Marcoux avait une voix noble mais d’une sensibilité frémissante. La clarté de l’émission était telle que la projection se faisait jusqu’au plus loin des dimensions de n’importe quelle maison d’opéra, donnant l’illusion d’un naturel exposé sans le moindre effort apparent, concentrant tout l’art du chant à révéler l’énergie et le plein sens des rôles dans leur plus secret intérieur.
Michel Sénéchal a eu ce génie de l’articulation, il l’a transmis tout au long de son enseignement, Elisabeth Schwarzkopf aussi, Irmgard Seefried aussi et tous les grands passeurs de chaque génération. De même de l’école de la Marchesi, de Manuel Garcia et tant d’autres.
Cela ne suffit pas à faire une école mais probablement à perpétuer des courants qui maintiennent vivants les génies propres de nos différentes langues.
…………………………………………………………………………………………….
13 Août
à Bernard -(avant le départ pour les Cyclades)-
J’en ai fini avec les réflexions sinistres, j’ai préparé le balluchon.
Avec bien sûr la casquette. J’ai peur qu’elle fasse un peu trop anglais.
Qu’importe. On s’attend à tant de frou-frou. Un peu de rigueur britannique fera contraste.
Je redoute (à Mykonos) les terribles décibels d’après-midi et de la nuit.
On sera dans une petite rue du centre bien protégée paraît-il.
Dans le giron de Mykonos on verra Délos, l’île des dieux. Prévu de 11h jusqu’à 17h. Elle est minuscule. Il y a la maison de Cléopâtre entre autres choses.
Puis Naxos, la plus grande sur notre route. Puis ce sera Santorin pour trois jours plein. Et retour pour le dernier jour complet à Mykonos.
On n’attend plus que le récit.
…………………………………………………………………………………………….
Les cyprès arrachés, un muret a été élevé entre le 28 et chez nous. Reste à le crépire et à remplacer les arbres par de grands panneaux de feuillages dès que possible. Le jardin me paraît bien tristement dévasté. A la fin du mois il prendra un tout nouveau visage, avec un nouveau dallage. Le plus triste c’est quand on va devoir arracher le prunius.
…………………………………………………………………………………………….
13 Août
Bernard est en Bretagne. Nos lettres se croisent.
…………………………………………………………………………………………….
PRELUDE AUX CYCLADES
Je n’ai point fait un voyage pour l’écrire.
J’allais chercher des images, voilà tout.
Chateaubriand (Préface à l’Itinéraire de Paris à Jérusalem)
Demain je serais, tard dans la nuit, sur le sol des îles grecques. Je n’avais jamais fait que survoler Athènes en septembre 71, l’Acropole vue du ciel déjà illuminée vers dix huit heures, pour une première escale d’un vol à bas coût qui devait me mener bien plus loin, en cinq autres étapes (!) vers Bombay et les Indes où je séjournerais plusieurs semaines. C’était la première fois que j’approchais les patries des racines de la philosophie occidentale.
Quelques longs mois plus tard je serais en classe de philo pour y découvrir Lucrèce, Platon et tant d’autres. Et Clément Rosset dans l’amphithéâtre, les rires au bistro du coin, l’initiation aux sources de toute pensée.
…………………………………………………………………………………………….
Que mon corps ne me dicte pas d’insomnie…
…………………………………………………………………………………………….
LES CYCLADES 14 / 21 Août…
Mercredi 14 Août
Devant la multitude des îles grecques qui s’offraient à la curiosité, il fallait bien choisir.
Ce sont quatre îles qui furent élues parmi les deux cent cinquante existantes et la quarantaine habitées. Mykonos, Délos, Naxos et Santorin, pour un temps évidemment compté.
…
C’est encore un vol différé. Cette fois l’attente se fait dans l’avion même durant une heure en bout de piste, comme du temps des déconvenues terroristes.
Nous décollons au crépuscule d’Août, donc bien tard. La nuit est bien tombée déjà pour voir depuis le hublot de gauche l’impressionnant spectacle qu’offre la Rome éternelle à quelques milliers de mètres au-dessous, un tissage féerique d’électricité comme une toile de Pollock, avec des trouées noires signifiant les espaces inhabitées.
Saint Exupéry, parlant des paysages, disait qu’on ne pouvait mieux en apprécier la valeur qu’en prenant de la hauteur.
L’arrivée à Mykonos se fait vers vingt trois heures. Le taxi se fraie un chemin (où ne devait passer que des mules auparavant) et nous dépose à l’ «Orphéas Rooms », charmant petit cube d’un blanc immaculé, aux fenêtres et aux balcons rouges. L’hôtesse nous expose le plan de la cité et les divers lieux qui pourraient nous intéresser. La fenêtre de notre chambre donne sur la mer au loin et la lune est ce soir une lune rouge.
Puis c’est la descente à pied vers le cœur de la ville où les commerces ne ferment apparemment jamais. La violence de la lumière électrique prend les entrailles de Mykonos dans un étau de couleurs glauques. Ce qui prend aussi physiquement à la gorge, et qui saisit, sans qu’on puisse s’y soustraire, c’est l’horrible fond sonore qui tapisse le moindre recoin des ruelles, les placettes et tout le dédale de ce qui serait le cadre le plus parfait d’un paradis terrestre.
Je ne sais le nom des rues, des lieux publics, puisque les inscriptions ne sont qu’en alphabet grec. Quelques chapelles immaculées se rencontrent au hasard des rues, entre deux tavernes et un restaurant saturé.
Comme à Venise, mais pour d’autres raisons, tout descriptif me paraît inutile, pas même les quelques échappées de ruelles semblant se perdre dans quelque inopinée douce obscurité où l’on devine les tons traditionnels de l’architecture aux escaliers et aux fenêtres de bois bleus sur des murs d’une blancheur limpide.
Et je me pose cette question qui en devient lancinante « que pouvait bien être ce paradis naturel il y a cinquante ans ? »
De paradis, les humains y ont installé le pire de leurs artifices, la laideur de leur enfer.
La petite Venezzia, la nuit tombée, est l’image même de cette frénésie décadente et barbare de bruit et de fureur de jouir.
Pourtant, au détour d’une petite place, un trait d’humour ne m’aura pas échappé : un minuscule bistro propose, à l’entrée, des manteaux de fourrure avant d’aller consommer au bar où la température est celle d’un frigo. On peut apercevoir, au travers d’une fenêtre, des clients comme autant d’ours blancs patauds et hilares.
Nous tentons de prendre un verre, d’un vin exécrable, à l’heure où la fatigue commence à se faire sentir sur des fauteuils qui s’enfoncent dans leur faux cuir à l’un des multiples établissements encombrés, malgré la gentillesse d’un serveur affable.
Les femmes sont extraordinairement endimanchées pour la nuit qui va suivre, parées dans leurs élégantes robes à frisson qui seront souillées de leur sueur dans quelques heures…
Les moulins du haut de la colline, à quelques pas de notre résidence, semblent insensibles, et dressent leur hiératisme comme d’éternelles sentinelles.
Et puis cette nuit la lune sera rouge.
Jeudi 15 Août
Et pourtant Mykonos est belle. C’est comme des fantômes que nous pénétrons dans les rues qui rendent leurs lots épars de fêtards, mais ces rues respirent maintenant de leurs boyaux étroits, avec ces fameux pavés bicolores qui indiquent comme des cailloux de petit Poucet la ligne de fuite des perspectives. Ces rues de gros dallages joints par de l’enduit blanc forment aussi une sorte de fil conducteur continu comme une peau de serpent. Cela donne l’illusion que c’est la rue qui nous montre le chemin où sont les maisons de couleurs encore endormies.
Le vent nous prend le long des quais du port de plaisance. Les gros navires de croisière accostent déjà.
Les moulins, comme celui de Don Quixote, sont face au soleil, les pieds dans la poussière jaune, ne reçoivent jamais d’ombre et sont les phares repérables de n’importe quel point de la ville.
Depuis une église orthodoxe, dans tous le quartier alentour , nous parvient une liturgie grave et profonde, avec des voix solistes, ténor et basse, alternant avec des chœurs. C’est évidemment le 15 Août ! Donc depuis une de ces églises principales, puisqu’elle est traversée par une rue que nous emprunterons fréquemment, s’élèvent les longues litanies du grand Chant Octogonal à la Vierge qui prennent à la gorge tant l’intensité du rituel des fidèles semble sourdre du fond de leur foi.
C’est une réflexion que je me fais en songeant à toutes ces errances que les différentes conférences catholiques ont pu entreprendre pour détruire l’essence même du lien rituel qui se fonde dans le chant religieux, dans la mystique musicale. Le Concile de Trente avait définit les canons de la musique liturgique, avant que, par abandons successifs, l’élévation et la mystique ne sombrent et ne cèdent à l’appel de l’attraction du monde. Depuis Vatican II, le vide s’est installé en matière de ciment liturgique pour faire place à des ritournelles à la limite de la chansonnette qui seraient juste appropriées pour la veillée de jeunes scouts.
Le Pape François a même déclaré récemment que la musique de l’église catholique se devait d’être à l’écoute des expressions les plus représentatives de notre temps…
Loin en effet de cette ferveur hors du temps qui se répand ce matin dans les rues d’une ville pourtant peu enclin à donner d’elle un tel visage.
La foule se presse silencieuse jusque loin à l’extérieur, après le parvis de l’église.
Le vent souffle fortement sur le port. La mer a sa couleur de cobalt avec des frisottis blancs d’écume et le sel mange la peau en un rien de temps.
Au loin, face au port, les maisons blanches sont bâties sur des sols arides où ne se profile aucun arbre. Quelques moulins désossés tiennent compagnie à une multitude de chapelles blanches aux coupoles rouges ou bleues se confondant avec le ciel.
Et en début d’après-midi, c’est l’embarquement pour Délos.
DELOS
Délos la déjà africaine, Délos, royaume de pierres et de ronces. La mer à l’encre la plus bleue, la mer d’Egée, la mer des îles, la mer rugueuse où à l’arrière du navire le sillage laisse un remous large et profond jusque loin derrière nous.
« Nous espérons l’infini dans les possibles de l’homme » (Livre des Répons, p. 146)
Nous espérons l’éternité derrière l’aridité de la pierre, des solitudes et des espérances closes dans la vanité de ce qui meure, même si la mer, la terre, les bleus infinis marquent un monde qui a cru un jour s’approcher du parfait.
Le paysage aux abords de l’île, embrassée du regard, respire le dessèchement sur toute l’étendue du site archéologique, jaune et austère.
Des colonnes isolées, par deux, ou par trois, émergent droites et solitaires, des murets et des murs d’enceinte forment les seuls vestiges visibles, donnant un semblant de verticalité à l’arrivée du petit port.
C’est la petite et humble île de Délos que choisit comme pays natal Apollon Phoebus, le superbe dieu de la lumière. Sans doute a-t-il fait le meilleur choix possible parce que nulle part ailleurs on ne rencontre cette lumière céleste dans laquelle baigne le paysage granitique et nu de l’île, cette sérénité surnaturelle qui se répand dans l’air à Délos.
Et qu’est-ce que Délos ? Un rocher de granit au milieu de la mer. Tout autour, les Cyclades parsèment le centre de l’Egée, elles semblent définir la circonférence d’un cercle magique, dont le centre serait l’île sacrée.
Comme un noyau tellurique rayonnant.
Ses petites dimensions ( à peu près six kilomètres de long sur moins de quinze cent mètres de large), ne suffiraient d’elles-mêmes à justifier le destin que lui réservait l’Histoire. Seule la protection des dieux pouvaient l’expliquer.
Plusieurs légendes sont liées à l’île. C’est Homère qui chante l’hymne à la naissance d’Apollon dès la fin du VIII° siècle avant J.C. L’ancienne petite Astéria, la sœur pétrifié de Letô, ne pouvant pas jeter l’ancre, devient Délos (l’Apparente) et prend appuie sur de solides colonnes au fond de la mer. Les Cariens sont donnés comme les premiers habitants de Délos et Thucydide les associe aux morts accompagnés de leurs armes de fer découverts dans les tombes pendant la Purification. Les vestiges archéologiques prouvent que les premières traces de vie sur l’île datent du III° millénaire avant notre ère.
L’époque mycénienne (1580- 1200 av. J.C.) est mieux représentée. Un habitat complexe est localisé sur le rivage près du port.
En 1873 commencent les fouilles de l’Ecole Française d’Athènes dont Maurice Holleaux fut Directeur et Organisateur des Fouilles de 1904 à 1912 comme l’indique une plaque à l’entrée du Musée. Ces fouilles se poursuivent jusqu’à nos jours, mettant en lumière la majeure partie de la grande ville riche, avec ses temple et ses ports, ses marchés et les quartiers aux somptueuses villas, agrémentées de cours et d’atrium, décorées de mosaïques et de fresques.
Les visiteurs que nous sommes, qui vont errer dans les rues et les places de cette ville antique unique, palpitante de vie, resteront sous l’impression que ses habitants viennent juste de la quitter, laissant derrière eux, parmi les ruines, toutes leurs possessions, ainsi que leurs espoirs et leurs rêves.
C’est par l’Agora des Compétaliastes, l’Exèdre en marbre, devant les Propylées, l’Agora des Déliens, l’Oïkos des Naxiens, du Colosse des Naxiens, quatre fois la taille naturelle dont il ne restent que quelques fragments du torse, les colonnes redressées des Artémisiens que l’on arrive à cet extraordinaire allée qu’est celle du quartier des Lions, que l’on associe à l’image de l’île, sorte de vitrine et emblème de Délos que les visiteurs et les amateurs d’art antique connaissent déjà pour les avoir vu sur des livres d’art. Ils bordent l’avenue d’une manière qu’on ne retrouve que dans les sanctuaires de l’Orient et d’Egypte. Ces fauves impressionnants ressemblant plutôt à des panthères, par leur absence de crinière et une certaine maigreur (on voit saillir leurs côtes), sont assis sur leurs pattes arrières comme de vrais gardiens du Sanctuaire.
Suivent la maison des Tritons, la Maison du Lac, dont le sol de l’atrium est recouvert de mosaïques aux simples motifs géométriques, le gymnase aux arcades, la Fontaine Minoé, l’Exèdre de Dionysos, la Maison de Dionysos dont le détail le plus célèbre est la sublime mosaïque de la cour qui constitue une des créations les plus remarquables de l’art de la mosaïque hellénistique. Dionysos est représenté les ailes grandes ouvertes, couronné de lierre sur un tigre qui porte autour du cou une couronne de feuilles de vigne et des grappes.
Tous les motifs sont des symboles du dieu du vin qui est peut-être représenté ici revenu de son retour des Indes.
Puis c’est la Maison de Cléopâtre l’Athénienne (et non l’autre), la statue de la maîtresse de maison et Dioscoride, peut-être parmi les plus belles à ciel ouvert.
La Maison du Trident dont l’intérêt est qu’elle représente le type de péristyle que l’écrivain Vitruve qualifie de « Rhodien », le Théâtre, la Maison des Masques avec une fois encore une mosaïque de Dionysos monté sur une panthère sur fond noir.
La Maison des Dauphins aux animaux fabuleux.
Puis le sanctuaire et l’Antre du Cynthe, sommet de l’île que nous ne grimperons pas sous la fournaise de ce jour, mais où l’on peut accéder par une rue montante aux escaliers taillés dans le granit.
Héraïon, et enfin l’édifice le plus célèbre et le plus spectaculaire, le temple d’Isis aux colonnades doriques et au fond de la cella, la statue de la déesse.
Redescendant, c’est la « Maison à une seule colonne » celle de l’Hermès à deux niveaux, une des plus belles, et le temple d’Aphrodite.
Le Musée en forme de fer à cheval, où est déposée à l’entrée la plaque au nom de Maurice Holleaux, s’ouvre sur une fantastique série de statues du haut archaïsme, de la période archaïque récente, des périodes classiques, et des périodes hellénistiques.
La concentration d’autant de chefs d’œuvre fait de ce lieu un des plus attractifs qu’il m’ait été donné de voir. Et c’est sur cette petite Délos.
…
De retour à Mykonos, c’est la chapelle blanche aveuglante au soleil d’après-midi, mangée de plantes grasses sur le côté gauche de la façade, la Chapelle Paraportiani, faite comme si elle était née de la pierre même de la ville tant elle semble inséparable du paysage au Sud de la ville. Malgré la relative petitesse de taille et la sobriété de la chapelle, elle n’est pas le fruit d’un élan spontané, mais d’une sorte d’assemblage autour d’une construction d’origine. Cet ensemble est surtout le résultat des jeux du hasard, des temps et du vent. Œuvre d’un artisan mykoniate, anonyme et mystique, qui réussit à transformer un tas de ruines de ce qui était un modeste édifice en un chef d’œuvre architectural non moins sobre mais d’une beauté plastique irrésistible.
Sur la petite Venise, à peine calmée de ses fureurs nocturnes, nous longeons le chemin étroit et dallé, léché par les vagues. La perspective des maisons de couleurs sur des semblants de pilotis donne l’impression de défier le front de mer. Nous grimpons ainsi en bout de promenade littorale jusqu’aux moulins dont l’exposition solaire est maintenant au dos des ailes, mais dont la perspective perfore en vue plongeante sur la petite Venise et les maisons à pilotis maintenant tout au bout de la jetée.
C’est le repos du milieu d’après-midi, gorgés de soleil, écaillés de fatigue.
Vers vingt heures nous rencontrons, dans l’église orthodoxe du plein centre de la ville, le bien étrange Père Georges qui veille sur d’admirables fresques dont les toujours présentes Dormitions de la Vierge et de l’immanquable Saint Georges au Dragon. Le père Georges en ce jour de la fête de la Vierge est intarissable sur les beautés qu’il a rencontré dans son existence, sur ses voyages, sur les différentes langues qu’il semble pratiquer (auprès de quelques autres visiteurs qu’il salue au passage), que nous en arrivons presque à quelques familiarités en nous risquant à parler de vin. Des cinq traditionnellement admis comme plus grands vins blancs de France, dont je me pris à décliner les noms, buttant sur le cinquième, bien que je les cite chaque fois presque sans y réfléchir. Le Père Georges me fit promettre de lui transmettre le nom de ce fameux inconnu dans les plus brefs délais…
Puis c’est le soleil qui décline, c’est l’heure où depuis les fenêtres de la chambre, les oiseaux entonnent une symphonie électroacoustique qui ferait pâlir les meilleurs Pierre Henry.
C’est ensuite le début de la nuit dans les vieilles ruelles, le T. Bone de veau, le vin blanc de la région, avant la paisible méditation sur le balcon blanc aux boiseries et aux chaises rouges de la chambre d’hôtel, avec le rhum blanc à boire devant la lune qui n’est plus rouge cette nuit mais qui se reflète sur les petites vagues dont on devine les clapotis sereins le long du rivage.
Vendredi 16 Août
Depuis la fenêtre de la chambre j’aperçois maintenant nettement l’île oblongue de Délos. C’est comme si le côté sacré devenait aujourd’hui évident, le regard ne pouvant s’empêcher de s’attarder sur elle plus que sur les autres éléments du paysage qu’offre la lumière matinale.
La chaleur semble aujourd’hui plus intense encore, et ce sont les moulins sur la colline qui se présentent tout vifs au soleil du levant, et plus loin, après la Petite Venise, merveilleuse et solitaire, la chapelle Paraportiani, dans sa blancheur de chaux, qui expose aussi sa façade dans sa grande nudité.
Par les rues et par les chemins, puisque c’est un privilège ici d’avoir le cœur de la ville à soi avant le réveil de toute les cohortes de touristes. Il n’est que les camionnettes de livraison qui encombrent de leur mouvement les ruelles qu’elles parcourent de leurs pétarades.
C’est ce cheminement curieux du matin qui donne l’impression dès aujourd’hui de connaître déjà toutes les petites traverses de la ville, avec ces différences d’éclairage que la lumière expose, durant la trajectoire du jour, sculptant différemment les pierres et la densité des couleurs.
Chateaubriand disait : « Ce ne sont pas les objets qui constituent les paysages admirables, ce sont les effets de la lumière ».
Dans une de ces rues près du port déjà soufflé par le vent frais, il est une étonnante boutique, une sorte de caverne d’Ali Baba, une caverne de merveilles qui regorgent de peintures religieuses sur bois. Nous sommes chez Sofoklis Georgiadis, au salon de l’esprit comme il est indiqué sur l’enseigne Konstantinos. Toutes sortes de thèmes sont représentés dont les Vierges à l’Enfant, les Saint Georges et les apôtres, les Anges et Archanges sveltes et dans les plus stricts canons de la représentation orthodoxe. Il s’agit dans cette boutique, d’une entreprise familiale dont Sofoklis Georgiadis fait partie, de peintres reproduisant depuis 1902 et quatre générations, à partir d’originaux, les exactes copies qui se trouvent être des commandes pour d’autres monastères ou des acquisitions à la demande de particuliers.
L’homme est affable et nous présente une sublime Vierge à l’Enfant au lourd vêtement prune et aux mouvements de membres d’une exquise composition, la tête de la Vierge légèrement inclinée comme il se doit dans les portraits traditionnels orthodoxes. Seule la position assez hiératique de l’Enfant trahit l’importance du sujet sous le regard attendri de la mère.
Nous restons longtemps en admiration devant ce magnifique travail qu’on ne peux plus qualifier d’artisanal tant la reproduction est maîtrisée par l’artiste qu’elle peut être considérée comme une réappropriation originale.
L’artiste proposa de nous céder l’œuvre pour quelque cinq cent euros sans pour autant se départir d’une attitude qui n’envisageait pas le seul aspect commercial et sans appuyer avec insistance sur sa proposition. Ce qui dans ces cas donne des regrets de ne pas saisir ce genre d’opportunité. D’autant que cette reproduction sur bois valait largement le prix demandé.
L’homme de l’art accepta que je prenne une photo de l’œuvre et même une seconde avec l’artiste tenant la Vierge à l’Enfant entre ses mains.
Le vent souffle toujours sur le port de plaisance et n’en est que plus encore ressenti par contraste avec l’espace confiné de la petite boutique.
C’est maintenant l’embarquement pour Santorin.
Le navire qui se présente, face au quai bouche ouverte, est un mastodonte proche du sourire du requin, sur deux ailes latérales à la manière des catamarans pouvant ici tracter plus d’un milliers de passagers et une quantité impressionnante de véhicules.
C’est le taxi des mers qui se répand un peu partout entre Paros, Ios, Naxos, Héraklion et le terminus pour nous, Santorin en moins de deux heures trente, à raison de cinquante nœuds (quatre vingt treize kilomètres/heure).
Depuis les vitres du navire on a pu apercevoir Naxos, son portique érigé sur le maigre promontoire battu des vents et du sel marin, l’anse du port et la blancheur des habitats que nous reverrons bientôt… Ios a été également une étape sur notre chemin. Peu de passagers sont descendus dans cette île qui aurait été, mais d’autres le revendique aussi, le lieu de naissance de Homère.
Puis enfin les hautes falaises de Santorin, anormalement abruptes, falaises de plusieurs centaines de mètres, tranchées dans le volcanique rouge de la pierre, où de loin on peut constater, au-dessus de nous, que les nids d’habitations ont été érigés sans aucune espèce de crainte du vide et du vertige. A certains endroits, selon les points de vue on pourrait croire en plissant les yeux légèrement, que la neige s’est fixée au sommet de ces masses colossales de granit rouge.
Nous n’accostons pas , comme les navire de croisière, au pied de la ville de Fira au cœur du volcan englouti dans cette petite mer qu’on nomme Caldeira, d’où la vue sur le théâtre naturelle rappellerait un peu celui du cirque de Gavarnie, comme une sublime panoramique et d’où en quelques minutes, les visiteurs sont hissés par un téléphérique vertigineux au pied des habitations.
L’impossible route des ânes à flanc de rochers n’est évidemment pas pratiquée par les touristes.
Pour nous la route sera plus longue. Le gros navire nous dépose sur un petit quai qui ne fait pas face à la ville d’en haut, mais sur une petite anse de côté qui donne sur une sorte de petit port furieusement animé qu’on croirait à un village western de studio.
Le bus prendra une route aride et dangereuse, où les car qui montent croisent ceux qui descendent durant de longs kilomètres, rendant sublimes certains points de vue, depuis les virages, sur les îlots au pied de la falaise dans le décor d’un coucher de soleil extraordinaire qui semble s’annoncer lentement dès le milieu de l’après-midi.
L’arrivée à Fira se fait donc par l’arrière de la ville. On pourrait presque dire par les coulisses qu’on ne visite généralement pas, sorte de banlieue qu’on imagine déplacée dans ce décor habituellement connue comme décor de carte postale face à la mer.
Le car nous laisse finalement à la gare routière grouillante et bruyante, sur des pavés coupants, généralement en pente, avec une distance à parcourir qui paraît interminable avec nos valises roulantes, au travers des ruelles commerçantes qui nous détournèrent, par tant de confusion, du chemin menant au modeste complexe hôtelier, le « Sweet Pop » excentré mais heureusement isolé.
La vue sur la mer promise lors de la location n’est pas la vue imaginée au pied des falaises sur la mer de Caldeira, mais la vue sur l’autre rivage de l’île, celle de l’est, qui n’est finalement distant que de quelques kilomètres à vol d’oiseau depuis notre terrasse.
La déception viendra d’apprendre que le chemin de corniche qui surplombe superbement toute la crête de l’île est coupée depuis de longs mois du à l’effondrement de certaines roches rendant périlleux le passage obligé le long de ce sentier poétique. Il faudra un détour par de caillouteux sentiers pour parvenir au raccordement donnant sur la vue splendide de Fira où les lumières des maisons troglodytiques livrent toutes la majesté d’un spectacle de lumière.
Nous dînons dans un restaurant à plusieurs niveaux de terrasses, d’un bœuf Stroganoff en guise de compensation, et par le plus grand des paradoxe, notre restaurant se situe à quelques mètres de l’arrivée habituelle du funiculaire.
La pleine lune éclaire maintenant notre terrasse et enveloppe de ses reflets d’argent toute la mer qui regarde vers la Turquie.
du fond du verre la tête armée
le sommeil au fond des clartés
le sommeil du fond des plaies
(Livre des Répons , p. 104)
Samedi 17 Août
Lettre à Bernard :
Santorin : Oïa est une ville tout au nord de l’île, sublime. C’est ce que montrent toutes les photos de voyage qui font rêver. Fira , l’autre ville, au centre, est beaucoup moins séduisante. C’est un peu St Trop ou St Paul.
D’une manière générale, les villes sont les plus photogéniques qui soient pour les yeux du touriste, mais à y mettre les pieds, même au plus poétique des ruelles et des chemins, tout est affreusement sale. Parfois mal odorant.
On dirait que les ramassages de déchets sont en grève permanente. Et visible sans que ça gêne. On est réellement aux portes de l’Afrique du nord. Les grecs sont rarement affables. Plutôt impatient, surtout dans les lieux où on attend un peu plus d’amabilité et de compréhension comme les offices de tourisme ! On a eu des réponses cinglantes du genre " I don’t know" sur le ton le plus mal approprié. Parfois quand la préposée ne connaît pas le lieu, l’imagination supplée à l’ignorance : "on ne vous mènera pas sur ce site, car personne n’y va" ou une variante "ça vous coûtera 200 euros en taxi" alors que le site en question est accessible par le car toutes les vingt minutes. Et ainsi pour tout. Quand il faut aller à droite, on vous indique d’aller à gauche. On y a senti comme une certaine malveillance pour tout dire. Et le plus triste c’est l’absence d’information. Un mépris absolu pour tout ce que nous considérons comme culturel ou digne de curiosité.
On dirait que la taxe carbone est réservée aux pauvres français qui devraient comparer avec la Grèce. La pollution due aux 2 roues (cinquantenaires souvent) et les déchets de plastique qui jonchent les terres arides ne peuvent pas s’expliquer par la seule pauvreté du pays. Les voitures peuvent donner l’impression de n’avoir jamais été lavé. Les sièges défoncés où ne manquent que les ressorts qui vous rentreraient dans les fesses…
Nous sommes devenus des tyrannisés de l’écologie quand l’Europe tolère ce qui se passe dans ce pays. C’est le pays cancre de l’Union. Le Portugal est un parangon de civisme à côté.
Platon est mort il y a longtemps. Comme pour l’Egypte, il y a eu une mutation entre les peuples antiques et ceux de maintenant.
…
J’assiste au lever du soleil qui troue la ligne d’horizon. C’est l’avantage d’être logé côté Est de l’île.
La traversée de Fira, très tôt, par le sentier des mules mal odorant, n’est pas propice à embrasser le village et sa partie troglodytique qui n’est pas encore dans la lumière face à la mer. Dans l’un des tournant de la descente, la pente est tellement raide au-dessus de la falaise qui regarde la mer, à plus de trois cent mètres, que je dois me profiler le plus près possible le long de la paroi rocheuse. Il est sûr que je ne remonterai pas par le même chemin.
L’intérêt se trouve être maintenant sur l’autre orientation de l’île, vers le Nord. Et comme les ânes et les pèlerins qui vont à pied, nous cheminons jusqu’à Firostefani par le sentier tortueux, accidenté de cette route de crête, qui traverse les merveilles qui s’offrent en traversant les hameaux et les habitations qui ont parfois l’insolence de plonger le regard bien haut au-dessus de la Caldeira et de n’avoir d’autre obstacle que l’infini horizon. Ce chemin présente ce qu’il y a de plus poétique jusqu’au sommet de la ligne de crête. Les vues successives, au hasard du cheminement, prennent des accents allant du plus riant panorama à ceux qui confinent au sublime. Les chapelles sont nombreuses qui jalonnent le parcours. Celle qui ponctue la sortie du quartier de Firostefani avec ses parures d’ocre jaune, de carmin et de bleu, surplombant la falaise, est la plus éblouissante.
Parvenu au monastère dont la coupole était visible depuis la sortie de Fira, il nous est impossible d’y pénétrer. De pieux zélotes en défendent l’accès, ne recevant pas de promeneurs, surtout les femmes en petits pantalons.
L’austérité du lieu est d’autant plus remarquée que des popes de hautes tailles, tout de noirs vêtus en accentuent la sévérité. La pureté de l’orthodoxie, paraissant prendre le pas sur la tradition de l’hospitalité chrétienne. La maîtresse dame accompagnant l’un d’eux est passée devant nous sans un salut, ou plutôt nous offrant le regard du mépris, portant une lourde charge de victuailles et de ce que je crois avoir reconnu comme étant ce fameux vin blanc de Santorin.
Dommage, la coupole que l’on suivait des yeux depuis longtemps, dans son bleu se confondant avec le ciel, restera momentanément un regret sur notre chemin. Celui-ci est toutefois chaotique et douloureux après quelques heures de marche, que nous décidons de faire une halte en sortant de la route de crête, pour un havre ombragé et le verre de blanc de l’île.
Il est clair que la raison nous dicte de rendre les armes et il n’est maintenant plus question de rejoindre Oïa à pied, désespérément distante d’encore plusieurs kilomètres, les plus pentus, les plus arides.
C’est au bas d’une pente s’enfonçant vers des paysages plus communs et sans trop d’intérêt, dans des végétations abandonnés, aux maisons inachevées, que se trouve l’arrêt de bus, en pleine campagne.
Le bus va sillonner la côte sèche, ingrate et dépouillée jusqu’à longer le littoral Est, contournant le chemin que nous aurions du poursuivre à pied et que de jeunes courageux ont adopté, montant au travers d’un chaos de pierre et de fournaise, où leur silhouette apparaît tout là-haut comme des fourmis clairsemées, sur ce que je crois être l’enfer que nous avons évité avant de parvenir à Oïa.
Cette fois, le bus n’aura pas à nous laisser loin du but de notre excursion. C’est en pleine Oïa, d’où émerge tout de suite des clochetons et une coupole bleue, que commence la découverte de la ville.
Oïa est immédiatement beaucoup plus attractive que Fira, d’autant que la lumière est orientée de telle manière que le soleil passe puissamment sur les maisons troglodytiques dans une course d’Est en Ouest sans être contrarié par aucun contre-jour.
Les ruelles souvent bien étroites ont le charme des fleurs et des murs qui se marient aux divers débouchés sur le bleu des coupoles elles-même mêlées à l’azur où ils se confondent.
La rue principale qui longe la ville du Nord au Sud, délaissant les pierres disjointes et sombres de Fira, est pavée d’une sorte de marbre gris, plat et uniforme, infiniment moins douloureuse pour les pieds, réfléchissant la lumière limpide sur tout le parcours, où il y a comme un parfum aristocratique qu’on ne trouvait pas à Fira.
De quelque côté que ce fut, Oïa est soumise à la lave, au volcan antique, à cette Atlantide dont certains pensent qu’elle est au cœur de cette Caldeira plongée au pied de la falaise.
La ville est nichée, et comme des champignons qui se sont développés sur l’assise de ces roches de volcan, au sommet et aux flancs de cet assemblage granitique, à la manière d’une neige vue de loin, où ont poussé les dômes, les églises et les maisons dans le plus beau désordre anarchique pour l’émerveillement du monde.
Une femme disait voir, très au sud, une traînée de blanc qu’elle ne pouvait comprendre, au sommet des falaises. Devant tant d’évidence, je répondis en toute univocité, semble-t-il, que c’était de la neige au sommet de la lave au lointain. Elle rétorqua sèchement : « pas du tout, j’ai cru voir au loin quelque chose qui ressemble à un clocher… »
L’humour, avec certaines personnes, ressemble à un mur qui se casse lorsqu’on veut le retenir, et l’absence d’humour un désert d’imbécillité comme une mort dans l’âme.
Après avoir été jusqu’aux lisières Sud de la ville, revenant par l’artère principale, nous avons suivi les dalles de couleurs qui parsemaient les petits boyaux à flancs de falaises nous menant vers cette sorte de trouée où le paysage devient sublime en contrebas, avec les moulins au loin et les trois églises à coupole bleue, en une vision de carte postale, se détachant sur la mer Egée et le couchant. Depuis un emplacement où était sûrement un ancien fortin, la vue sur l’ensemble des maisons, des dômes aux petits drapeaux grecs flottant fièrement, des ruelles serpentines, des églises parsemées, et la blancheur aveuglante sur tout l’ensemble, en était le point sommital.
De retour à Fira, la soirée se passe dans un petit bouzouki faisant entendre, sans cesse, mais discrètement, la musique de Zorba le Grec.
Rendus à notre terrasse, face à l’Egée, et dans le prélude à la nuit, le vent qui passait sur nos visages lavait de la fatigue de tant de lumière, de coulées troglodytiques, de ruelles serpentine à Oïa dont je ne cache pas la déception de n’y avoir trouvé que des chambres d’habitation à louer de très haut luxe, alors que je les imaginais dans la liberté de leur enracinement sur l’île.
Je me suis pris à rêver à cette possible Atlantide, comme à toutes les Atlantide qu’on a dans le cœur.
La lune rouge a passé à nouveau du côté Est, pourpre, sous nos fenêtres confuses, puis a grimpé dans un voile de pâleur comme une Ascension, quand je me suis aperçu de toute l’intensité lumineuse que drainait cette côte Est qu’on avait cru dans la discrétion endormie du jour, avant ce merveilleux spectacle des lumières scintillantes sur la plaine.
Des cloches résonnent encore avec au loin la lumière verte clignotante du petit aéroport qui attend les rares avion de la nuit.
La terre découpée dans ses plaies aveugles
…
la nuit à l’englouti théologique
(Livre des Répons , p. 68)
Dimanche 18 Août
L’ANTIQUE THERA
Le soleil est encore à peine sorti de la ligne d’horizon et fait pâlir le grand îlot tortueux d’Anafi qui est légèrement sur la droite face à notre fenêtre.
C’est une petite distance que l’on parcoure en bus depuis le terminal, menant à la côte au Sud Est. Le village est charmant avec ses maisons basses clairsemées dans une physionomie qui n’a pas d’âge et qui m’a fait retrouver un peu de ces villages colombiens sans ordre et comme sortis d’une amnésie.
Kamari est aussi une délicieuse station balnéaire sans bruit et sans grande prétention sinon d’avoir la beauté de celles qui savent qu’elles sauront charmer.
Nous profitons quelques instants du bord de mer, de la plage en contrebas avec son sable fin et noir comme la lave qui l’environne, ses chaises longues, ses parasols de paille et tout là-haut un grand escarpement de montagne sévère.
C’est depuis la petite agence de tourisme que le minibus, par une route pentue à dix pour cent, comme l’annonce le panneau dès le début de l’ascension, que commence le chemin menant à l’Antique Théra.
Quelques kilomètres plus loin, nous voici au pied d’une immense masse montagneuse présentant un chemin balisé, caillouteux, fortement pentu et rendu plus aride par les rafales d’une force inouï qui menacent à tout instant de faire vaciller. L’air est incroyablement pur, dégagé, et à mesure que l’ascension se poursuit, on voit se profiler tout en bas, à flanc de falaise, le village de Kamari qui dévoile progressivement toute l’étendue de son paysage.
Et là, c’est un petit miracle qui s’est produit. Je sais que mon organisme est sujet à une sensibilité totalement irrationnelle au vide et à certaines configurations fussent-elles vertigineuses en mode ascensionnelles (sentiment de perte de la gravité). D’un côté je marchais sur ce sentier très étroit donnant sans protection sur le vide de la falaise, offrant le spectacle du village diminuant à mesure de l’escalade, de l’autre la montagne écrasante de majesté. Dès le début de l’escalade j’ai pensé qu’il me serait impossible d’aller plus loin, mais les symptôme de mon trouble n’apparaissant pas, je poursuivais le cheminement dans les rafales du vent, l’escarpement de plus en plus étroit et le vide menaçant sur ma gauche. Et c’est là que par ce que je nomme un petit miracle, les manifestations de mon mal ne se réveillèrent pas.
Le chemin n’en parut pas moins long et douloureux. Parfois il s’écartait du vide et le village n’était plus perçu sur la gauche. La pente semblait plus abrupte à mesure que nous approchions du plateau de la cité antique.
Et puis soudain, après ce petit calvaire d’ascension, sur le plateau enfin dégagé, un autre univers, intemporel et silencieux, si ce n’était le vent solitaire et complice de l’azur, s’est offert à nous.
Un paysage serein dominant de près de quatre cent mètres la mer Egée, avec au premier plan les premières ruines antiques et les arbres méditerranéens sombres et courbés par ce vent éternel, l’herbe sèche, brûlée et jaunie.
C’est là, dans l’harmonie de cet environnement de tous les éléments végétaux, la pierre taillée, l’azur sur le fond de mer lointaine, le souffle du vent, que l’on est saisi par ce sentiment du paysage classique.
La Grèce éternelle.
…
Nous venions de loin à la rencontre d’un temps lointain.
…
Au 8° siècle avant notre ère, des colons doriens, originaires de Sparte, s’installent à Callisté, comme l’île s’appelait à cette époque. Leur chef, Théra, donne son nom à l’île et à la ville qu’il fonde, qui sera, tout au long de l’Antiquité le centre administratif et religieux de la Cité de Théra.
Pour fonder cette ville, il choisit la colline de Mesa Vouno qui appartient au noyau prévolcanique de l’île dominant la côte Sud-Est entre des plaines de cendres volcaniques.
Des routes pavées à flanc de colline relient la ville à la plaine et aux côtes où sont fondés des ports, Oïa au Nord et Eleusis au Sud. Probablement dépourvue de muraille, la ville s’étend sur le sommet de la colline où nous sommes. Les bords étroits et escarpés de la colline abritent des lieux de culte, tandis que la partie centrale, plus régulière, permet le développement du centre urbain de la ville. Les fouilles ont révélé la forme qu’avait la cité aux époques hellénistiques et romaine, c’est à dire les plus récentes. La continuité de l’occupation a détruit les vestiges des périodes antérieures, comme les inscriptions archaïques gravées sur les rochers, qui attestent du plus vieil alphabet grec de l’Egée.
Des sanctuaires à ciel ouvert, des temples, des bâtiments publics, un théâtre, une agora, des boutiques, des quartiers d’habitation composent l’image de la ville et reflètent son apogée à l’époque hellénistiques, quand Théra constituait une base navale et une possession des Ptolémée, les souverains du royaume hellénistique d’Egypte.
A partir du III° siècle après J.C. la ville décline, et à partir du VIII° siècle, elle sert de refuge contre les Arabes aux habitants de ses ports. Peu à peu la cité cesse d’être habitée.
…
Il me vient en tête une réplique de Beckett à je ne sais qui : « je me sens bien dans vos ruines »
…
Qui ai-je aimé de ce dur désir de la pierre ?
(Livre des Répons , p. 136)
Revenus à l’arrêt où le bus nous avait laissé, le vent continue de siffler, c’est la lente descente vers Kamari qui reprend son visage de petite station de bains de mer, à l’heure tardive du déjeuner, sous le calme des parasols et l’île de Anafi qui se découpe cette fois face à nous.
La plage est couleur de cendre, le vent souffle encore violemment. La mer a la couleur de l’émeraude sombre.
Le vent et le sel nous baptisent de ce morceau d’Egée qui va dormir jusqu’au prochain soleil de demain, de son âme classique comme toutes les âmes qui ont été porté par ces souffles d’éternité chaque jour recommencés.
…
C’est depuis le balcon d’un petit restaurant indien qui domine la place et la rue piétonne du Fira populaire et animée que nous dînons au vent frais du soir, avec le spectacle des lumières qui s’allument sur les promeneurs de cette fin de dimanche.
Ce soir la lune est redevenue rouge, mais semble avoir perdue une partie d’elle-même comme si on l’avait grignotée telle un pain d’épices.
Le petit aéroport près de Kamari fait descendre ses avions. Demain nous quittons ces rivages volcaniques et son cratère d’Atlantide.
Lundi 19 Août
Les jambes sont bien lourdes ce matin. C’est une brève visite, à l’heure calme et au soleil bas, de l’église catholique à l’intérieur aux voûtes ogivales d’un bleu marial et au clocher qu’on a pu apercevoir durant tout le temps qu’on a passé dans le quartier.
Fira et ses maisons troglodytiques sont toujours dans l’ombre et le sommeil du matin.
Puis le car nous même par la même route vertigineuse qu’à l’aller, aux pierres rouges, jusqu’au petit port toujours en effervescence dans l’attente du départ pour les autres îles.
Il y a, dans ses odyssées d’îles en îles, un aspect auquel on ne pense pas avant de partir dans les Cyclades, c’est l’épuisement des attentes aux quais, les retards et la soif sous le soleil. Cela donne momentanément un petit côté exode dans ces enchaînement d’îles où les cohortes de touristes se croisent. Ceux qui attendent l’arrivée du navire, ceux qui en sortent en longs chapelets ininterrompus.
…
Nous quittons Santorin.
L’Atlantide et ses rêves laissent ces mystères millénaires sur le sillage insensible des remous du navire revenant vers Mykonos.
Le vent frais est toujours là aidant à supporter la chaleur au sortir du navire.
C’est chez Spanelis, tout près du port, qu’un chemin improbable nous mène sans indication aucune, comme c’est de rigueur dans le pays, vers un portail bleu comme la mer un jour de grand vent. Au sommet d’un promontoire, juste avant le portail, une petite église présente sa solitude face à la mer. La mer odorante dans ce coin de l’île, exposée ici au vent plus que du côté des moulins d’Orphéas.
Même la table de jardin qui nous accueille au pied de la maison a la couleur profonde de la mer Egée. La terrasse de notre chambre donne au couchant, droit sur la mer, et en contrebas, on peut apercevoir les grands ferries prêts à l’aventure.
C’est par cette approche opposée que nous descendons vers le port de plaisance, progressivement vers l’anse du vieux Mykonos.
Je prend un cliché apparemment improbable, mais la tentation était forte, d’une barque tanguant sous l’effet d’une houle légère, dans un contre-jour presque parfait, laissant tout l’espace inférieur de la photo dans un coulis horizontal de noir et blanc qui exclut toute autre couleur.
Les rues sont animées en ce milieu d’après-midi et l’église orthodoxe Métropolis est fermée. Je ne peux donc pas dire au Père Georges, qui nous avait si bien reçu lors de notre visite, que le cinquième des meilleurs vins blanc de France était le Château Chalon qui venait tout ensemble avec Montrachet, Château Yquem, Château Grillet et La Roche aux Moines et sa Coulée de Serrant…
Nous déambulons longtemps comme pour nous imprégner fortement, en territoire bien connu maintenant, dans les ruelles et les rues de ce côté Nord de la ville, présentant les mêmes caractères de pavés scellés par ces larges enduits blancs, les balcons saturés de couleurs et les ciels qui les enserrent pareillement à ceux que nous avions traversés dans les quartiers Sud de la cité, vers Orphéas.
C’est chez Funky Kitchen, qui, malgré son appellation passe partout et finalement banale, que nous goûtons, et c’est presque un luxe, dans une ruelle à l’abri des frénésies de la ville, la meilleure des cuisines qui pourrait venir de Lyon ou d’une belle tradition de France. Le rouge de Crète complétant cette élégante pause à la tombée de la nuit, d’autant que les lumière s’allument rendant une belle transfiguration à cet îlot de quiétude à l’heure où Mykonos s’embrase à deux pas d’ici.
Le retour chez Spanelis sur le sentier hagard de la nuit ne peut cacher la fatigue évidente ressentie au terme du sixième jour.
Mardi 20 Août
Le vent a claqué les volets et les portes de toute la terrasse d’un souffle de tempête que la nuit en a été écourtée. Le ciel a gardé ce matin toute la limpidité et la sérénité que peuvent avoir ces îles bénies où l’on ne lève plus même jamais les yeux au ciel pour savoir quel temps il fera.
Naxos est bientôt en vue. Y-aura-t-il une Ariane au cœur de notre séjour ? au cœur de notre rencontre durant les quelques heures de notre passage ?
« Es gibt ein Reich… Il est un Royaume » dit la longue mélodie de Strauss. Il y a une Naxos pour l’Histoire, et une pour les légendes.
Dès l’arrivée par l’arrière du navire, comme la baleine de Jonas, nous sommes déversés sur l’embarcadère, et tout de suite sur la gauche, le promontoire battu des vagues et du vent, telle une sentinelle qui connaîtrait seule les secrets de l’histoire, se dresse le monument peut-être le plus connu, le plus symbolique des cyclades. C’est la Porte de Naxos. C’est aussi un grand moment d’émotion en parcourant la jetée qui mène à cette extrémité tout au bout du port. Nous recevons les embruns qui sifflent, les vagues qui fracassent tout le long du maigre passage.
La mer est émeraude, la mer est de cyan.
C’est la porte qui domine les ruines d’un temple dédié à Apollon. Son plan ionique à trois nef est encore discernable.
Selon la légende, c’est là que Thésée abandonne Ariane à son retour de Crète après avoir vaincu le Minotaure. C’est là aussi que la belle fut secourue, enlevée en fait, par Dionysos. On suppose donc que c’est ici que se développa le premier culte de Dionysos.
On peut entendre, mais encore faut-il bien écouter ce que dit la mer, la longue plainte du Lamento d’Arianna.
La porte est là, tournée vers la ville et donnant loin sur la mer, blonde, patinée jusqu’à l’os, mangée de sel comme une punition, le vestige nu comme une épave se dresse donc à la proue de Naxos.
Les vagues se font violentes que la peau est déjà imprégnée de ce sel que le vent charrue loin, bien loin des rivages et jusque dans l’intérieur des terres.
Naxos est encore légende. La plus célèbre est celle opposant Poséidon et Athéna pour Athènes. Le dieu de la mer fut aussi défait à Naxos où Dionysos fut préféré.
C’est ainsi que, même avant d’avoir franchi un pas à l’intérieur de la ville, le rêve et l’histoire nous saisirent.
Les ruelles montantes, à l’heure où le soleil est encore ascendant, ne favorise pas les rencontres. On n’y perçoit que nos ombres qui passent sur les murs.
L’église orthodoxe, dans l’agora est silencieuse. Les icônes même semblent accablées. Le décati des maisons et la nudité des ruelles nous renvoient à un vide et à la réalité d’une pauvreté que ne masque plus le pittoresque que les pauvretés savent parfois vêtir de la féerie que tissent les harmonies irrationnelles de la ruine et de l’imagination.
L’église catholique à peine plus loin, au cœur de la cité qu’occupèrent les ducs francs jusqu’au XVI° siècle, présente le même silence de l’abandon alentour, de gravats, de poussière à peine masquée par la blancheur et la dignité des dédales où gît peut-être l’âme de Naxos.
Du haut de la citadelle, qui combattit probablement, de là où nous sommes, Barberousse, le dernier à conquérir la belle qui deviendra très vite une possession ottomane.
Du haut de la citadelle, devenue aujourd’hui un rendez-vous immanquable des promeneurs, la vue sur l’ensemble aux quatre coins de la ville est imprenable. C’est depuis cette citadelle que s’est développé depuis 1739, l’Ecole des Ursulines avec son école de musique et sa carte de la France viticole (!) et qu’aujourd’hui, la vue panoramique sur Naxos au « 1739-Terrasse-Café », juste en dessous de la rue Nikos Kazantzakis, propose cette perspective sur les collines, sur tout le paysage jusqu’à l’horizon, et tout au loin comme un cœur dans la ville, le dôme bleu d’une église orthodoxe plus vaste que la cathédrale d’ici.
La ville d’aujourd’hui semble avoir appris et faite siennes les paroles du Lamento d’Arianna, Lasciatemi Morire.
Déambulant au hasard des quartiers périphériques à la recherche de quelque vestige médiéval, les rues sont sales et brûlantes vers midi, que même les cactus aux figues de barbarie paraissent pétrifiés et livrés à la calcination.
Une ancienne chapelle grise dans la pelade de ses murs semble avoir échoué au bord de la mer.
La Chôra est mangée par la jaunisse de l’abandon des hommes.
Est gibt ein Reich… Je n’ai trouvé à cette heure méridienne que tristesse et absence de cet esprit qui parfois habite les lieux dont les œuvres d’art portent les traces d’anciennes harmonies.
Mais peut-être n’ai-je pas rencontré Ariane ?
…
Le retour en ferry vers Mykonos se fait à l’heure de la tombée du soleil. Le vent n’ayant renoncé à souffler, les maisons sont effectivement comme la neige à la crête des roches à volcan.
Les terrasses des Spanelis sont le meilleur promontoire pour l’heure équivoque du soleil qui rentre doucement dans la mer.
Un couple de jeunes, charmants anglo-saxons (lui à l’accent trahissant fortement l’Irlandais, elle Australienne de Perth, qui n’a jamais ouïe « La Jeune Fille de… » la même ville, pas plus que le Carmen de Bizet, nous invite à boire leur blanc sec sur cette terrasse de la résidence sans que l’on ait su les raisons de leur invitation, sauf à partager ce moment où l’horizon mauve et triste, pathétique et toujours recommencé, dans ce décor où plonge les sensibilités d’une sorte de langueur après les fatigues du jour.
Rentré dans notre appartement, depuis la terrasse, ne restait plus qu’à voir mourir de manière plus aiguë encore les derniers mauves et les jaunes lancinants sur la mer Egée, dans son bleu de cyan, où maintenant les quelques gros navires immobiles brillent de tout le prisme de leurs guirlandes de couleurs électriques.
Mercredi 21 Août
C’est avec le car parti du vieux port que nous faisons connaissance avec l’intérieur des terres, que nous rejoignons le monastère de Panegia Tourliani dans le village de Ano Mera.
C’est tout de suite à l’entrée, sur un surplomb dominant la vallée désertique, à l’intérieur des terres. Le monastère est composé d’une façade surmontée d’un triple clocheton à peigne et d’un élégant clocher de marbre beige sur la droite de l’édifice. Le bâtiment est enceint d’une galerie à arcades blanches qui donne sur les chambres des moines suivant le pourtour de l’église.
A l’intérieur, des joyaux de l’art orthodoxe, comme le très fréquent Saint Georges au dragon et une extraordinaire Dormition de la Vierge. Le thème de la Dormition est étonnamment présent ici alors que la thématique est quasiment inexistante dans le christianisme occidental, sinon au Liget dans une minuscule rotonde dans des champs de fèves en Touraine.
La coupole centrale est décoré d’un Christ Pantocrator, rappelant celui de Céfalù, sur des murs de bleu marial.
L’isolement du village en fait un lieu propice au silence et à l’oubli du temps.
La place principale offre malgré tout ses tavernes et ses échos de bouzoukis entêtant.
Partout alentour c’est le désert.
Puis sur le retour vers Mykonos, nous échangeons quelque mots avec d’étranges passagers venus de Casablanca, et faisons halte à Klouvas, où dans ce désert de rocaille et le brûlé des herbes, des ronces et le jauni des étendues, se dresse une oasis à l’édifice bariolé de teintes extrêmement vives qu’on le croirait issu d’une hacienda mexicaine ou de l’imagination débridée d’un architecte de Las Vegas. C’est tout bonnement l’hôtel « Sun of Mykonos » qui a fait le choix de se perdre à plusieurs lieues de la ville. Plongé dans ses végétations de bougainvilliers, ses plantes grimpantes et ses successions de boiseries bleues et rouges, d’escaliers menant aux chambres sur d ‘éclatant murs blancs s’étageant sur plusieurs niveaux avec en fond de décor une minuscule chapelle où sont de merveilleuses icônes dont deux Jugement Dernier anonymes qui rivaliseraient avec les plus beaux spécimens du genre dans la peinture occidentale.
L’Oasis est ainsi tellement hors de contexte dans l’aridité de cet intérieur des terres que tout ce décorum me fait hésiter à le qualifier d’architecture de poupée ou, suivant comment on l’envisage, de la plus belle imagination qui soit pour un prochain séjour à moins de quatre kilomètres de Mykonos. Le jardinier, paraissant lui aussi d’un autre monde, arborait un sourire rayonnant tout à la fois humble et fier de ses créations, ne parlait apparemment pas un seul mot d’anglais.
Puis c’est le retour, jusqu’au surplomb où sont ces deux moulins isolés faisant face à l’autre extrémité de la ville, ceux-ci dominant la colline du port et dégageant une superbe vue sur toute l’étendue menant le regard vers les départs pour Délos et les autres îles.
Pour cet ultime après-midi, c’est la lente déambulation dans les ruelles, les douleurs du corps étant depuis longtemps devenues vives par tant de curiosités offertes au travers des sites et des chemins où nos pas ont épousé le pavé.
…
J’ai une pensée pour le vieil étudiant de philosophie, venu si tard sur le sol et les rivages de la pensée occidentale, de sa trajectoire, comme un archéologue qui aurait œuvré sur un site qu’il n’aura jamais foulé que vers la fin de sa vie.
…
Rentrés au déclinant du jour, rendant le relief du paysage plus acéré, c’est au havre de chez Spanelis, sur la terrasse, que la lente procession du drame du couchant peut commencer, avec le gros navire, hier encore amarré au port, qui suit perpendiculairement la route de la ligne d’horizon, et donner l’illusions de vouloir aussi se jeter comme la trajectoire du soleil devenu oranger, derrière une petite île dont on ne saura jamais le nom.
Maintenant l’horizon s’est paré de ses plus beaux roses et mauves, et la féerie se poursuivra encore profonde et lyrique jusqu’à notre départ de nuit pour l’aéroport.
Le vent souffle, le silence s’est installé dans le cœur. C’est tard dans la nuit que nous serons à Nice.
…………………………………………………………………………………………….
22 Août
« C’est faire injure aux loups dans l’homme est un loup pour l’homme ? ». Pourquoi tant de détestation, de mépris pour ce que nous sommes, déjà tremblants et désespérés ?
Est-ce la seule fécondation de la pensée athée ?
Je tremble, je prie pourtant sans croire à rien moi aussi. Du moins je peux imaginer une autre lumière derrière cette porte qui va se fermer demain. Pourquoi pas ? L’absurdité de ce que nous vivons est-elle la seule vérité appréhendable parce que rationnelle, visible, probable et comme vérité qui vous tombe des bras ?
L’animal ne sera jamais désespéré. Il n’anticipe pas ce que nous imaginons derrière le rideau final. Il finira pourtant comme nous. Ecrasé par le poids de ce qui confirme son programme mathématique de vivant, sa finitude.
Dans la dimension humaine, il y a cette tentation d’entrevoir et de croire en une dimension au-delà de l’impossible acceptation de cette aberrante fin dans la dissolution.
…Requiem pour notre misère.
…………………………………………………………………………………………….
25 Août
A-t-on remarqué que Lili Boulanger dont les œuvres se sont hissées au niveau des plus belles compostions de son temps, avec entre autres merveilles, ce fameux Hymne au soleil pour chœur et contralto, que cette sœur de Nadya est décédée dix jours avant Claude Debussy.
Il ne serait pas non plus trop insistant de remarquer qu’elle est née un 21 Août donc la veille de l’anniversaire de Debussy…
…………………………………………………………………………………………….
29 Août
Combien de fois déjà suis-je allé pèlerinant vers Conques, depuis ce fameux 29 août 80, où la lumière du couchant faisait chanter les pierres du divin tympan ?
Et combien de fois avons-nous omis de nous y rendre, comme dans ces années-là, une année sur deux ?
L’auberge Saint Jacques…
…………………………………………………………………………………………
31 Août
Je crois finalement que ma plus belle photo du séjour dans les îles grecques est le cliché pris sur le port de plaisance de Mykonos, apparemment anodin mais infiniment plastique, où apparaît, dans le plus parfait contre-jour, une barque solitaire sur la partie supérieure avec les vagues légèrement creusées en un ensemble que l’on croirait avoir été converti en noir et blanc. Le résultat du cliché me fait penser à une étude de Soulages, une laque fluide dans le mouvement brillant des vagues qu’aurait esquissé un pinceau suivant la rythmique de la houle. Je crois que j’aimerai ce portrait de mer pour son côté abstrait qui ne laisse imaginer aucune notion de temps ni de localisation particulière.
…………………………………………………………………………………………….
1 Septembre
Mon humeur chansonnière est, en ce début de mois, d’une sensibilité d’Avril, si ce n’était que nous ne sommes pas dans les avrils, en ces jours d’été aujourd’hui languissant, entre l’impossible « Il suffisait de presque rien » et « Avec le temps » pour ne pas dire « Je n’aurai pas le temps ».
C’est toujours ainsi, les saisons vont vers ces rentrées des classes qui sont souvent l’avril des amours.
…………………………………………………………………………………………….
Lettre à Bernard :
Ce soir je me sens vidé. Ce n’est pas que l’écriture du matin m’épuise, mais c’est l’angoisse de ne pas trouver le mot, l’expression…
Il en va du modelage de l’ensemble.
Et puis, comme tu sais, je ne me défais vraiment d’un voyage que quand le récit a donné son point final.
C’est la que je comprend que le voyage est fini. Il arrive alors un peu de tristesse. Tous ces soleils, ces couchants, ces pierres… et puis tout ce qui s’échappe comme de l’eau dans une main qui aurait soif.
Je ne peux pas non plus vivre que de départs pour Cythère.
C’est vrai que depuis que je suis inactif la bougeotte nous saisit. C’est un peu le lot de tous.
Je crois que je vais me mettre dans un club où on apprend à connaître les champignons. C’est une de mes grandes ignorances.
Notre amie de Salzbourg a déjà des paniers entiers de cèpes et de trompettes de la mort pour remplir des casiers entiers pour l’année et celles qui suivent.
J’ai encore un pot plein de ce qu’on avait ramassé en octobre dernier.
La plus grande qualité de John cage c’est finalement d’être mycologue.
…
Je ne crois pas que les enfants échappent à la conscience de la finitude. C’est vrai qu’ils ont d’autres étapes prioritaires et c’est mieux ainsi.
La conscience de la fin des haricots je l’ai ressentie à cinq ans peut-être, quand ma mère m’a dit maladroitement qu’elle ne me donnerait pas toujours la main.
Nous attendions mon père sur le trottoir à la sortie du travail.
Ma main s’est pétrifiée dans celle de ma mère comme celle du Commandeur dans Don Giovanni.
…………………………………………………………………………………………….
5 Septembre
Il est aujourd’hui d’horribles crimes commis, peut-être plus nombreux, souvent plus barbares que dans des temps lointains, relevant soit d’idéologies et de fanatismes les plus cinglants, soit de meurtres perpétrés par la violence privée s’abattant, comme il devient courant de le constater, souvent sur des victimes collectives. « Meurtres à l’arme blanche, actes de déséquilibrés, foules prise de panique… » etc.
Concernant la première catégorie, il s’agit d’actes de guerre. Souvent revendiqués par les auteurs dans l’exercice de la pratique terroriste. On remarquera, que ces actes-là ont parfois une logique dont l’issue s’achève en retournant la violence contre soi. C’est notamment le cas des kamikazes de ces dernières années.
Concernant la seconde catégorie, elle relève de crimes de droit commun, plus crasseusement je dirais, du fait divers.
Les deux catégories de crimes ayant pour point commun de devoir rester impunies dans l’ordre de la sentence suprême.
Mitterrand ayant, par son Ministre de la Justice, fait abolir en 1981, la peine de mort, il n’est plus aujourd’hui de repères dans la hiérarchie des peines. Les criminels des deux catégories en sont tout à fait conscients.
Et la France est un terrain privilégié sur lequel les deux types d’actes sont commis sachant que la Justice ne montera jamais dans les plafonds de l’application réciproque de la mise à mort.
…
Il me vient donc à l’esprit plusieurs réflexions :
– La peine de mort est supprimée pour les seuls meurtres commis par des particuliers qui tirent avantage de leurs abominations (Il sauvent leur vie).
– Par contre, les actes de guerre perpétrés par les Etats, dont la France engagée récemment en Syrie auprès des Américains, justifiés ou non, comme le largage de bombes sur des populations civiles, restent des méthodes détournées mais non moins certaines de condamnations à mort. La raison d’état justifiant les actes de guerre engagés contre des populations au bout du monde.
– Pour ce qui concerne l’abolition de la peine capitale pour les auteurs de meurtres quels qu’ils soient, ce sont aujourd’hui les mêmes militants, de Droit de l’Homme ou autres, qui refusent son application, que ceux qui revendiquent bien fort les bienfaits et les méthodes de la Révolution française.
…
Les tristes contradictions de la France dans sa marche aveugle se retrouvent à un degré différent mais non moins aussi hypocrite que dans les avancées des glorieux et enorgueillis défenseurs de la loi Veil (qui finalement n’est que la légalisation de meurtre sur fœtus) qui s’opposent farouchement à l’euthanasie et qui bientôt applaudiront au non remboursement des frais médicaux pour les vieux de plus de quatre vingt cinq ans..
…………………………………………………………………………………………….
LE COQ MAURICE AU TRIBUNAL
Le coq Maurice a finalement le droit de chanter… Depuis deux ans, une plainte a été, le plus naturellement du monde, déposée contre le chant d’un coq, aussi rapidement qu’hasardeusement surnommé Maurice, pour trouble de l’environnement, par un particulier vivant à proximité d’une ferme.
Celui-ci n’ayant certainement opéré un départ vers le monde rural que récemment.
(Il serait donc légitime de se poser la question de savoir qui trouble réellement l’environnement).
Il ne s’agit pas ici de Fable de La Fontaine, ou d’une quelconque métaphore morale pour l’édification du bien de tous , bien qu’on eut pu nommer cet épisode de la vie de campagne, Maurice et le chant du coq, mais bel et bien d’un épisode judiciaire réel comme on ne manque pas d’en rencontrer dans ce pays de France, où l’humour baisse aujourd’hui bien souvent la garde et où le ridicule pourrait revenir tuer.
Un des chefs d’accusation étant que le citadin accusateur ne supporte pas le bruit, surtout le bruit de la campagne.
Il est bien connu que le Parisien a une tolérance particulièrement large et comme allant de soi, à l’exclusion de tout autre, pour son seul environnement.
N’ayant pas eu accès , ni au dossier ni à l’audience, je suppose que si il avait eu gain de cause, il lui aurait fallu s’enhardir et continuer de gagner avec facilité des procès intentés contre les cloches du village, les cigales en saison chaude, contre Eole et le vent dans les arbres, tout autant que contre Neptune et ses vagues qui frappent sans ménagement les rochers proches des fenêtres du malheureux riverain.
Dans un contexte aujourd’hui qui penche vers la protection du vrai du bon et du beau, du naturel et de tout ce qui est à l’écoute de la planète, il est étonnant que nous n’ayons pas encore encombré les prétoires de plaintes contre les nuisances pour l’oreille que nos défenseurs farouches de l’environnement (il y aurait de quoi remplir une pleine page) ne considèrent pas souvent dans le catalogue de leurs doléances et qui se déversent comme autant de vomissures dans nos bonnes vieilles villes de France.
Des nuisances d’une nature bien plus autrement féroce pourtant.
On commence à rencontrer, non seulement des lois et des décisions affaiblissant de plus en plus l’univers économique agricole et le monde de la campagne en général, mais on arrive maintenant à pouvoir même imaginer nuire et peut-être détourner de sa nature de chanteur un bon coq comme ce Maurice.
…………………………………………………………………………………………….
6 Septembre
J’apprends hier que Ivo Malec est mort. Le dernier de la génération 1925. Un des plus discrets. Je lui avait parlé lors de la création de son concerto pour violoncelle, donné à Nice dans le cadre des MANCA, vers 2008. Il était étonné que j’ai fait un rapprochement avec son éblouissant concerto pour contrebasse : « Vous avez remarqué ? C’est vrai, j’ai cité pour ce concerto, une phrase de celui pour contrebasse », avant qu’une hystérique des premiers rangs ne l’accapare, lui faisant me tourner le dos.
…………………………………………………………………………………………….
15 heures
L’abuela est morte aujourd’hui. Je vois que je ne rencontre que la mort tout autour. Pour Dona Elena c’était prévisible. L’âge, les soucis, les ennuis répétés, une mort différée tant de fois par un insolent rebond que le ciel lui accordait. Y avait passé deux mois, l’an dernier avec son arrière grand-mère. Le souvenir ne restera pas dans sa mémoire.
Ce qui me peine particulièrement c’est la douleur de Cécilia, souvent muette, toujours discrète. Je sais son attachement à sa mère. Ses appels en Colombie deux fois par jour depuis plusieurs années.
Nous avons allumé une petite bougie, comme il y a huit ans pour maman, le 4 du même mois. Nous avons toujours besoin de lumière. Il peut faire si froid.
…………………………………………………………………………………………….
Lorsque mon père est mort, j’ai du comprendre que le fait de se trouver devant ce scandale incompréhensible, nécessitait une sorte de béquille, un baume apaisant, et c’est tout naturellement que je trouvais dans la bibliothèque du Musée Chagall, « La Mort » de Jankélévitch. Que je lus d’un trait. On y apprend que ce qu’on sait déjà, que la mort on ne la connaît pas avant, et qu’après c’est déjà fini. Qu’il y a un je ne sais quoi et un presque rien qui entoure ou qui auréole le moment même, insaisissable comme pourrait l’être l’imperceptible décomposé du mouvement.
Je retrouve à l’occasion du décès de Dona Elena cet ouvrage qui reste ce qu’on a, malgré tout, fait de plus approchant sur le sujet, en m’attachant plus particulièrement sur ce chapitre de la vieillesse qui n’a pas pris une ride :
« Chaque jour il devient un peu plus malaisé de dire pourquoi on vit, et en vue de quoi, et à quoi rime tout ça. L’absurdité intestine de la vie, théoriquement perceptible dès le plus jeune âge, s’impose ainsi avec une force croissante. Chez le nouveau-né, qui a tout l’avenir devant lui, une dose de non sens infinitésimale et en quelque sorte homéopathique pourrait être décelée dans l’immensité du sens : chez le vieillard , au contraire, la marge du futur tendant vers zéro, ce sont les dernières traces de sens qui achèvent de se perdre dans l’océan du non-sens. Le « sens de la vie » pour ceux qui se chargent de la trouver, implique à la fois signification et direction. »
…………………………………………………………………………………………….
Comme je prépare un peu le séjour qui nous mène à Paris dans quelques jours, je remarque que au cœur même de la ville, le Quai François Mitterrand est exactement parallèle au Quai Voltaire de part et d’autre de la Seine. Dans la symbolique de la grandeur, l’ancien Président de la République, comme écrivain, n’aura pas perdu au change.
…………………………………………………………………………………………….
C’est un vent de Spinoza qui revient où qu’on aille. Je ne peux pas faire un pas sans tomber sur Spinoza. Même mon coiffeur, peut-être parce que Portugais, laisse sur le guéridon un gros volume de l’Ethique en version bilingue (?). Des ouvrages d’explication, des exégèses, des méthodes pratiques, voire des exercices spirituels. Va-t-on vers un yoga, un zen Spinoza ?
Chez des amis, pas plutôt franchi le seuil, c’est l’ouvrage de Deleuze, ou de tel essayiste qui extirpe de Spinoza les quintessences de son enseignement philosophique pour atteindre la félicité, c’est l’incontournable Frédéric Lenoir qui propose de considérer la vie comme le verre à demi plein plutôt que l’autre, bref, on assiste à une unanimité de joie partout au travers de sa lecture. Est-ce parce que l’on a proposé à nouveau d’en faire légitimement, mais sans succès auprès des autorités rabbiniques d’Amsterdam, le père du nouvel Etat hébraïque ? Du côté de Pessoa, bien qu’il n’ait connu l’élan actuel de passion pour le père de la pensée où le Portugal pourrait se reconnaître, il est un silence et une absence d’intérêt qui semblent inexplicables.
…………………………………………………………………………………………….
7 Septembre
Dans la vitrine de la Librairie Masséna, je regardais un volume de la « Phénoménologie de l’Esprit » ré habillé avec de beaux motifs abstraits pour une édition nouvelle. J’entrais et pris dans le rayon philo le volume en question et fut frappé par la quatrième de couverture, où le traducteur n’hésite pas à considérer l’ouvrage majeur de Hegel à la hauteur du théâtre de Shakespeare, de la Divine Comédie et des Tragiques grecs dans la pensée occidentale.
Je n’avais retenu de cette œuvre que ce que j’avais pu en lire sans me sentir impuissant devant une réelle absence de compréhension qui ne pouvait donc nourrir une structure de pensée ou une direction à donner à celle-ci.
Clément Rosset m’avait dit un jour : « Un être à peu près normalement intelligent peut lire et comprendre Kant, la Phénoménologie de l’Esprit, non ». L’auteur lui même concevait des doutes sur la possibilité d’un lecteur qui l’eut compris. De même qu’il émettait des doutes le concernant devant la hauteur et la portée de la pensée qu’il avait engendrée.
La langue allemande étant par essence une langue tournée vers l’abstraction et les concepts dans leurs nudités, les enchevêtrements de ceux-ci n’ajoutent donc rien à la compréhension d’une pensée tendue ici comme un arc.
J’avais pourtant rédigé, dans mes années d’études, un mémoire sur « la Musique dans l’Esthétique de Hegel » dont la matière était redevable à la limpidité de cette Esthétique.
La tentation était donc grande, par la seule séduction de la quatrième de couverture, de reprendre quarante cinq ans plus tard, un monument depuis lequel j’avais mille fois chuté.
…………………………………………………………………………………………….
8 Septembre
Nonina aurait eu cent vingt ans… Elle est dans l’éternité, mais j’en suis encore à compter depuis l’échelle qui est la mienne. Maman l’a suivie dans la crémation, il y a huit ans.
…………………………………………………………………………………………….
L’harmonie absolue serait la restitution enregistrée sur quelques fragments de temps de tous les sons émis simultanément sur notre planète depuis l’origine des mondes.
…………………………………………………………………………………………….
LA VOIX SOUPCONNEE
La voix humaine a un visage. La clarinette ou le banjo n’en ont pas. Il n’est pas rare même de modeler, à partir d’une voix entendue, un visage composé, une panoplie de traits apparaissant comme autant de fréquences issues des sons de cette voix.
Dans les mélodies de Schumann ou de Fauré, et de bien d’autres, dans l’intimité des paroles, l’interprète sait toujours placer l’inflexion et la couleur qui transfigureront les mots, en même temps que se dessinent le caractère imaginaire d’un visage que l’auditeur se fait de l’interprète.
Le caractère principal est celui de l’âge, de la fraîcheur ou au contraire de la maturité avancée d’une voix. Viennent ensuite des caractères secondaires ou annexes, comme le tempérament, la blondeur imaginée, le diaphane ou l’ardente peau d’une brune, d’une Marguerite ou d’une Carmen.
A partir des seules fréquences de la voix sur le spectre sonore, l’imagination supplée et surajoute à la réalité de l’analyse que peuvent enregistrer les scientifiques. Une clarinette restera toujours une clarinette, alors que l’on peut, avec un peu d’attention reconnaître entre mille, la voix de Maria Callas ou celle de Régine Crespin.
De Kathleen Ferrier, on dit, sans trop se tromper, qu’elle est une voix unique. Ensuite, comme une voix est vivante, on lui attribue des qualités généralement exprimées par la personnalité de l’interprète. S’agissant d’elle en particulier, ce qu’elle a d’unique est d’être la voix d’un monde rare et fragile dont elle serait l’incarnation. L’ange, la voix maternelle, l’ambiguë androgyne, et paradoxalement pourtant absolument femme, la voix de lait maternelle tout autant que celle d’un long fleuve de miel, médiatrice d’un monde céleste. Femme absolue, englobant à elle seule toutes les voix de femmes en une seule, absolue et idéale, relevant de Platon et pourtant incarnée et réelle. Blonde ou brune, selon le phantasme, jeune, fragile et pourtant sans âge, puisque dans l’éther d’un monde où le temps n’est plus.
Mais cette adéquation entre une voix et l’ensemble de ses caractéristiques qui la révèlent comme angélique, diabolique, blonde ou brune, n’est plausible que lorsqu’il s’agit d’artistes qui ont acquis réellement ces traits de caractère et les ont hissé au point de les utiliser et de les employer dans le registre psychologique où on les attend, comme relevant d’un code ou d’un ensemble de nuances avec lesquelles ces chanteuses vont jouer.
…
Me trouvant depuis un moment, qui paraît toujours trop long, dans la salle d’attente d’un médecin, je pouvais presque entendre la conversation entre celui-ci et la patiente, des éclats qui laissaient place à des sons plus étouffés, des bribes se perdant ensuite dans des fins de phrases inaudibles, puis des inflexions très nettes, des exclamations proches du soulagement ou de la perplexité. Toute une gamme de sons filtrés par une simple cloison d’où tout un univers psychologique transparaissait au travers des voix du médecin et de la patiente.
Puis mon attention se fixa sur celui de la femme, celle du médecin n’étant devenue qu’une traînée de grisaille morne, monocorde, dans mon esprit qui ne s’y intéressait plus, pour mieux me concentrer sur la voix qui lui faisait face.
Celle-ci me semblait légère et claire, jeune. Surprendre ainsi une conversation voilée par une simple cloison est souvent un plaisir qui peut distraire de l’ennui, comme c’était le cas dans cette salle d’attente. Les inflexions donnaient à penser qu’elle avait l’air de prendre plaisir à exposer des doutes ou ajouter des nuances et des précisions comme il se doit lorsqu’on veut convaincre un interlocuteur.
Je me suis pris à imaginer les traits de visage que je voyais dans un ovale enveloppant une peau douce comme les mots qui me parvenaient. Ces mots eux-mêmes n’étaient rien que des mots d’usage courant et relatait dans leur choix quelque souffrance sans gravité. La scène commença à me paraître s’éterniser quelque peu, et j’imaginais déjà la silhouette, la stature de cette femme qui ne pouvait pas avoir plus de quarante ans, peut-être même trente, lorsqu’elle franchirait la porte dans un moment. Affinant mon portrait mentalement, j’entendais une voix qui aurait pu être une voix calibrée comme celle entendues dans les aéroport ou sur les répondeurs de téléphone. La voix universellement jeune, sans aspérités et sans personnalité aucune, sinon d’être jeune et douce, aimable en toute circonstance.
Du moins j’imaginais ce genre de personnalité lisse s’exprimant ici dans le naturel d’un dialogue banal sans les contraintes professionnelles de la voix de velours des répondeurs. C’était comme si l’opératrice était là, saisie dans une scène où le naturel serait revenu et où la douceur et la jeunesse de timbre demeuraient.
Alors je la voyais belle, j’étais impatient de voir confirmer mon intuition lorsqu’elle franchirait le pas. J’hésitais encore sur quelques détails, mais elle devait immanquablement être blonde et grande et il me semblait que c’était elle qui dirigeait le dialogue bien qu’étant ici la patiente.
Enfin la porte s’ouvrit doucement et les voix, sur le seuil, étaient devenues maintenant claires et sans ambiguïtés.
« Merci docteur, nous nous revoyons dans un mois. D’ici là… Je compte sur vous… etc. »
La personne qui à ce moment se révéla à mes yeux au travers de cette voix qui continuait d’émettre, mais aussi de toute sa présence physique, était une petite dame proche de mon âge, aux cheveux courts et blanchis depuis longtemps semble-t-il, légèrement courbée et aux gestes un peu hésitants et fragiles. Je n’eus le temps de trop être frappé par le contraste de ce que j’avais imaginé et ce qui fugitivement et furtivement avait maintenant disparu de mon champ de vision, que le médecin était déjà là à me tendre la main.
…………………………………………………………………………………………….
10 Septembre
La pluie est tombée ce matin. C’est le vrai commencement de l’automne.
Y a pêché sa première truite hier. Il avait décidé qu’elle serait pour Tita et moi. C’est aussi la première fois que je suis amené à vider un poisson.
…………………………………………………………………………………………….
La grisaille qui est tombée sur Nice est peut-être un avant goût de notre séjour à Paris qui promet d’être pluvieux jusqu’en fin de semaine. C’est un réel plaisir que ces quelques jours qui préludent aux départs. Et cette année, ce ne fut que départs et retours, comme devrait toujours être le mouvement de la vie. Où l’on n’a jamais le temps de se figer.
…………………………………………………………………………………………….
PARIS 12/17 Septembre
12 Septembre
Cette fois c’est en train, comme il y a cinquante ans, lorsque je m’en allais avec Henri de Cacérès, vers cette capitale où j’allais pour la première fois.
Tous les amis du Pub Latin nous avaient accompagnés sur le quai de la gare. C’était comme aller vers un inévitable paradis.
Démunis mais souverains.
J’allais y retrouver Jo qui ferait sa classe de Terminale, loin de Nice où ses parents voyaient pour elle trop de tentations.
C’était fin octobre.
A quelques semaines près, cela a la couleur d’un pèlerinage.
Cinquante années plus tard, j’accompagne Cécilia valider les années d’activité qu’elle aura passées en Colombie. Et bien entendu, ce sera l’occasion de prendre ces quelques jours à flâner dans Paris, pour la première fois ensembles.
…
Je n’aime pas le train bien sûr, mais je ne suis pas insensible à ces gares où on sent que des mains se tendent, des mains vont se séparer, d’autres se retrouver.
Avant, mais n’est-ce pas toujours le cas, on agitait des mouchoirs ?
Et puis il y a ces sifflets et ces vapeurs, même si aujourd’hui tout marche à l’électronique, j’ai toujours, malgré moi ces illusions de sifflets et de vapeurs qui préludent au départ de ces toujours monstrueuses locomotives. Et déjà le bruit des rails, l’accélération…
C’est avec une relative lenteur que jusqu’à Marseille et Aix, le train se traîne, après il prend vraiment de la vitesse et insensiblement on voit le paysage changer. Lorsque le soleil descend après Lyon, je ne me lasserais pas du paysage bourguignon, de ce presque crépuscule qui s’annonce, de ces pâturages blonds et lisses à contre jour, de ses vaches blanches encloses dans des champs infinis. De ces fermes et de ces hameaux épars, aux toits rouges et aux clochers modestes.
Puis c’est fugitivement Cluny, dont le transept de l’abbaye, unique, aperçu de loin pour un œil avisé, les ruines de sa nef, laissent imaginer quelle était sa puissance sur le monde chrétien il y a quelques siècles. Cela ne dure que le temps d’y rêver un peu.
L’arrivée en gare de Lyon se fait vers vingt heures. La tour au gros horloge est toujours d’une grande majesté et me fait penser inévitablement à une cousine de Big Ben.
Le Train Bleu accompagne la sortie sur la Place de la gare à une heure où les rues ne sont pas encore vraiment éclairées, mais ou les Uber et les taxis sont pris d’assaut. Les terrasses de café font sentir que la journée est finie et que le parisien vient y épancher ce besoin de terrasse et de liberté avant la nuit. Mais les terrasses à Paris ne désemplissent jamais. Comme une nuit éternellement bleue qui va venir, avec le jaune des éclairages donner la mesure de cette liberté qui se répand aux quatre coins de la ville.
Un premier malentendu s’installe lorsque le taxi nous dépose au pied de l’hôtel « des Buttes-Chaumont ». Si celui-ci se nomme ainsi il n’en est pas moins éloigné du parc du même nom de plus de six cent mètres, ce qui en terme d’espace parisien peut changer énormément le caractère et la physionomie des lieux. Le quartier des Buttes dont je gardais le souvenir d’un passage en 74, entre Bolivar et Botzaris, me semblait calme, pavés et propice à la sérénité qui se fait souvent sentir en certains autres quartiers vers les marges de la ville.
En fait, notre « hôtel des Buttes Chaumont », rue Secrétan, se situe exactement à l’entrée du métro Jaurès, avec au nord Stalingrad, Louis Blanc et au sud Colonel Fabien. Au pied du Bassin de la Villette et du canal Saint Martin de l’autre côté. Quartier grouillant, fortement africanisé, populaire et criard, pauvre, bariolé et anarchique.
L’hôtel est tenu par des algériens, l’inévitable moquette est souillée et l’espace de la chambre exigu. Depuis le balconnet on voit la ville qui gronde et qui tremble par le passage du métro aérien et qui s’impatiente dans le plus féerique des paysages de lumières de véhicules, avec les klaxons comme lointain souvenir de Bamako ou d’Alger.
Le second malentendu arrive lorsque l’homme de l’accueil nous demande d’où nous venons :
– De Nice.
– Et vous y êtes depuis longtemps ?
– En ce qui me concerne, depuis plus de cinquante ans. Mon épouse depuis trente cinq ans.
– Et auparavant ?
– Ma femme est colombienne et je suis né à Rabat, au Maroc.
– Et de conclure en toute logique:
– Ah ! vous êtes juif du Maroc !
– Silence de la surprise.
– Je n’ai pas dit ça…
– Déductif :
– Ah ! vous êtes donc français né au Maroc.
– Exactement, comme mes parents.
Et de là s’ensuivit chez l’homme intarissable, une improbable ébauche des mérites du Général qui auraient pu être plus grands s’il avait mieux saisi la situation en Algérie, dont lui était originaire, sur cette affreuse Guerre qui n’avait fait que des victimes de part et d’autre, avec d’ailleurs tous ces algériens qui venaient chercher ici du travail et…
…
Avant de monter par un minuscule ascenseur, harassés, vers la chambre de nos cinq nuits à venir.
…
Dans la rue, les lumières sont maintenant métalliques et le grouillement plus intenses encore depuis la nuit complètement descendue sur nous. Sur la terrasse d’un bistro d’en face, où nous n’avons d’autres forces que de dégringoler quelques verres de vins, les jeunes filles sont souvent en petites bandes, entre elles, pour des secrets de filles, et des cigarettes qui se consument à la vitesse de leur volubilité.
La nuit est jalonnée par le féroce passage régulier du métro sur le métal du pont tremblant de toute sa carcasse, le temps de disparaître dans les profondeurs balisées.
Vendredi 13 Septembre
Derrière la faible lumière que filtrent les rideaux en fin de nuit, c’est évidemment la grisaille parisienne. La grève des transports en commun promise.
Nous sommes dans l’ambiance.
L’impression de glauque est rendue par la triple conjonction du temps triste, de la circulation anarchique et improbable au milieu de travaux qui semblent ceux d’Hercule en vue des Jeux de 2024, et la résignation qui se lie sur les visages pressés et automatisés, dès huit heures du matin face à la paralysie de la grève, rendant les arrêts de bus habituels gonflés de cette population résignée et silencieuse.
Le grand taxi Uber conduit par un africain nonchalant nous laisse sur un angle des Champs-Elysées et de la rue de Berri où est le cossu Consulat de Colombie.
L’attente ne sera pas insupportable et les démarches administratives de Cécilia achevées, nous reverrons le ciel vers les onze heures.
Nous longeons les Champs jusqu’au Rond Point des Champs-Elysées et les très massives et paradoxalement si élégantes architectures du Petit et Grand Palais.
L’entrée au Petit Palais en ce jour de grisaille reste comme une parenthèse avant l’éclaircie.
Une grande galerie très claire présente des bustes et des sculptures de pied en cap. On y rencontre au hasard, Bernard Palissy, des Carpeaux et des Sèvres au bleu royal, des tapisseries et du mobilier Louis XIV et Louis XV. Des chinoiseries aussi.
Construit à l’époque de l’Exposition Universelle de 1900, le panorama des œuvres est très large qu’on ne sait si il sera possible de tout voir.
Ce qu’on retiendra c’est probablement les peintures, celles peu connues de Gustave Doré, d’un romantisme violent, un Ambroise Vollard de Cézanne aussi sculptural que les portraits de Madame Cézanne où les humains sont traités comme les cailloux, les pommes ou les natures mortes qui ont fait sont génie.
En face, un Monet immédiatement reconnaissable parce qu’il paraît être Impressions Soleil Levant. Il s’agit du même motif dans les gris d’où émerge ce soleil rouge sur l’horizon à petites touches et deux barques noyées dans le flou du fleuve. On peut situer l’œuvre comme antérieure au Soleil Levant qui donnera le nom au mouvement Impressionniste, parce que daté de 1870-1872, alors que le plus célèbre est de 1874.
Défilent des Delacroix (le Combat de Giaour et du Pacha), des Courbet dont la Blouse de Proudhon, des Renoir et des Toulouse-Lautrec. Un tableau qui s’apparente au fameux « la Liberté guidant le Peuple », le « Combat devant l’hôtel de ville, 1830» de Jean-Victor Schnetz, reprenant le même mouvement du drapeau tricolore qui montre le chemin.
Des Corot diaphanes, des Théodore Rousseau.
Sisley et le chevet de l’Eglise de Moret dans l’incendie de son crépuscule.
Tout une salle est consacrée, en musique, aux icônes de l’Orient Chrétien, avec les fameux thèmes vus il y a peu dans les Cyclades.
La Renaissance, dont j’ai remarqué surtout cette Vierge à l’Enfant d’un anonyme lombard.
La flânerie, attendant le lever de la lumière, aura duré une belle partie de la matinée, avec un regard au jardin intérieur qui ajoute un charme à la longue découverte des lieux.
C’est vers midi que nous prenons le vin blanc sur le Quai d’Orsay, non loin du Pont Alexandre III, dans la tonalité qu’a le ciel, gris rehaussé des dorures jalonnant toute la longueur du pont.
Le ciel se montre timide, mais déjà quelques moutons s’étirent dans les lointains, laissant apparaître quelques trouées de bleu.
Sur les quais, la maison Kugel présente à la vente de somptueuses pièces d’Antiquités. Nous sommes les seuls curieux à cette heure et tellement suivis à la trace que l’on a l’impression de marcher sur des œufs.
Plus loin dans la même direction, c’est le Musée d’Orsay, un des plus fabuleux d’Europe. Aujourd’hui le temple de l’Impressionnisme depuis 1986. Nous n’épuiserons pas les ressources d’un tel lieu bien que toutes les œuvres présentées ne concernent que la période allant de 1848 à 1914.
C’est au cinquième étage, après avoir traversé toute la longueur de l’immense verrière que nous allons directement aux Impressionnistes.
Mille cent toiles nous attendent.
Le Déjeuner sur l’Herbe et l’Olympia de Manet, immenses toiles, la petite danseuse de quatorze ans de Degas, l’Origine du Monde, l’Enterrement à Ornans et l’Atelier du peintre de Courbet de dimensions impressionnantes. Les Joueurs de Cartes de Cézanne, le Moulin de la Galette de Renoir, et puis le plus émouvant, parce que peut-être résumant ce qu’est l’Impressionnisme, la série des Cathédrales de Rouen de Monet, où les différentes expositions solaires au chevet de la Cathédrale, comme celle de Moret vue le matin, sont autant d’entités et de variations sur le thème de la lumière et de ses féeries éphémères.
L’art du temps suspendu dans ce qu’il a de plus irréversible.
En parallèle, nous avons, durant cette même période, les orientalistes, éblouissant par la concision du trait, la sélection de la couleur gourmande, les clairs obscurs délicats, et la mise en scène de l’invitation au voyage, aux rêves que faisait la bourgeoisie, de cet ailleurs qui se projetaient du temps des grandes odyssées orientales sous Napoléon III.
La cohabitation des deux univers est aujourd’hui possible dans le grand vaisseau de ce Palais d’Orsay.
Depuis l’intérieur de l’édifice, à hauteur de l’immense cadran horaire, se dresse, dans les lointains, sur la Butte, le Sacré Cœur.
…
Entre la rue du Bac et la rue de Beaune, c’est le carré prestigieux des antiquaires.
Nous prenons un verre au Voltaire, sur le quai du même nom, avec au-dessus de nos têtes la plaque qui indique que c’est ici que l’auteur est mort.
L’après-midi déroulent ses quais, maintenant inondés de soleil, ses bouquinistes et les derniers vestiges de nuages ont fait place à la blondeur réfléchie de la pierre. Le Pont Neuf exerce une attractive lumière de crépuscule. Les badauds laissent pendre leurs jambes au dessus de la Seine, d’autres investissent le pavé sous les arbres qui habillent la perspective pour le spectacle du jour finissant. L’institut est déjà dans l’ombre. La beauté de la ville dans cette féerie est comme la quintessence de ce qu’on idéalise de la lumière parisienne, dans ses bleus, ses blonds et les gris de ses bleus de l’âme.
L’épuisement bien compréhensible nous mène vers Jaurès, où nous dînons au restaurant du même nom qu’on va finalement adopter à deux pas de l’hôtel.
Samedi 14 Septembre
L’apôtre Raoul Follerau, l’apôtre des lépreux, est sur le chemin du Canal Saint Martin. Sa statue du moins.
Il est neuf heures ce matin et ce n’est pas sans une certaine détresse que Paris me semble dans le sommeil. Peut-être est-ce parce que la fin de la semaine a commencé hier soir.
Que penserait Bernard, avec qui j’avais longé le canal voici deux ans, riant et vivant, et qui me parait aujourd’hui dans l’abandon, livré à l’incivilité que je ne croyais possible que sous les négligences de la Grèce des îles ? Les ordures, les bouteilles flottant vides dans l’eau du canal, les ignobles graffitis s’affichant et ne laissant aucun espace libre dans le périmètre des maisons et des berges.
Même l’hôtel du Nord, pour rendre un peu plus l’impression de désolation, est fermé, et tout alentour semble abandonné et livré à la plus noire des négligences. Tout ce qui fait surface pourrit au fil de l’eau où les feuilles d’automne dans la tristesse des lieux, accompagnent ce catalogue de misères.
Je croyais que Madame le Maire avait pour priorité la préservation et la défense de l’environnent.
Les trottinettes vertes n’y suffiront pas.
Les écluses elle-même sont pétrifiées. Dans l’eau morte, l’ombre du matin et la rouille des aciers.
D’un tel site, l’impression que j’en ai ressentie est la même que pour une usine abandonnée dans laquelle on aurait travaillé une partie de sa vie.
Une jeune asiatique, sur le même pont que moi, ne semble pas remarquer ces petits désastres toute préoccupée qu’elle est de se selffier sous toutes les coutures.
La Place de la République est en vue. Nous y faisons la halte du café croissant au bistro du même nom. Tout y est excellent.
Par la rue de Turbigo il n’est plus qu’à suivre les longues perpendiculaires menant à la transversale de la Rue Saint Martin où est le Passage de l’Ancre, avec ses cent mètres de longueur seulement. Un petit coin oublié des urbanistes, ou du moins un coin épargné de maisons séculaires et bariolées, de plantes grimpantes où est la dernière boutique de réparation de parapluies, et de parasols, précise-t-on.
Un peu plus bas, dans la rue Montmorency, se trouve la belle demeure en gros moëllons jaunes de Nicolas Flamel, dont les inscriptions d’époque sont encore lisibles au-dessus de l’entrée, et juste après encore, la Place Beaubourg, ses commerces, ses cafés innombrables et planté au cœur, le monstrueux vaisseau du centre Pompidou, toujours aussi unique et génial, comme échoué d’une quelconque planète inconnue.
Des tonnes de tubulures, d’acier et de métaux aux teintes criardes et sans recherche d’harmonie, dans le côtoiement presque aléatoire des jaune et des verts, des rouges, des bleus sur des gris. C’est comme une baleine pétrifiée face à la Fontaine Stravinsky qui étale ses sculptures et son bassin d’eau. Il ne manquerait plus que les sirènes annonçant un quelconque échouage sur les lieux.
S’il est un monument où on peut dire que la somme des parties est plus importantes que les parties elle-mêmes, c’est bien dans ce gros navire dont on ne connaît d’équivalent ailleurs.
Dans la continuation de la rue Saint Martin, les pavés arrivent, et le gothique, le baroque tout ensembles de la Chapelle saint Merry. C’est à la fin du XV° siècle, quand Paris redevient une ville prospère que l’église est de nouveau reconstruite dans le gothique, après avoir été simplement un petit Oratoire Saint Pierre des bois. Ce saint Merry deviendra le patron de la rive droite.
Dernier édifice avant de franchir le pont pour l’Ile de la Cité, la majestueuse Tour saint Jacques.
Notre Dame est tant cernée de clôtures que nous n’en aurons qu’une fugitive vision à contre-jour, sans plus, parce que le cœur n’y est pas.
Depuis la rue de la Cité et ensuite la Place Lépine, c’est la vue générale du Palais de Justice et de la sainte Chapelle qui s’élève avec élégance au dessus de l’ensemble.
…
LA SAINTE CHAPELLE
Avant de pénétrer dans la Sainte Chapelle, je suis étonné que la longue file d’attente soit épargnée aux moins de vingt six ans. Lorsque je demande à l’accueil quelle en est la raison, je m’entends dire qu’il s’agit d’un privilège qui depuis Emmanuel Macron, et à sa suite Anne Hidalgo, ressemble fort à un encouragement à faire voter la jeunesse pour eux. Il fut un temps où des tarifs préférentiels étaient attribués aux étudiants et aux personnes âgées. Aujourd’hui, les retraités n’entrent pas dans les priorités de nos gouvernants et peuvent bien faire la queue… Sera-ce suffisant pour gagner les prochaines élections ?
…
La sainte Chapelle est édifiée, selon la volonté de Louis IX, futur saint Louis, pour conserver les reliques de la Passion du Christ. Parmi celles-ci, la plus célèbre, la Couronne d’Epines, acquise en 1239 pour une somme dépassant largement le coût de la construction de l’édifice lui-même.
Les reliques appartenaient aux Empereur de Constantinople depuis le IV° siècle. En les achetant, Louis IX accroît le prestige de la France et de Paris, qui devient, aux yeux de l’Europe médiévale, une Nouvelle Jérusalem, et par-là même, la seconde capitale de la chrétienté.
Pendant la révolution, la Sainte Chapelle, symbole de la royauté, subit de nombreuses dégradations, mais les vitaux restent miraculeusement en place. En 1846, l’édifice fait l’objet d’importantes campagnes de restaurations qui donne au monument son visage actuel.
A l’intérieur de la Chapelle basse, c’est la statue de la Vierge qui accueille le visiteur. La restitution du décor polychrome date de la période de restauration, avec ses magnifiques arcatures aveugles trilobées et des médaillons des douze apôtres. Les fleurs de lys sur fond azur des voûtes se retrouvent sur les colonnes en alternance avec des tours sur fond pourpre, armes de Blanche de Castille, mère de Louis IX.
Dans l’abside de gauche, une fresque du XIII° siècle représente l’Annonciation. C’est la plus ancienne peinture murale de Paris.
Dans la Chapelle haute, sculptures et verrières donnent l’impression d’accéder à la Jérusalem Céleste, baignée de lumière.
Les 1113 scènes des quinze verrières sont un vrai poème qui raconte l’Histoire de l’Humanité, de la Genèse à la résurrection du Christ.
Aujourd’hui la Sainte Chapelle et la Conciergerie sont les seules parties encore visibles du plus ancien palais des rois de France.
Cécilia me demandait, durant notre longue file d’attente , comment il était possible que de cet édifice de l’Ancien Régime put côtoyer le Palais de Justice actuel.
Je n’ai pu trouver d’autre réponse que de lui dire que la légende faisait que saint Louis avait l’habitude de rendre aussi la Justice sous un chêne.
…
Ma préférée est là, juste avant la rue Danton. La Fontaine Saint Michel. Avec ses colonnes roses qui donnent la lecture et le mouvement vertical dans des proportions du plus beau classicisme. Saint André des Arts, un petit cœur de Paris, au sein même du cœur de Paris.
Depuis Danton, il est aisé de rejoindre le Boulevard Saint Germain, saturé de bistros, bruyant, large et assommé de chaleur. Je me suis toujours demandé comment un boulevard si large avait pu être le lieu attractif de tant de caveaux à jazz, d’intimité et de création intellectuelle. Devant les Deux Magots et le Flore, où les places sont investies et où chacun donne l’air de participer au renouvellement de la pensée parisienne, je doute tout de même que Sartre y ait composé son Etre et le Néant.
Si au pied de l’église Saint Germain des Près, un ensemble de jazz de vieux faiseurs perpétue l’illusion, le sentiment que j’éprouve devant tant de signifiants laisse à penser que ce temps là est vraiment révolu.
Comme promis nous déjeunons à la Brasserie Lipp. On nous réserve une table sur la minuscule terrasse, légèrement aérée, d’où l’on peut observer le va et vient incessant de l’abondante clientèle, et celui toujours aussi zélé des vrais professionnels que sont les serveurs..
Puis, par la rue des Saints Pères, nous remontons vers l’Ile de la Cité, jusqu’à un extraordinaire magasin de jouets, R. et D. Duchange, qui expose de véritables chefs d’œuvre de damiers, de jeux d’échec en ivoire, de monopolys en matière rare, de jeux de l’oie dans des tonalités de bleus et de jaunes qui feraient surtout rêver les plus grands des enfants. C’est encore une rue où les antiquaires abondent.
…
Par les quais, et une grande arche traversée, c’est l’immense espace de la Cour du Louvre.
La grande fête permanente. Le bonheur de découvrir la ville dans son déshabillé, dans son simple plein air sous une telle lumière, justifie qu’on ne sacrifie pas à une visite d’une partie de cet immense Louvre.
C’est là le spectacle de l’eau de l’acier du verre et de la pierre, le jeu des transparences anguleuses mais fragiles contre l’éternité des masses semblant porter le poids de l’Histoire. Les jets d’eau ajoutant, à l’art de l’éphémère, une clarté différente à chaque angle de l’immense carré de cette Cour. Le bonheur encore semble traverser l’espace où l’illusion du silence se pose sur toute l’étendue du lieu. Un cerf volant vient ajouter sa note d’insouciance dans ce samedi après-midi.
Un Louis XIV équestre semble régner sur l’ensemble.
…
Revenant du côté du Pont neuf, je fais un bref passage à Saint Germain l’Auxerrois, puis depuis le Pont, c’est la descente sur le Vert Galant, le Square, puis le minuscule rostre de saule pleureur infesté de promeneurs et pire encore, de pique-niqueurs sous le petit espace d’ombre de l’arbre.
Jacques de Molay, le dernier Maître des Templiers fut brûlé dans le périmètre de ce square.
…
TOUTHANKAMON
Vers vingt heures, après une pause à l’hôtel, c’est le départ pour le Parc de la Villette. Vaste espace d’où émerge le tout nouvel édifice abritant la Philharmonie de Paris, aux courbes lisses et métalliques comme un vaisseau profilé.
L’été est encore bien là et une foule innombrable et éparse investit les pelouses alentours pour une soirée qui a du mal à entrer dans la fraîcheur.
L’exposition Touthankamon en est à son dernier soir. C’est maintenant ou jamais. Devant le vaste Palais des Expositions, déjà des files interminables patientent. Il devient évident que se procurer un billet pour un tel événement revient à participer à ce qui sera probablement la nouvelle « expo du siècle » aux dires des billets vendus à ce jour. Le Pharaon ne reviendra plus, c’est sûr. Il résidera définitivement dans le nouveau Grand Musée Egyptien du Caire.
L’entrée en matière, quelque peu agaçante dans l’attente de l’ouverture du sanctuaire, à la manière des combats de boxe ou des événement propices à dramatisation, on nous assène des commentaires à la voix fébrile avec accompagnement de bandes son plutôt proche de la Guerre des Etoiles que du repos après la mort d’un monarque fut-il égyptien, et antique.
Après les préambules, c’est l’émerveillement dès l’entrée au cœur des ténèbres d’une visite d’un monde admirablement présenté. Peut-être trop. Certains visiteurs, de peur de manquer une information passent de longs moment à lire chaque cartouche au risque de monopoliser tout l’espace au premier rang des objets présentés, faisant s’impatienter ceux qui se situent juste derrière.
De tels élans de la part des organisateurs et des responsables de l’expo du siècle aurait pu être tempérés par de simples indications concernant les objets ou les personnages exposés derrière les vitrines.
L’exposition telle que nous l’avons découverte eut été idéale pour une visite pédagogique d’un groupe d’amateurs ou pour une classe d’étudiants spécialisés.
Puis, c’est le défilé que l’on se risque à faire de manière informelle, puisque ce qui nous intéresse c’est l’aspect visuel de ces trésors exceptionnels. De Thouthankamon chevauchant une panthère noire, de sa statue colossale usurpée par Ay el Horemhed, de tant de pectoraux et de colliers, de divinités et de masques et de faucons, de rigidités sereines au-delà de la mort, de parcours initiatiques et de secrets connaissables qu’après le passage de celle-ci.
Comme tout un chacun, je cherchais vainement ce que je pensais voir en final de l’exposition, à savoir l’impressionnante représentation du pharaon dans son grand sarcophage qui servit d’affiche dans toute la France.
Cécilia me dit qu’elle l’avait déjà photographié et que je n’avais pas à attendre autre chose que cette petite canope délicate de quelque trente centimètres où devait probablement se trouver une infime partie des restes du souverain.
Je ne dirais pas que c’était une déception mais je n’avais pas imaginé que cette affiche, rencontrée mille fois depuis le début de l’année, eut été autrement qu’une représentation grandeur réelle de cet énigmatique Touthankamon. Toute représentation égyptienne d’envergure étant dans mon insigne ignorance d’une toujours monumentale dimension.
J’avais pourtant appris, il y a longtemps, qu’on peut obtenir du monumental avec des réalisations de très infimes dimensions dans les terres cuites précolombiennes que Cécilia m’avait faites découvrir.
…
C’est devant une soupe à l’oignon merveilleusement gratinée au Jaurès que nous finissons, avec ce début de nuit, les étoiles dans les yeux.
Dimanche 15 Septembre
PERE LACHAISE
Ce n’est pas Paris tu m’as pris dans tes bras, mais le Père Lachaise qui est, à sa façon, un ventre de Paris, suivant le modelé capricieux de la terre mamelonnée sur tout l’espace de ce vaste cimetière qu’il en paraît avoir une autonomie dans la ville, un implant sur un arrondissement dont il éclipse forcément les autres caractéristiques. Un ventre où se seraient engloutis nos poètes, nos illustres écrivains, mais aussi des hommes d’épée, de guerre ou d’engagement politique. Mais aussi des anonymes. Les concessions sont parfois à vie , parfois on découvre des plaies béantes attendant un nouveau venu.
…
Ce matin pourtant, sur le quai du métro, une femme visiblement de sortie d’hôpital psychiatrique pour le dimanche, nous a croisé avec un « bidochon ! » sonore que nous aurions pu prendre pour un présage néfaste pour la journée qui s’annonçait. C’est vrai que malgré les quelques quinze à vingt kilomètres parcourus tous les jours, l’embonpoint est là.
…
Ce sont les pavés, larges, souvent disjoints, en pente, ou sur des allées infinies, qui finissent par user les jambes.
Arrivés par la ligne presque directe depuis l’hôtel, l’entrée du cimetière nous accueille avec la liste des centaines de milliers de morts parisien, par ordre alphabétique, entre 1914 et 1918, sur un panneau rigide s’étalant sur une centaine de mètres à l’extérieur de l’enceinte. Les morts célèbres eux, ont droit au repos et à un regain de curiosité, à l’intérieur de l’enceinte. Ce sont donc les Chopin, Piaf, Proust, Balzac, les plus illustres de nos morts que les visiteurs viennent honorer d’une simple visite. L’ombre est encore à cette heure un bienfait en attendant la lumière vive et la haute chaleur annoncée.
Mais sans plan du lieu, il devient vite aléatoire de trouver les grands noms. C’était l’erreur commise dès l’entrée où des plans étaient mis à disposition. A ce jeu de découverte et d’identification, il n’est que le hasard, sur un tel vaste périmètre, pour tomber sur un de ces noms recherchés.
Suivant un groupe visiblement guidé par un habitué, nous trouvons Chopin, encore enguirlandé des couleurs du drapeau polonais, et le lieu de naissance, Zevavola zola, que j’avais retenu, pour l’avoir prononcé devant des foules d’étudiants durant mes cours des années quatre vingt, puis plus loin, sans le vouloir, c’est la palette tenu entre les doigts et le Radeau de la Méduse qui signifie Géricault.
Puis les pieds s’usent, le petit désespoir de répartir irrationnellement nos effort nous gagne.
Après avoir acquis un plan dans une boutique funéraire hors du cimetière, qu’un guide croisé un peu plus tard nous annonce comme étant truffé d’erreurs (!), on se concentre sur Eluard et Edith Piaf qui semblent être voisins. Après de longues distances parcourues, Piaf se trouve un peu en arrière de Henri Salvador et de son épouse, en second rideau, presque cachée par tant d’anonymes alentour. Quelques adorateurs s’y trouvent déjà, discrets et recueillis. Pour Eluard, une fois avoir compris le sens du carré lui correspondant, l’étonnement fut grand de constater qu’il n’était visiblement pas seul, mais entouré strictement de ses amis Thorez, Duclos, du Colonel Fabien et de tout ce qui semble constituer le carré des communistes. Jusqu’à des caveaux collectifs concernant les grands morts de la RDA, et tant d’autres victimes et de martyrs dans la défense de justes causes. Il est même un caveau récupérant les victimes de la shoa.
Pas un n’est enterré, après la trêve de l’au-delà d’une vie bien remplie, de combats et de convictions, auprès d’un proche de la famille, de leurs femmes ou de leurs enfants.
Les communistes, même dans la mort, sont enterrés entre eux, entre camarades, et dans un coin de terre séparé des autres.
Dans un cimetière bien bourgeois et de privilège d’accès.
…
Plus bas, dans un carré restreint, d’où venait doucement la musique des Doors, la tombe de Jim Morrisson, déplacée après tant de marques d’idolâtrie passée, est aujourd’hui clôturée et comme enchaînée et prise en tenaille parmi d’autres.
…
Pourquoi, en effet, ce jeu, ce besoin d’aller à la rencontre des sépultures ? Il eut été plus poétique de simplement se laisser aller à la grâce des arbres, des allées pavées et hors du temps, des douces lumières filtrant les larges végétations et les ruelles montantes vers quelque croisement d’allées un peu plus haut dans le hérissement des caveaux de part et d’autre de ces allées. De cheminer sans autres raisons que de traverser pour elle-même la quiétude de ce lieu nécessaire de méditation et de beauté indélébile.
…
MONTMARTRE
A main gauche du Moulin Rouge, propret dans sa toilette écarlate, qu’on croirait un gros jouet conçu il y a peu, la Rue Lepic monte en croisant la rue des Abbesses, et poursuit plus haut vers le Virage Lepic, ouvert en ce dimanche, pour raison de changement de propriétaire. On y déguste le Brouilly que les parisiens semblent priser puisque proposé dans bon nombre de restaurants. C’est presque midi, mais nous ne pourrons pas déjeuner là, le nouveau patron ayant fêté plus que prévu son samedi soir et fait encore aucune prévision culinaire pour ce jour.
Au bout du chemin, le Marcel Aymé de bronze qui traverse la Muraille du square, et plus loin le Moulin de la galette, l’ancien inaccessible au public, et le faux qui s’harmonise malgré tout au paysage devenu réellement montmartrois à ce moment de la pente.
C’est donc insensiblement vers le sommet de la Butte et sa Place du Tertre que nos pas nous mènent.
Avec Montmartre, et notamment la Butte, il y a toujours ce désir de trouver dans cette colline de Paris, un impossible village idéal tel qu’il a pu exister il y a longtemps. Il ne reste aujourd’hui qu’une vaste carcasse de maisons, de rues pavées où déambulent des hordes de visiteurs, les commerces et les restaurants les plus improbables à mesure qu’on approche la Place du Tertre, devenue une mangeoire sous chapiteau. Les quelques vrais/faux rapins sont relégués entre le pavé de la chaussée et les immondes structures de bois sombre au cœur même de la place.
Les quelques arbres frêles, qui faisaient le charme et donnait cet équilibre de poésie sous le ciel de Paris, ont disparus sous les ombrages ainsi accordés aux restaurants.
Un vaste charroi permanent de touristes, de badauds venus des quatre coins du monde transpercent les espaces de la colline devenues irrespirables d’où émergent quelques vestiges, où sont encore les vignes, bien qu‘enserrées de clôtures, les maisonnettes roses et le Lapin Agile, rue des Saules, que les curieux n’osent descendre, et qui rappelle que Utrillo y puisait la poésie de ses magies colorées de rêveur fragile.
Les escaliers de la rue Foyatier, et les autres trouées montantes vers la Butte, si caractéristiques il y a quelque trois ans, en novembre, ont perdu sous le grand soleil, ce charme de la grisaille et du vert minéral, ce qu’ils ont gagné en lumière tranchante et en agitation trépidante.
Tout l’environnement du Sacré Cœur est un paroxysme de cet envahissement de visiteurs et de saltimbanques (toujours fortement appréciés ici), où ne manque que le cracheur de feu.
Depuis la rue de Steinkerke, c’est la descente grouillante et vivante des commerces bariolés vers la Place Clichy.
Nous déjeunons tard dans l’après-midi dans un petit restaurant colombien de la rue d’Amsterdam où Cécilia trouvent enfin le fameux chocolat qu’aime Y.
…
Ce n’est que vers dix huit heures que nous émergeons de l’ombre de notre chambre d’hôtel, en direction de la Place des Vosges, devenue sous le regard équestre de Louis XIII, un immense espace de repos estival, à même l’herbe des pelouses à la manière des pique-nique de Glynbourne, enserré par les ocres sereins et les architectures majestueuses qui jettent leurs derniers feux avant le crépuscule. Le premier graffiti historié de la ville, introuvable aujourd’hui, aurait été gravé par Rétif de la Bretonne sur un des piliers de cette place.
…
Depuis le Pont de Sully Henri IV, se profile le vaisseau Est de Notre Dame et à sa gauche, tout à l’infini, la crête de la Tour Eiffel. L’incendie de cette descente progressive de la lumière, grave et saillante pourrait presque passer pour le même incendie de ce printemps dernier, et offre, à cette heure, une dernière draperie de sanguine sur tout l’Ouest de la capitale.
La rue Bautreillis, a vu une partie de la jeunesse de Pierre Boulez dans sa phase ascendante, et la mort de Jim Morrisson.
Sur le dessus de l’entrée de la dernière demeure parisienne de celui-ci, il est un petit encart qui dit discrètement, et justement : Jim Morrisson did not die here.
Depuis la Place de la Bastille et son opéra, il est difficile de garder les yeux ouverts tant est aveuglante la lumière vers l’Ouest et son couchant. La déception est grande de ne pas trouver Montaigne et la Louve romaine dans ce square que j’avais découvert de nuit près de la rue des Ecoles et du square Paul Langevin.
C’est donc vers le Panthéon, où quelques pâles blondeurs de lumière accrochent encore la pierre, que nous prenons la rue Soufflot, bien connue de moi il y a cinquante années pour y avoir séjourné une nuit au commissariat, transis de froid. Derrière nous, la belle église de Saint Etienne du Mont dans son baroque clair et classique.
Aux étonnants balconnets à hauteur des tribunes latérales. Jean-Paul II y aurait fait une halte lors d’un séjour parisien.
Il n’ y a apparemment plus de commissariat dans cette rue, mais nos pas nous mènent, après l’avenue saint Jacques, vers Saint Michel et près des quais, la Fontaine du même nom et la placette de saint André des Arts où nous dînerons.
Un dernier regard vers la si belle fontaine, creusée par l’éclairage nocturne, et les inévitables artistes de rues sous le charme discret des petites colonnes roses.
Lundi 16 Septembre
(Paris a inventé le sous bock personnalisé d’un genre nouveau. Tous les bistros de chaque arrondissement proposent des dessous de verre, non plus en carton, insignifiants et jetables, mais en plastique fin et sur leur verseau, vierge de publicité, un guide rapide des changements de métros à partir de la station la plus proche du bistro allant dans toutes les directions où un changement est nécessaire. Par exemple, d’une station proche de la Rue des Ecoles et donc du bistro X, en direction de chaque terminal de ligne, vous changez à X et vous filez directement à votre destination Z. Ainsi pour chaque grande ligne ayant un changement pour votre destination, partant du bistro où vous vous trouvez… Le prix du café en est un peu augmenté. C’est le sous bock à la demande. Mais la formule classique coexiste aussi pour toujours le même prix du café.)
…
J’étais ainsi à rêver à ces histoires de métro et de changements de lignes devant mon café croissant, Rues des Ecoles. Depuis hier, je ne comprenais pas pourquoi, passant devant le square Langevin, il n’y avait pas mon Montaigne et ma louve romaine.
Nous sommes donc revenus dans les parages pour refaire le parcours présumé et comprendre l’erreur survenue la veille au soir. L’endroit de départ ce matin est un bistro auvergnat très agréable où nous prenons le café devant la grande vitre donnant sur la terrasse. Au-dessus de nous, sur les toiles du bistro il est écrit : « ici on sert de la race d’Aubrac ». L’endroit ne pouvait être mauvais. En sous sol, où était les toilettes, une grande salle avec des tables et des fauteuil confortables. Je me suis souvenu de ce que disait Georges Gombert et ses moustaches frétillantes sur la fraternité des aveyronnais de Paris.
…
Mon Montaigne et ma Louve, je les ai finalement trouvés ! L’erreur de la veille tenait simplement à une question de Paul. Dans la nuit embrumée d’il y a trois ans, rentrant avec Bernard pour prendre la station Monge, j’étais persuadé que mon Montaigne était au pied de Paul Langevin (à cause de Monge). En fait, nous étions sur le trottoir d’en face et en sens inverse. Le square du Montaigne au pied usé était dressé devant le square Paul Painlevé… et on ne peut plus en face de la Sorbonne.
La journée remettait enfin les choses dans l’ordre.
Cette matinée propose un plein soleil de plus sur notre petit séjour. Nous longeons donc les quais, sur les pavés allant vers le Pont Neuf et le Vert galant, les larmes tombantes de son saule, voir comment est celui-ci vers les neuf heures.
La lumière est rase, quelques grosses péniches sont amarrées dans leur sommeil, et le quai à la pointe du saule où était la frénésie de ce samedi après-midi, a fait place à une douce sérénité matinale, envahie de lumière crue, rasante encore, et où, à la proue, deux jeunes filles, des amies dans l’intimité de l’heure propice, se faisaient quelques confidences, comme seules au monde, comme les seules ombres légères et à contre jour, anonymes, sur le tableautin.
…
L OPERA
L’opéra se dresse face à nous. Imposant, majestueux. C’est toujours la même surprise devant l’ampleur des volumes, de l’équilibre serein et opulent, la grâce dans les proportions et la rythmique monumentale.
Le bassin de la Pythie mène au Grand escalier et à la somptueuse nef de trente mètres de hauteur. Cette nef de marbre abrite les degrés de l’escalier à double révolution qui mène aux foyers et aux différents étages de la salle de spectacle.
La merveille est cette longue galerie qui compose le Grand Foyer, comme un petit Versailles de jeux de miroirs, au plafond peint par Paul Baudry en milieu de XIX° qui décline l’histoire de la musique. La lyre est l’élément principal, elle règne sur tout le vocabulaire décoratif. Orphique.
La salle de spectacle dans le pourpre feutré de l’éclairage d’aujourd’hui, est dans la tradition des théâtre à l’italienne mais son architecture en fer à cheval est dite à la française, en raison de la disposition des places selon leur catégorie, et conçue pour voir et être vu.
Et puis le plafond de Chagall. Nous avons accès à celui-ci par une des loges. C’est un peu pour la lumière et la poésie aérienne et tranchante et une toujours impression de décalage sur la conception globale et l’esthétique de l’ensemble de ce vaisseau que les regards viennent s’extasier. De purs bleus, des jaune et des verts saturés, et des rouges où dansent des épisodes de la Flûte Enchantée, des Ballets de Stravinsky et d’un peu tout le répertoire lyrique qui semblent embarqué dans un manège tournoyant en apesanteur. Je me suis longtemps attardé à trouver la scène d’amour de Pélléas et Mélisande.
Puis quelques bustes, au hasard. Je me suis trouvé devant celui de Adolphe Nourrit, ténor universel du milieu du XIX° siècle où tous les plus grands théâtres d’Europe s’arrachaient ses interprétations. Interprète régulier des ouvrages de Rossini, Nourrit est en fait le dernier d’une tradition qui va se voir éclipsée par Gilbert Duprez qui sera le premier à tenter un contre ut de poitrine. Dépressif, Nourrit se défenestra d’un troisième étage.
Ce qui m’attriste ce matin, c’est cette ironie de sort qui continue de s’acharner sur cet illustre chanteur, par une maladresse ou un mauvais goût des décorateurs de l’opéra, qu’on n’a pas trouvé mieux que de placer son buste triste dans le hall des toilettes, entre deux illustres anonymes de la profession.
En sortant, une famille de chinois pique niquait sans autre souci que de bien prendre ses aises, nappe dépliée sur les marches de la façade, entre cornichons et tube de ketchup.
…
Depuis la Place de l’Opéra nous descendons la Rue de la Paix, ses hôtels et ses vitrines du plus haut luxe. La Place Vendôme, une des plus élégante de la ville, réserve aujourd’hui une double surprise qui ne la révèle pas sous ses meilleurs atours. Les travaux de ravalement et de restauration, dont il semble qu’ils fassent partie d’un vaste plan général avant ces fameux Jeux de 2024, balafrent malheureusement une partie du paysage urbain. A Vendôme, on a masqué les échafaudages et toutes les plaies qui brouillent les façades des immeubles, par de très vastes publicités aux visages de femmes idylliques, de plages ou de pays de rêve, au nom évidemment des marques de Chanel, Dior et de tous ceux qui officient habituellement ici.
Les orfèvres ne perdent jamais au change.
L’autre désagrément viendrait d’une cohorte de cars de CRS massés agressivement en ce jour promis d’agitation syndicale dont on attend maintenant, comme les fois précédentes, les débordements habituels.
Mais la Place Vendôme garde tout de même cette élégance rationnelle et sobre sous un soleil plein qui l’aura plus encore rendue admirable.
…
Rue de Rivoli, les jardins des Tuileries que nous longeons. C’est bientôt la raréfaction de tout le périmètre habituel des bistros et des commerces grouillants, pour le Paris historique des parcs et des monuments en deçà des Champs-Elysées. Dans la petite rue Rouget de l’Isle on y boit tout de même notre verre de Baume-de-Venise.
La Place de la Concorde règne sur une vaste plaine qu’on a du mal à lui trouver le relief qui permettrait au regard d’absorber les lointaines Assemblées nationales d’une part, et de la Madeleine à son opposé. La circulation, comme un manège capricieux, tourne sur ce périmètre qui en fait la Place la plus vaste des grandes capitales.
Raymond Dumay qui a toujours une manière d’étalon qui rendra toute chose bien figurée, remarque que la Place de la Concorde a exactement les dimensions du Domaine de la Romanée Conti. De là à dire que celui-ci est un miracle viticole sur un écrin de dimension relativement restreinte…
Les deux Fontaines des Mers et Fontaines des Fleuves confirment, en plus du génie naval de la France, cette volonté symbolique d’en faire un espace d’immensité. Depuis l’obélisque, de loin, au fond des Champs- Elysées, dans le mirage brûlant de la perspective, l’Arc de Triomphe.
Les arbres des Tuileries sont dénudés, la poussière des travaux environnant dessèchent jusque loin dans les jardins tout espace de verdure. C’est l’automne.
…
NYMPHEAS
C’est côté Assemblée Nationale que l’on pénètre à l’Orangerie. A l’entrée, donnant le dos à la place, le baiser de Rodin à l’ombre des marronniers. Du moins l’une des multiples copies qui ne laissent de surprendre où on ne les attend pas.
Le vestibule a été dessiné par Monet afin de créer un espace entre l’agitation de la ville et son œuvre. Les autres salles ne sont pas accessibles au public pour raison de travaux ici aussi.
En offrant les Nymphéas à la France, au lendemain de la Première Guerre , Monet invitait à une contemplation de la nature peinte à l’infini : « les nerfs surmenés par le travail se seraient détendus là, selon l’exemple de ces eaux stagnantes, et à qui l’eut habitée, cette pièce aurait offert l’asile d’une méditation au centre d’un aquarium fleuri » écrit-il en 1909 alors qu’il commence à méditer son projet.
Véritable testament artistique, ces immenses décorations constituent l’aboutissement de toute une vie. Conçues de 1914 à sa mort en 1926, elles s’inspirent du jardin d’eau de Giverny. Dès 1886, Monet s’attache à représenter son jardin au rythme des variations de la lumière.
Les huit panneaux présentés dans les deux salles évoquent la marche des heures, depuis le matin à l’est, jusqu’au couchant à l’ouest. Monet ne représente ni haut, ni bas. Les quatre éléments se mêlent dans une composition sans perspective seulement rythmée par les nymphéas.
Le peintre donne ainsi l’illusion d’un tout sans fin, d’une onde sans horizon et sans rivage.
Par la nudité et la sobriété de l’ensemble, par l’encerclement d’un repli diaphane sur l’espace, la sérénité résultant d’une presque abstraction lyrique, c’est un petit Japon, ou une Chine d’avant Zao Wou Ki qui se profilent en bordure même de la place de la Concorde.
…
L’arrivée au pied de la Tour Eiffel n’est pas si aisée par le long Chemin poussiéreux des Australiens, longeant la Seine.
Le sentiment d’espace, de grandeur, si fréquent dans le Paris des grands monuments, est aujourd’hui confusément amoindri entre le Champ de Mars et le Palais de Chaillot qui lui fait face, par une forêt de grues, et d’installations gigantesques à des fins de concerts nocturnes défigurant la limpidité habituelle des lieux, comme dirait Nougaro de Notre Dame, s’appliquant à la Tour Eiffel, aujourd’hui vieille dame hissant son mouron.
…
PATRIMOINE
Le Palais de Chaillot abrite le Musée de l’Architecture et du Patrimoine (anciennement Musée des Monuments français, jugé peut-être un peu trop vichyste d’appellation ?) est le plus vaste musée de ce type au monde.
Dès l’entrée, c’est un rappel de tant de voyages et de géographies dans la France des villes, des clochers et des campagnes, qui s’exposent en un espace condensé de tympans, de façade d’églises, et de sculptures médiévales. Les cinq plus beaux tympans, ceux de Conques, de Vézelay, de Beaulieu, de Moissac et de Saulieu.
L’ange au Sourire de Reims, d’un sentiment pré-botticelien, côtoie la Vierge de l’Annonciation quasiment hellénique par le drapé et le mouvement ample.
Les sculptures des niches de Conques, si hautes dans la basilique originale, sont visibles à quelques pas, à portée de toucher.
Puis Strasbourg et ses vierges sages et folles. Les conversations mystiques de Pierre et Paul au narthex de Vézelay. Le chapiteau énigmatique du Moulin Mystique de Vézelay qui cite symboliquement le passage de l’Ancien Testament en Nouveau Testament, de grains à moudre, en pure farine.
J’en avais fait en d’autre temps un chapitre particulier dans mes cours sur l’art roman.
Puis les longues statues colonnes du portail de Chartres qui invitent à pénétrer, les plus impressionnantes figures tout à la fois bibliques et royales à l’entrée de la Cathédrale, le saint Jean Baptiste du portail nord, la Vision d’Adam dans la pensée de Dieu, la création du même Adam modelé par les mains de Dieu aux cordon de voussures, qu’on peut ici presque toucher.
Puis la sculpture romane toulousaine, languedocienne, celle de Saintonge et la pierre d’Auvergne rude et granitique, ici moulée et sûrement légère comme une simple écorce, les chapiteaux colorés de Saint Nectaire, et ceux, sombres de Notre Dame du Port à Clermont, la Danse de Salomé devant Hérodias, le trumeau d’entrée de Souillac avec le sacrifice d’Abraham dans un mouvement de haut en bas d’une compacité et d’un raccourci vertigineux. La danse furieuse de Jérémie.
Il n’était plus nécessaire de poursuivre, l’essentiel de l’âme formelle de nos basiliques, du génie médiéval, pouvait laisser place à des époques ultérieures se poursuivre dans d’autres salles, d’autre sensibilités, la promenade suffisait avec ce voyage dans les formes qui résumaient d’une certaine manière les voyages que j’avais entrepris dans le passé, durant tant d’années.
Restaient encore les peintures de la même période. Dans des salles à la presque obscurité, dans le plus rapproché des éclairages d’origine et souvent cryptiques.
Les souvenirs passaient des images aux absides de Montoire dans l’Indre, de la Rotonde en plein champ de fèves du Liget, sa dormition de la Vierge en pastel de Touraine, la reproduction de la chapelle de Vicq- Nohant, à deux pas de chez Georges Sand en Berry, aux personnages en dégradés d’ocres et aux traits nerveux des contours, l’immortel baiser de Judas. Du fabuleux Saint Martin tendant la main au pauvre du cul de four de Saint Aignan, dans les tonalités si douces des peintres d’Indre et Loire.
Berzé la Ville et ses peintures de l’abside, son saint Laurent sur le gril, son Christ en mandorle. L’entière crypte de Tavant que nous avions utilisé avec Bernard dans un vieux Photos/poèmes de mes créations.
Et enfin, la somme de toutes les théologies de ce temps là, la Sixtine du Moyen Age dit-on, mais avec tant d’esprit en plus et moins d’agitation, les voûtes et le narthex de Saint Savin sur Gartempe qui, bizarrement, ont trouvé leur monumental refuge dans la bibliothèque du Musée.
…
Un clin d’œil sur l’Arc de Triomphe et aux trépidations des Champs-Elysées pour y sentir la vague large et plongeante jusqu’au lointain de la Place de la Concorde, avant le retour vers Jaurès et le dernier dîner en bordure de la terrasse de la Brasserie, le parfait carré d’agneau, le dernier Brouilly.
Mardi 17 Septembre
L’Histoire de France, depuis le XIX° siècle, est indélébilement liée à l’Histoire de l’Algérie. La Mouzaïa est le nom d’un col près de Blida en Algérie, qui vit les combats, lors de la Conquête de celle-ci par la France en 1830, entre le général Clauzel et les troupes du bey de Tittery, puis plus tard, entre le général Lamoricière et les troupes d’Abd el Kader. C’est aujourd’hui une rue du XIX° arrondissement.
…
Ce matin le ciel est couvert sans être menaçant. C’est le ciel qui convient pour une fin de séjour, pour un départ. En se disant qu’on aura vécu Paris sous un beau grand soleil. Presque un privilège.
Puisque les Buttes-Chaumont sont au bout de la rue Secrétan, à six cent mètres à peine, c’est en cette direction que je finirais le séjour, dans ce 19° arrondissement que j’avais connu il y a quarante cinq ans, dans des souvenirs de quiétude, de rue tournantes et pavés. Décidément, au chapitre des souvenirs, les chiffres sont ronds.
…
BUTTES CHAUMONT ET MOUZAIA
Nous prenons le café à la Brasserie Bolivar, dans un intérieur feutré, aux fauteuils profonds. Montant vers le parc, à un moment, la rue Secrétan croise le Boulevard Bolivar qui continue sur notre droite, et au bout de Secrétan nous arrivons à la rue Manin qui borde l’entrée Ouest du Parc des Buttes Chaumont.
A cette heure, les allées sont peu fréquentées, quelques promeneurs, les joggers du matin et surtout, sur le sommet des collinettes, les fameux chinois qui s’exercent à la sagesse avec des mouvements au ralenti, en des gestes décomposés et sûrement codifiés, accompagnés par une musique chinoise discrètement audible.
Les arbres, souvent centenaires et majestueux, ont les couleurs de la saison, les feuilles jonchent de grandes parties des pelouses et certains sont déjà dénudés.
Ce quartier n’a guère changé apparemment. De beaux immeubles sages ont l’avantage, à Botzaris, de donner sur le Parc et sur tout l’Ouest de la ville au loin. Derrière le lac, au cœur du Parc, se trouve le point culminant de la Butte, avec son kiosque dans le style romain. Malgré le gris matinal, de là haut, l’échappée sur les toits d’ardoise et les mansardes le long de la rue Manin probablement, donnent un aspect romantique et très XIX° siècle au quartier. Le dénivelé entre le sommet de la Butte et le pied de celle-ci est étonnamment élevé, ce qui ne paraît pas lorsqu’on ne s’y aventure.
Redescendant par le Boulevard Botzaris, nous croisons la rue de Crimée, et au-delà, c’est le Boulevard du colonel Brunet et la rue Mouzaïa.
Celle-ci a déjà des allures de rue de province, de quiétude et de simplicité, étrangère à l’agitation environnante. C’est l’extrême Est avant le périphérique. La rue Mouzaïa dessert, à notre grand étonnement pour si peu d’originalité, la rue Liberté, que suivent les inévitables rues Egalité et Fraternité. Ces rues ont été percées en 1889 en mémoire de la Révolution, un siècle plus tard.
Depuis celle-ci, c’est toute une série d’allées ombragées, secrètes, flanquées de maisonnettes et de minuscules jardins, les Villas ( les allées se nomment d’ailleurs Villa) de la Mouzaïa.
C’est un réel enchantement que de bifurquer de la rue Egalité et de prendre la Villa qui plonge en pente douce et pavée, entre deux rangées d’arbres qui cachent discrètement toute une série de maisons simples, les anciens pavillons ouvriers du siècle passé, et d’imaginer la vie telle qu’elle a pu être vécu dans ces petits paradis humbles qui semblent aujourd’hui des vestiges d’un temps oublié.
Une fois parvenu au bout de l’allée, si elle n’est pas en cul de sac, il suffit de prendre la rue d’en bas et de remonter « une villa » en sens inverse.
Une fois remontée une Villa, parvenus au sommet, on en reprend une suivante, en descendant à nouveau.
Ainsi on revient à tout un passé au gré des Villa des Lilas, de la Villa Alexandre-Ribot, des Villa Amalia, Fontenay, Marceau, celle des Boers, Cronstadt et Hauterive. Les jardins sont souvent minuscules, négligés, ce sont de simples habitations et souvent colorées en harmonie avec les voisines, des roses et des bleues, jaunes ou vertes, souvent jalouses de leur intimité, cachées par des haies végétales, depuis lesquelles on imagine des intérieurs sans aucun luxe, des havres de poésie échoués là, avec parfois certaines maisons à cheminée.
Je suppose que de vivre ici représente maintenant, par un juste retour des chose, un privilège, à voir certaines maisons apparemment à la revente, entièrement nues et restaurées de fond en comble.
Au-delà de cet îlot bienfaisant du XIX°, plus à l’Est, à portée de périphérique et de regard, j’imagine l’enfer contemporain des ahurissantes tours à mille étages qui nous parlent de notre temps.
…
Revenus par le bout de Botzaris, la rue Manin qui laisse à main gauche le Boulevard Bolivar, c’est un simple escalier quittant la rue, qui grimpe de façon abrupte sur une centaine de marches et débouche sur un autre îlot inattendu. La Butte Beyregère.
Ce n’est rien d’autre qu’une rue circulaire, ou plutôt en ovale, sur un sommet, la rue Georges Lardennois, pavée et sans issue sinon de revenir sur elle-même, coupées par deux fois, par la Rue Edgar Poë et la rue Rémy de Gourmont.
C’est un autre havre, discret, coupé du monde dans la sérénité de ses immeubles d’habitation, de ses arbres qui flanquent certaines maisons et où l’accès en véhicule ne se fait que par la rue Lardennois, où tout ici est dans le calme baudelairien d’une poésie qui se dérobe à l’érosion du temps. On croirait traverser un bout de quartier des années cinquante.
Le petit jardin nous aura échappé ainsi que le vignoble, produisant un pinot noir , le « clos des chaufourniers », du nom de la rue, qui donne ses cent litres de vin par an.
Vivent ici, tout de même, ou ont vécu pour certains, Jean-Paul Goude, Clovis Cornillac, Jacques Audiard et le Directeur du Ballet de l’Opéra de Paris.
Sur le côté ouest de la colline, au croisement d’Edgar Poë et de Lardennois, un dégagement permet de saisir une vue large et originale, maintenant bien ensoleillée sur le reste de Paris, en direction de Montmartre et tout en haut, du Sacré Cœur.
…
Il est plus de midi. Une dernière bavette échalotte au PMU, dans une brasserie au bas de Bolivar. Sur plusieurs étagères on peut emprunter et échanger de vieux livres fatigués. Je n’ai pu m’empêcher de choisir un roman de Julien Green. Bernard viendra déposer quelques volumes à l’occasion.
…
Il est temps d’aller vers la Gare de Lyon. Sa tour de l’horloge est aujourd’hui en plein azur.
Il reste un peu de temps pour prendre un verre au Train Bleu. Sa remarquable architecture nous plonge dans le climat des années 1900. Les peintures, déjà nous rapprochent de notre Sud, puisqu’elles retracent les villes importantes où se destinent les trains en partance d’ici.
Les trois plafonds honorent Paris, Lyon et la Méditerranée. Avec des œuvres de François Flameng, élève de J.P. Laurens, de Dubufe et de Saint Pierre.
On sera surpris de la ressemblance des peintres figurant ici. Ce qui leur permit de concourir à un ensemble décoratif sans dissonance.
La Méditerranée et le Théâtre d’Orange d’Albert Maignan, le Villefranche et le Monaco de Montenard, Menton, Nice et sa bataille de fleurs de Henri Gervex. Et enfin le réseau des Alpes qui évoque le Mont Blanc et la peinture de montagne.
…
Puis, dans le train « Ouigo », défilent ensuite les paysages de Bourgogne dans la lumière blonde. Les vaches blanches semblent n’avoir pas quitté les pâturages. De temps à autre, un village aux teintes brunes, des prairies brûlées, et un clocher roman. La nuit descend. ………………………………………………………………………………………………
23 Septembre
Le voyage est fini. Ca tombe bien, Geneviève, la petite vendeuse de livres usagés au pied de la cathédrale, m’apporte un vieil enregistrement de chansons d’Yvette Guilbert et d’Aristide Bruant.
A la Bastille ! A La Villette ! A Batignolles ! A la Roquette !
………………………………………………………………………………………………
24 Septembre
La Civilisation Occidentale a été conçue sur le socle du christianisme, lequel n’a trahi que l’ordre rationnel.
………………………………………………………………………………………………
Francis m’appelle depuis quelque part dans le sud ouest. Il vient de passer une grande période sur les hauteurs des Pyrénées. Son goût de la solitude n’aura pas eu raison des froids de l’hiver. Nous avons promis de nous revoir, soit vers Brantôme, soit ici. Les coupoles de Saint Front de Périgueux valent bien un déplacement.
………………………………………………………………………………………………
26 Septembre
Paul Badura-Skoda est décédé. Il nous restera comme le très grand pionnier du piano forte de collection. Ses quatre quatuors de Mozart avec l’ensemble Festetics resteront un modèle et une référence des années quatre vingt. Ses sonates de Schubert d’un toucher maigre et fragile, incomparables.
Il avait enregistré des Debussy sur Bösendorfer.
…
Jacques Chirac s’en est allé aussi aujourd’hui.
…
Chirac est donc mort. Visionnaire ? Pour un Président de l’Unité Nationale qui, en quelque vingt années, n’a pas vu que ceux qu’il avait toujours honnis, sont aujourd’hui quelque douze millions de Français ignorés depuis sa position de rassembleur…
C’est aussi à la demande de Jacques Chirac que la référence « aux racines chrétiennes de l’Europe » fut retirée en 2004 du projet préambule de la Constitution européenne. En France, cela allait de soi. Il n’en est pas de même en Italie, en Pologne, en Autriche, au Portugal et en Hongrie.
Chirac est aussi le premier Président français à avoir lancé la mode de la repentance.
………………………………………………………………………………………………
Je reviens du Musée du Patrimoine, et il est vrai que la perfection de la statuaire grecque, si on la compare à celle de notre Moyen Age, s’était affranchie du cœur. Ce qui fit dire à Malraux, que rien depuis le Moyen Age Roman, ni avant, ni dans d’autres civilisations, n’avait reçu cet équilibre entre les libertés de la forme et l’expression des sentiments.
………………………………………………………………………………………………
NOSTALGIE ENCORE
Pourquoi refuser la nostalgie, cette période de temps qui nous a filé entre les doigts. Stéphane disait détester la nostalgie qu’il assimilait à quelque chose comme le ressenti d’une assemblée d’anciens combattants « ah! oui, j’y étais »…
Je crois qu’il n’a pas réellement eu le temps de quoi que ce soit.
Partir vers la cinquantaine, c’est encore être dans l’énergie où le questionnement et le rangement des choses du passé n’est à peine qu’effleuré. Puisqu’il devient évident qui si l’on ne songe qu’à ce fantomatique présent, c’est que l’avenir vous appelle encore d’une certaine manière, et que celui-ci est envisagé pour son lot d’espérance.
D’autre part, Stéphane me semblait aussi contradictoire lorsqu’il reconnaissait admettre positivement la nostalgie à condition qu’elle fut une sorte d’horloge interne. Mais que pourrait-elle être d’autre ? Ce grelot maigre qui tinte à l’oreille de la mémoire, et qui attribue à tel ou tel événement ou moment de la vie, une place de privilège qui ressort du fatras des quantités d’informations de notre passé.
Parce que les évènements qui font dépôt et qui donnent ce relief particulier parmi les myriades de faits constituant le passé ont une valeur de sens. Il ne s’agit pas de larmoyer sur tel fait passé en disant « c’était le bon temps », mais de reconnaître que parmi tous ces fait qui constituent notre vie passée, certains d’entre eux sont signifiants.
C’est un peu comme reconnaître que hier matin il faisait beau et que j’en ai été conscient. Cela marquera la mémoire de ce jour d’une pierre blanche.
La mémoire positive de certains événements d’un passé reculé se voit donc triant ce qui a valorisé ce passé dans le sens où avoir été heureux à un moment donné signifie que la vie qui me traversait à ce moment là valait que j’y ai peut-être consacré quelque effort, et si cela n’a demandé aucun effort dans le sens du bonheur, reconnaître simplement que la grâce m’aura donné ses quelques marques que j’ai su conserver en mémoire.
Maintenant, il est vrai que vingt ans plus tard, vers soixante et dix ans, il advient comme une émergence dans la structure de notre dépôt mémoriel, qui fait que certains évènements passés ont valeur de conscience.
Conscience que notre temps était sans limite, que l’avenir n’avait pas même encore de relief. La nostalgie n’est donc rien que la conscience de ces moments qui se hissent sur d’autres, insignifiants, à l’heure où le temps de maintenant se défait comme la peau de chagrin, et qui donnent simplement envie de dire parfois merci à la vie.
………………………………………………………………………………………………
29 Septembre
Depuis Parménide et son homme comme mesure de toute chose, il devient évident que d’avoir de plus en plus fait descendre Dieu vers l’homme, celui-ci avait oublié qu’il avait essayé, dans la part de transcendance qui pouvait être la sienne, de faire monter l’homme vers sa part divine.
………………………………………………………………………………………………
1 Octobre
Jessy Norman est morte. Rivales des grandes voix du passé, elle restera au moins la fabuleuse incarnation des derniers lieder de Strauss et une des plus belles Ariane à Naxos. Pour beaucoup, hélas, elle ne sera que celle qui se drapait dans les couleurs tricolores au temps des commémorations de la Révolution française.
Aurait-elle été une grande Isolde ?
…
Pascal Dusapin a livré son dernier opéra, « Penthesilea », où l’orchestre a la même fluidité que dans « Morning in Long Island ». Des cuivres graves, une assise qui soulignent les hachures lyriques des protagonistes. Un pas encore vers plus de dépouillement, bien loin de son Roméo et Juliette un peu trop échevelé et une poésie de Olivier Cadiot boursouflée.
………………………………………………………………………………………………
4 Octobre
MA CHAMBRE 1964/74
Aujourd’hui, cela fait plus de vingt ans que nous habitons sur la commune de Villeneuve-Loubet, et notre salon, là où je passe le plus de temps dans la maison, se voit saturé de mes livres et de mes enregistrements de musique qui dévorent l’espace, de toutes sortes de bibliothèques, au point qu’il semblerait qu’une pièce supplémentaire serait comme une extension aussi souhaitée qu’utopique.
…
Lorsque nous sommes arrivés à Nice, il était évident que nous logerions près de chez Lucia, par cet instinct qui faisait qu’on n’ imaginait pas de s’installer autrement que physiquement proches les uns des autres. C’était naturellement cette inquiétude des lendemains d’incertitude ressentis devant de nouveaux horizons, comme une hantise, maintenant que mes parents se trouvaient loin de leur première existence.
Après les premiers mois passés chez ma tante, nous avions trouvé, dans la même avenue des Arènes, au 128, un grand deux pièces, dans un immeuble récent et cossu, bordé de hauts cyprès, dans la longue montée qui mènent aux arènes romaines.
Le quartier a toujours été réputé bourgeois et, comme toujours dans ces cas-là, l’établissement de commerces de proximité se faisait rare et à part le luxe relatif des habitations, l’avenue ne présentait pas de réelles commodités.
La déception est venue sans prévenir.
Mon père ayant surévalué le nouveau salaire qui serait le sien durant l’année probatoire dans ce Crédit Lyonnais de l’Avenue Jean Médecin, il devenait impossible raisonnablement de payer les loyers élevés dans ce quartier de Cimiez.
Le comble, dans ce triste début de notre nouvelle existence, c’est que l’avance de trois mois de loyers consentie à l’agence immobilière s’est vue envolée en fumée.
La Banque, étant propriétaire d’appartements et de biens immobiliers, nous proposa donc, comme il lui arrivait de le faire de manière préférentielle aux personnels de la société, un deux pièces, entre Gambetta et Grosso, dans la Rue des Potiers.
…
Lorsque, par l’Avenue des Fleurs, la voiture de Lucia tourna sur sa gauche, passant devant les arbres géants de la villa qui faisait face à ce modeste « Pacific », au numéro 42, je fus pris de larmes. Tout me semblait étriqué, étroit, et pauvre pour tout dire, quand je songeais au beau dégagement de l’immeuble de Cimiez avec ses bordures élégantes de cyprès et la quiétude de son environnement.
C’est là que je passerai pourtant les plus belles années de la fin de l’enfance et les premières envolées de l’adolescence jusqu’à ce que je quitte enfin, dix années plus tard, ce troisième étage que mes parents occuperont encore trois années supplémentaires.
Ma chambre était en fait le coin que j’occuperai dans la seconde pièce qui faisait aussi office de salon. Donc il y avait la vielle table qui trônait au milieu de la pièce sur un beau tapis de Rabat. L’avantage, quand le coin chambre était remis en ordre, c’est que je profitais bien de cette table où je faisais tourner mes petits cyclistes en métal dans le sens des aiguilles d’une montre, m’imaginant quelque étape du Tour de France, ou la dernière classique belge dont j’avais vu les images sur l’hebdomadaire Miroir des Sports.
En grandissant, la petite bibliothèque grossit de quelques Camus, dont l’Homme Révolté auquel je ne compris rien, qu’une immense admiration pour mon destin futur. Il y avait aussi la trilogie d’enfance de Pagnol pour laquelle des larmes de tendresse pourraient encore couler, et toute une littérature qui ne dure que le temps d’une génération ou qui aura eu de très longues éclipses, comme les ouvrages de Pearl Buck, de Georges Blond, des Cesbron et d’autres volumes que Maman rapportait de la librairie des Galeries Lafayette.
L’adolescence venue avec son lot de hardiesses et ses petites révoltes bien naturelles, je tapissais les murs et le dos de la porte d’affiches et de signes, ce qui était comme une barrière que nul ne pouvait franchir, étant sur mon territoire, qui avait valeur de revendication et d’exposition de mon évolution mentale à faire valoir contre l’ordre familial.
Dans le désordre, il y avait une grande affiche de La Pléiade, avec des auteurs dont je n’appris le nom qu’au travers de celle-ci, comme Céline, Valéry Larbaud, Dostoïevski que j’allais bientôt mettre au rang des miens, plus tard une affiche de Jimi Hendrix, de Jack Bruce grimaçant sur sa basse, puis dans un autre registre, des portraits de Pedro Rodriguez, coureur automobile qui s’était tué quelques années auparavant au Mans, qui avait rejoint dans la mort son frère Riccardo après avoir juré de ne jamais reprendre un volant.
Il y avait près du lit, un superbe portrait dont je n’ai jamais su le nom du photographe, de Jane Birkin, torse nu et en jean, se croisant pudiquement les bras sur une poitrine à peine esquissée. Puis plus tard, en forme de provocation ouverte, un portrait du même noir et blanc de Alan Ginsberg et Peter Orlovsky se tenant par les épaules, mais néanmoins nus comme des vers.
Mais ce dont j’étais le plus fier, c’était cette citation d’ « Une saison en Enfer » épinglée dans la plus belle évidence, écrite fébrilement à la main : « Un soir j’ai assis la beauté sur mes genoux.
Et je l’ai trouvée amère.
Et je l’ai injuriée. »
Tout le monde pouvait prendre connaissance de cette vitrine impudique de mon coin de chambre. Je m’en réjouissais d’autant plus.
Comme c’était tout à la fois ma chambre et accessoirement la seconde pièce faisant salon, on s’y rassemblait à quelques rares mais très certaines occasions, à huit ou dix personnes de la famille.
Personne n’a jamais fait le moindre commentaire concernant ces déballages de mes premières affirmations turbulentes d’adolescence.
Il y avait aussi ce petit bureau bleu minéral, dessiné par un architecte de renom à Rabat, offert par Angela, où les après-midi, après le bain et le pyjama, les quelques devoirs à recopier fait sous l’éclairage de la lampe, j’écoutais la « Pastorale » ou quelque concerto de Tchaïkovsky.
………………………………………………………………………………………………
Léon-Paul Fargue estime déjà vers 1932 que les paroles de chansons de Bruant telles :
« Mais l’quartier d’venait trop rupin
Tous les sans l’sous tous les sans pain
Radinaient tous, mêm’ ceux d’Grenelle, A la Chapelle » étaient en voie de disparition.
A la fin des repas, il n’ y a pas si longtemps, du temps des dernières réunions familiales, dans ce fameux salon, mais surtout certains soirs chez Lucia, l’oncle Rio se levait, l’air canaille, et à ce moment là, dans l’ élan de respect de tous, dû à son ancienne fonction de directeur de Banque, il entonnait, les mains dans les poches, des chansons connues de lui seul, d’une voix au bord des rails, avec un faux accent entre Maurice Chevalier et celui de ce même Bruant. Nous ne comprenions que la moitié des mots, parfois c’était de vieilles chansons bretonnes et nous le laissions finir son petit récital, non sans que certains n’échangeassent quelques regards compatissants, voire d’impatience.
……………………………………………………………………………………………..
8 Octobre
Le prunius aux feuilles rouges a été abattu. Comme chaque fois que la mort frappe, c’est l’étonnement. On est toujours surpris, même si on sait. On a l’impression que la mort d’un être, comme la mort d’un arbre, arrive au moment où on se donne un répit, lorsque la conscience est occupée par quelque autre affaire, qu’elle en profite pour nous ravir ce qu’elle doit faucher un jour ou l’autre. J’étais occupé à écrire sur le clavier et je n’ai pas du tout entendu le jardinier qui vient souvent faire des travaux dans le jardin. Lorsque je suis sorti par le côté nord de la maison, j’ai pu voir la lumière franche frapper sur les murs donnant sur le jardin. Il n’y avait plus, et il n’y aura plus cette ombre qui venait adoucir la violence de la lumière du matin, et les branches qui montaient jusque plus haut que le balcon de la chambre d’Hélène.
…
J’ai l’humeur Vaughan Williams aujourd’hui. J’espère accompagner le prunius dans son départ avec le Lark Ascending…
………………………………………………………………………………………………
C’est la nuit qui est tombée. C’est la voix de Kathleen Ferrier dans le Magnificat de Bach, avec Irmgard Seefried qui occupent l’espace.
Sur une étagère du salon, j’ai disposé tous les flacons de parfums qu’on m’a offert ou que j’avais adopté par le passé. Celui auquel je tiens le plus est un cadeau que Hélène m’avait offert pour le Noël de 97. Une simple eau de toilette de Yves Rocher. Elle avait précisé : « Ce n’est pas grand chose, ce n’est pas aussi beau qu’un Guerlain ».
………………………………………………………………………………………………
9 Octobre
Après le meurtre à l’arme blanche de quatre fonctionnaires de la Sécurité dans l’enceinte même de la Préfecture de Police, perpétré par un islamiste infiltré dans cette administration, l’étonnement fut grand de constater qu’aucun rapport écrit ou qu’aucune enquête interne ne soient jamais remontés dans la hiérarchie concernant les agissements troubles du futur meurtrier. Celui-ci refusant depuis plusieurs semaines d’avoir des contacts avec la gente féminine s’était aussi ouvertement réjoui des attentats de janvier 2015.
Le Président de la République dans son discours d’hommage aux victimes a considéré que nous devions « vivre dans une société de vigilance et non de soupçons qui corrodent… », un vieux relent, pour lui, des années quarante peut-être, confirmant ainsi qu’aucune disposition préventive ne saurait être prise.
………………………………………………………………………………………………
J’avance dans « l’Itinéraire de Paris à Jérusalem ». Le grand chapitre sur la Grèce m’a plongé dans une Antiquité de pierres et de ruines. Remplie de Sparte (la Lacédémone d’aujourd’hui) à laquelle Chateaubriand s’attarde pour avoir apporté sa contribution à certaines découvertes de la cité.
Puis c’est le départ pour l’archipel, pour les Cyclades. Je m’attendais à voir se croiser à distance des noms et des lieux que j’ai moi-même traversés cet été. Il n’y consacre que quelques pages dont la plus intéressante, qui résume son désenchantement, est relative à Jean-Jacques Rousseau : « Rousseau dit quelque part qu’il eut voulu être exilé dans une des îles de l’Archipel. L’éloquent sophiste se fut bientôt repenti de son choix. Séparé de ses admirateurs, relégué au milieu de quelques Grecs grossiers et perfides, il n’aurait trouvé dans des vallons brûlé par le soleil, ni fleurs, ni ruisseaux, ni ombrages. Il n’aurait vu autour de lui que des bouquets d’oliviers, des rochers rougeâtres, tapissés de sauges et de baumes sauvages : je doute qu’il eût désiré longtemps continuer ses promenades au bruit du vent et de la mer, le long d’une côte inhabitée. »
………………………………………………………………………………………………
12 Octobre
L’automne entre tout doucement. Les nuits sont bien plus fraîches. La huitième symphonie de Mahler va bien avec. Surtout la seconde partie franchement opératique, inspirée du Second Faust de Goethe. De longues coulées lyriques et fanées comme si l’auteur se reprochait de n’avoir jamais composé d’opéra.
La neuvième allant dans le sens d’un renoncement et une acceptation de la vie. Mahler, à cinquante ans, pose un regard définitif sur celle-ci.
………………………………………………………………………………………………
C’est vrai que nos habitudes ne tarderont pas à changer. Il y avait ce matin pour le petit déjeuner de Y, des mangues, un ananas frais et sur les marchés, à la mi octobre, on voit de plus en plus de figues de barbarie et des grenades. Les figues à cactus que nous avions vues pourrir sur pied à Naxos sous des chaleurs accablantes, arrivent ici de plus en plus fréquemment.
……………………………………………………………………………………………..
15 Octobre
Erdogan, le président turc, est lâché par les occidentaux pour avoir attaqué des kurdes sur son territoire. En représailles, il décide le largage de réfugiés syriens sur les territoires du monde occidental. C’est bien la preuve que l’envoi massif de contingents de migrants sur les sols européens est une véritable arme de guerre.
…
Nous nous devons d’être vertueux, « éco-responsables », sensibles à tout ce qui porte intérêt à l’avenir de notre planète, ce qui n’empêche nos dirigeants (comme tous ceux du monde occidental) de se trouver sur tous les points stratégiques de la guerre des énergies, du pétrole et de la meilleure manière de nous rendre sa dépendance la plus douce.
………………………………………………………………………………………………17 Octobre
Le temps est un peu comme le cœur qui veut battre en maîtrisant la dimension de ses certitudes. Avec l’automne qui tombe, le soir appelle à certains replis. Je ne pourrais mieux définir ce sentiment de douce quiétude qu’au travers des Suites pour violoncelle de Bach. C’est comme pénétrer dans l’arche d’une cathédrale. Je ne sais si c’est la sarabande de la seconde ou de la cinquième suite qui offre ce moment d’apesanteur ou cette abstraction de toute contingence de ce monde périssable. Rostropovitch a attendu longtemps avant de livrer sa conception de ces œuvres et a choisi l’extraordinaire acoustique de la basilique de la Madeleine à Vézelay. Il y a, on ne sait pourquoi, un réel transfert réciproque de l’esprit qui passe de la résonance de la polyphonie de cette musique à cette architecture romane, baignée d’une lumière immatérielle, qui l’enveloppe de toute sa grâce.
………………………………………………………………………………………………
La première fois que j’ai entendu Brel chanter « Amsterdam », j’ai compris bien après pourquoi j’aimais le flux continu du chant wagnérien.
……………………………………………………………………………………………..
Réponse à un courrier de Bernard :
La Birmanie. Je n’y aurais pas pensé, mais je vois que Fabie est de plus en plus aventureuse. Tu arriveras bien à te laisser surprendre par quelques reflets d’or du couchant sur certains temples abandonnés.
J’aurais plutôt pensé au Cambodge (ma secrétaire y est allée l’an passé rapportant de surprenantes et très poétiques photos de Angkor Vat).
Je suis un peu comme toi. Les voyages je les apprécie aujourd’hui lorsqu’ils sont de proximités, en terrains à la fois bien connus et pourtant à hauteur de surprise.
Pour l’Asie, je n’ai qu’à écouter le piano de Debussy (qui n’y était jamais allé), et je suis sur "La lune (qui) descend sur le temple qui fut" -ça s’est déjà tout un voyage- ou sur "La terrasse des audiences du clair de lune", peut-être même sur des "Pagodes", et sans sortir d’entre mes murs, je vais bien loin.
J’ai déjà écrit au hasard des carnets ce que le bouddhisme m’inspirait concernant les plus sensibles et les plus jeunes en occident : ce qu’une religion ramasse d’incertitude, de misère et de désarroi spirituel lorsque la foi ancienne est à l’agonie.
C’est vrai que la grande religion des athées a fait couler aussi ses rivières de sang durant la Révolution et celles qui ont suivies.
Puisse l’Islam ne pas trop ramasser sur nos déserts d’incertitude. Mais n’est-il pas déjà trop tard ?
Voilà qui n’est pas trop réjouissant. C’est une première réflexion parallèlement à tes considérations pessimistes du jour.
………………………………………………………………………………………….
Réponse à un courrier d’Alain Jacquot :
L’intégrale du Sigurd par GeorgesThill est éditée chez Malibran depuis longtemps. Oeuvre très wagnérienne en n’étant pas du Wagner. Thill est le plus classique (au sens du marbre des plus belles certitudes) et le plus idéal des ténors lyriques.
Nous n’en avons pas retrouvé d’autres dans nos écoles de chant. Ailleurs non plus. J’écoutais justement Björling dans le « nessun dorma » (une vague nostalgie qui revient de temps à autre) qui est assez exceptionnel. Et j’ai passé juste après ce que Thill chante en 1929 dans le même air. Le secret c’est, entre autre, la fragilité d’une voix comparée à d’autres qui semblent ne jamais être en danger. (Comme B. Nilsson, ou justement Björling). Ajoutée à cette grâce d’un timbre inimitable qui faisait dire à J.L Thézier que la fin du premier acte de Werther ressortait tout autant d’un moment ineffable de l’esprit que de l’art du chant le plus accompli.
C’est vrai qu’avec Boulez c’est le grand écart. On ne peut faire plus éloigné dans l’univers de la musique. J’irais voir ce Christian Merlin. On ne peut en rester au Goléa ou au Dominique Jameux. Rien n’avait été fait d’exhaustif (est-ce possible ?) à son sujet. Tu sais à quel point il est un témoin et une vitrine du siècle passé qui a maintenant disparue. Ses Mahler pour DDG sont peut-être les plus aboutis. Bien que n’ayant pas les meilleurs chanteurs sa Huitième avec la Staatskapelle de Berlin est la seule que j’arrive à aimer. Donc on aura bientôt une lecture commune.
J’étais dans mon Chateaubriand ces temps-ci. J’aime tant ce style. L’homme est parfois hautain, mais là aussi c’est dans le marbre de la pensée qu’on se surprend à admirer la hauteur de vue. Et de belles vues, autant que de matière à penser il y en a en traversant ces Cyclades que j’ai abordées moi-même il y a peu ! Je vais bientôt arriver à Jérusalem…
Pour tout avouer, je suis plutôt dans l’austère dans ce que j’écoute en ce moment : les suites de Bach. Même si il s’agit aussi de danses. J’ai trouvé (en ne cherchant pas), un enregistrement de Rostro fait en public à Prague en 55.
La conception est toute différente de celle réalisée (pourtant à Vezelay) bien plus tard. A Prague, c’est la rythmique, la danse qui est mise en avant, une fougue saisie peut-être un peu près du micro, mais dans une perspective tout à fait étonnante et éloignée du vibrato qui donne souvent un halo proche du sentimental (Je ne vais pas me faire d’amis). En tout cas en 55, les sarabandes des deuxième et cinquième suites sont les plus convaincantes. L’apesanteur certaine.
Aujourd’hui c’est la pluie, comme souvent ici, abondante et violente. Donc l’automne qui sonne fort, des fois qu’on ait pas le calendrier en tête.
Je suis allé à Paris du 12 au 17 septembre. Il faisait un temps de rêve et je suis passé près de chez mon éditeur de l’ Harmattan. Non loin de là, j’ai pu revoir le Montaigne au pied usé juste en face de la Sorbonne. On dit que les étudiants font un voeu avant les examens en caressant son pied droit.
Comme d’habitude, avant de recevoir ton message, je m’étais promis de te dire des tas de choses et celles-ci ont glissé loin de moi avant de les écrire. Il faudra que je note une rubrique « ne pas oublier de dire à Alain Jacquot »
J’espère que la prochaine fois on ne sera pas non plus confronté à ce répétitif syndrome du "je passe par ici et nous nous manquons".
A bientôt donc mon ami.
…………………………………………………………………………………………
Dans le monde de la Science, l’avenir annule le passé
(du monde clos à l’univers infini)
Dans le monde de l’art, l’humanité s’ajoute
(de Lascaux à au-delà de Picasso)
…………………………………………………………………………………………….
Nous vivons avec des objets nous environnant qu’on ne regarde plus, qu’on ne voit même plus. Les plus beaux tableaux disparaissent de notre conscience et de notre attention à force de les avoir continuellement sous les yeux. Peut-être s’ennuierait-on avec une Joconde dans le salon. Ce n’est d’ailleurs pas la qualité de l’objet, de la peinture ou du meuble de style qui est en cause, mais bien plutôt la fréquence du voisinage de ces décors que nous avions désirés qui nous les rend étrangers, au point de les ignorer de notre sphère sensible après qu’on s’y soit accoutumé.
Il est un lieu dans le salon où je m’assois fréquemment. En face, j’ai changé plusieurs fois les petits tableaux qui côtoyaient la fenêtre donnant sur le jardin.
Depuis quelques mois, c’est une peinture totalement insignifiante représentant une vue du village de Villeneuve qui est venue prendre la place d’un petit format qui m’était cher, que Dalila avait rapporté de Tunisie, rappelant le désert par quelque palmier, un chameau, quelques personnages perdus et solitaires.
Depuis, cette peinture naïve et malhabile commence à prendre tout son sens, bien qu’elle n’ait aucune valeur, pas même celle d’avoir été faite avec un rien de talent. Elle n’a aujourd’hui que l’intérêt que ma sensibilité veut bien lui accorder au-delà de ses qualités réellement picturales. Plutôt comme quelque chose qui s’impose discrètement par une inertie à laquelle mes yeux s’accoutument, et une faculté qu’ont les objets de s’insérer dans le paysage mental de notre intimité comme on le ferait avec un animal familier.
Ce tableau revient de loin. Il avait été acquis négligemment par Cécilia depuis une quelconque après-midi de brocante et traînait dans un coin de salon, attendant de finir dans une prochaine brocante.
C’est peut-être quelques détails d’une maison triste et solitaire, quelques arbres frileux au pied de la colline qui ont inconsciemment arrêté mon intérêt pour l’ensemble de ce paysage.
L’attachement aux être et aux objets est souvent indépendant de leur réelles qualités, mais dépendant d’une relation inexplicable qu’on entretient avec eux.
Il est maintenant accroché à proximité des trois Marchand des Raux qui se sont insérés depuis plus de vingt ans dans ma géographie intime sans plus que j’y prête d’attention sauf à me dire, de loin en loin, que ceux-ci ont toujours la valeur d’un temps qui les a vu accompagner mon existence d’alors.
…………………………………………………………………………………………….
21 Octobre
Christian Merlin vient de sortir sa très documentée biographie sur Pierre Boulez. Depuis celle due à Dominique Jameux, datant tout de même des années quatre vingt, on n’avait pas encore eu accès à tant de documentations, (surtout le dépôt fait à la Fondation Sacher) concernant le plus illustre compositeur de la seconde moitié du XX°, qui demeure toujours le plus secret, qu’on pourra se poser la question de savoir qui, de lui ou de Ravel, est le plus énigmatique.
Je n’en suis qu’aux premières pages et le ravissement le dispute déjà à l’enchantement. On y apprend que Pierre Boulez Premier aurait existé dès 1920 et serait mort de maladie infantile. En 1925, Pierre II va naître et prendre conscience de la plus brutale des façons devant une pierre tombale, qu’il est en quelque sorte une doublure d’un Pierre qui l’aurait précédé. D’où probablement cette fureur d’avoir eu à composer son existence.
…………………………………………………………………………………………….
J’ai toujours un peu jalousé Bernard pour cette histoire d’affiche qu’il a exposé généreusement dans les toilettes de chez lui. C’est en fait la reproduction d’une scène (XXXV) de la « Chair de l’Homme » de Novarina. Cette scène catalogue propose des milliers de citations sur Dieu, en blanc sur un bleu de mer profonde, ayant préoccupés les penseurs et philosophes de tous les temps, antiques ou non, saints ou dépravés. Chaque sentence ou définition étant en soi une matière à réflexion infinie. On y apprend de Irénée de Lyon que « la gloire de Dieu, c’est l’homme vivant, et que la vie de l’homme c’est de voir Dieu ». Le très élégant Artaud glapit que « si Dieu est un être, c’est de la merde », auquel répond, à la manière qu’on lui connaît, Heidegger : « Dieu est le demeuré manquant de l’Etre s’abstenant ». Et ainsi toutes les cervelles de la pensée universelle, de Bossuet en Saint Bonaventure, en Grégoire de Tours, de Isaac l’Aveugle à Françoise Sagan avec des centaines d’autres, de nous donner cette parcelle étincelante de Dieu condensé en quelques lueurs d’esprit, considéré comme source de préoccupation première de tout ou de rien. Et de tout et de rien, chaque lambeau expressif les concernant forment le grand buccin dans lequel se forme peut-être le visage de celui qui sera ici modelé à la fin des temps.
C’est dans la position du penseur de Rodin que nous méditons à ces bribes de sentence merveilleuses, catalogue ouvert à toutes les incertitudes de la plus noble et la plus infinie des matières à réflexion dans un lieu plutôt propice à l’évacuation.
…
Non enregistrée dans la scène XXXV : « Dieu tenait l’humanité par les roubignolles ».
…
J’aurais tout de même exposé l’affiche ailleurs bien que l’idée d’une méditation dans la position du penseur…
…………………………………………………………………………………………….Nous aimons Boulez pour mille raisons. Mais ce qu’il y a de supérieurement élevé chez lui, qu’on ne saurait trouver chez d’autres musiciens, chefs, musicologues ou simples praticiens de la musique, c’est la pensée qui accompagne chacune de ses actions et qui les justifie. Une pensée justement qui dit mieux que de grandes explications la hauteur intimidante de ses démarches : « J’ai la réputation, vraie ou fausse, d’être exclusivement rationnel et logique, critères primordiaux de l’objectivité. Je sais pertinemment que rationalité et logique reposent sur l’incertitude de la confrontation subjective. »
…
Sur les ruses de la raison, sur les antinomies de celle-ci, Kant a bien ouvert quelques pistes
…………………………………………………………………………………………….
23 Octobre
La Librairie Acropole a fermé ses portes. Elle vendait de beaux livres d’art à prix réduit sur le boulevard Félix Faure. Comme toutes ces librairies qui ont un petit étalage à l’extérieur et qui ont le temps de voir la couverture des livres pâlir et se décolorer à la lumière des fins d’après-midi. Mais enfin, c’était une librairie sympathique qui avait des merveilles comme « l’Art à Mantoue » ou un « Zao Wou Ki » préfacé et commenté par Dominique de Villepin. J’y avais déniché des ouvrages sur le Moyen Age ou sur l’Atlantide, un catalogue complet des œuvres de Jean Michel Atlan, ses pastels et ses rêves d’abstractions d’une Afrique idéale, des livres d’enluminures persanes et tant de surprises quand l’humeur du moment nous faisait compenser par d’autres ouvrages ce qu’on n’avait pas initialement trouvé dans les autres librairies de grandes dimensions.
Elle a donc été remplacé par un fleuriste, ce qui atténue la peine de voir une librairie donner son espace à une agence immobilière comme c’est souvent le cas, ou une petite succursale de banque.
J’entendais il y a longtemps un vieil habitant de Moulinet qui me disait que lors de chaque enterrement d’un ancien du village, le sentiment qu’éprouvaient ceux qui suivaient le cortège était qu’il y avait un habitant de moins qui ne serait jamais remplacé. Comme une voix qui manquerait toujours à l’appel.
C’est ce que j’ai ressenti quand j’ai vu la vitrine passée au badigeon blanc et une nouvelle présentation colorée à la devanture de l’Acropole, une nouvelle enseigne.
Il ne reste donc plus que deux (vraies) librairies dans notre ville de plus de trois cent mille habitants. Courageuses.
………………………………………………………………………………………….
26 Octobre
J’avais convaincu Cécilia d’aller à ce concert d’Avril 87, dans le vieux Monaco, à la chapelle de l’Annonciation. C’était un événement, même pour Monaco, que de pouvoir entendre René Jacobs, un des artisans de ce qu’on nomme aujourd’hui les baroqueux de la première heure. Dans ces années là, il faisait partie des très estimées voix de contre ténor qui n’étaient pas aussi nombreuses qu’aujourd’hui où elles tendent à se ressembler toutes et se développent aussi naturellement qu’elles paraissent artificielles, parce que prématurément développées avec des techniques qui relèvent de l’uniformisation. On ne connaissait alors que le précurseur, Alfred Deller, et déjà Henri Ledroit, Dominique Visse, Charles Brett, James Bowman, Paul Esswood et quelques autres qu’on aurait reconnu les yeux fermés.
René Jacobs faisait partie de ceux qui nous firent entendre des Leçons de Ténèbres dans la verdeur et tout à la fois l’extrême sophistication de ces Couperin inespérés.
Ce soir là, en présence de la Princesse de Monaco, le récital donnait des œuvres rares de Benedetto Ferrari della Torbia, de Pergolese et quelques délicats airs de cour de Michel Lambert. La voix de volute s’élevait dans l’espace de la chapelle en une apesanteur que rien ne pouvait troubler. La carrière de Jacobs était à un point de sa trajectoire où il lui fallut bientôt choisir la direction d’orchestre exclusivement. Pourtant la voix était aussi admirable que quinze ans auparavant, et je mesurais à quel point ce récital relevait du privilège.
La chapelle n’était pas bien grande et je sentais que je sortirais avec ma tête dans les nuages. Après les ovations qui n’en finissaient pas, je pris l’allée latérale jusqu’à me trouver maintenant à deux pas de la sortie quand je vis, face à moi, Caroline de Monaco à la même hauteur au bout de l’allée opposée. Elle était vêtue d’une robe sombre assez serrée et d’un chapeau à la mode des années trente. Son regard croisa le mien franchement, que je sentis que ces quelques deux trois secondes parurent bien plus longues avec, juste derrière, une cohorte de messieurs tout en noir dont les regards me fixaient comme autant de pairs d’yeux sentant venir le sacrilège.
En l’espace d’une fraction de seconde j’avais cru pouvoir franchir le pas vers l’extérieur, lorsque justement se présenta celle que je n’avais pas prévue. C’est par un vieux fond d’éducation et un réflexe bien naturel que je cédais l’espace nécessaire pour que la Princesse, d’une légère rotation, le buste droit, et comme si je n’avais jamais existé, franchisse la première le portail menant aux marches de la chapelle où une large limousine l’attendait déjà.
…………………………………………………………………………………………….
Courrier à Bernard :
….Je suis tombé sur le dernier enregistrement du Château de Barbe Bleue de Bartok, et bien que peu fanatique des innovations technologiques, je suis demeuré en arrêt devant cette version (Michelle de Young et John Relyea) qui utilise la technique (que je ne saurais définir) du SA CD. J’avais, pour l’ouverture de la cinquième porte du château, l’impression que l’orchestre était entré dans la maison. Jusqu’aux larmes. C’était déjà en soi un passage grandiose que je redécouvrais maintenant dans tout l’espace idéal qu’on ne reproduit qu’en salle de concert, alors que j’ai un matériel bien dépassé aujourd’hui. Michelle de Young, je l’avais entendue à l’opéra de Monte Carlo dans le rôle de Judith, la dernière victime de Barbe-Bleue. C’est une grande d’aujourd’hui…
…………………………………………………………………………………………….
28 Octobre
Déjeuner avec Alain Jacquot et Anne-Marie « aux Viviers » de Jacques Rolancy. C’est somptueux. Une des meilleures tables de Nice. Quelques numéros plus loin sur la Rue Alphonse Karr, une cave vient d’ouvrir, des vitrines exposant de grands Sauternes, Château Latour et Margaux, La Tâche et Romanée des meilleurs millésimes, mais à des tarifs qu’on ne sauraient plus aborder, aujourd’hui que les Saoudiens ont fait flamber les prix.
Une anecdote qui nous fait encore bien rire sur la rivalité qui animait, du temps de Raymond Dumay, bourguignons et bordelais, relatée par celui-ci : « Invité chez un de ses homologues œnologues dans le bordelais, un bourguignon se fut offert à goûter un Château Margaux d’un millésime incontestable. Attendant dans le plus grand silence un commentaire de celui-ci, il lui fut offert un second verre de dégustation après un temps suffisamment long. Le silence qui s’était installé et pesait depuis le début de l’opération fit pencher les têtes des bordelais dans le sens d’une presque impatience dans l’attente de l’éloge, quand le tasteviné se fendit enfin, sans autre commentaire fleuri, d’un seul « Oui … », au grand soulagement de l’assemblée. »
………………………………………………………………………………………….
Courrier à Bernard :
…Le cirque a le vent en poupe semble-t-il. A voir le nombre de saltimbanques à Nice sous les différents chapiteaux de fin d’années.
Il est fréquent aujourd’hui de voir de tout jeunes faire des numéros de jongleries aux arrêts des feux rouges.
Dans les pays d’Islam, aux feux rouges, il y a des auto collants rappelant de ne pas oublier la prière. De quoi méditer spirituellement aux arrêts imposés.
Peut-être aura-t-on bientôt des numéros de cirque mêlés (ou alternant) à des incitations à ne jamais manquer à nos devoirs spirituels.
Je me suis donné une chance supplémentaire de me raccommoder avec Spinoza grâce à une petite collection (Ellipses) qui dissèque (avec Spinoza j’ai un problème d’avancée géométrique) le contenu des grandes philosophies.
Bien que je dusse connaître tout ça depuis mes universités, je mets donc encore tout à plat…
………………………………………………………………………………………….
31 Octobre
Le mois s’achève. Le début novembre c’est toujours triste (les Morts, les Saints en tous genre), mais bon, c’est ainsi, une manière de ne pas oublier ceux qui nous avaient accompagnés.
Et puis généralement le temps se met de la partie, grise et souvent pluvieuse. Aujourd’hui ça ne déroge pas à la règle.
Je vais me réfugier dans le petit Spinoza et ânonner comme un baudet devant la géométrie de la pensée. Mais la crème des géométries.
…………………………………………………………………………………………….
Devant la librairie Masséna, une exposition d’ouvrages de Giono, prétexte à une séance de signatures du dessinateur Ferrandez, illustrant les ouvrages de celui-ci sur la Provence de l’écrivain.
…
Parmi les volumes exposés à part, je mis la main sur les fameux Bulletins annuels ou bi-annuels de l’Association des Amis de Jean Giono, dont l’un passait au crible la discothèque de la maison de Manosque. C’est toujours pour moi comme le miroir réfléchissant d’une personnalité ou de sa sensibilité qui ne peut mieux s’exprimer que par l’énoncé des choix et des goûts musicaux. Pour Giono comme pour d’autres.
On savait déjà par les récits ou par des entretiens avec Amrouche ou les amis du Contadour que Bach et quelques Monteverdi (le Lamento d’Arianna) faisaient partie de la sensibilité de l’auteur, du moins était-ce la partie émergée.
Il y avait une quantité impressionnante, songeant à l’époque du soixante dix huit tours, de Cantates de Bach éparses, quelques Brandebourgeois comme il y en a toujours dans n’importe quelle collection, et les fameuses toccatas dont celle en ré mineur. Puis au hasard, des Schubert, un Glück perdu dans une anthologie d’Ouvertures du XVIII°, plus loin, des Wagner, probablement des extraits, mais nulle part je n’ai remarqué l’existence d’un Debussy. Pas même les quelques dix minutes de l’Après-midi d’un faune.
S’agissant du miroir sensible d’un auteur que je considère comme le plus grand poète de nos romanciers, j’ai été surpris de constater une telle absence.
C’était le temps où le grand public ne jurait que par Beethoven, Furtwängler et ses cinquièmes symphonies, le gros des discothèques de base n’étant constitué, presque exclusivement, que de compositeurs germaniques allant de Bach à Wagner.
Peu de lyriques chez Giono, sinon des bouts de Verdi, les Wagner déjà cités, et depuis les années cinquante, Vivaldi qui était exhumé pour ses trop fameuses quatre saisons devenant une sorte d’incontournable.
…………………………………………………………………………………………….
J’ai longtemps pensé qu’il y avait une contradiction du fait que le légendaire Pélléas et Mélisande de Désormière fut enregistré à Paris en 1941 alors sous occupation allemande.
Ou peut-être avais-je pensé que l’amour de la musique, que l’on croit à tort, être une seconde nature chez les allemands, avait permis de telles largesses en ce temps-là.
Que le plus prestigieux et le plus emblématiques des opéras français soit ainsi enregistré dans des studios parisiens en pleine guerre, songeant aujourd’hui encore à ce que coûte la mise en boîte d’un ouvrage lyrique, projet forcément soutenu par les responsables culturels occupant Paris, on est frappé par ce hiatus.
Mais à y regarder de près, en relevant les dates, on constate que Pélléas fut enregistré en quelques jours du 26 Avril au 26 Mai 41… Le Pacte germano-soviétique permettait à l’URSS et à l’Allemagne d’alors de conjuguer des liens, fussent-ils en faisant éclore un tel projet , permettant à Roger Désormière, du « Front National de la Résistance », crée par la Parti Communiste, d’être à la tête d’une réalisation majeure du plus exceptionnel ouvrage lyrique français.
C’était un miracle qui n’aurait pu être réalisé à une date ultérieure, la rupture du Pacte entre l’Occupant et l’Union soviétique mettant fin à cette alliance en Juin de la même année… Le plus célèbre des enregistrements du chef d’œuvre de Debussy ayant donc été engendré sous la double bénédiction de l’Allemagne et de son allié de l’Est du moment, dans une France à genoux.
…………………………………………………………………………………………….
Réponse à Bernard :
Spinoza, rendre intelligent ? Je crois qu’on lit pour se situer, pour savoir la distance entre soi et un autre. Mais Spinoza, comme d’autres peuvent éclairer.
Parfois je me heurte à des lumières trop fortes comme la "Phénoménologie de l’Esprit" ou Heidegger. (Leurs auteurs ne se sont-ils pas effrayés d’eux-mêmes ?)
…………………………………………………………………………………………….
1 Novembre
Toussaint
C’est ma vie, c’est ma vie
Je n’y peux rien c’est elle qui m’a choisi
C’est ma vie, c’est pas l’enfer, mais c’est pas le paradis (Adamo).
Partant du Maroc, la carrière de ce chanteur prenait son essor avec « Tombe la neige ». C’était en plein été. Que de drôles de pensées pour le jour des Morts.
…………………………………………………………………………………………….
Takemitsu : « J’écoute l’eau rêver ». N’est-ce pas l’origine du monde ?
…………………………………………………………………………………………….
Le monde avance. J’écoute Emmanuel Pahud, flûtiste virtuose et titulaire à la Philharmonie de Berlin. Le son est large et plein. Il a rejoint Marie-Claire Lenglamet qui est la première femme étrangère à avoir été acceptée à l’unanimité par les membres de la Philharmonie. Ce qui est la condition préalable pour se voir admis dans l’année probatoire qui suit, comme titulaire membre de cet ensemble. J’avais du la rencontrer au Collège Duruy où sa mère était professeur d’Histoire me parlant de sa fille prometteuse au Conservatoire. La harpiste a fait bien du chemin et son retour à Nice pour le Centenaire en 2015 a été très remarqué par une série de fausses notes, pardonnée comme il se doit par un public fière de son ambassadrice à Berlin. Il est loin le temps où les étrangers, et les français en particulier, n’osaient même espérer pénétrer dans ce sanctuaire. Emmanuel Pahud en est aujourd’hui un fleuron que tout Berlin admire.
…………………………………………………………………………………………….
Aujourd’hui c’est les Morts. Avec sa pluie, sa grisaille et ce silence qui dure un peu plus tard dans la matinée. Les gens veulent bien fêter leurs morts mais il leur faut d’abord dormir un peu plus aujourd’hui.
……………………………………………………………………………………………
L’Egyptien de Michael Curtiz est encore un film qui se regarde sans qu’il ait pris une ride. Un classique du genre. Akhénaton, adorateur d’un seul dieu, treize siècles avant notre ère et dans les circonstances présentées dans le roman de Waltari, semble bien une préfiguration de notre période christique. La croix de vie d’Aton venant avant l’autre.
Freud y voyait plus directement l’origine du monothéisme hébraïque.
…………………………………………………………………………………………….
3 Novembre
La pluie toute la nuit. Pour la journée qui vient aussi. Hier c’était la réunion mensuelle des niçois et occitans dans une atmosphère hivernale. Le Sauveur avait un petit air de bistrot breton. Vers quinze heures, le ciel était bleu comme le Pacifique, menaçant comme de gros traversins mobiles et sonores sur toute la surface du ciel.
…
Hélène et le petit sont installés à la maison jusqu’à l’accouchement. Leur maison est toujours en chantier.
…………………………………………………………………………………………….
Feuilletant quelques images de Grenade, je tombe sur de merveilleuses peintures de l’Alhambra de Joaquin Sorolla y Bastida. Virtuose du blanc, d’évidence. Le Palais et les rues de la ville peints par lui, ne pouvaient que rendre naturelle la lumière qui en jaillit. Entre l’impressionnisme et un réalisme plus anecdotique.
…………………………………………………………………………………………….
5 Novembre
FONCTIONNEMENT D’ETAT
Christophe Castaner , Ministre de l’Intérieur niait encore l’an passé qu’il existât des zones interdites aux forces de l’ordre, déclare aujourd’hui, après les divers attentats commis un peu partout dans les marges urbaines : « nous reprendrons mètre par mètre les territoires abandonnés à la violence… ». Que ne les avions-nous fait respecter depuis le temps !
On aurait pu entendre ça au Liban dans les années quatre vingt.
Aveu d’impuissance, de zones de non droit, et d’état de guerre civile dans la France d’aujourd’hui.
…
LOGIQUE DE LA JUSTICE
On relâche des délinquants accusés lourdement sous le prétexte qu’un manque de personnels accompagnant habituellement ceux-ci ne permettrait pas de les mener de la prison au Tribunal pour y être auditionnés.
Ne pouvant être entendu à l’audience, les délinquants sont donc relâchés dans la nature.
…………………………………………………………………………………………….
7 Novembre
Courrier à Bernard :
Oui, tu as bien compris. Le carnet a été une porte ouverte à de plus vastes possibilités. Creuser le passé, avoir des réflexions sur le passé le présent le futur.
Pouvoir noter des faits d’aujourd’hui ou mieux, restituer le passé en forme de Mémoires c.a.d. la réflexion qu’inspirent des moments importants de la vie passé.
Symboliquement tout a commencé en 2012, j’avais 60 ans. Ma mère disparue depuis un an.
Instinctivement ce fut le démarrage du carnet.
Il était temps.
Que n’ai je commencé à l’époque des "écrits sur l’écorce des arbres" !
Il en serait resté quelques « journaux » sommaires du temps de Stef, disparus lors de déménagements parce que jugés inconsistants et trop notés à la hâte…Toutes ces périodes depuis le Pub Latin, le Janot etc. Envolées hélas. Quelques bribes réapparaissent seulement…
Inversement le journal poétique d’aujourd’hui est plus étique. J’ai souvent l’impression que dans la masse de ces écrits il y a un goût de "déjà dit". Donc ça part à la rature.
Il ne reste que ce que je te transmets. Et chaque fois c’est le même doute : l’impression de forcer le trait ou de répéter. Une torture. Donc, je fais peu…
Puisqu’on en est à "peser" tout ça, j’ai bien l’impression que je laisse derrière moi (si je partais aujourd’hui), bien plus de mille pages de vers.
Comme dit Chateaubriand à la dernière phrase de son Itinéraire : "j’ai trop écrit si mon nom doit s’effacer, et bien assez s’il doit vivre".
…………………………………………………………………………………………….
8 Novembre
Courrier à Bernard :
Malgré tout, ce sentiment que des tournures, des mots même, utilisés par le passé, recouvrent la poésie la plus proche d’aujourd’hui , d’un accent de « déjà lu », me met dans un doute périodiquement.
Cela n’a rien à voir avec ce qu’on a l’habitude de lire dans mes "variations" de peintures ou de textes, volontairement nuancés pour des raisons identiques aux habituelles variations qu’on peut avoir en musique : l’épuisement du matériau thématique.
Là, cela relèverait plutôt du symptôme de « remettre les pieds dans les mêmes pas". Du tic…. J’espère me tromper. Peut-être est-ce ma signature, tout simplement, qui se répète de poème en poème. En tous cas j’écris encore.
Le carnet, justement, est un dérivatif à ce sentiment, parce que dans le carnet on avance autrement…
…………………………………………………………………………………………….
Lucette Destouches, épouse de Louis Ferdinand est morte aujourd’hui.
…………………………………………………………………………………………….
La différence entre les deux génies que sont Debussy et Ravel est que l’un fait monter une émotion dans tout l’abandon de moi-même et l’autre non.
Pour paraphraser Couperin, je dirais que l’un me touche et que l’autre je l’admire.
…………………………………………………………………………………………….
Un de ceux qui viennent chez Sauveur, rebelle et partisan d’une certaine anarchie, me disait, juste avant de remonter dans ses collines, un des plus beaux oxymores du moment, « c’est capital, camarade… »
………………………………………………………………………………………….
Lucas Debargue avait crée l’émotion lors du Concours Tchaïkovsky en 2015. Il n’a rien a envier aux plus grands. Ses Scarlatti et son Gaspard de la nuit, sa Méphisto valse côtoient le meilleur Horowitz.
…………………………………………………………………………………………….
10 Novembre
« Arcana » de Varese, la plus absolue des passacailles d’aujourd’hui vient à se révéler durant plus d’une heure dans les terribles confrontations d’interprétations de ces trente dernières années. Il est évident qu’avec les orchestres de Chicago, New-York et le Royal Concertgebouw d’Amsterdam, Martinon, Boulez et Chailly, on a entendu la véritable œuvre héritière (1927) , en plus cosmique, du Sacre du printemps, qui aurait pu être une tangente logique à la trajectoire future de Stravinsky.
Les arcanes du monde sont là, les trous noirs, les tragédies humaines, les tremblements occultes, la complexion de la matière, les ordres et les désordres diffus des espaces du sidéral et le gouffre de nos avenirs.
Arcana qui décida de la vocation de Pascal Dusapin.
…………………………………………………………………………………………….
Courrier de Bernard :
octobre est un mois important, celui de mon anniversaire
à nos âges, toutes les dates sont chargées, de divers souvenirs, ce qui fait que chaque jour amène son lot de commémorations.
Ce n’est pas si simple de vivre sans avoir l’œil dans le rétroviseur, et cela le sera sans doute de plus en plus en vieillissant
que te dire sur ta poésie que je n’ai pas encore dit et qui te donnerait l’énergie de poursuivre ton œuvre?
Tu as une manière, un style marquant. Ton écriture est quasi abstraite; tu ne racontes pas une histoire, ni décrit un paysage; tu brodes en continu sur un thème unique: mort/amour/temps. Ta rythmique est sombre. Alors, bien sûr, une lecture superficielle pourrait donner à penser que tu te répètes. Pour moi, ta poésie est comme un phénomène naturel, le désert, la forêt, la mer, que sais-je, … oui ça a l’air uniforme, mais en vérité, et quand on observe attentivement, qu’on lit sérieusement, qu’on rentre dans le texte, la variété éclate, les ruptures, les contradictions, les surprises, les formules, les plaisanteries, …. Et c’est un des charmes de ton écriture. Au-delà d’un thème monolithique, il y a le charme fou de l’inspiration qui improvise des effets toujours renouvelés.
Il faudrait que je prenne le temps du recul, de te relire in extenso. Je prends le mois que tu livres, je l’insère dans le site, je le lis et le relis une fois qu’il est installé. Mais je vais rarement dans le passé, souvent à l’occasion d’une modification du site, d’un bug, plus rarement pour relire un passage, comme leçons des ténèbres (un de mes favoris) ou autre. J’ai une impression de continuité, de reprendre un dialogue interrompu le mois précédent.
Je ne peux pas me poser comme lecteur lambda, qui aurait acheté l’œuvre et l’aurait lu de a à z. La sensation serait peut-être différente. Et puis ça ne convient pas à la poésie, mais plutôt au thriller, ce n’est pas le même genre.
Est-ce parce que tu n’as pas assez de lecteurs que tu as peut-être l’impression d’écrire en vain? L’édition de l’Harmattan n’est pas suffisante pour te donner l’ampleur nécessaire. Le site web est fallacieux. C’est comme une bouteille à la mer.
à Bernard en réponse :
Je viens de lire tes messages et les larmes me viennent doucement. C’est vrai que tu es un lecteur et un éditeur inlassable et confiant.
Ami, je n’ai pas besoin d’autres vérités.
Je ne demande pas qu’on me rassure, mais je cherche un chemin qui serait simplement évolutif.
Je cherche le cristal, voire le diamant, c’est pour ça que je parle encore de caillasses et de pierres, à défaut, de porphyre.
Merci
…………………………………………………………………………………………
11 Novembre
Grisaille pour cet anniversaire d’armistice. Comme souvent, c’est un jour qui a la couleur de la nature qui s’endort.
Le froid arrive aussi, doucement. C’est d’ailleurs un beau contraste avec mes séjours au Moyen Orient avec Chateaubriand. Les bords de la Mer Morte, les restes des murailles de Jéricho parsemés en sable dans les eaux du Jourdain, où il n’y a plus de roses et de palmiers, la chaleur odorante aux abords de Jérusalem. L’ouvrage ne m’est pas tombé des mains, au contraire, je chemine pas à pas avec l’auteur. Je prends le rythme du désert. C’est bientôt l’arrivée dans la ville Sainte.
……………………………………………………………………………………………
12 Novembre
à Bernard :
Non, ce n’est pas une crise de vers (Mallarmé). Je continue de différencier ce qui est "variations" : (épuisement du matériau thématique, jusqu’à saturation), qui ouvre plusieurs perspectives comme un prisme ou une forme de cubisme de la réalité
de ce que je crois être un piétinement par le fait de mettre les pieds dans les mêmes ornières.
J’espère évidemment qu’un lecteur qui prendrait de la distance ne partage pas mes doutes.
…………………………………………………………………………………………….
13 Novembre
DINKY TOYS/ SOLIDO
Le goût des collections m’est venu très tôt, dès l’enfance. Nous habitions le quartier de l’Aviation, un peu en lisière du centre de la ville de Rabat, non loin effectivement d’où atterrissaient et décollaient de petits bi moteurs, et je crois que c’est resté un quartier modeste mais qui avait le charme d’être un îlot de villas et d’immeubles qui ne dépassaient guère un seul étage dans l’absolue tranquillité. L’allée qui menait à l’école où je fis ma maternelle, était protégée par un étroit sentier très ombré, bordé de roseaux géants, et passé celui-ci, il fallait traverser un champ qui me paraissait immense où l’on ramassait de petites fleurs jaunes dont les tiges entre les dents donnaient un jus pareil à de la vinaigrette. L’endroit que nous habitions était en fait une dépendance de la villa d’une tante, du côté de mon père. Le jardin était vaste, du moins à mes yeux d’alors. Il avait largement de quoi façonner une imagination d’enfant de quatre, cinq ans. Mes premiers coins secrets et mes premières chutes dans les orties se firent dans ces lieux fleuries mais qui avaient sus rester sans apprêts, avec un grand bassin et deux allées qui contournaient le corps principal de la villa pour atteindre notre petite baraque tout au fond. Il y avait un puits aussi, où je prenais plaisir à jeter des sons, des petits cris que je variais, puis quelques pierres pour voir quels sons sortiraient du fond des profondeurs. Il m’était tellement agréable de varier les sonorité inattendues venant du fond du puits que j’y risquais parfois même des objets qu’un archéologue eut été étonné de retrouver aujourd’hui.
J’avais, dès que j’ai pu en prendre conscience, une attirance sans borne pour un magasin de jouets du centre ville, le Nain Bleu, situé à l’angle d’une artère principale. La vitrine exposait tous mes objets de convoitise. Des petites voitures à l’échelle 1/43, les fameuses Dinky Toys et les Solido en métal que je préférais nettement aux Norev en plastique, qui me paraissaient mesquines et qui, dans mon esprit, devaient être destinées aux enfants pauvres ou n’ayant aucune propension au rêve. De simples jouets, alors que j’attribuais à ces perles de modèles réduits de telles qualités qu’il m’était difficile, même dès cet âge, d’imaginer les manipuler autrement que dans la gaucherie de gestes qui trahissait l’emprise qu’elles exerçaient sur moi. J’aurais aimé en fait qu’elles puissent se maintenir dans cet état de perfection que les boîtes en carton accompagnaient lorsque mes timides tentatives de les faire un peu rouler étaient terminées. Ce magasin était ce que je crois avoir été la première idée que l’on peut avoir d’un palais enchanté ou, je le sus plus tard, une caverne d’Ali Baba, avec des odeurs de carton neuf, de savon frais, de tissu, de ces parfums qu’on associe à ces désirs d’objets appartenant au monde des songes qui avaient leur propre existence nocturne une fois le sommeil venu.
J’ai vécu ainsi dans ce petit paradis d’échange entre ces voitures pour enfants, dont mes parents avaient la largesse d’augmenter le nombre à de multiples occasions, et l’univers que je me construisais autour de ces formes arrondies ou anguleuses, ces couleurs aux reflets métallisés, aux détails infimes des poignées de porte ou des intérieurs vernis, les vitesses dont j’imaginais qu’elles fussent capables d’atteindre, et que j’admirais aussi lorsque, dans la ville, on retrouvait les vraies au hasard d’une rue.
Ma collection augmentait d’année en année, mais l’adolescence mit un peu un frein à ces accumulations de modèles réduits qui trônaient sur le manteau des cheminées de Rabat, puis dans ma chambre de la Rue des Potiers où l’espace était plus restreint. D’autre part, cela contredisait la personnalité nouvelle qui grandissait en moi et qui se détachait de ce que je considérais d’un âge ancien qui me faisait maintenant sourire en dedans.
Vers dix huit ou vingt ans, je n’ai plus jugé utile de les conserver. Elles étaient toujours impeccablement rangées dans leur boîte d’origine. Le temps avait fait que je ne reconnaissais plus, ou alors avec cette tendresse qu’on peut avoir pour les illusions entretenues trop longtemps, ces jouets d’enfant unique qui m’avait fait jusque là constituer un champ de protection contre un monde que je n’avais pas encore voulu faire mien, celui des adultes, qu’il devenait urgent de rejoindre aujourd’hui en se défaisant de vieux oripeaux devenus inutiles.
Je destinais donc, sans qu’ils en fussent plus étonnés que ça, ces quelques cinquante petits bouts de métal et de caoutchou dans leur protection de carton, à mes cousins plus jeunes que moi, les enfants de mon oncle André.
Maintenant j’épinglais dans la chambre de nouvelles images, j’avais d’autres icônes, je me voyais au travers de lectures complexes me grandissant à mesure que mes fréquentations s’accordaient à ces changements comme il est naturel dans l’évolution d’un jeune de presque vingt ans.
Puis j’oubliais tout ça dans la délicate métamorphose qui s’ensuivit pendant bien des mois, peut-être plus.
C’est en repensant à ces échos avec lesquels je jouais au bord de la margelle du puits du jardin de la villa de l’enfance, à ces pierres que j’avais jetées afin d’en entendre les sons graves ou plaintifs, les jouets de bois ou les objets de métal qui semblaient rendre un son vivant à mes oreilles attentives, que je fus horrifié, comme on peut l’être d’un cataclysme relatif, en constatant, lors d’une visite chez les cousins en question, que les petites voitures tant aimées et tant ou trop respectées, jonchaient le sol de leur chambre, les recoins des couloirs, sous les tables, inanimées, privées de la plupart de leurs attributs, comme les revêtements de tissu, les pneus brûlés par je ne sais quel incendie perpétré, les portières arrachées, les collisions et les entrechocs occasionnés par les voitures probablement lancées d’un bout à l’autre de la chambre, que l’ensemble me parût un désastre pareil à ces jeux auxquels se livrent en grandeur nature ceux qui aujourd’hui brûlent, pillent et dévastent l’environnement de leur mal être.
Je revis en un instant les petites années d’où émanait la douceur de ces objets accompagnant de leur pouvoir de rêver, mes solitudes et mes joies simples d’alors, et toute cette trahison qui me venait maintenant au visage que je ne pus pas même en parler à mes deux cousins qui n’auraient pas compris que ces morceaux de rêves maintenant défigurés et torturés n’avaient pu servir qu’à de barbares et immédiats plaisirs de joies intempestives.
…
L’avenir se nourrissant toujours de quelque passé, la trentaine venue, je fus repris par ce démon de réunir de nouveaux modèles réduits, beaucoup plus précis, plus lourds, plus fidèles dans la réalisation et tout simplement encore plus sophistiqués dans les finitions, les Western Models, horriblement chers. Je fus accompagné en cela par l’ami Michel Guillon qui, lui, avait eu la patience de conserver intacte sa collection d’antan.
Je conserve aujourd’hui, sans jamais les sortir de leur emballage, de merveilleuses Bugatti de types divers, des 35, des Atalante carrossées par de fabuleux artistes des années 30, des Atlantic merveilleusement profilés, des Hispano-Suiza de Labourdette décapotables, quelques Delage, Delahaye et Rolls Royce, la fameuse Bugatti Royale, si colossale que même le commanditaire Roi Karol de Roumanie ne se sentait pas d’honorer une commande si fastueuse, et tant d’autres qui continuent de vivre leur vie d’objet sans que je les trouble dans leur boîte protectrice. Peut-être que lorsque Y sera grand…
…………………………………………………………………………………………….
14 Novembre
à Bernard :
La grève générale, comme au bon (?) vieux temps est pour le 5. Tout sera paralysé. Le trotskisme n’est pas mort.
La SNCF se plaint. De quoi ? Avant les trains partaient au moins à l’heure (une fierté).
On n’avait pas les Douanes à 22h sur un Paris-Nice (!)…
La Poste avait 2 levées. Quand il n’y avait pas de courrier le matin, on se disait que la lettre de la petite amoureuse arriverait vers les 17 h.
J’ai envoyé des cartes postales de Rome en 2016. As-tu reçu la tienne ? Tu me l’aurais dit. Pareil au Sauveur. Pas arrivée. Le facteur du coin m’a dit avec un sourire dont on se serait passé :" en ces temps de déclaration d’impôts, il y a des priorités".
Non, sincèrement, faire transiter des choses aussi sérieuses qu’un courrier ou des documents importants (Livre des Répons, colis de presque un kl !) ne devraient jamais transiter par des mains anonymes ou irresponsables.
En un mot je fais modérément confiance à nos services publics. C’était le courrier de la mauvaise humeur.
…
Je suis souvent, ces temps-ci, dans des souvenirs d’enfance. Des mémoires qui viennent parfois de loin.
Ce matin, cardiologue à la première heure. Tout va bien. J’ai vu ça sur une échographie en couleur. Le plus impressionnant c’est le son des battements du coeur. C’est très fort, le son est comme comprimé et ça bat comme ça pendant des années. On comprend bien pourquoi un jour toute cette mécanique en a marre.
…………………………………………………………………………………………….
Poulidor va pouvoir enfin porter le maillot jaune aujourd’hui, là où il va.
Personne ne lui enlèvera jamais, là où il est , ce qu’il n’a pas eu ici bas.
Maintenant cette couleur d’or qui lui aura toujours échappée va faire sourire mon père qui le recevra en lui parlant de Jacques Anquetil.
Mais même dans la mort celui-ci l’avait encore devancé.
…………………………………………………………………………………………….
POURQUOI
Pourquoi ne s’intéresse-t-on pas juridiquement à l’industrie du rap sous l’angle du racisme et de l’incitation à la haine de ce que nous sommes ?
Pourquoi la FNAC en est-elle le principal diffuseur ?
…
Pourquoi la France est-elle un des rares pays soulevant et exportant la montée de l’antisémitisme à proportion des conflits successifs dans la bande de Gaza ?
…
Pourquoi la figure de Gallieni est-elle si pâle dans le cortège habituel des généraux et des maréchaux de nos places et de nos avenues, de nos étoiles ?
Et Lyautey, l’homme du Maroc moderne ?
………………………………………………………………………………………….
15 Novembre
Roman Polanski fait aujourd’hui parler de lui à double titre. Sur le plan professionnel et, comme souvent, sur le plan des mœurs. Certains disent déjà, très subtilement, que son dernier film est comme une défense anticipée de l’accusation dont il est l’objet. Quelle divination ! Au travers de « L’Affaire Dreyfus », c’est un peu le signal que Polanski lancerait à son public de ne pas avoir à commettre, à son endroit cette fois, une nouvelle erreur judiciaire.
Les habituelles consciences des professionnels de la morale ont déjà sorti le toujours habile distingo entre le génie d’un auteur et la piètre faiblesse toute humaine de l’auteur lui-même. On pense évidemment, à un degré supérieur, à l’auteur de « Mort à Crédit » et à l’homme Céline. Mais l’on pourrait également se demander où se situe la distance entre l’homme Mozart, ridiculisé et infantilisé dans le film de Milos Forman, et l’auteur de Don Giovanni. On pourrait, pour chaque grand créateur, tracer une sorte de barème de la valeur humaine et mesurer la distance d’avec la grandeur de l’œuvre. On pourrait même penser que la valeur d’un créateur sera toujours disproportionnée à mesure que son génie est plus élevé.
Et que penser d’Homère ? Certains pensent d’ailleurs qu’il n’a jamais même existé.
Et Shakespeare ? Que plusieurs personnes habitent le même créateur.
Polanski a réalisé des films qui sont un peu le miroir de notre époque.
Je pense qu’il n’a pas fait mieux que son chef d’œuvre absolu, Rose Mary’s Baby dont le New-York des années soixante semble l’avoir façonné et modelé des ses hantises et de son destin dramatique. Comme on dit aujourd’hui, quelque part son œuvre l’aura rattrapé.
Ou dans le cas précis de l’assassinat de Sharon Tate, l’aura précédé.
Céline a été poursuivi comme rarement pour les raisons que l’on sait. Aujourd’hui son antisémitisme est condamné parce que des lois sont venues encadrer l’antisémitisme. Sinon ses pamphlets (les Beaux Draps, Bagatelles pour un Massacre et l’Ecole des Cadavres) ne seraient, et n’auraient-ils pas du être reconnus comme telles, que des expressions de la liberté de penser ? Même si cela doit choquer encore.
D’autant que ces lois contre l’antisémitisme auraient aujourd’hui réduit au silence, voire auraient condamné deux mille ans d’histoire, Saint Louis, Wagner, Liszt et tant de milliers d’autres d’un temps où les lois n’encadraient pas la plupart de ceux qui, anticipant les jugements définitifs concernant Dreyfus, n’eussent pu s’opposer à ceux qui le défendaient.
Il faut des lois désormais pour encadrer ce qui est convenu comme pensable et des interdits qui fixent bien les sangles d’un cordon sanitaire moral.
L’industrie du déferlement du rap seule bénéficie d’un droit d’éructer les pires vomissures et de passer outre les règles drastiques imposées depuis longtemps, à ceux qui pensent hors des normes de la pensée autorisée.
Les délits de Polanski relèvent simplement du droit commun et ne regardent pas la matière de son œuvre cinématographique, laquelle va pourtant souvent dans le sens de la bienpensance, et il serait aberrant de se priver de son dernier film au nom d’une tartufferie de bonne moralité (hors champ) qui ne pourrait le condamner que pour des délits d’ordre privé.
En son temps, la bourgeoisie du Second Empire, plus logique sur le plan du contenu de l’œuvre, condamnait Bizet, moins pour sa musique, mais pour un livret de Mérimée qui heurtait la sensibilité des jeunes filles dont les parents ne supportaient pas qu’elles fussent mises en présence d’une séductrice doublée d’une « intouchable » bohémienne.
Mais comme dit le proverbe, mieux vaut parler de moi, même en mal, plutôt que de ne pas en parler.
Les émois qui entourent la sortie prochaine du film sur les écrans n’empêcheront pas le public d’y voir l’affaire traitée comme il se doit, dans le sens où l’histoire a depuis bien longtemps porté son jugement sur un innocent capitaine de l’armée française. De ce point de vue là, de scandale il n’y aura pas.
………………………………………………………………………………………….
16 Novembre
Ce samedi, le soleil est de retour après les déluges glacés qui se sont abattus sur le Sud. Cécilia et moi accompagnons « un de chez Sauveur » à Tarascon, dont le fils est incarcéré depuis quelque temps.
…
(A Bernard : Hier nous avons eu un temps radieux. Et c’était mieux pour accompagner "un de chez Sauveur" à Tarascon où il allait porter des vêtements propres à son fils au pénitencier de la ville. Ville balafrée par l’ennui, la désolation et le vide de ses commerces, de ses activités. Seule, la façade d’un Théâtre semble un fantôme d’un temps où la ville devait avoir un peu de lustre, et laissait supposer qu’il y avait une vie sur ces bords du Rhône.
Par contre nous avons déjeuné au centre d’Arles, dans ses couleurs, au bord du marché du samedi, revu le centre historique, grimpés aux arènes, revus les Alyscamps.)
…
C’est l’occasion de revoir Arles vers midi, le soleil de la Place des Lices, le marché animé jusque tard vers quatorze heures, sa viande de taureau au Wauxhall, les arènes toute dépouillée et tout le cœur de la ville, petit miracle de poésie provençale, sa pierre classique et ses architectures de noblesse romaine, les Alyscamps dans la solitude qui lui sied si bien, avant de filer vers Tarascon en fin de journée, son pénitencier gris, sa cité désolée, morne et délaissée. Le théâtre seul, avec sa façade de belle proportion, laisse supposer un temps plus souriant où devait y baigner un semblant d’âme au bord du Rhône.
Où étaient donc les Tartarin ?
…
Dans les villes du pays on fêtait le premier anniversaire des Gilets Jaunes, vagues fantômes de perpétuelles revendications qui s’essoufflent dans le désordre de leurs désirs, mais dont les marges anarchistes et d’extrême gauche, parallèlement, organisent de plus en plus clairement un caillassage de toutes les symboliques du pouvoir.
De cela seul il a finalement été question.
……………………………………………………………………………………………
19 Novembre
à Bernard :
J’ai toujours en mémoire la seule fois où je suis allé à Tarascon, comme toi, pour les "3 jours" de détection préalable à l’engagement d’un an de service militaire.
Comme toi j’y ai échappé, mais en deux étapes.
Je ne tenais nullement à faire un an de service, étant déjà étudiant et fortement épris d’une jeune femme que je ne me voyais pas quitter pour mettre l’uniforme.
D’abord étant né outre mer, je ne fus pas convoqué aux 3 jours. Tous mes copains de classes et d’ailleurs sacrifiaient à cette contrainte sans que je reçoive aucune notification. Je me suis cru miraculeusement oublié, jusqu’au jour où je reçus un courrier du commandant de Perpignan me signifiant que je partais en septembre pour l’Allemagne (Stuttgart, fameux bataillon disciplinaire) ne m’étant pas inscrit comme j’aurai du le faire à notre arrivée en France ! Je croyais naïvement "exister" automatiquement puisque j’existais dans d’autres domaines (sécu. sociale, mutuelle étudiant etc).
Je fus contraint d’écrire un courrier demandant un report d’incorporation et la possibilité de faire ces fameux 3 jours.
On accepta le report.
Entre temps je fis préparer une bouée de sauvetage (un certificat médical obtenu chez un psy) que je fis valoir à Tarascon.
Tout n’était pas encore gagné. j’avais le n° 13, et les douze premiers qui passèrent successivement avant moi allèrent vers la gauche du couloir, ce qui signifiait qu’ils n’étaient autorisés à se rendre vers le centre médical.
Mon n° 13 me porta chance, je pus accéder à un psy vers la droite du couloir et je fus ainsi, après bien des palabres, exempté d’une d’année que je fis fructifier autrement.
Je me souviens des paroles du médecin de l’armée :"je vois que vous ne tenez à faire votre service obligatoire, vous verrez, vous regretterez un expérience importante qui compte dans une vie"
Je me souviens aussi que lors du retour en train, on ne connut wagon aussi joyeux autour des canettes de bière. Ceux qui étaient heureux d’avoir passé favorablement les épreuves qui partaient le mois suivant, et les exemptés qui l’avaient échappés belle.
…
Ce samedi, si ce n’était le beau temps, Tarascon m’aurait paru simplement un lieu de désolation.
Quand je pense à toute cette petite aristocratie de province et à tous ces Tartarins disparus.
…………………………………………………………………………………………….La Jérusalem de Chateaubriand est encore comme du temps du Christ. On croirait entrer dans les maisons qu’il aurait connu, les temples les tombeaux et le Saint Sépulcre aussi. Au 19° siècle la ville semble ne pas avoir changé. Qu’en est-il aujourd’hui ?
……………………………………………………………………………………………
La pluie s’installe, les nuages noirs ne quittent pas le ciel. C’est Eugène Ormandy qui meuble l’après-midi de sa Marche hongroise, du Tzigane avec Stern, rugueux comme jamais, de l’Oiseau de feu d’une rare poésie, de Peer Gynt et du premier concerto pour violoncelle de Chostakovitch. C’est la philharmonie de Philadelphie qui sculpte le son. Un orchestre qui ne quitte jamais sa position dans le Big Five. C’est peut-être la meilleure dixième de Malher qui est produite par Ormandy, la première enregistrée intégralement.
…
Léontyne Price, qu’on soupçonnait un peu de se sentir une diva à l’ancienne, reconnaît n’avoir d’autre souvenir que d’elle-même comme seul objet de culte.
…………………………………………………………………………………………….
Parmi tous les anniversaires que cette année en 9 fait surgir en ma mémoire, il en est un qui a sa place pour un quarantième anniversaire, celui de la Révolution Islamique en Iran. Le temps des ayatollah pouvait commencer. En 79, et à partir de 80 le Pub Carlone voyait une déferlante de réfugiés, anciens partisans du régime du Shah. Vêtus de noirs ou de treillis militaires, souvent barbus, austères et un tantinet méprisant, ils traversaient la terrasse et les salles du pub sans nous voir. Leur univers était clos sur eux-même, les femmes ne fréquentaient aucun d’entre nous et on entendait parler le persan comme si nous étions à Téhéran. Tous ou presque logeaient à Fabron, dans les luxueuses résidences de l’abbaye de Roseland.
…………………………………………………………………………………………….
21 Novembre
à Bernard :
L’inceste est un phénomène culturel lié à un risque d’affaiblissement de l’être par le sang mêlé. L’interdit absolu qu’il semble impossible à transgresser. Du moins pour des gens comme nous. Mais il y a bien des transgresseurs dont on parle rarement. Dans les campagnes, dans des lieux de misère humaine. C’est du moins une rumeur qui monte de temps à autre des profondeurs de la désolation.
Parfois aussi des exemples de très hautes figures Antiques. L’inceste semble avoir fasciné dès les premiers embryons de civilisation. Mais peut-être que déjà Sophocle est un moment élevé de la civilisation.
C’est sûrement le phénomène culturel le plus lié étroitement à un phénomène naturel, lesquels avancent pour une fois ensemble devant un danger menaçant.
Le Musil en question (traduit par l’excellent Jacottet) m’est toujours tombé des mains (3000 pages c’est trop pour mon attention peu soutenue). Mais je lirais les pages en question sur l’inceste entre le frère et la sœur si tu me les indiques.
« L’homme sans qualité » me fait l’effet de tous les Thomas Mann, c.à.d. l’impression que les traductions introduisent un filtre de lourdeur dans la narration. C’est long, c’est pesant. Alors que dans Proust je suis chez moi.
Bref, 6, c’est donc le pourcentage de transgression de l’inceste constaté ? Bigre ! c’est presque un pourcentage de parti politique. A 5% on rembourse les frais de campagne…
…………………………………………………………………………………………….
22 Novembre
POURQUOI CE FOND DE CIEL ?
Il est étrange de constater sur un temps relativement long, que la France, généralement prompte à réagir devant toutes sortes de dictatures, s’en va en guerre pour un oui ou pour un non dans des contrées où il n ‘est pas évident qu’elle aille dans le sens de nos intérêts. Pour conséquemment hériter de conditions qui, généralement, débouchent sur un renforcement des forces islamiques.
Depuis bien avant le départ du Shah d’Iran, réfugié au Etats-Unis, nous avions préparé à Nauphle-le-Château un hôte de marque qui, sitôt le Shah destitué, vit arriver après donc un exil chez nous, le triomphateur ayatollah Komheini, qui ne tarda pas, en forme de remerciements, à montrer notre pays comme un allié du Grand Satan.
Plus tard il n’y eut pas de mots trop durs pour qualifier les agissements du dictateur Saddam d’Irak, dans les années qui ont suivi, lequel était pourtant le dirigeant le plus tolérant en matière de religion, ayant lui-même épousé une chrétienne, ce qui ne s’imagine pas dans les pays de cette région du monde. Il s’en est suivi rapidement des relations plus que tendues avec ce pays, à se demander si notre diplomatie ne fonctionne pas en proportion inverse de nos intérêts. Là aussi nous fûmes montré du doigt et engagé dans des tractations qui finirent heureusement, grâce au parapluie américain et nullement à notre politique, après bien des peines, par la disparition d’El Kaïda et de son chef Ben Laden.
Toujours est-il que dès que nous participons, souvent en supplétif, à la destitution d’un tyran bien ordinaire, nous voyons éclore une non moins bien ordinaire vague d’islamisme qui ne tarde pas à se retourner contre nous.
Et pour finir sur cette série, la Syrie, qui se voit depuis huit ans en proie à son dirigeant Bachar El Assad, a vu grandir des forces rebelles et islamistes quand nous persévérons à ne voir de danger pour nous que la seule dictature du dirigeant syrien. Lequel s’est immédiatement tourné vers un autre colosse sur l’échiquier géopolitique, la Russie de toujours, ce qui enlise par le jeu des alliances, la position de la France qui s’est vu engagée, puis désengagée, puis dégagée au gré de la valse diplomatique entre les vrais grands de ce monde, tout en étant maintenant en proie à une invasion de toutes natures venant de cette poudrière qui n’a plus par ailleurs le rempart libyen qui la retenait au-delà de la Méditerranée. La cause en est que le très peu sympathique Kadhafi a été lui-même considéré par le Président Sarkozy, comme un dictateur dans son pays et donc éliminé du jeu politique et exécuté.
Là encore Daech, l’armée du califat islamiste, nous a montré du doigt comme un ennemi prioritaire.
Les attentats de ces dernières années montrent bien la faillite de la diplomatie française.
Là où la France voit rouge devant des dictatures qui ne nous intéressent pas en priorité, nous avons hérité de lourds ressentiments venant des opposants de quelque nature, et la certitude de voir se déverser toutes les misères du monde sur notre sol. Il n’est qu’à voir comment le verrou des migrations, véritable arme de guerre, a facilement sauté lorsque la France a pris position pour les kurdes contre le gouvernement turc.
En psychanalyse, on pourrait conclure que nous avons tout fait inconsciemment pour que la France se hâte de devenir, en important une très lourde démographie en provenance des terres d’Islam, la première prochaine terre officiellement musulmane en Europe.
…………………………………………………………………………………………….
23 Novembre
D’AUTOMNE
L’épidermique de Pessoa, du plus loin du renoncement, est une pensée qui sent, plutôt qu’une sensibilité assujettissant la pensée.
…
C’est le temps qui m’exile, qui me rend dépendant d’un temps qui se dérobe, qui accélère.
Je voyage parce que je quitte l’instabilité de l’immobilisme, je fuis vers des latitudes aimées.
…
On dit de Néron, mais qu’en sait-on, qu’il avait brûlé Rome pour motiver à nouveau l’inspiration de sa lyre en perte de vitesse, construire un ouvrage lyrique qui le rendrait digne des dieux. C’est cher payer une adrénaline qui, comme dans le phénomène de l’addiction, demande toujours plus.
…
Néron est pris au piège de la surenchère, comme ceux, à l’extrême du film de Musumara, La Bête Aveugle, où les forces de l’énergie vitale ne se rechargent que par un surcroît d’intensité du plaisir, puis au-delà de toute sexualité, jusqu’à plus encore de douleur, de mutilations de la chair. Jusqu’à l’aveuglement, jusqu’à la sensibilité anesthésiée et aveuglément improbable des insectes s’entredévorant.
…
Cette nuit je regardais la pluie tomber fortement avec régularité. Dans le calme de notre îlot. Tout le monde se plaint lorsqu’il pleut, mais il y a une gravité ressentie dans le chant de la pluie qu’on mesure le champ restreint et presque timide de chaque havre protecteur. Les murs, les clôtures, l’eau qui s’écoule avec son bruit de gargouille, le gras des feuilles qui brillent en tremblant, reflétant les halos de lumière qui s’étirent dans les lointains, la brume tombée, le temps momentanément figé.
…
Réponse à Bernard et son figuier normand :
C’est l’enfermement, la mélancolie de l’automne qui descend. La pluie drue, comme rarement, si régulièrement qu’on n’y voit pas Saint Paul et encore moins le Baou.
Tu me parles des arbres de Normandie. Le figuier est un de mes préférés. Arbre qui résiste aux froids, aux glaces. En janvier 85, lors de ce prodigieux hiver de neige qui avait recouvert Nice de plus de cinquante centimètres et fait dévaliser les magasins de photos, un ami me disait, et je ne mesurais pas l’importance de ses paroles, que le figuier de son jardin avait résisté. Que pour un arbre du Sud, il était extrêmement résistant. Quand il arrive à mourir c’est que le froid est à son comble. Et puis j’aime sa forme, ses feuilles larges et franches et puis tout simplement sa vertu décorative et enveloppante dans un jardin. J’ai vu malheureusement des figuiers séculaires disparaître (par mort naturelle ?) et longtemps laissés à roussir devant les murs gris du Lycée Masséna. Quelle tristesse. Aujourd’hui ils sont remplacés par de bien pauvres palmiers qui, les jours de grand vent ressemblent à quelques rastas perdus dans le paysage.
…
La méchanceté dans la littérature a tellement été annexée par Céline qu’on se demande si les auteurs qui ont suivi ont eu la force de s’y coller.
……………………………………………………………………………………………
Hélène est anxieuse. Nous sommes le 23, le jour prévu pour l’accouchement. Elle est évidemment un peu perdue.
…………………………………………………………………………………………….
24 Novembre
On se réveille avec le déluge au-dessus de nous, incessant et ce n’est pas de l’eau de lavande fine. Les rues, les ponts, les routes et les chemins sont recouverts de larges épaisseurs d’eaux boueuses rendant impraticables la plupart des axes de communications. Villeneuve-Loubet est en alerte rouge. Nous sommes depuis deux jours confinés chez nous. Le ciel est encore bas ce matin et aucun espoir de voir une amélioration ne se fait attendre.
Par chance la configuration de notre hameau permet l’évacuation, même lors de terribles orages.
Dans le var, c’est pire, du côté de l’Argens des maisons sont emportées, d’autres inondées, des ponts sont submergés.
Hélène habite un îlot isolé de Cagnes. Son angoisse est bien compréhensible. La route menant à la clinique Saint Jean est-elle même encore praticable ?
…………………………………………………………………………………………….
25 Novembre
à Bernard :
Ca c’est vrai, le diable on n’en a pas fini. Il est tellement plus porteur que "l’autre" et sa pente est si facile.
Quant à Ferré, je ne l’ai jamais cru sincère. Je lui accorde tout le talent qu’on veut, mais l’honnêteté non.
Venir faire la leçon en chanson, s’estimer honoré de ne pas passer dans les médias (qu’aurait-il fait aujourd’hui ?). C’est vrai qu’en ce temps-là, passer dans les médias, c’était « commercial ».
Et arriver en Rolls à St Paul de Vence…
Une histoire d’anarchie pour autrui.
Globalement c’est aussi sincère que "sympathy for the devil", ça fascine. Un peu comme jouer à se faire peur. C’est porteur.
…
Tu as de la chance de planter des arbres. Giono a écrit un tout petit livre, presque un inaperçu, "l’homme qui plantait des arbres". A recommander.
Y a décoré son premier arbre de Noël, avec les lumières qui vont avec, l’étoile et tout. Il a commandé trois cadeaux au père Noël, dont un petit appareil photo. On lui a demandé "et rien d’autre ?", « non rien d’autre ».
On espère la petite soeur le plus vite possible.
………………………………………………………………………………………….
La circulation est improbable aujourd’hui. C’est le quatrième jour d’auto réclusion.
Le seul arbre qui nous reste a perdu en partie ses feuilles. Le jardin ressemble à une marqueterie de jaunes et de verts.
…
Dans l’école de Y les jouets sont cassés ou ont été emportés par les eaux.
………………………………………………………………………………………….
27 Novembre
Je reçois d’un ami, des images d’archives du Maroc du début du XX° siècle, où tout était à construire. Des images, non seulement des lieux, ici surtout de la naissance de Casablanca, mais des pionniers débarquant des navires, des quelques maisons nouvellement construites, et au-delà, les déserts à défricher à l’intérieur du pays. Les noirs et blancs de ces images mouvantes et presque fantomatiques rendent encore plus sèches ces nudités immenses aux portes de l’océan. On y voit progressivement l’édification de la ville, la percée des grandes avenues, l’arrivée du Maréchal Lyautey, inspirateur du Maroc contemporain.
Casablanca se sera souvenu et aura honoré ce Maréchal, dont la statue équestre (c’est l’honneur le plus insigne en matière de représentation sculptée qui n’est souvent rendu qu’au roi du Maroc) est encore debout dans le centre de la ville.
Le Maroc n’aura donc pas oublié ce passé où des traces de la présence française faisaient qu’il y a un siècle, paraissant un autre temps, ce pays se donnait les moyens d’accéder à la modernité.
L’Algérie d’après 1962 laissera un sentiment d’amertume et d’ingratitude à proportion inversée que cette contribution, de plus de cent trente années de présence de français nés dans ce territoire, aurait pu laisser dans de fantomatiques symboles, pour ceux qui ont vu naître l’Algérie du XX° siècle, comme ceux de Lyautey au Maroc, l’épée pointant fermement vers l’avenir du haut de son cheval de bronze.
…
D’autres images viennent à ma mémoire. Des images de Rabat l’aristocrate, de ces murs blancs jusqu’à ne plus avoir la force de garder les yeux ouverts en ces débuts d’après-midi de plein soleil, de ces murs de l’école Pierre de Ronsard, de la rue Taillandier (qui était-il au juste ? n’était-ce que le rue d’anciens tailleurs de pierres ou de fer ?) et des mirages qui ondulaient sous le coup d’une chaleur intense au-delà des fenêtre de mon autre école, celle des frères de La Salle, qui donnaient vers cet infini d’ocre au nord de la ville. Je pouvais rester sur mon banc d’élève, sans bouger durant les heures de classe, regardant au loin derrière ces fenêtres, à rêver lentement à ces espaces qui donnaient on ne sait où.
…………………………………………………………………………………………….
à Bernard :
Je me suis incomplètement exprimé. Concernant Beckett, Feldman a écrit :
1) "For Samuel Beckett" , pour musique de chambre. Donc Sam n’a rien à y voir. Plutôt un hommage du compositeur.
2) "Neither", opéra , paroles de Beckett. C’est très court. Tu pourras les lire sur internet.
3) "Samuel Beckett", sans précision de genre comme souvent chez Feldman, il n’y a pas de référence à un genre existant.
Sous titré words and musique. A destination d’une pièce radiophonique.
Je t’ envoie les words en question (de Beckett) :
« vieillesse est à croupetons
crachotant sur les tisons
le temps que la sorcière
finisse de bassiner
et t’apporte ton arrow-root
tu la vois venir
dans les cendres qui aimée
ne fut pas conquise
ou conquise pas aimée
ce genre d’ennui
venir dans les cendres
comme dans cette vieille lumière
le visage dans les cendres
vieille lumière sans étoile
le dehors sur la terre
à nouveau répandu »
silence…………………………………….trying to sing softly ………………. Je te renvois au texte de présentation de l’édition discographique Montaigne où il est dit que Beckett, dans une version première est très impliqué dans l’élaboration "musicale" de son texte.
D’autre part, si tu t’intéresses aussi à Feldman, tu peux lire son recueil ECRITS ET PAROLES, précédé d’une monographie , édité chez l’ L’HARMATTAN (1998)… 380 pages remarquables de finesse, d’humour et de témoignages sur l’histoire de la musique de son temps. Un livre essentiel pour comprendre la musique américaine, mais pas que…
Beckett y est cité pages 11, 91,92,99,112,115, 209,259,297,307,313,327 , donc tout au long de l’ouvrage.
…………………………………………………………………………………………….
« LA FIN DES CULOTTES COURTES »
28/30
Comme nous sommes encore en Novembre, il n’est pas trop tard pour dire ici, en forme de stèle, ces quelques évènements que je garde de l’automne 69.
Si ce n’était un épisode d’un développement qui a laissé des empreintes dans ma vie, je n’en aurais pas écrit une ligne tant ces évènements que je vais relater sont d’une grande banalité. Sauf que je les ai vécu dans toute la brillance et la vivacité mentale qui se présentait alors dans la fragilité du développement de mon âme d’alors.
Septembre de l’année mille et neuf cent soixante et neuf. Je suis au Copacabana depuis quelques mois puisque c’est le glacier de la famille de Cacérès chez lesquels on se réunit tous les matins au bas du Boulevard Gambetta. C’est Stef qui m’y mène pour la première fois vers Avril. On y prend le café. C’est là que, progressivement vont apparaître tous les acteurs de ce temps qui correspond à la fin du lycée pour certains, à l’adolescence qui va laisser place, pour d’autres, à l’adulte qui se profile. Même si la frontière entre ces deux concepts d’adolescent et d’homme est finalement plus subjective que réellement tracée avec des contours précis. C’est avec Henri, le fils de la maison, que je partirais la première fois à Paris. C’est ce genre d’événement qui fait qu’on croit avoir résolument penché vers une réelle évolution et un passage vers une indépendance nouvelle ou supposée.
La plupart de ces matins on s’assemblait autour des tables de la terrasse. Nous étions entre lycéens du Parc Impérial pour la plupart, le bac était pour bientôt, pour la fin de l’année scolaire, bien lointaine encore, on commentait Rousseau, l’idéal social, Stendhal ou la poésie américaine des années cinquante, on s’essayait à la persuasion verbale, et tout ceci, à l’exclusion, pas que nous l’ayons voulu, des filles, qui de leur côté, avaient leurs préoccupations et leur mode de sentir. Nous n’avions pas encore eu l’opportunité de les expérimenter et de les confronter avec nos propres soucis et nos espérances sur l’avenir.
La mi septembre arriva, et comme souvent, avec le rythme des saisons et des rentrées scolaires, de micro évènements se produisent, orientant autrement l’ordre des choses sans que l’on s’en aperçoive forcément. Une de ces fins de matinée vit arriver deux des plus turbulents d’entre nous, motards se défiant sur le boulevard Gambetta en pirouettes sur leurs deux roues, rivalisant d’absurdité , mais ce jour-là flanqués de deux jeunes filles qu’ils menaient vers les lieux de nos rendez-vous.
Rapidement le cercle s’élargit et l’habitude fut prise de voir Claude Sanchez et Danièle Belmonte se joindre aux habitués du Copacabana.
L’attention était maintenant évidemment déplacée sur le centre nouveau que représentaient les deux filles, les plus enhardis allant jusqu’à de très grossières tentatives de séduction, plus pour manifester leur débile assurance que pour croire réellement à la possible réalisation de leurs vœux de conquête féminine.
Ma première pensée, dès le premier jour, quand j’eus vu les deux filles entrer dans le cercle, fut le sentiment qu’on était en train de perdre cette douce quiétude et cette nonchalante habitude d’être entre nous, entre hommes pour tout dire, et que dorénavant la cible de nos échanges passait non plus par la transformation du monde, les rêves les plus chimériques, ni même par des discussion sur notre avenir à court terme, mais par ces deux vampiresses qui reflétaient, sans qu’on se l’avoue, les désirs les plus confus dans notre esprit.
J’avais, durant ce temps de l’adolescence, une timidité qui confinait au handicap. Je peux même dire que le regard croisé d’une fille, même furtivement, me faisait rougir d’une sorte de panique incontrôlable.
Et c’est donc ce que je craignais qui me rendit à chaque fois à la torture, lorsque qu’au beau milieu du cercle de la terrasse du Copacabana, mais plutôt sur le cercle presque extérieur au groupe, on s’avisait de prendre mon avis sur un sujet des plus banals. Je ne trouvais les mots, pas plus que je ne savais maîtriser un tremblement léger de tout le visage. J’en arrivais à ne pas reconnaître ma voix tant elle penchait vers une tonalité qui me semblait empruntée ou fausse.
Plusieurs fois je balbutiais une réponse à une question anodine de Claude ou de Dan. Du moins je me débarrassais de la réponse en quelques mots furtifs. Je me faisais l’effet du plus benjamin de tous ceux de ces assemblées.
Je m’étais construit un moi qui se voulait idéal aux yeux des autres, sans aspérité et orgueilleux qu’il en devenait absent. Tellement idéalisé qu’il semblait ne plus avoir de prise sur le réel.
Puis ce fut, passé la mi septembre, le rapatriement vers le Pub Latin, plus proche du Lycée. Claude et Dan étaient à Estienne d’Orves, juste au-dessus du Pub, et les garçons retrouvaient le Parc Impérial.
Les réunions n’avaient fait que se déplacer d’un bistro à l’autre. Sauf que la terrasse de Gambetta avait fait place à de plus intimes banquettes séparées les unes des autres à l’intérieur du Pub, sombre et intimidant. Atomisant parfois en plusieurs groupes ceux qui s’y rassemblaient.
Jusqu’à ce vendredi en fin de matinée, où je vis Claude s’approcher et me demander le plus simplement du monde, si je pouvais passer prendre un verre en début d’après-midi.
Je compris bien vite qu’il s’agissait de me voir vers treize heures, seul avec elle ! Evidemment je balbutiais, plus pour éviter à nouveau de sentir le rouge au visage, que par un effet net de ma volonté, que je serais là, bien entendu.
J’arrivais en avance et vis quelques minutes plus tard, une Claude méconnaissable, tant le maquillage, les hauts talons et une robe serrée la faisait franchement femme, que je pensais la voir pour la première fois.
Dans la pénombre du Pub, assis sur le faux cuir d’une banquette plus à l’abri des regards que d’autres banquettes, je me trouvais face à Claude. Qui me parlait de banalités, comme le fait d’être dans un lycée exclusivement réservé aux filles, ou de ces quelques autres de la bande qu’elle était heureuse de ne pas voir aujourd’hui !
Déjà comme un aveu et une intimité à partager.
Je n’avais bien sûr rien à redire sur de telles évidences. Et je n’avais d’ailleurs rien à dire du tout, que cela établit assez vite une gêne dans ce contexte de la banquette isolée, d’une Claude plus féminisée que jamais, et de ma toujours trop pudique réserve qui en ces circonstances ne pouvait durer longtemps sans faire retomber une féerie que celle qui me faisait face avait sue si bien tisser à ma grande perplexité. Je crus même, à certains signes d’impatience, que Claude regrettait presque cet élan et cette initiative de m’avoir élu en quelque sorte pour ce quelque chose dont je me doutais, mais que je pensais encore irréalisable tant cela me paraissait relever d’un Himalaya de la séduction.
Elle proposa enfin de faire un tour vers le jardin Alsace-Lorraine, prétextant avoir trop chaud à l’intérieur du Pub.
Je la suivais plus que je ne l’accompagnais, du moins c’est le sentiment que je ressentais bien qu’elle m’eut pris par le bras en allant jusqu’à ce petit banc isolé près du jardin.
Nous n’étions plus face à face mais côte à côte, ce qui n’enlevait rien à la pesanteur qui entourait le silence jusqu’au moment où, comme en un geste qu’on réalise sans en avoir eu une totale conscience, je me penchais vers elle et l’embrassait. Non sans avoir entendu, au moment où mes lèvres effleuraient déjà les siennes, quelque chose comme un « Ah ! Enfin ! » de délivrance.
Nous sommes remontés marchant sur un nuage, moi du moins, depuis la longue avenue Châteauneuf vers le bistro « Chez Jeannot » face au pub, sachant que les motards et autres prétendants éconduits le mois précédent nous regarderaient avec ce mélange teinté d’étonnement et d’incrédulité envieuse où nous pûmes enfin nous vautrer sur le moelleux de la banquette dans le triomphe accompli de ma première hardiesse en la matière.
…
Ce n’est qu’au retour de Paris, donc quelques semaines après le début de ces petits jeux de séduction que Claude prit aussi simplement la décision d’y mettre terme comme elle avait eu celle de leur donner naissance.
C’est juste après, qu’une expérience plus approfondie vit le jour avec la rivale de toujours, Dan, qui prétextant s’intéresser à mes goûts en musique, entreprit de prendre la succession de ce qu’avait entamé Claude. C’est ainsi que, rougissant, inexpérimenté et maladroit, j’avais eu les faveurs que n’eurent pas les plus hardis prétendants du Copacabana, des deux premières femmes qui entrèrent dans mon existence, bien que Jo eut gardé de toute éternité, au même moment, la plus inaccessible place au panthéon des amours impossibles.
…
Bien des années plus tard, je revis Claude devenue plasticienne et je créais pour elle l’atelier d’art plastique au Musée d’Art Naïf. Je pris son fils Charlie avec moi, pour des vacances en Corse dans la maison de famille de Henri Aubert. Puis Claude disparut à nouveau.
…
J’ai revu Dan aussi dans le début des années 2000. Elle me fit l’honneur de m’inviter à Rabastens dans la maison familiale. Nous sommes allés à Cordes-sur-Ciel, à Albi, pour parler de ces quelques courts mois de Juin et Juillet où elle passait ses après-midi avec moi, rue des Potiers. Il a suffi, en 2008, d’un malentendu ou une querelle sans importance pour qu’elle ne donne plus signe de vie. J’ai de rares nouvelles par Bernard. La dernière fois qu’elle a essayé de me joindre, il n’y a pas si longtemps, elle est tombée sur Cécilia et lui aurait fait la morale à mon sujet. Je n’ai pas eu la force (l’envie ?) de rappeler.
Je n’ai pas retrouvé non plus la pierre sur laquelle j’avais gravé nos noms en lisière d’Ezao, hameau minuscule au cœur de la Corse où l’ami Jean-Marie Villa avait une maison. La mousse avait sûrement recouvert ces vieilles passions dans l’ombre humide de ce petit coin de forêt.
…………………………………………………………………………………………….29 Novembre
Cinq heures du matin.
Ma petite fille est née. C’est la photo d’une magnifique L que m’envoie Hélène vers huit heures du matin.
…………………………………………………………………………………………….
1 Décembre
J’ai fait connaissance hier de la petite L. J’oublie toujours à quel point c’est petit à la naissance, fragile et tremblant, baillant et contorsionné par je ne sais quelle douleur au ventre. Elle a ouvert plusieurs fois les yeux comme un point d’interrogation devant le monde qui venait à elle.
Elle a comme seconds prénoms, Helena, Cécilia et Nina, le diminutif de maman. Les seconds prénoms n’ont d’importance que parce qu’ils symbolisent ceux qui sont venus avant. Les fantômes à ne pas oublier de suite.
…
Le déluge continue, les volets restent clos. J’ouvre, le soir venu et durant quelques instants, la porte donnant sur la terrasse du nord, béante sur la fraîcheur et le bruit des quantités de pluie lourdes rendant une beauté sauvage et inquiétante l’environnement sonore qui se déverse depuis la maison jusqu’à Saint Paul et plus encore vers le Baou.
Un dimanche qui allait bien avec le Gaspard de la Nuit.
Ondine et le Gibet…
…
Pessoa, malgré un désabusement assumé, avait peur des orages, comme les enfants, comme Hélène toute petite avait compris que la foudre était le résidu transposé de terreur, dans les connexions de la mort, de la vie et de la nature hors de ses gonds. Le chien Bello, malgré sa taille prodigieuse, gémissait en silence et couchait sous la table, le nez contre terre, dans la campagne de Merzenstein, en Basse-Autriche, où les orages pouvaient être effrayant.
…………………………………………………………………………………………….
4 Décembre
J’ai revu Le Mépris de Godard. Je souffre toujours dans ces cas-là. L’image est volontairement sabotée et le son sonne faux, les plans hideux. L’intrigue est d’une minceur à faire peur et la plupart des interprètes à contre emploi. Les acteurs récitant tous à la manière dont Jean-Pierre Léaud a entrepris de faire réciter le moindre film intellectuel comme on débite en tranche les pages du Bottin. Que faisait donc Fritz Lang dans ce naufrage ? Encore une fois, il y a quelqu’un dans une baignoire avec l’inévitable chapeau. Ce n’est plus un chapitre sur Velazquez de Elie Faure qu’on lit, mais un extrait d’une monographie sur Fritz Lang. Ce film est mythique au point que ses thuriféraires ont du l’encenser à sa sortie pour une raison qu’on imagine bien, toute extérieure à la platitude de l’œuvre. Je pose encore la question, que faisait, la même année, Kurosawa ?
…………………………………………………………………………………………….
5 Décembre
Projet pour la réforme générale des retraites. Puits sans fond. Contradictions.
C’est la grève générale dans le pays. La paralysie des transports, des administrations. La plupart des commerces exposés aux violences vont fermer. Certains ont protégé les façades et les vitrines. Le phénomène concerne surtout Paris. Cécilia est partie tôt à son bureau, à l’extrême Nord-Est de la ville. Le temps gris est tout à fait dans le ton de la journée qui se profile. On en parle depuis plusieurs semaines qu’on croirait à une fin de monde. Le mouvement a été prévu pour cette journée. Comme nous sommes jeudi, la paralysie durera probablement jusqu’à la semaine prochaine. Avec les gilets jaunes d’une part, et les caillassages habituels des extrêmes gauche des samedis.
« Un TGV sur six circuleront », dit un porte parole de la SNCF. Un seul donc. Pourquoi ce pluriel zélé ?
Mozart est mort également un 5 décembre.
…
« A la Bastille », « A Batignolles », « A la Roquette », disait Bruant.
Aujourd’hui, ce sera « A l’Elysée ».
…………………………………………………………………………………………….
Chateaubriand, dans les développements du chapitre sur Jérusalem, page 388 des éditions Folio :
« Les peuples de l’Orient…accoutumés à suivre les destinées d’un maître, ils ont vu passer tous les hommes qui ont changé la face de la terre : Sésostris, Cyrus, Alexandre, Mahomet et le dernier conquérant de l’Europe, ils n’ont point de lois qui les attache à des idées d’ordre et de modération politique : tuer, quand on est le plus fort leur semble un droit légitime : ils s’y soumettent ou l’exercent avec la même indifférence. Ils appartiennent essentiellement à l’épée. Ils aiment tous les prodiges qu’elle opère : le glaive est pour eux la baguette d’un Génie qui élève et détruit les Empires. La Liberté ils l’ignorent. La force est leur Dieu.
Quand ils sont longtemps sans voir paraître ces conquérants exécuteurs des hautes justices du ciel, ils ont l’air de soldats sans chef, de citoyens sans législateur, et d’une famille sans père. »
Qu’ajouter à cela ?
L’on pourrait reprendre ces quelques lignes, sans rien omettre encore aujourd’hui, pour comprendre les fossés qui nous séparent de ces peuples qui se rapprochent et qui feignent, pour les plus attachés à leur culture, d’adopter nos modes de vie.
………………………………………………………………………………………….
8 Décembre
Courrier à Bernard :
Je viens de recevoir un bien joli cadeau de la part de cette artiste que j’avais découverte à Aix au printemps, et qui vit dans les hauteurs de l’Ubaye.
Il s’agit d’une gravure inspirée par les "Jardins sous la pluie " de Debussy vers lesquels je l’avais orientée.
Je t’en envoie une photo par whatshap. ça te donnera une idée de cette délicatesse qui anime son travail.
Je ne l’ai en fait jamais rencontrée malgré une invitation à me rendre voir son atelier. Peut-être à l’occasion d’un passage sur les routes des Hautes ou Basses Alpes.
……………………………………………………………………………………………
10 Décembre
Encore la grève. Elargie. Les écoles s’y mettent aussi. La Poste ne passera pas pour un colis prévu aujourd’hui. Mais le beau temps est revenu.
…
Mélenchon estime que les violences ne peuvent être que policières.
…
J’ai revu « Le Voyou » hier soir. Peut-être le meilleur Lelouch. Du moins parmi ceux que j’ai vu.
Charles Denner y est plus grand encore avec la patine du temps.
……………………………………………………………………………………………
11 décembre 19
A Bernard :
Rue Gubernatis est vraiment une rue extraordinaire. On connaissait sa cave Wilson (qui a gardé sa devanture à l’ancienne, et un intérieur avec le comptoir pour accro de la petite piquette et sa somptueuse réserve de grands crus de toutes les régions viticoles).
Il y a un herboriste réputé (la cave et les herbes peuvent se compléter) mais je resterai client de la petite boutique de la place de la Tour. Puis, ce que j’ignorais, il y a un immense magasin pour artistes. Des couleurs par millions, qu’on dirait une cour de récréation si ce n’était si bien rangé, du matériel pro et amateur pour peinture, dessins, fusains, acrylique , toiles etc. Et j’ai pu trouver mon cadre pour la gravure.
Ne pas oublier que dans la même rue il y a "La Part des Anges" qui est une autre cave où je me souviens avoir mangé un plat du jour avec le vendeur de disques de la rue d’à côté. (il n’ y a que trois ou quatre tables de jardin qui reçoivent au beau milieu de la cave. C’est un peu comme à la maison, ou comme à la cuisine, avec seulement un plat ou deux proposés. Par contre pour les vins, on pourrait s’y perdre si le patron ne vous conseillait).
…………………………………………………………………………………………….
L’hiver s’est bien installé, beau et froid et convient tout à fait aux quatuors à cordes de Lachenmann et ceux de Kurtag. Quand la nuit descend.
…………………………………………………………………………………………….
DES GOUTS/DES COULEURS
Je suis très attentif aux jugements que je porte sur ceux qui n’ont pas toujours mis les pieds dans les mêmes traces que moi.
Depuis que j’ai eu l’indélicatesse de reprocher à maman d’aimer Andrea Boccelli, j’ai mesuré l’étendue des différences qui sont, bien que souvent invisibles, celles que nous portons par l’éducation, le développement culturel ou simplement le milieu ambiant et les mystérieuses cristallisations qui se fixent dans ce qu’on nomme les goûts et les couleurs.
Lorsque nous avons une vision plus large, plus développée que d’autres, comment comprendre ceux qui n’ont pas fait le même parcours que nous ? Les juger, leur demander de nous suivre sur les traces de notre vision des choses ? Les aimer depuis là où leur chemin les a mené ? Entre ces deux interrogations, il reste la possibilité de se rejoindre, soit en comprenant la place que peut prendre l’objet de nos différences d’appréciation par celui ou celle qui n’a pas le souci de partager nos attachements, soit que la personne qui n’a pas encore eu connaissance d’un territoire plus subtil et plus élevé y parvienne par un effet de la sensibilité qui ne demandait qu’à s’épanouir.
Des procès en élitisme sont souvent fréquents. La même personne qui pensera que mon jugement ne considère que la pointe extrême de critères esthétiques considérée comme sommet d’une certaine intellectualité, verra son propre jugement faire de même à l’égard d’autrui situé à l’échelle inférieure ou jugée comme telle. Il ne peut en être autrement à moins de déconsidérer les jugements verticaux et n’admettre que l’horizontalité des goûts en matière de jugements esthétiques. Johnny Hallyday serait ici aimé à l’égal de Ligeti ou de Messiaen. Est-ce possible ? Le dessin d’un enfant serait jugé par ses parents à l’égal des plus beaux Rembrandt. Et puis, ne dit-on pas que les goûts et les couleurs ne se discutent pas.
Des murs peuvent séparer cette absence de rencontre.
Mais croit-on que la poésie de Mallarmé, si tant est qu’on la situe haut dans l’échelle de la poésie, est accessible à celui qui n’a jamais lu ou entendu que des vers de quelque versificateur ?
Léonard disait qu’on commence à aimer à proportion de ce qu’on connaît. C’est paradoxal, parce que c’est, à la fois vrai, et que d’autre part on peut subir, sans analyse préalable aucune, un choc immédiat devant une œuvre d’art.
La cause en est que, dans ce cas précis d’une foudre qui s’abattrait, la structure de notre jugement est alors masquée mais conditionnée par l’engrangement de connexions subtiles, de connaissances et d’expériences culturelles qui sont déjà allées vers quelque cime de notre développement sensoriel et intellectuel, réactive au moment de la révélation de cette œuvre nouvelle.
Et qu’en définitive, la pointe du savoir qui déterminera la sensibilité, se hissera plus loin que celle qui aura été moins affûtée.
Le hasard n’existe pas dans ce qui est le miroir des goûts et des couleurs. Ceux-ci sont toujours le fruit d’une quelconque éducation ou discipline dans le domaine des jugement qui seront portés.
…
Je remarque que l’on est plus féroce en procès d’élitisme qu’on est indulgent en matière de nivellement. Avec la mise à disposition mondiale des objets d’art, des styles, même les plus éloignés de ceux que nous avons sus produire dans notre histoire occidentale, les normes ont, pour beaucoup, vacillé. Comment pourrait-on juger, à quelle aune pourrait-on évaluer une statue Mochica de l’ancien Pérou et le torse d’une statue grecque de l’époque classique, à moins de laisser l’estimation de leur valeur réciproque dans le champ relatif de la culture qui les a vus se développer ?
…
La confusion la plus grande règne lorsque l’horizontalité est admise comme seule critère de goût. On voit alors, d’une part, des murs infranchissables qui se dressent entre les amateurs de jazz, ceux attachés à l’histoire et au développements des musiques savantes, ceux qui n’entendent que les éphémères productions des vagues de la variété ou du rock, et de l’autre, pour les plus souples, un égal bonheur de réunir dans une vision syncrétique, l’ensemble de ces genres.
…
Et qu’y a-t-il de commun dans l’évaluation frontale d’une chanson de Trenet et une sonate pour clavier de Beethoven ?
La perfection de chacune dans son genre, mais aucun pont d’où faire se rejoindre l’une et l’autre. Hormis la souplesse de certains qui jugent l’une aussi recevable que l’autre, et seulement dans la sphère de leur sensibilité subjective. Ou suivant les moments de la journée. Ou surtout, suivant l’évolution de leur jugement sur un temps long de leur sensibilité.
…
En dernier lieu, c’est toujours la subjectivité qui fera qu’on a adhéré à tel ou tel type d’expression dans l’abondant foisonnement des genres existant.
D’objectivité, il ne peut y avoir. Personne ne mesurera un mesurable qui n’existe pas entre la mystérieuse statue Mochica et le torse d’un dieu de l’amour de l’âge classique grec.
On peut seulement avoir un penchant pour. Ou les réunir dans la même admiration.
Encore faut-il admettre que l’une et l’autre de ces expressions de civilisation soient à un degré de perfection équivalente.
…
Le marché du vin donne une bonne idée en matière de jugement qualitatif, et par là-même, d’un élitisme certain.
…
Lorsque je m’étais moqué un peu facilement de maman appréciant sincèrement Boccelli, je n’avais rien fait d’autre que substituer ma connaissance plus complète du domaine du lyrique que je n’avais compris qu’une échelle de valeur ne peut être un critère d’appréciation pour celui qui n’en a pas les clés.
…………………………………………………………………………………………….
Nuit du 13 au 14 Décembre
DE LA NUIT
Maintenant c’est le vent, en tempête. Je me suis réveillé haletant vers les trois heures. La maison s’était mise à gémir, des souffles fantomatiques passaient par les pores invisibles des fenêtres et des chuchotements en anamorphoses se faisaient entendre à mesure que je sentais bien que les arbres tout près ployaient sous les rafales violentes du vent. Si j’avais ouvert les volets j’aurais bien imaginé les étoiles vacillant dans l’encre du ciel. La nuit, la sensibilité est tendue, à l’écoute de voix qu’on est disposé à croire venue d’ailleurs, le moindre tressaillement rendant plausible la présence d’un disparu qui murmure une douleur ineffable. Ces éclats de nuit me sont devenus aussi pénible avec l’âge avançant que dans l’enfance ils étaient sources d’une terreur inexplicable.
Les ombres même frémissent dans le peu de relief que la faible luminosité rend méconnaissable, comme le dossier du bureau, que je perçois dans l’embrasure de la chambre qui fait face à la mienne, semble porter l’ombre d’un vivant assis depuis toujours à la table de travail, comme d’autres ombres sont, dans d’autres circonstances, éternellement figées dans le décor d’un champ de bataille.
Comme il ne fait jamais vraiment une obscurité totale dans une maison, ce qui équivaudrait à se draper d’une obscurité de tombeau ou d’une néantisation momentanée en ces morceaux de nuit, les ombres dansent au gré des quelques lueurs filtrées par les fenêtres, exécutant autant de simulacres d’âmes en contorsion et de rondes tourmentant l’esprit encore dans la demie conscience frémissante d’une fragilité à fleur de sommeil.
Souvent c’est l’ombre de mon père statufiée que j’imagine venue dans sa timide maigreur, assis droit sur le bord du fauteuil, dans le costume de ses funérailles, attendant de me dire un secret, n’osant encore révéler ce que j’imagine la démarche d’un messager dont je devine la teneur de la révélation, une ombre donc qu’on nomme habituellement un revenant, d’autant qu’il porte, en ces circonstances, la légitimité du dernier passeur des générations qui m’auraient précédé et cette terrible nuit qui dirait en substance, dans de muettes paroles, tu viendras bientôt, je n’ai fait que te précéder ».
…
le sommeil parvient, après les vagues de l’angoisse, à trouver le repos des dernières phases de la nuit, comme lorsque l’on dit que si on a passé une certaine heure, on ne franchira pas cette fois le passage tant redouté.
…………………………………………………………………………………………….
16 Décembre
Chateaubriand m’a mené aux portes de Jérusalem et j’ai voyagé sans plus bouger qu’il n’en fallait pour imaginer la ville au Saint Sépulcre et aux sept portes ouvertes sur le désert. J’en suis ressorti hier, après que les vers du Tasse ait parcouru une fois encore les batailles menant à la Jérusalem Délivrée, aux épopées de Godefroy de Bouillon apparu aux frontières de la Palestine en 1099, entouré de Baudouin, d’Eustache, de Tancrède, de Raimond de Toulouse, des comtes de Flandres et de Normandie, de Guicher, célèbre déjà pour avoir coupé un lion par la moitié… c’était le temps où de simples chevaliers sautaient de la brèche sur le trône : le casque apprend à porter le diadème.
Godefroy refusa de mettre sur sa tête la couronne brillante qu’on lui offrait « ne voulant point, dit-il, porter une couronne d’or où Jésus-Christ avait porté une couronne d’épine ».
Dans le poème épique du Tasse, le seul personnage fictif est Renaud. Il n’y eut point de guerrier appelé Renaud au siège de Jérusalem. Le premier chrétien qui s’élança sur les murs fut non pas Renaud mais Létolde, chevalier de la suite de Godefroy, suivi de Guicher et de Godefroy lui même.
On pourra toujours rêver à l’Armide de Lully et à ses amours avec Renaud, et à tant de légendes où Renaud se serait illustré, il n’en reste pas moins que tous les historiens des Croisades « parlent de la piété de Godefroy, de la générosité de Tancrède, de la justice et de la prudence du comte de Saint-Gilles… Le poète nous a donc peint les héros tels que nous les connaissons ».
C’est en Egypte que se poursuit le récit.
……………………………………………………………………………………………
Dans Penser l’Islam, si j’ai bien lu Onfray, il s’agit, au fil de l’entretien avec Asma Kouar, de l’homme occidental (Onfray lui-meme) qui se doit de se justifier, confronté (car c’est à lui de démontrer, un peu comme dans les procès où il s’agit de démontrer son innocence, son absence d’islamophobie), à la double lecture du Coran.
Celle de la Mecque ou celle de Médine. La double face d’un Coran inséparable de la main de fer théocratique et celle de l’unique (!) sourate qui dirait : « Pas de contrainte en matière de religion (II.256) ». L’une ou l’autre interprétation serait justifiable par le fidèle en fonction de ce qu’il a envie de faire dire aux sourates, lesquelles peuvent se contredire à la suite les unes des autres.
Quiconque voudra la paix a priori aura des sourates pour lui donner raison ; quiconque voudra la guerre a priori disposera aussi d’autres sourates qui lui donneront raison.
…
Passage de témoin :
Quand une civilisation s’effondre alors qu’une autre semble en pleine ascension planétaire, il se crée une relation du faible au fort devenu faible, et il ne s’est jamais vu qu’un ancien fort devenu faible, l’Occident en l’occurrence, soit considéré avec générosité, clémence magnanimité, par l’ancien faible devenu fort.
…
La gauche et l’Islam :
Quel Islam ? Celui des sourates de guerre (Calife de l’état islamique, Khomeiny) ou celui des sourates pacifiques (Omar Khayam, René Guénon), mais aussi quelle gauche ?
La Gironde est de droite quand la plupart de ses membres veulent épargner la mort du roi, mais les Jacobins qui sont de gauche veulent le décapiter.
En 1981, une fois les socialistes parvenus au pouvoir, c’est la droite qui défend la guillotine.
Hier la gauche condamnait le pouvoir de l’argent et le combattait au nom de l’humanisme. Elle luttait contre le Capital qui exploitait les enfants dans les mines et voulait les sortir des galeries du charbon pour les éduquer dans les écoles.
Aujourd’hui, ce qui se présente comme la gauche défend l’idée que les pauvresses rendues misérables par le capitalisme puissent louer leur utérus à des riches désireux d’implanter leur fœtus dans des ventres de location. Donc où est la droite, la gauche, où est l’islam ?
…
L’opium du peuple ?
Pourquoi donc, à l’instar d’Alain Badiou et quelques autres intellectuels qui lorgnent du côté du PCF, du Front de Gauche ou du NPA(ex Gauche révolutionnaire), plus effrayés par l’islamophobie française que par l’islam terroriste, qui lui fait des morts, se trouve-t-il des marxistes pour défendre l’islam, y compris dans ses formules les plus sanglantes ?
Pour ceux-là, la religion n’est pas l’opium du peuple, mais la force d’un peuple, même embrumée par les vapeurs d’opium, qu’il s’agit d’utiliser comme un levier pour mettre à bas le capitalisme.
…
André Tosel, avant de mourir, ne disait pas autre chose.
…
Marx et la question juive :
L’essence du judaïsme et la racine de l’âme juive sont l’opportunité et l’intérêt personnel. Le Dieu d’Israël est Mammon qui se manifeste dans la soif de l’argent… On trouve chez Proudhon, Fourier, les mêmes assimilations entre les juifs, les capitalistes, les bourgeois et l’argent.
L’antisémitisme change de forme après Auschwitz. L’antisionisme en devient la principale composante.
Certes la création d’Israël n’est pas allée sans d’incontestable expropriations infligées au peuple palestinien, mais ce peuple payait hélas la politique de collaboration avec Hitler mené par le grand Mufti de Jérusalem.
…
Le contexte devient différent avec la décolonisation :
… des peuples qui souhaitent se libérer du joug colonial découvrent la capacité de l’Islam à fédérer contre l’Occident avec une idéologie, une spiritualité et une politique de substitution.
… Sartre soutient Septembre Noir, auteur du massacre des athlètes israëliens à Munich, la Bande à Baader…
Jean Genet, amant d’un SS pendant l’Occupation, fait l’éloge de la « poésie » du massacre d’Oradour-sur-Glane et magnifie le « banditisme le plus fou » de Hitler… ce qui ne gêne ni Sartre ni Derrida, ni Foucault.
…Jean Luc Mélenchon apportait son soutien au pouvoir en Iran alors que celui-ci menaçait de rayer Israël de la carte ou l’affection qu’il portait à Hugo Chavez pour qui « une minorité, les descendants de ceux qui ont crucifié le Christ…s’est emparé des richesses du monde ».
L’opposition de ces deux dictateurs aux Etats-Unis ne saurait justifier qu’on se contente de l’idée que les ennemis antisémites de gauche de nos ennemis capitalistes de droite soient nos amis.
…
On a vu qu’au nom de la haine anticapitalisme, de l’argent et des juifs associés de manières fautive, une certaine gauche marxiste, pouvait soutenir un islam politique au nom d’un antisionisme présenté comme l’idéologie de la lutte (révolutionnaire) contre l’impérialisme américain (sioniste).
…
Souscrire à l’islam qui est une politique et pas seulement une éthique ou une spiritualité, c’est souscrire à la théocratie puisque la parole de Dieu dit le vrai en tout… donc en matière de droit et de loi.
Bien.
…
Ce qu’Onfray n’a pas dit (parce qu’il ne pense, dans son opuscule, qu’à cet islam de l’état islamique que nous sommes évidemment amenés à combattre, bien que le premier agresseur fut l’Occident dès 1991 –les Bush et Mitterrand- et non à cet islam universel qui a aujourd’hui ses assises au cœur même de notre sol) :
Si il est vrai que nous sommes dans une passation de pouvoir au cœur d’un Occident qui se meurt dans ses valeurs, dans sa spiritualité dont l’appendice ultime est aujourd’hui le consumérisme absolu ( la messe du dimanche matin dans les grandes surfaces), et le vide non moins absolu de projets fédérateurs purement occidentaux, l’islam démographique au cœur de nos cités, de nos banlieues, se voit grandir à la vitesse exponentielle.
Il n’aura pas même à porter les armes contre le moribond, puisqu’il lui suffira de grandir. De grandir en toute légitimité, puisque cet islam est un islam porté par ces français de demain, de plus en plus nombreux.
La menace vient moins d’un état islamique dont la violence semble faire l’unanimité contre lui (à part pour cette gauche dont parle Onfray), et qui sera éradiqué, que contre ce temps à venir.
Ce n’est pas une fiction.
Nos erreurs viendraient plutôt d’avoir voulu régenter des équilibres fragiles au Moyen Orient, en Afghanistan, en Syrie (petits pays faciles à agresser) où nos intérêts n’étaient pas directement menacés, alors que nous sommes impuissants face à d’autres, bien plus virulents comme les états d’Arabie Saoudite ou les qataris du Golfe qui prennent assises chez nous.
Ce qui donne bien le visage contemporain d’une France qui n’a plus de réel pouvoir ni d’anticorps. Et cela remonterait déjà à la fin de la guerre d’Algérie.
Faute d’avoir eu une volonté protectionniste en matière d’immigration et de droits accordés qui accompagnèrent son implantation.
En train d’agoniser par déliquescence.
…
Combien d’Edwy Pleynel, combien d’intellectuels, déjà prêts à voler au secours d’une vitalité musulmane qui frappe aux portes ?
…
Le risque ?
Il suffira, d’ici une courte génération, que la croissance des fidèles à l’islam bascule en une population majoritaire dans cette même France, (2050 ? 2040 ?), (peut-être tout simplement par la voie des urnes au travers d’un parti musulman officialisé) pour qu’il n’y ait plus qu’à ramasser, peut-être même sans violence, ces ruines d’un espace politique qu’on croit encore notre (la laïcité, ligne Maginot contemporaine !), et qui demain régentera un pays nouveau dont nos enfants n’auront de place qu’aux conditions que l’islam théocratique leur assignera.
…
Michel Onfray analyse parfaitement l’état des lieux de la France d’aujourd’hui, sans en tirer réellement les bonnes conclusions. Entre utopie et résignation :
Le christianisme s’est effondré. Il est devenu minoritaire. De la loi 1905 au mariage homosexuel en 2013, en passant par la législation de l’avortement et l’abolition de la peine de mort, la France s’est déchristianisée. La démographie aidant, la spiritualité active, en France, est devenue moins judéo-chrétienne que musulmane.
En France, il existe une position de principe qui ignore le réel et une position pragmatique qui ignore les principes.
La seconde position est iréniste, islamolâtre, elle essentialise l’islam pour en faire la religion des opprimés du Capital. Une certaine gauche souscrit donc au compagnonage avec cet islam idéalisé, déshistoricisé, idéologisé parce qu’il offre une formidable perspective révolutionnaire.
…Or je ne souscrit à aucune de ces deux religions là : laïcisme et islamolâtrie…il existe dans l’islam d’aujourd’hui une fraction active qui veut en finir avec le capitalisme mais aussi avec les valeurs de la république: liberté, égalité, fraternité, laïcité et féminisme.
La soumission n’est pas loin :
Proposer un contrat social avec l’islam en France pour qu’il y ait un islam de France.
… Le réel est celui-ci : l’islam en France est financé par des pays qui n’ont aucune raison d’aimer la France. Il s’agit de solliciter la communauté musulmane pour lui rendre désirable la République et pour que la République compose avec un islam qui, lui aussi, se serait rendu désirable.
J’en conclue que la République en question n’est plus maîtresse du jeu, mais dépendante d’un islam pour lequel cette République devrait encore proposer et présenter, (je suppose, avec des contorsions tout en racolage), une séduction qu’elle a eu tant de peine à imposer jusqu’à maintenant.
Ce qui n’a pas été possible hier, le sera-t-il demain ? Les nouveaux conquérants et maîtres du jeu ont-ils d’ailleurs encore besoin de cette République ?
………………………………………………………………………………………………
19 Décembre
La raison me fait peur autant que l’imagination comme moteur absolu et unique de la pensée.
Sur quelle assise la raison, au-delà de l’empirisme qui nous fait débiteurs des enchaînements des causes à effet, nous dicte-t-elle une vérité ?
………………………………………………………………………………………………
21 Décembre
L’hiver est là. Le jour le plus court de l’année. Accompagné des plus furieuses calamités de pluies depuis deux jours.
…
Chateaubriand me mène aux pied des pyramides. « …le mélange des sables du désert et de la plus fraîche verdure : les palmiers, les sycomores, les dômes, les mosquées et les minarets du Caire ; les pyramides lointaines de Sacarah d’où le fleuve semblait sortir comme de ses immenses réservoirs : tout cela formait un tableau qui n’a point d’égal sur la terre.
Mais quelque effort que fassent les hommes, dit Bossuet, leur néant paraît partout : ces pyramides étaient des tombeaux !
… Je sais que la philosophie peut gémir ou sourire en songeant que le plus grand monument sorti de la main des hommes est un tombeau… mais pourquoi ne voir dans la pyramide de Chéops, qu’un amas de pierre et un squelette ? Ce n’est point par le sentiment de son néant que l’homme a élevé un tel sépulcre, c’est par l’instinct de son immortalité. (P.466/467)
………………………………………………………………………………………………
24 Décembre
Comme nous sommes en fin d’année, il est encore temps de remonter, pour les saluer, les quelques jalons qui se rapportent au cinquantenaire qui nous a précédé, puisque ce sont par ces longues périodes de temps qu’on peut aujourd’hui mesurer l’étirement de celui-ci dans le déroulement du souvenir, de ces souvenirs qui sont autant de sédiments qui prennent vraiment place dans la hiérarchie des valeurs mémorielles.
Mon grand-père maternel, dans l’ordre de ceux qui nous ont quitté , au plus loin qu’on remonte dans le temps, fut le premier. Le premier de ceux qui me furent proches, ceux du côté maternel, de la Nonina.
Mon grand-père paternel, le grand père Deydier, comme on l’appelait, ou simplement Paul Deydier, était mort au début des années soixante, mais je n’en ai gardé qu’un souvenir vague, celui d’un cercueil de bois clair qu’on sortait d’une maison d’Aïn el Aouda, à moins que ce ne fut le cercueil de ma tante Pauline, entouré d’une foule compact de personnes vêtues de sombre. C’est surtout cette caractéristique qui dans ma mémoire d’enfant est attaché au phénomène de la mort et de l’enterrement. C’était une journée où j’appris qu’on n’écoutait pas de musique, que c’était un jour de deuil et que, par respect pour le disparu, on gardait une certaine dignité. Du moins c’est ainsi que je comprenais les paroles qu’on m’adressait et dont je n’étais pas trop sûr du sens. Je m’abstins donc, ce jour là, d’écouter ces quelques quarante cinq tours d’Elvis Presley dont l’oncle André me permettait de profiter.
La mort du Nono est bien plus présente dans mon souvenir, puisqu’elle remonte à 1969, à ce fameux mois de Juin où l’histoire de mes dix sept ans dessinait les contours de ma vie future au travers des êtres qui n’ont fait ensuite que hanter le reste du chemin qui fut le mien jusqu’à ce jour.
Pour donner un ordre de grandeur à ce temps lointain, je dirai que le Nono est né en 1886, année où est mort Franz Liszt, et disparu après les évènements dont il n’a jamais soupçonné les conséquences de l’après soixante huit.
En comparaison, je suis né lorsque Arthur Honegger est mort ( c’est le plus proche quant aux dates qui me viennent à l’esprit), et j’ai, depuis, vu partir toute la génération de ceux qui faisaient la Musique Contemporaine dans l’après-guerre de ce XX° siècle. Le temps continue bien évidemment et la comparaison avec mon grand-père est effectivement encore incomplète.
Ce matin de l’enterrement du 13 Juin nous étions sur la colline du cimetière de l’Est, dans toute l’inhumanité de ces immenses collines qui servent à conserver un certain temps les morts. A les conserver, non pas dans des cercueils plongés sous la pierre tombale ou des caveaux de famille mais dans des casiers dont il faut conjointement retenir le nom et les numéros du carré et de l’allée correspondant au casier, au risque de se perdre.
Ce qui fut bien souvent ce qui se produisit avec l’emplacement où demeurait mon père, donc avant de monter sur la colline on prenait bien soin de prendre les numéros du carré et de l’allée en question. Mon père disparu complètement vingt ou trente ans plus tard, lorsque nous n’avons plus renouvelé la concession décennale et avions cessé de faire le chemin vers la colline, le jour des Morts.
C’est ensuite au tour de la fosse commune, de l’incinération. Donc les morts nous quittent parfois plusieurs fois.
Pour l’enterrement du Nono, la matinée avait été très ensoleillée et dans le flou des images j’ai devant les yeux les larmes inconsolables de l’oncle Joseph perdu dans son costume bleu marine et la cravate qui l’étranglait. De ma Nonina je n’ai aucune image dont je me souvienne.
J’avais en tête une méchante rengaine qui devint vite insupportable, peut-être par ce vieux réflexe qui veut qu’on ne trouble pas le respect au défunt par de la musique frivole le jour de son départ.
Mais cette journée fut autant marquée par cet après-midi où nous avons filé, Josiane Roche et quelques uns de ses soupirants, sur nos petits deux roues vers les rivages de la plage de Passable où nous prîmes l’habitude de fixer à tout jamais le paysage neuf de notre toute jeune insouciance.
…
La trilogie de ces années 69/71 vient de prendre aussi un cinquantenaire de mémoire. Ce qui commence à prendre une telle ampleur patinée qu’au moment où on les vécut on était loin de soupçonner.
…
Dans les chiffres ronds qui sont pour moi comme une nécessité dans l’ordonnancement d’une mémoire bien composée, il y a la journée déjà mille fois décrite du 16 juillet 64, qui correspond à l’arrivée à Nice , il y a cinquante cinq ans.
2019 étant un carrefour de saisie du temps passé qui ne reviendra plus que pour un centenaire où bon nombre d’entre nous auront disparu depuis bien longtemps.
…
Quarante années ont passé aussi depuis la réussite au concours de médiateurs culturel et musical qui tracera le sillon de ce qu’on nomme le parcours professionnel.
…
Et puis trente cinq années ont été enregistrées ce 22 décembre qui vit le jour de notre mariage, Cécilia et moi.
………………………………………………………………………………………………
En cette veille de Noël il est difficile de trouver du pain, tant les boulangeries sont prises d’assaut. Ce qui n’empêche pas Noël de devenir bien autre chose qu’une fête de la Nativité, que j’ai constaté en quittant l’endroit où on m’avait servi trois gros pains, que la vendeuse ne me dit évidemment pas « Bon Noël » ni même « Bonnes fêtes » comme on dit fréquemment aujourd’hui, mais « Bon dimanche » en ce plein milieu de la semaine…
………………………………………………………………………………………………
15 heures
…
Chateaubriand s’attarde maintenant à la situation géographique de Tunis, à son lac et à la Goulette qui relie le lac à la mer par un long canal et le petit port que chérissent encore ceux qui ont vécu dans ce coin tant aimé durant la présence française.
Puis surtout, dans des pages sublimes, il résume, comme par la force d’une vision de foudre, la grandeur de Régulus lors de la première Guerre Punique, ses exploits guerriers, son attachement à sa campagne romaine pour laquelle il demande à se faire démettre de ses fonctions de proconsul à Carthage.
Suivent le temps de ses malheurs et de sa captivité, de son retour au Sénat romain, sous condition, où il plaide pour une continuation de la guerre pour le bien de Rome, ce qui pour lui est l’acceptation de revenir en prisonnier auprès de ses bourreaux auxquels il avait promis de reprendre ses chaînes à Carthage si la paix n’aboutissait pas.
…
« L’itinéraire » qui en est presque à son épilogue m’a fait pénétrer dans l’œuvre de manière crescendo, comme si une force continue avait dicté un enthousiasme et un lyrisme croissant durant ce séjour d’une année autour des hauts lieux des civilisations antiques.
…
Après vingt quatre années de combats, un traité de paix mit fin à la première Guerre Punique. Mais les Romains n’étaient déjà plus ce peuple de laboureurs conduit par un Sénat de Rois, c’étaient des hommes qui se sentaient faits pour commander et que l’ambition poussait incessamment à l’injustice. Ils envahirent la Sardaigne et s’applaudirent d’avoir fait, en pleine paix, une conquête sur les carthaginois. Ici commence la seconde Guerre Punique.
…
Annibal me semble avoir été le plus grand capitaine de l’antiquité : si ce n’est pas celui qu’on aime le plus, c’est celui qui étonne davantage. Il n’eut ni l’héroïsme d’Alexandre, ni les talents universels de César, mais il les surpassa l’un et l’autre comme homme de guerre.
…
Le nom de Scipion l’Africain est l’un des plus beaux noms de l’histoire. L’ami des dieux, le généreux protecteur de l’infortune et de la beauté.
…
Annibal et Scipion se rencontrèrent aux champs de Zama : l’un célèbre par ses victoires, l’autre fameux par ses vertus.
…
Suivent des pages admirables décrivant le départ de Scipion quittant les rivages de la Sicile et se présentant face aux rivages d’Afrique.
…
Le vainqueur fut Scipion. Ce qui mit fin à la seconde Guerre Punique.
…
Scipion à Annibal : A votre avis Annibal, quel a été le premier capitaine du monde ? – Alexandre, répondit le carthaginois. – Et le second ? Pyrrus – Et le troisième ? Moi.
Que serait–ce donc , s’écria Scipion en riant, si vous m’aviez vaincu ?
Je me serais placé avant Alexandre… Analyse qui prouve que l’illustre banni avait appris dans les cours l’art de la flatterie et qu’il avait à la fois trop de modestie et trop d’orgueil.
…
Et puis il y eut une troisième Guerre Punique, avec d’autres protagonistes dont Scipion le second.
Et puis, et puis…
………………………………………………………………………………………………
25 Décembre
Avec Bernard nous sommes sur le cours Saleya comme d’autres sont sur les terrasses inondées de soleil dans des stations de ski. Lunettes noires en proue.
La lumière y est presque en incendie, le vin coule à flot, nous faisons le tour de nos univers et réinventons la poésie.
…
Place Rossetti, une crèche immense, avec des personnages grandeur nature, les chameaux, le boeuf et l’âne, le décor de la Palestine, mais une Marie et un Joseph affreux devant le berceau de paille d’un petit Jésus absent.
…
Vers seize heures, pour la première fois depuis la fin des pères Noël d’Hélène, les cadeaux sont de retour sous le sapin, face à la fenêtre qui donne sur la forêt. Je vois Y comme je revois sa maman au pied des paquets et de l’arbre illuminé. Cette année, il y a le supplément de la petite sœur emmitouflée dans le landau.
………………………………………………………………………………………………
26 Décembre
Ce matin la lumière est en état de grâce, les nuages en moutons sur l’azur dans une liesse silencieuse, comme du temps de « ma maison sous incendie » du côté des Terrasses de la Madonette.
…
Midi chez Sauveur. Beaucoup de monde. Bernard se joint à nous.
Le vin continue de couler.
…
La Municipalité a enfin trouvé un enfant Jésus pour la crèche. Le 26, après midi. Probablement alertée par un curieux étonné…
…
Le lieu est malgré tout sous protection policière permanente.
……………………………………………………………………………………………..
« Caravane vers le soleil » de Russell Rouse, avec Susan Hayward, 1959. Proche de la « Piste des Géants », avec le débouché final signifiant la fin du voyage sur les plaines fertiles de Californie. Cette fois ce sont les conquérants basques qui traversent les grands espaces, les bérets sont de rigueur, les valeurs ancestrales fendent les plaines et les montagnes de l’Ouest. Certains plans présentent souvent des tonalités qui ne sont pas loin d’être celles qu’on trouve dans « el quitasol » de Francisco Goya. Hasard ou subtilité du réalisateur ? Lors de l’attaque des indiens, les basques bondissants, de rocher en rocher, poussent ces fameux yodl (les youyou basques) des chasseurs que j’ai cru entendre ceux de la palombière de Echalar au col du même nom à la frontière de l’Espagne.
………………………………………………………………………………………………
31 Décembre
C’est la fin de « L’Itinéraire », la fin des guerres puniques, et comment mieux achever le voyage qu’en y revoyant Saint Louis à Tunis en ses derniers jours.
Ducange parle d’un manuscrit décrivant avec une sagesse infinie une sorte de testament spirituel adressé à Philippe, fils aîné et successeur de Saint Louis.
Puis, « …j’arrivais à Bayonne après avoir fait le tour entier de la Méditerranée , visité Sparte, Athènes, Smyrne, Constantinople, Rhodes, Jérusalem, Alexandrie, Le Caire, Carthage, Cordoue, Grenade et Madrid. »
………………………………………………………………………………………………
Au lieu des sempiternelles valses de Vienne, pourquoi jamais de 31 décembre et de premier janvier avec le génial jacques Offenbach ?
…
Après quarante cinq années d’amitiés, sans que j’en sache le motif, la sœur d’Henri m’a raccroché au nez. Je pense que la dépression de son frère s’est installé de façon chronique. Il ne me rappellera plus.
…
L dort à la maison. Je n’ai pas même vu la couleur de cette nuit.